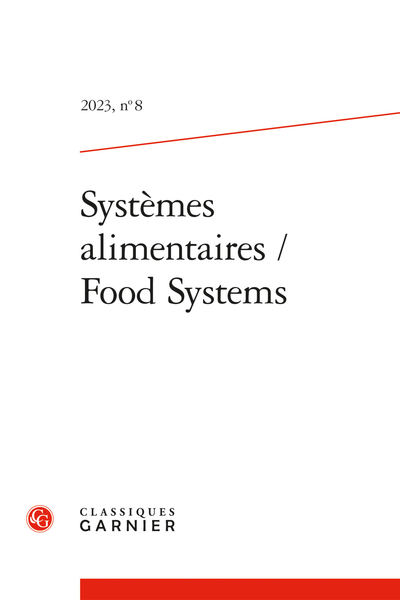
Chaînes et maillons du commerce : xvie siècle–xixe siècle Sous la direction de Gilbert Buti, Anne Montenach et Olivier Raveux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2023, 300 pages
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Systèmes alimentaires / Food systems
2023, n° 8. varia - Auteur : Paché (Gilles)
- Pages : 293 à 297
- Revue : Systèmes alimentaires
- Thème CLIL : 3306 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie de la mondialisation et du développement
- EAN : 9782406158042
- ISBN : 978-2-406-15804-2
- ISSN : 2555-0411
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15804-2.p.0293
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/11/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Chaînes et maillons du commerce :
xvi e siècle–xix e siècle
Sous la direction de Gilbert Buti, Anne Montenach
et Olivier Raveux, Aix-en-Provence,
Presses Universitaires de Provence, 2023, 300 pages
Voici un ouvrage collectif qui devrait retenir l’attention de nombreux chercheurs, enseignants et étudiants en sciences humaines tant sa richesse et sa profondeur sont en tous points remarquables. On retrouve « à la manœuvre » Gilbert Buti, Anne Montenach et Olivier Raveux, trois membres du fameux UMR TELEMMe (CNRS–Aix-Marseille Université), dont la réputation internationale sur les recherches en histoire globale n’est plus à faire. Certes, à première vue, on pourrait penser que les préoccupations du lectorat de Systèmes alimentaires / Food Systems sont bien éloignées d’un ouvrage abordant les chaînes et maillons du commerce mis en œuvre dans un lointain passé, en partie déconnecté de problématiques contemporaines. Qui plus est, à la découverte de la table des matières, d’aucuns ajouteront que le soufre et la soude, les soieries ou encore les biens de luxe, traités dans des chapitres ad hoc, n’ont vraiment pas grand-chose à voir avec l’alimentation et les produits alimentaires. Pourtant, quelle méprise… et quelle erreur de ne pas se plonger dans un ouvrage collectif recelant de nombreuses pépites d’érudition, des pépites qui ne laisseront pas indifférents celles et ceux convaincus que décrypter « hier » s’avère essentiel pour mieux comprendre « aujourd’hui ».
L’ouvrage proprement dit est constitué de 13 chapitres, écrits par autant d’auteurs d’horizons géographiques et institutionnels différents, et précédés par une brillante introduction générale cherchant à clarifier des notions aussi polysémiques que « chaîne » et « réseau » (une dimension sémantique largement abordée en sciences de gestion et en économie agro-alimentaire depuis plusieurs décennies, mais que les coordonnateurs 294de l’ouvrage ne traitent pas, ce qui est logique compte-tenu de leur champ disciplinaire d’appartenance). Les 13 chapitres sont regroupés en trois parties ne suivant pas un ordre chronologique mais, au contraire, s’appuyant sur trois éclairages pertinents : un éclairage sur les acteurs qui animent les chaînes de l’échange international ; un éclairage sur les relations qui se nouent entre lesdits acteurs dans certaines chaînes internationales, mais aussi nationales ; un éclairage sur des produits singuliers qui, en tant que maillons, se placent au cœur de réseaux transactionnels et logistiques. À ce titre, on peut parler d’un riche kaléidoscope qui conduit le lecteur, chemin faisant, à se plonger dans une grande diversité de « situations de gestion », en fonction de sa curiosité ou de ses centres personnels d’intérêt.
Bien évidemment, hors de question ici de synthétiser chacun des chapitres, ce que l’introduction générale de l’ouvrage rédigée par ses trois coordonnateurs fait excellemment. Je souhaite plutôt souligner en quoi les développements historiques, abordés dans plusieurs des contributions, renvoient plus ou moins explicitement à des questionnements très actuels en matière de management des chaînes de valeur, en général, et des food chains, en particulier ; par exemple dans la construction d’un climat de confiance entre acteurs pour poursuivre efficacement une aventure commune. En bref, je propose de faire part de mon propre voyage au sein de l’ouvrage collectif à travers l’identification de six grandes thématiques :
– Thématique 1 : maîtriser les flux logistiques. Impossible de passer à travers la logistique tant elle est présente dans plusieurs chapitres, soulignant le rôle de certains ports comme plates-formes collectrices et redistributrices de multiples produits alimentaires. C’est le cas notamment de Lorient, plaque tournante – on dirait aujourd’hui hub – pour le poivre, le café, le thé ou encore le blé en provenance de l’Océan Indien. Le cas aussi de Marseille, qui accueille des « négociants suisses » dont le sens des affaires identifie rapidement la ville phocéenne comme un point majeur de concentration des flux en provenance d’Afrique ; ou encore le cas de Cadix, au cœur des échanges entre le Mexique et l’Europe, notamment avec la présence d’efficaces flotistas, une forme de logistique à la performance avérée. Inutile de souligner que nous retrouvons là des problématiques largement sous le feu de l’actualité, et plus encore pendant la crise de la Covid-19, quand des dysfonctionnements logistiques ont mis à mal de nombreuses global value chains.
295– Thématique 2 : s’adapter aux exigences des clients. Traverser l’Océan Atlantique pour vendre des marchandises exige d’en prendre soin pour ne pas en diminuer la valeur aux yeux des clients, ce qui fut aussi, hélas !, le cas du trafic d’esclaves pendant la terrible période du commerce triangulaire. Or les assauts des flots peuvent nuire à la qualité des cargaisons à l’arrivée, sans parler de délais de transport beaucoup trop longs gâtant les marchandises. Voilà des farines malodorantes, des œufs pourris ou des fromages corrompus que le représentant d’un armement est obligé de brader après d’âpres négociations, voire des enchères descendantes. En bref, toute une politique de rabais doit être envisagée, y compris pour un vin du Languedoc, « aigre et sans davantage de couleur que l’eau » (p. 53), ce qui n’est pas sans rappeler des pratiques de remises et ristournes très actuelles pour qui s’intéresse au commerce moderne.
– Thématique 3 : fractionner les ventes. Alors que les approches traditionnelles des chaînes du commerce tendent à privilégier les logiques de massification, sans doute parce que la vision qui l’emporte est celle des réseaux d’approvisionnement internationaux (dont l’efficacité exige du volume pour obtenir d’importantes économies d’échelle), la vente au détail devient pas à pas un élément essentiel des échanges. Il s’agit désormais de fractionner l’offre de produits alimentaires, tout en laissant à des acteurs spécialisés – et compétents – le soin de gérer les opérations logistiques de transport sur longue distance, puis de stockage avant la mise en vente. Détaillants d’un côté, grossistes de l’autre : se dessine progressivement dans l’ouvrage la morphologie des canaux de distribution tels qu’ils seront abondamment étudiés par une littérature spécialisée en marketing dès la fin du xixe siècle, et surtout dès le début du xxe siècle, aux États-Unis puis en Europe.
– Thématique 4 : approvisionner les espaces urbains. Comme on le sait, dès le Moyen Âge, les villes prennent une place grandissante en Europe. Les alimenter en produits alimentaires devient par conséquent un enjeu majeur pour sustenter les populations, une question d’ailleurs largement étudiée par des historiens français comme Fabien Faugeron, Charles Higounet ou Fabienne Huard-Hardy. L’espace urbain s’inscrit par conséquent dans l’organisation des chaînes du commerce et s’appuie sur l’intervention des acteurs dynamiques précités : les grossistes et les détaillants (ou marchands-magasiniers). L’une des interrogations principales concerne dès l’instant l’échelle géographique d’intervention de ces acteurs, ce 296que l’on dénomme aujourd’hui les « zones de chalandise ». Comme on peut le constater, la ville devient un « nœud de communication » qui joue un rôle majeur de coordination des flux à l’échelle régionale, de quoi alimenter la réflexion sur les configurations actuelles de logistique urbaine (ou city logistics en anglais).
– Thématique 5 : impulser de nouvelles habitudes de consommation. Penser des réseaux d’approvisionnement à l’échelle internationale ouvre une perspective stimulante en matière de pratiques de commercialisation : faire découvrir et adopter des produits alimentaires exotiques aux habitants des pays européens. C’est typiquement ce que le négoce suisse triomphant fait à Marseille puisqu’il « retire de l’espace méditerranéen un panel de “produits du cru” dont la diffusion nourrit les structures industrielles et imprègne les habitudes de consommation » (p. 161). Ainsi, s’il est incontestable que les chaînes du commerce offrent à des produits locaux une ouverture vers de nouveaux marchés par-delà les océans – par exemple pour l’huile et le savon – c’est aussi la découverte par les marchés domestiques de nouvelles marchandises, jusqu’alors inconnues, qui est facilitée. Ne peut-on pas imaginer là d’y voir les prémices d’une globalisation portée par un modèle néo-libéral auquel nous sommes soumis, pour le meilleur et pour le pire, depuis plusieurs décennies ?
– Thématique 6 : tirer avantage de l’expertise des femmes. Au détour de deux chapitres, les femmes sont mises sur le devant de la scène de la circulation des marchandises, tant pour une face sombre (un rôle clé dans le piquage d’once, autrement dit le vol de déchets dans la soierie lyonnaise), que pour une face lumineuse (un rôle clé dans le fonctionnement du négoce marseillais). Dans le premier cas, apprend-on, des ouvrières peu scrupuleuses profitent du fait qu’elles maîtrisent l’environnement urbain et que leur présence y est très banale pour mener à bien leurs larcins, tandis que dans le second cas, au contraire, c’est une expertise toute féminine dans la négociation, au cœur de la chaîne marchande, qui fait des merveilles. Ainsi, entre des maris récemment décédés et des enfants trop jeunes pour prendre la suite de l’affaire familiale, des veuves excellent dans l’organisation et le suivi des flux afin que des cargaisons arrivent à bon port. Voilà qui devrait passionner des chercheuses comme Blandine Ageron, Ludivine Chaze-Magnan et Émilie Hoareau, étudiant actuellement les compétences en logistique sous le prisme du genre !
297Les six thématiques retenues, je le rappelle, sont le fruit d’une lecture toute personnelle du brillant ouvrage coordonné par Gilbert Buti, Anne Montenach et Olivier Raveux, une lecture qui est d’ailleurs celle, non pas d’un historien, mais d’un spécialiste du management s’étant pris au jeu : n’est-il pas possible d’identifier des traces des pratiques et stratégies contemporaines relatives aux food chains dans le fonctionnement des chaînes et réseaux entre le xvie et le xixe siècle ? La réponse est sans conteste positive, et pour tous les admirateurs de l’école des Annales, aucune surprise à cela. Pour celles et ceux qui veulent comprendre la dynamique du capitalisme marchand, il est impossible de ne pas se référer à un temps long, détaché de l’histoire purement évènementielle qui privilégie des « oscillations brèves, rapides, nerveuses », comme l’écrit si bien Fernand Braudel dans La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1949). Alors même qu’un véritable « tsunami » de travaux sur les chaînes et les réseaux existe dans la littérature en sciences de gestion et en économie agro-alimentaire, force est d’admettre qu’ils se coupent le plus souvent de toute épaisseur historique en référence au temps long. Reconnaissons à l’ouvrage publié aux Presses Universitaires de Provence une vertu qui n’a pas de prix : nous donner à voir, par petites touches et avec grande intelligence, les fondements lointains de l’économie-monde planétaire dans laquelle nous vivons.
Gilles Paché
CERGAM,
Aix-Marseille Université