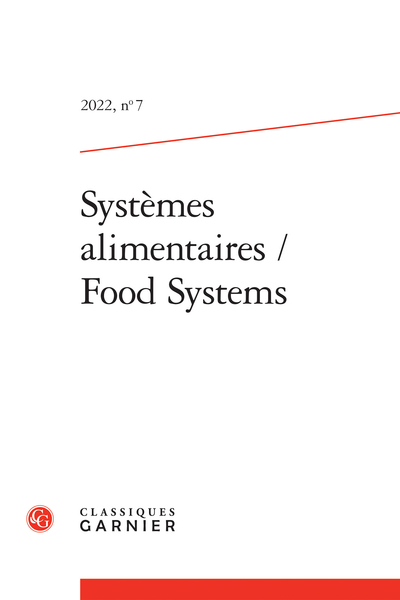
Un monde sans faim : gouverner la sécurité alimentaire sous la direction d’Antoine Bernard de Raymond et Delphine Thivet, Paris, Presses de Sciences Po, 2021, 306 p.
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Systèmes alimentaires / Food Systems
2022, n° 7. varia - Auteur : Rastoin (Jean-Louis)
- Pages : 345 à 348
- Revue : Systèmes alimentaires
- Thème CLIL : 3306 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie de la mondialisation et du développement
- EAN : 9782406142294
- ISBN : 978-2-406-14229-4
- ISSN : 2555-0411
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14229-4.p.0345
- Éditeur : Éditions Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/11/2022
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Un monde sans faim :
gouverner la sécurité alimentaire
sous la direction d’Antoine Bernard de Raymond et Delphine Thivet, Paris, Presses de Sciences Po, 2021, 306 p.
Antoine Bernard de Raymond, chercheur à l’Inrae, et Delphine Thivet, enseignante-chercheuse à l’université de Bordeaux, nous proposent un ouvrage collectif traitant, à partir d’un titre évocateur, de la lancinante question de l’insécurité alimentaire mondiale. Massimo Montanari, professeur à l’université de Bologne, considère à juste titre que « l’alimentation embrasse l’histoire tout entière de notre civilisation ». On peut alors faire le triste et accablant constat – pour « notre civilisation » – que le problème de la faim demeure non résolu à ce jour. Cette question est abordée à partir de la crise financière de 2007-2008 caractérisée par une très forte volatilité des prix des denrées alimentaires de base (triplement en quelques semaines des cours des céréales et des oléagineux) et une incapacité des gouvernements à l’endiguer. L’approche adoptée par les auteurs est résolument multidisciplinaire. Elle mobilise les sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, politique, économie, droit, histoire, géographie principalement). Cela procède d’un choix tout à fait pertinent, s’agissant d’une crise globale et multifactorielle, et donc d’un objet de recherche polysémique.
L’ouvrage, écrit par 16 scientifiques confirmés, est organisé en une introduction, 9 chapitres et une postface, en 297 pages. Il alterne analyses conceptuelles et empiriques sur l’essentiel du sujet : sémantique mouvante de la sécurité alimentaire, scénarios de prospective sur les futurs alimentaires, dynamique des régimes alimentaires, structures et acteurs de l’offre, évolution des ressources en terres, gouvernance de la sécurité alimentaire aux échelles nationales et internationales, aide alimentaire. Deux études de cas très instructives menées dans 346des pays émergents – le Brésil et l’Inde – viennent étayer le propos. Le programme « Faim zéro » mis en place par le président Lulla au début des années 2000 au Brésil constitue depuis 2015 le 2e objectif du développement durable (ODD) 2030 des Nations Unies. Dans les deux cas, on peut parler avec Florence Pinton et Yannick Sencébé1 de Grandeur et revers d’une politique. En Inde, Delphine Thivet apporte un point de vue critique sur les programmes publics d’aide alimentaire et les tentatives d’institutionnalisation du droit à l’alimentation. La postface de François Collart Dutilleul interpelle le lecteur de façon convaincante sur les droits humains fondamentaux dont le droit à l’alimentation, inscrit à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, constitue une priorité absolue, puisque sans aliments il n’y a pas de vie possible.
Le fil conducteur du livre se déroule en caractérisant et en discutant la controverse contemporaine sur les voies et moyens d’assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de crise systémique. En simplifiant2, 2 paradigmes contrastés débouchent sur 2 types de préconisations stratégiques. Le 1er scénario, fondé sur le couple « technologie d’artificialisation plus marché optimisateur », prône une intensification chimique, génétique et mécanique conduisant à une hausse de la productivité des facteurs (capital et travail). Dans le second, c’est la trilogie du développement durable (équité, environnement, économie) qui est mobilisée à travers des technologies s’appuyant sur les écosphères et une régulation capable d’atténuer les défaillances de marché et de réduire les inégalités sociales. En confrontant dans les différents articles de l’ouvrage ces 2 visions du futur, les auteurs démontrent que le scénario 2 que l’on peut qualifier d’alternatif au scénario 1 (dit « tendanciel »), est le plus apte à générer des progrès en termes de sécurité alimentaire.
La gouvernance sectorielle a beaucoup évolué depuis le 1er sommet mondial de l’alimentation (Rome, 1973) en sophistiquant – souvent 347inutilement si ce n’est pour des raisons de consensus a minima – la définition de la sécurité alimentaire et en multipliant les instances chargées de la gérer. L’aboutissement – provisoire – en est la création, en 1974, du Comité de la sécurité alimentaire mondial (CSA), réformé et complété en 2009 par le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Ce dispositif prend aujourd’hui une forme incluant toutes les parties prenantes : organisations internationales, société civile (dont ONG) et entreprises3. Il en résulte des asymétries de pouvoir aujourd’hui plus favorables aux très grandes entreprises de l’agrofourniture et de l’agroalimentaire disposant de moyens financiers considérables qu’aux autres partenaires des institutions de gouvernance. Autre signe de dysfonctionnement du mode de gouvernance, l’explosion du phénomène d’accaparement des terres à la suite de la crise financière de 2007-20084. Ce « pillage foncier » conduit à un modèle de production agroindustriel épuisant les ressources naturelles… et humaines en accélérant l’exode rural.
Finalement, cet ouvrage remarquable constitue une solide base scientifique pour contribuer à l’accélération de la transition socio-écologique présente aujourd’hui dans les narratifs des politiques, de certains chefs d’entreprises et d’une majorité d’organisations de la société civile. Ce livre est donc un pont potentiel entre verbatim et action. Nous lui souhaitons une large audience auprès des nombreux acteurs des systèmes alimentaires. Certains lecteurs pourraient souhaiter un recours plus large aux données quantitatives et à la littérature francophone. Dans cette perspective, Un monde sans faim appelle la communauté scientifique à ouvrir, dans son sillage, un nouveau chantier de recherche justifié par l’actualité de deux événements d’ampleur mondiale : la pandémie covid-19 et la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022. Ces crises, encore plus que celle de 2008, aggravent l’insécurité alimentaire. Elles risquent, comme en témoignent certaines orientations politiques perceptibles aujourd’hui, de différer des décisions pourtant urgentes en matière de changement climatique et d’inégalités sociales. On peut diagnostiquer dès à présent que des efforts considérables devront 348être consentis pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale car, en 15 ans, peu de chemin a été parcouru. Le dispositif de gouvernance de la sécurité alimentaire des Nations Unies constitue un lieu de concertation indispensable, il doit à présent renforcer son effectivité pour aller vers un « monde sans faim » et une alimentation durable.
Jean-Louis Rastoin
Institut Agro Montpellier, UMR MoISA
1 Les auteurs rappellent que Josué de Castro (1908-1973), professeur à la Faculté de médecine de l’université fédérale de Salvador da Bahia, géographe et homme politique, auteur de l’ouvrage Géographie de la faim. Le dilemme brésilien : pain ou acier (Rio de Janeiro, 1946) est « le premier à établir le lien entre le sous-développement de la région du Nordeste, soumise à des épisodes de sècheresse récurrents, et la faim dont souffrent ses populations rurales ».
2 Voir dans cette revue Rastoin J.-L., 2021, « Éditorial. Prospective des systèmes alimentaires : futur souhaitable ou exercice sous influences ? », Systèmes alimentaires / Food Systems, no 6, 2021, p. 17-24.
3 Chapitre 5 de l’ouvrage : « Fragmentation et privatisation de la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire. Le retour du paradigme productiviste », par Pierre-Marie Aubert.
4 Chapitre 6 : « L’engouement international pour les terres agricoles. Vers un nouveau front productif ? », par Matthieu Brun et Sina Schlimmer.