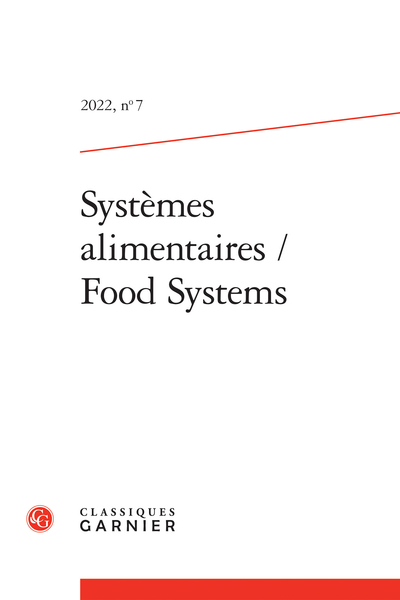
Éditorial Pour une sécurité alimentaire durable : refonder la gouvernance de nos systèmes alimentaires
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Systèmes alimentaires / Food Systems
2022, n° 7. varia - Auteur : Rastoin (Jean-Louis)
- Résumé : Les objectifs de développement durable et le concept « une seule santé » conduisent à recommander un changement en profondeur du modèle de consommation et de production agro-industriel. Ceci suppose une nouvelle forme de gouvernance des systèmes alimentaires dont les piliers reposent sur une information complète et transparente, un renforcement de la régulation par les États, un équilibre entre les acteurs, un redéploiement des institutions de recherche et de formation et de nouveaux statuts d’entreprise.
- Pages : 17 à 29
- Revue : Systèmes alimentaires
- Thème CLIL : 3306 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie de la mondialisation et du développement
- EAN : 9782406142294
- ISBN : 978-2-406-14229-4
- ISSN : 2555-0411
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14229-4.p.0017
- Éditeur : Éditions Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/11/2022
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : gouvernance, système alimentaire, prospective, développement durable, initiative.
ÉDITORIAL
Pour une sécurité alimentaire durable :
refonder la gouvernance de nos systèmes alimentaires
Jean-Louis Rastoin
Institut Agro Montpellier
UMR MoISA
Dans le monde entier, des initiatives pour une alimentation plus durable foisonnent. Elles résultent d’une double prise de conscience. D’une part, qu’une bonne alimentation est un élément décisif de la santé humaine et plus largement du bien-être individuel et collectif. D’autre part, que les conditions dans lesquelles sont produits et consommés nos aliments, du gène à la poubelle, ont un impact significatif sur l’environnement naturel, économique et social (Bozino et al., 2021). Pour passer du diagnostic à l’action, le mode de gouvernance des acteurs publics et privés des systèmes alimentaires constitue un levier essentiel qui conditionne la réussite des politiques alimentaires.
Convergence entre objectifs d’un développement durable et concept « une seule santé »
Le concept « Une seule santé » – de l’homme, des animaux et de l’environnement – lancé en 2004 à l’initiative des vétérinaires fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus international, avec le soutien de 3 grandes organisations intergouvernementales, la FAO (agriculture 18et alimentation), l’OIE (épizooties) et l’OMS (santé). Il stipule une interdépendance entre ses 3 composantes et préconise en conséquence une action systémique (Destourmieux-Garzon et al., 2018). Les 17 ODD (objectifs de développement durable) définis par l’assemblée générale des Nations Unies en 2015 pour l’horizon 2030 se situent dans une telle perspective. La pandémie covid-19 est venue apporter une confirmation au paradigme « Une seule santé » et à la pertinence des ODD. Une abondante littérature scientifique (Béné et al., 2020) et le dernier rapport du GIEC (IPCC, 2022) insistent sur l’urgence d’une transition socio-écologique.
En effet, l’anthropocène, caractérisé par une exploitation inconsidérée des ressources naturelles, mais aussi du capital humain, a conduit au dépassement de plusieurs limites planétaires : prolifération d’entités nouvelles, intégrité de la biosphère, flux biogéochimiques, changement d’affectation des sols, changement climatique, soit 5 limites sur les 9 identifiées par les chercheurs (Wang-Erlandsson et al., 2022). Après le premier choc déstabilisateur provoqué par la crise financière de 2007-2008, le second choc de la covid-19, outre les effets sanitaires, a ébranlé les économies nationales et l’économie mondiale avec un retour de l’inflation et de sérieux problèmes budgétaires, particulièrement dans les pays à faible revenu.
La violente secousse géopolitique résultant de l’agression russe en Ukraine en février 2022 est venue augmenter les risques de non-réalisation de la plupart des ODD. La prophétie d’Antonio Gramsci sur les « phénomènes les plus morbides » surgissant dans les périodes de passage de l’ancien au nouveau monde retrouve une actualité alarmante. Ainsi la triple crise survenue en moins de 15 ans devrait inciter à revoir en profondeur des modes de gouvernance des sphères publique et privée qui l’ont provoquée.
Enjeux et stratégies de bonne gouvernance publique pour une alimentation durable
Dans le domaine de l’alimentation, le modèle agroindustriel, devenu hégémonique, se caractérise par une intensification chimique 19et thermo-fossile, une spécialisation productive, une concentration et une financiarisation des entreprises, une globalisation des marchés. Ce modèle, après avoir permis d’accroitre – en moyenne, mais avec de fortes inégalités – la sécurité alimentaire mondiale dans un contexte de forte croissance démographique, se trouve aujourd’hui dans une impasse. Plusieurs rapports récents de structures intergouvernementales (CNUCED, FAO, GIEC, IFPRI, OCDE, UE-JRC) permettent de regrouper les externalités négatives générées par les systèmes alimentaires contemporains en 5 domaines :
– Santé humaine : évolution quantitative et qualitative de la diète alimentaire (insécurité alimentaire pour 40 % de la population mondiale, cause directe ou indirecte de 50 % de la mortalité annuelle)
– Changement climatique : baisse des rendements agricoles et irrégularité aggravée des récoltes, accroissement des gaz à effet de serre (GES) dont le système alimentaire mondial représente 30 % des émissions
– Ressources naturelles dégradées : 1/3 des ressources en terres utilisées pour l’agriculture, l’élevage et la forêt perdu ou menacé, pénurie en eau et stress hydrique impactant 50 pays en 2020 et 2,4 milliards de personnes, 59 pays et 5,4 milliards en 20501
– Inégalités économiques : concentration des acteurs fragilisant l’agriculture familiale et les TPE/PME industrielles et commerciales et forte contraction de l’emploi
– Instabilité des marchés.
On observe aujourd’hui quatre phénomènes qui expliquent en grande partie les crises à répétition qui secouent le système alimentaire mondial et les difficultés à relever les défis qui viennent d’être mentionnés : le déficit informationnel, l’effacement des États, l’asymétrie dans les représentations des acteurs, les lacunes de la formation des producteurs et des consommateurs. Or, une bonne gouvernance2 repose sur ces quatre piliers3.
20Le déficit informationnel public
et l’avalanche publicitaire
Il concerne les marchés et les produits. Au niveau européen, Eurostat, ou, au niveau international, la FAO, publient des mercuriales sur les marchés des produits agricoles et alimentaires et l’on dispose des données des marchés à terme tels que celui de Chicago. Ces statistiques permettent d’estimer des tendances dans le domaine des prix, mais d’une part elles ne concernent qu’une faible part de la production totale (de l’ordre de 20 %), d’autre part elles fournissent peu d’informations publiques sur les déterminants des prix (notamment la localisation et le niveau de stocks et la nature des opérateurs) ou les communiquent trop tard pour des actions correctrices.
À l’heure de la finance « haute fréquence » conduisant à des marchés très spéculatifs, il devient souhaitable de consacrer les moyens nécessaires pour mettre en place un système d’information performant sur les marchés alimentaires en vue de permettre une anticipation des crises et des actions préventives ou correctrices des pouvoirs publics et des acteurs privés. La FAO a créé au début des années 1970 un système mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR) sur la sécurité alimentaire, qui publie des rapports par pays, mais dont les moyens d’investigation sont limités. En 2011, suite à la crise financière de 2007-2008 le G20 a créé AMIS (Agricultural Market Information System), plateforme dont l’objectif était de mieux connaitre l’évolution des marchés afin de prévenir les crises. La grosse lacune de ce dispositif est de ne pas suivre les stocks, certains pays (dont la Chine) et les plus gros opérateurs de négoce international refusant de fournir leurs chiffres. Le conflit russo-ukrainien de 2022 avec l’envolée des prix des commodités agricoles sur marchés spot et l’extrême difficulté à accéder à des informations fiables sur les marchés est venu confirmer les lacunes du SMIAR et d’AMIS.
L’Union européenne est défaillante dans ce domaine. L’information relative aux produits agricoles et alimentaires concerne – de façon partielle – l’étiquetage et la mention de l’origine des produits et des ingrédients ayant servi à le fabriquer et le profil nutritionnel de l’aliment. Il existe depuis 1979 un système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires 21et les aliments pour animaux (RASFF, selon l’acronyme anglais) qui signale les infractions aux normes européennes de qualité sanitaire des produits fabriqués dans l’UE et importés. Ces dispositifs d’information ont le mérite d’exister, mais se caractérisent par leur incomplétude. Or, on constate que les discussions, au niveau de la Commission européenne comme sur le plan international sur l’amélioration de leurs performances, piétinent depuis des années du fait du lobbying agroindustriel. En conséquence les marchés ne peuvent être efficacement régulés et les consommateurs restent mal informés sur ce qu’il mange. Enfin, les conditions socio-économiques de la création et du partage de la valeur dans les filières agroalimentaires demeurent opaques. Pour les produits, comme pour les marchés, la transparence reste à construire.
D’un autre côté, les consommateurs sont soumis à des influences multiples, dont la plus persuasive émane des annonceurs publicitaires. Les budgets alloués à la publicité par les entreprises sont devenus considérables dans l’agroalimentaire et représentent aujourd’hui en France environ 15 % du prix final des produits. Le « marketing direct » résultant de la captation des données personnelles conduit à une saturation des consommateurs par des messages n’encourageant guère à une bonne nutrition et générant des maladies chroniques dommageables telles que l’obésité et le diabète de type 2. Les États généraux de l’alimentation (EGalim) réunis en France en 2017 avaient préconisé une interdiction de la publicité sur les écrans aux heures de grande écoute des enfants. Cette mesure de santé publique a pourtant été rejetée par le Parlement lors du vote de la loi EGalim en 2018. La convention citoyenne sur le climat tenue en France en 2019-2020 avait proposé d’interdire la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES) – rappelons que le système alimentaire est responsable de 30 % des GES (Crippa et al., 2021). Cette proposition ne figure pas dans la loi Climat de 2021, comme 89 % des recommandations de la convention4. Une information générique garantie par des labels officiels est indispensable dans ce domaine.
22L’effacement des états
On observe un recul de la régulation des marchés depuis le milieu des années 1980 avec la dérèglementation mise en place aux États-Unis (présidence Ronald Reagan) et au Royaume-Uni (Margaret Thatcher, Première ministre). Ce retrait a conféré un pouvoir croissant aux marchés financiers. Dans un contexte d’instabilité économique et de recomposition géopolitique, un renforcement de la régulation, en particulier dans le domaine des biens publics dont la sécurité alimentaire devrait faire partie, redevient indispensable. Par ailleurs, la bipolarisation sino-américaine et les difficultés d’émergence d’une gouvernance mondiale incitent à œuvrer pour une gouvernance régionale européenne et inter-continentale Afrique-Méditerranée-Europe mobilisant les complémentarités géo-économiques Sud-Nord et Sud-Sud (Guigou et Beckouche, 2017).
Les institutions publiques et professionnelles
Elles ont un rôle central à jouer dans la gouvernance du système alimentaire puisque de leur composition et de leurs règles de fonctionnement et de contrôle vont dépendre la nature des décisions prises. Les institutions sont les héritières de l’Histoire et donc le reflet des groupes de pression. À cet égard, on observe dans l’Union européenne comme au niveau mondial, d’une part, une dispersion et de fortes inerties et, d’autre part, des asymétries en faveur de certaines catégories d’acteurs qui n’ont pas forcément intégré les dynamiques des opinions publiques et les nouveaux enjeux de société pourtant clairement identifiés par la communauté scientifique et médiatisés à travers le paradigme du développement durable. Les institutions de l’Union européenne traitant de la sécurité alimentaire sont éclatées aussi bien au sein de la Commission que du Parlement entre les structures traitant de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la santé (par exemple, au moins trois commissaires et leurs directions générales (DG) sont compétents sur la question 23alimentaire : DG Agriculture et développement rural, DG Santé et consommateurs, DG Commerce international et DG Concurrence). Ces DG, tout comme les ministères dans les pays, fonctionnent en silo, voire en citadelle. Il y a donc un premier besoin de coordination autour du thème stratégique de la sécurité alimentaire. Ensuite, les mécanismes d’élaboration des décisions sont devenus en théorie participatifs, avec notamment le rôle accru des ONG et du Parlement, mais la puissance des lobbies sectoriels reste proportionnée à leurs capacités financières. Il en résulte une sur-représentation des firmes dominantes et une sous-représentation des acteurs de taille modeste. Une bonne illustration en est donnée par les affectations du budget de la politique agricole commune (PAC) selon les filières et les catégories d’exploitations agricoles ou encore la timidité des avancées de la politique nutritionnelle.
Au niveau mondial règnent les mêmes défauts : foisonnement des institutions (au sein du système des Nations Unies, plusieurs instances sont supposées œuvrer à la sécurité alimentaire mondiale : FAO, PAM, Comité de la sécurité alimentaire (CSA)5, High-Level Task Force on the Global Food Security (HTFL)6, etc., sans parler du Global Agriculture and Food Security Program de la Banque Mondiale et des initiatives nationales) et asymétrie dans les échelons décisionnels (la voix des PMA reste inaudible). L’amélioration de la gouvernance passe ainsi nécessairement par une coordination horizontale macro-régionale et mondiale, une recomposition plus équilibrée des institutions, l’adoption de règles de bonnes pratiques et des mécanismes de contrôle indépendants.
24Redéploiement de la chaine des savoirs
La crise environnementale, sociale et économique qui frappe la planète depuis 2007-2008 a, selon une large majorité de scientifiques, un caractère structurel et incite à de profonds changements pour être dépassée. En d’autres mots, il faut inventer de nouveaux modèles de production et de consommation. Les recherches sur une agriculture et une alimentation durable ont été initiées voilà une vingtaine d’années et s’intensifient. Des résultats sont d’ores et déjà disponibles. Cependant, l’innovation est le fait d’un très faible nombre d’acteurs et se trouve principalement orientée vers des technologies artificialisantes et de massification, c’est-à-dire de prolongation du modèle hégémonique de l’anthropocène. Elle doit donc être redéployée dans une perspective de transition écologique. D’autre part, la diffusion de telles innovations de rupture ne peut se faire qu’à partir d’un effort important de formation pour faire évoluer les mentalités, développer l’apprentissage de nouvelles techniques et changer les comportements. De plus, l’inertie, en matière de méthodes de production agricole ou d’habitudes de consommation alimentaire, est considérable, que ce soit au sein des établissements d’enseignement ou dans les entreprises et les ménages. La révolution agroindustrielle a conduit à une dilution du lien entre la terre et l’alimentation et à une banalisation de l’aliment, voire à une mise en concurrence de l’alimentation avec les autres biens. Or, l’aliment est porteur de fortes spécificités biologiques et sociales. Un plan d’éducation et de formation ambitieux s’avère en conséquence indispensable pour créer les conditions d’une connaissance (et d’une reconnaissance) renouvelée et élargie de modèles durables de production et de consommation agricoles et alimentaires.
Droit à l’alimentation et souveraineté alimentaire
En définitive, l’exercice du droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire, qui constituent les fondements d’une bonne gouvernance de 25la sécurité alimentaire en Europe comme partout dans le monde, suggère plus de transparence et de pertinence dans les systèmes d’information sur les marchés, les filières et les produits, une large diffusion, par la formation, des connaissances scientifiques et techniques sur des modes de production et de consommation alimentaires durables, un rééquilibrage des pouvoirs entre acteurs et une meilleure coordination institutionnelle. La sécurité alimentaire et, au-delà, la sécurité géopolitique impliquent une réorientation profonde des politiques agricoles et leur élargissement à la question alimentaire, en donnant une priorité à la production d’aliments par rapport aux utilisations non alimentaire de la terre et de l’eau. L’envolée des prix sur le marché du blé depuis quelques mois est en partie due à son usage en alimentation animale et celle des prix du maïs à la production massive d’agrocarburants principalement aux États-Unis (Galtier, 2022). L’Union européenne, toujours premier importateur et exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires en 2020 (y compris les échanges intra-communautaires), avec son expérience originale et globalement réussie de la PAC, pourrait développer un nouveau modèle permettant d’affronter les lourds défis alimentaires du xxie siècle. La stratégie « De la ferme à la fourchette » inscrite dans le Pacte Vert lancé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, en 2021 est porteuse d’évolution vers un développement durable du système alimentaire européen, avec valeur d’innovation et d’expérimentation pour d’autres régions du monde.
Une bonne gouvernance des systèmes alimentaires dans un cadre gouvernemental ou intergouvernemental est une condition nécessaire, mais non suffisante pour assurer une sécurité alimentaire durable. Le rôle des structures privées, notamment des entreprises et de leurs instances professionnelles sera déterminant pour atteindre cet objectif.
La gouvernance des entreprises
dans le système alimentaire
Si les organismes publics nationaux ou internationaux souffrent d’un empilement de structures générateur d’inertie et d’un manque 26de coordination, les entreprises peinent à prendre le chemin de la transition socio-écologique, non seulement du fait de leur aversion au changement, mais aussi en raison de leur statut de société par actions. Ce statut induit un mode de gouvernance qualifiée d’actionnariale avec une priorité donnée au retour sur investissement et à la plus-value des actifs, c’est-à-dire un objectif financier, alors que le contexte de crise systémique aggravée décrit plus haut appelle à prendre en compte les 3 composantes du développement durable de façon équilibrée parfois appelée « triple performance » : sociale, environnementale et économique. L’économie sociale et solidaire (ESS) y contribue – sur le volet social de la gouvernance – avec les associations, les mutuelles et les coopératives. L’appui à la reprise d’une entreprise par ses salariés, prévu en France par la loi Hamon de 2014 sur l’ESS, avec la formule des SCOP (société coopérative et participative) bénéficie d’avantages fiscaux. Selon une enquête de l’Insee, l’ESS comptait (en 2015) 165 000 entreprises en France totalisant 2,4 millions de salariés, soit 10,5 % de l’effectif total, avec une forte présence d’acteurs agricoles du fait de l’antériorité du mouvement coopératif dans ce secteur.
De façon plus large, le statut d’entreprise à mission créé par la loi française du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) ouvre la voie à la prise en compte des critères du développement durable. Son article 176 donne la possibilité aux entreprises d’affirmer publiquement, en l’inscrivant dans ses statuts, sa raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle entend poursuivre dans son activité. Il s’agit là d’une vision élargie de l’entreprise que l’on considère dès lors comme une communauté d’intérêts rassemblant les différentes parties prenantes (propriétaires, salariés, fournisseurs et clients, citoyens concernés) et non plus les seuls actionnaires (Favereau et Euvé, 2018).
D’après l’Observatoire des sociétés à mission7, fin 2021, les entreprises à mission étaient au nombre de 505 (dont 79 % de moins de 50 salariés et 39 % créées depuis 2920) comptant au total 530 000 emplois, en forte croissance sur l’année, malgré le limogeage en 2021 du PDG de Danone qui en avait fait la première entreprise à mission en France. Les secteurs concernés sont principalement les services (informatique, finances, conseil, etc., 79 % des entreprises), puis de façon très modeste, le commerce 27alimentaire (10,6 %) et l’industrie agroalimentaire et des cosmétiques (10 %) et l’agriculture (0,4 %). Hors du secteur des services, c’est donc dans les systèmes alimentaires que se concentre la grande majorité des entreprises à mission. Cette répartition traduit les préoccupations des consommateurs de biens essentiels à la vie cumulant les 3 dimensions du développement durable dont les créateurs d’entreprises sont conscients et constitue un indicateur positif pour la transition agroécologique.
La gouvernance partenariale, facteur de progrès
Les déficits institutionnels et organisationnels ont conduit à une aggravation de l’insécurité alimentaire partout dans le monde. Pour inverser cette tendance délétère, la transition socio-écologique constitue une alternative plausible au scénario tendanciel comme le montrent plusieurs études prospectives robustes (dont Afterres de l’association Solagro8, TYFA de l’IDDRI9).
Dans ces scénarios, les auteurs insistent sur la nécessité d’un changement en profondeur des comportements des consommateurs et des producteurs et distributeurs. Ainsi de la réduction de la consommation de produits issus de l’élevage bovin – viande et lait et leurs dérivés – pour ceux, nombreux, qui sont en surconsommation dans les pays à haut revenu. Pour les entreprises industrielles et commerciales, les préconisations portent sur de nouveaux itinéraires techniques réduisant fortement la pression sur la santé, les ressources naturelles et le climat. Il s’agit finalement de mettre en place des politiques alimentaires ambitieuses dont le succès dépendra largement du mode de gouvernance des institutions publiques et des entreprises, et de la place accordée à l’éthique dans les décisions. De plus, les moyens humains et matériels nécessaires devront être mobilisés dans la chaine des savoirs (recherche-développement, transfert d’innovations, formation et information) et les dispositifs d’incitation (infrastructures physiques et numériques, 28investissements et fiscalité). La transition socio-écologique des systèmes alimentaires, désormais actée dans les discours de la plupart des responsables politiques et économiques, sera un long et difficile chemin ponctué d’avancées et de blocages du fait d’objectifs divergents, voire opposés, des acteurs en présence. Cette transition est cependant devenue une condition existentielle pour nos sociétés comme l’ont montré les violentes secousses provoquées dans la période récente par la pandémie covid-19, des événements climatiques extrêmes et le conflit militaire russo-ukrainien.
Les nombreuses initiatives qui émanent dans leur majorité de la société civile et, à un degré plus modeste, de producteurs agricoles, de TPE et PME agroalimentaires, d’opérateurs commerciaux portés par une dynamique de changement incitent néanmoins à l’optimisme. Ces initiatives se présentent comme une réponse positive à la question que se pose le journaliste et écrivain Georges Orwell dans ses Essais : « Quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande avant tout s’il nous rend plus humains ou moins humains », réponse s’inscrivant, un peu moins de 2 siècles plus tard dans l’héritage du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau.
29Références bibliographiques
Béné C., Fanzo J., Prager S.D., Achicanoy H.A., Mapes B.R., Alvarez Toro P. et al., 2020, “Global drivers of food system (un)sustainability: A multi-country correlation analysis”, PLoS ONE 15(4): e0231071.
Bozino A., Régnier E., Soler L.-G., Thomas A., 2021, « Vers une alimentation saine et durable ? Dossier de ‘Ressources’ », La Revue INRAE, Paris : 10-39.
Charreaux G., dir., 1997, Le Gouvernement des entreprises : “Corporate Governance”, Paris, Economica (Théories et faits).
Crippa M., Solazzo E., Guizzardi D. et al., 2021, “Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions”, Nat Food 2, 198-209.
Destoumieux-Garzón D. et al., 2018, “The One Health Concept: 10 Years Old and a Long Road Ahead”, Front. Vet. Sci., 5:14.
Favereau O, Euvé F., 2018, « Réformer l’entreprise », Études, 9, Paris : 55-66.
Galtier F., 2022, Nous pouvons (et devons) stopper la crise sur les marchés internationaux, Paris, Fondation Farm, 5 p.
Guigou J.L., Beckouche P., 2017, Afrique – Méditerranée – Europe : la Verticale de l’avenir, Paris, Nevicata, 99 p. (L’âme des peuples).
HLPE, 2019, Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. A report by the High-Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome.
IPCC, 2021, “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability”, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the IPCC[H.-O. Pörtner et al. (ed.)], Cambridge University Press, In Press: 3675 p.
Kroll J.-C., Rastoin J.-L, 2011, « Quelle gouvernance pour la sécurité alimentaire européenne et mondiale ? », Communication en séance publique hebdomadaire, Académie d’Agriculture de France, 11 janvier, Paris, 3 p.
Steffen W. et al., 2015, “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”, Science, Vol. 347, Issue 6223.
Wang-Erlandsson L., Tobian A., van der Ent R.J. et al., 2022,“A planetary boundary for green water”, Nat Rev Earth Environ, 3: 380-392.
1 https://ecologicalthreatregister.org (consulté le 15 mai 2022)
2 Gouvernance est ici entendue comme l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des instances de décision politique dans le secteur public (public governance) et privé (corporate governance).
3 Les 4 paragraphes suivants sont tirés d’une communication à l’Académie d’Agriculture de France (Kroll et Rastoin, 2011), révisée et actualisée.
4 https://reporterre.net/Convention-pour-le-climat-seules-10-des-propositions-ont-ete-reprises-par-le-gouvernement (consulté le 3 mars 2022).
5 Créé en 1974, en même temps que le PAM, le CSA a été réformé en 2008, avec pour mission de constituer un forum international de concertation entre gouvernements, agences internationales, entreprises du secteur privé et organisations de la société civile et de définir un cadre stratégique global incluant des objectifs et un plan d’action. Il s’est adjoint en 2009 le HLPE (High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition) faisant l’interface avec la sphère scientifique. Le HLPE a produit 14 rapports entre 2011 et 2019. Bien que contraint à un consensus entre parties prenantes, dont le puissant lobby des firmes agroindustrielles multinationales, le HPLE apporte un appui précieux à la transition agroécologique comme en témoigne son dernier rapport (HPLE, 2019).
6 Créé en 2008 et dirigé par le Secrétaire général des Nations Unies, ce groupe de travail réunit les agences spécialisées de l’ONU (FAO, Fida, Pam, Unicef, OMS, Pnud), l’OMC, le FMI et la Banque Mondiale. Son opérationnalité est réduite car il n’implique pas directement les États.
7 https://www.observatoiredessocietesamission.com (consulté le 15 juin 2022).
8 https://afterres2050.solagro.org (consulté le 3 février 2022).
9 https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/une-europe-agroecologique-en-2050-un-scenario-credible-un (consulté le 12 juin 2020).