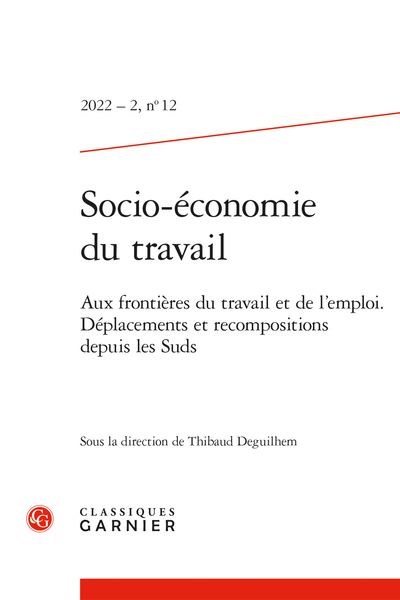
Introduction to the Special Issue At the Boundaries of Work and Employment: Shifting and Rebuilding from the Global South
- Publication type: Journal article
- Journal: Socio-économie du travail
2022 – 2, n° 12. Aux frontières du travail et de l’emploi. Déplacements et recompositions depuis les Suds - Author: Deguilhem (Thibaud)
- Abstract: In the North and in the South, workers have experienced many disruptions in the last years. The aim of the two special issues 2022-1 et 2022-2 is to look at the boundaries of work and employment in order to rethink work in the light of these contemporary transformations. The previous issue looked at the recomposition of these boundaries as they relate to leisure, activism and private and family life in the North. Mirroring the South, this issue (2023-1) looks at the blurring of employment boundaries as a result of social practices that bring together globalized social and geographical spaces, as well as at the reconfiguration of the norms of the world of work in developing countries.
- Pages: 15 to 30
- Journal: Social Economy of Labor
- CLIL theme: 3319 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités -- Travail, emploi et politiques sociales
- EAN: 9782406164357
- ISBN: 978-2-406-16435-7
- ISSN: 2555-039X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16435-7.p.0015
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-07-2024
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: boundaries, work, employment, qualification, South
introduction au numéro
Aux frontières du travail et de l’emploi :
déplacements et recompositions depuis les Suds
Thibaud Deguilhem
Université Paris Cité,
Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS),
Institut Français des Études Andines (IFEA)
Les frontières entre Nord et Sud tendent à disparaître révélant les deux faces d’une seule et même pièce, des mondes connectés par les ramifications de la mondialisation qui ont trop longtemps été analysés séparément par les sciences sociales. C’est le pari de ce numéro qui, par un dialogue, trop rare encore avec le champ de la socio-économie du développement, ses concepts et ses approches pour appréhender l’emploi et le travail dans les Suds, constitue un complément original et nécessaire au numéro spécial précédent. Ce numéro sera assurément source d’intérêt pour les lecteurs et lectrices de Socio-économie du travail, toujours attentifs à la variété des systèmes d’emploi immergés dans des contextes institutionnels spécifiques.
Si le numéro qui précède faisait état des bouleversements et des facteurs de déstabilisation du travail au Nord, ces grandes tendances se sont inscrites dans les Suds depuis longtemps déjà. Après la crise de la dette dans les années 1980 et jusqu’au tournant des années 2010, ces pays dits « périphériques » ou « en développement », vastes catégories souvent subdivisées en différents groupes de pays avec des variations 16selon les classifications retenues, ont été marqués différemment par des stratégies de libéralisation construites sous l’impulsion des organisations internationales (Lautier, 2013a). Les plans d’ajustement structurel à la lutte contre la pauvreté ont profondément ancré les dynamiques d’un mouvement de balancier penchant vers la domination du marché sur les faibles espaces de protections qui y échappaient jusqu’alors (Polanyi, 1983). Dans ce qui pourrait bien être un « laboratoire de la libéralisation », en poursuivant des objectifs de réduction de la dette et de bonne gouvernance, rapidement accompagnés par des mécanismes de transferts ciblés vers les plus pauvres, c’est bien la pluralité de l’emploi rarement assorti de protections qui s’impose comme norme dans les Suds (Tokman, 2007). Dans ces contextes de forte vulnérabilité et de faiblesse structurelle des ressources publiques, parfois combinées à des limites institutionnelles fortes, on comprend que la brutalité du choc en 2020 ait eu des conséquences dévastatrices sur le monde du travail, détruisant parfois en quelques mois les fragiles progrès des vingt dernières années, en particulier en Amérique latine (PNUD, 2022).
Malgré ce constat, certaines logiques de résistance récentes à cette « convergence globale » qui pourrait sembler indépassable interrogent depuis les Suds et finissent de brouiller les représentations traditionnelles qui pouvaient encore exister. Si les formes d’emploi et d’activité dites « informelles » en raison de leur vulnérabilité et de l’absence de protections prévalent toujours, on ne peut que constater le recentrage de l’agenda des politiques publiques sur la nécessité d’une « formalisation », de nouvelles protections (Lautier, 2013a ; Merrien, 2013, Collombet, 2014), avancées parfois pour réduire de fortes inégalités sur des marchés du travail profondément segmentés. Bien que la définition de cette « formalisation » soit un enjeu crucial au cœur du processus délibératif très souvent transnational tiraillé entre différentes représentations (Hickey et Seekings, 2017), cette notion permet de penser qu’une autre perspective est envisageable. Insistons sur le fait que cette autre voie est bien idiosyncrasique et non un retard sur des étapes de développement capitaliste qui devraient conduire à un Nord globalisé. Partant du constat de l’impossibilité structurelle d’une société où le salariat protégé serait la règle, la révision des stratégies nationales de protection sociale ne vise pas à reproduire l’un des modèles d’État-providence construits et façonnés au Nord (Esping-Andersen, 2007). Les pays « émergents », avec le 17Brésil en tête, protègent en étendant petit à petit des formes sociales de micro-protections à des catégories et des professions qui étaient jusqu’ici invisibilisées et exclues, telles que les travailleuses domestiques. Ainsi, au sein des Suds, le brouillage des frontières n’est pas uniquement celui que l’on pouvait observer il y a encore quelques années, mais consiste en des recompositions complexes dont il est nécessaire de comprendre les rouages.
Pour mener cette analyse des convergences qui effacent et des différences qui reconstruisent des frontières, c’est bien depuis les Suds, en décentrant le regard, que les déplacements et les recompositions du monde du travail et de l’emploi doivent désormais être questionnées. Rappelons que le pari des deux numéros spéciaux 2022-1 et 2022-2 de Socio-économie du travail est que porter le regard sur les frontières du travail et de l’emploi doit permettre de repenser le travail et l’emploi à l’aune des transformations contemporaines. Le précédent numéro (2022-1) interrogeait les recompositions de ces frontières qui s’établissent vis-à-vis du loisir, du militantisme ou de la vie privée et familiale au Nord. En miroir depuis les Suds, ce numéro (2022-2) porte quant à lui sur l’effacement des frontières de l’emploi sous l’effet des pratiques sociales qui rapprochent des espaces sociaux et géographiques mondialisés, mais également sur les reconfigurations de ce qui norme le monde du travail dans les pays en développement.
Les frontières analysées par les articles de ce numéro, consacré aux Suds parfois en comparaison ou parmi les Nords, s’établissent vis-à-vis des formes d’emploi, leur « raison d’être » et leur inscription dans des enjeux économiques et politiques qui dépassent les cadres nationaux mais qui mettent en relation différentes parties du monde. Dans cette perspective, les questionnements d’ordre analytique et empirique sont nombreux et concernent au moins deux niveaux de réflexion pour le champ de la socio-économie du travail. D’abord par le « bas » lorsqu’il s’agit d’interroger empiriquement les séparations qui prévalaient largement sur les marchés du travail des Suds et que les pratiques des acteurs viennent déplacer et remettre en cause (I). Qu’il s’agisse des travailleurs indépendants mais économiquement dépendants ou des activités informelles construites au sein de diasporas, la réalité sociale est toujours plus complexe que les catégories d’analyse et force les chercheurs et chercheuses à fabriquer de nouvelles grilles d’interprétation 18de ce qui « fait pratique » et qui mettent en évidence ces liens entre Sud et Nord. Cette élaboration de catégories analytiques adaptées aux spécificités contextuelles et institutionnelles constitue l’un des apports importants de la socio-économie du développement et un pont évident vers la socio-économie du travail. Par le « haut » enfin lorsqu’il s’agit d’interroger le régime d’emploi, économique et politique, jamais isolé d’un jeu plus vaste inscrit dans la mondialisation, mais qui a cette capacité à construire de la norme au travers d’arènes institutionnelles transnationales spécifiques, sans jamais effacer complétement les rapports (II). Nous présentons pour finir les articles qui composent ce numéro (III).
I. DISPARITION DES FRONTIÈRES SUDS-NORDS PAR LE « BAS » : LA QUESTION DE L’HYBRIDATION DES FORMES D’EMPLOI
L’emploi en lui-même constitue l’une des « expériences sociales centrales » pour chaque individu à la fois en âge d’avoir et ayant une activité socioprofessionnelle (Maruani et Reynaud 2004). Qu’il s’agisse du Nord ou du Sud, caractériser l’emploi ne peut se faire qu’en posant la question de comment et sous quelles formes cette expérience est susceptible de se matérialiser (Edgell et al., 2015). Cette approche, revendiquée dans ce numéro et qui rassemble la socio-économie du travail et celle du développement, implique de facto de partir du postulat que l’emploi n’est en aucun cas séparable des individus qui l’occupent et du reste de leur vie. Ainsi, si toute activité est inscrite dans un rapport social d’emploi1 composé d’un ensemble d’éléments qui encadrent intrinsèquement son expression (Lallement 2007), la prise en compte de la dimension institutionnalisée de l’emploi pousse alors nécessairement à regarder et à classer la variété de ses formes.
D’abord observé au Sud puis au Nord, ce rapport social tend à hybrider les formes d’activité créant une vaste « zone grise » de l’emploi dont 19l’origine historique se loge au cœur des années 1980 et des mutations des systèmes institutionnels d’accumulation. Ce constat du brouillage généralisé entre différentes catégories, salariat et indépendance, activités formelles et informelles2, longtemps jugées imperméables, procède de deux grands mouvements (Supiot, 1999) : un glissement des normes à la faveur d’une extension des formes atypiques d’emploi pour des professions déjà existantes ou émergentes, renvoyant à l’idée d’une institutionnalisation inégale de l’emploi, la superposition des situations impliquant une instabilité des statuts (Azaïs, 2014). Face à cette reconfiguration, les typologies traditionnellement utilisées, opposant emplois salariés et indépendants ou formels et informels, sont mises sous tension (Azaïs et Carleial, 2017), poussant les chercheurs et chercheuses comme les organisations internationales à les questionner en se réappropriant une perspective « depuis les Suds ».
Longtemps considérée comme une catégorie reine en socio-économie du développement pour analyser les spécificités de l’emploi au Sud, la notion d’informalité mettait initialement au jour les capacités autonomes du marché du travail à produire les ressources nécessaires aux besoins d’une nouvelle population urbaine affluant sous l’effet de l’exode rural (Hart, 1973). L’idée de dualisme du marché du travail adapte, au départ, les approches par la segmentation pour distinguer un segment formel productif, doté d’un contenu technologique important, caractérisé par l’existence de fortes barrières à l’entrée en termes de capital pour les entrepreneurs et de compétences pour les employés, d’un secteur informel regroupant de petites activités familiales à la production erratique, sans processus d’accumulation, et se contentant d’assurer la survie de ménages pauvres en l’absence de filet de protection sociale (Sethuraman, 1976 ; Peattie, 1980). À partir des années 2000, l’OIT (Organisation Internationale du Travail) offrait un prolongement de cette vision en l’associant à une perspective plus normative orientée vers la protection des travailleurs. Ce changement majeur reconnait ainsi toute la complexité des pratiques d’emploi au sein et en dehors d’un secteur informel dont les représentations étaient trop statiques initialement. Les acteurs de 20l’économie informelle, petits entrepreneurs ou employés, sont ceux qui se situent en dehors du champ d’action des systèmes de protection sociale, de la réglementation du travail, des droits syndicaux et de la sécurité au travail (Tokman, 2007 ; Kucera et Roncolato, 2008).
En opposition, la crise de la dette dans les pays du Sud au cours des années 1980 s’accompagne dans certaines organisations internationales comme la Banque mondiale d’un changement de paradigme qui pousse à construire une approche explicative utilitariste de l’existence et de la prolifération des petites activités informelles. L’ensemble de ces activités développées hors de toutes formalités, traduirait une « éruption des forces réelles du marché » dont les petits entrepreneurs seraient alors les acteurs essentiels et le moteur principal (De Soto, 1994). Une réponse « populaire » et « spontanée » aux contraintes excessives que ferait peser l’État sur les formalisés. L’informalité serait ainsi l’expression d’un « choix », une revendication de l’autonomie et de l’émancipation des individus, n’excluant pas nécessairement tout à fait à la marge l’existence d’un petit groupe de travailleurs précaires (Perry et al., 2007). Sans se poser la question du processus d’informalisation massive en lien avec la reconfiguration des institutions de l’emploi, la raison d’être de l’informalité ne réside plus dans les coûts de la formalisation, mais dans le résultat d’un arbitrage d’acteurs maximisant leur bien-être en raison de la faiblesse des bénéfices d’un État-providence défaillant (Maloney, 2004).
Au centre de ce débat, c’est bien la question de l’analyse d’un continuum hybridé qui reste aujourd’hui posée car, au « total, les dichotomies habituelles […] n’apparaissent pas les plus appropriées pour départager les “bons” emplois des emplois peu ou “moins désirables” » (Phélinas, 2014, p. 27). En effet, cette hybridation des formes d’emploi et des éléments qui les supportent laisse apparaitre des situations d’enchevêtrement, mixtes ou indéterminées, superposant des pratiques sociales et des représentations à des normes institutionnelles souvent peu protectrices (Hart, 2006 ; Lautier, 2013b). Face à cet enjeu, nombre d’auteurs font désormais davantage référence aux acteurs eux-mêmes, leurs pratiques sociales et leurs représentations, appréhendés par le « bas », sans jamais les essentialiser pour comprendre les formes d’emploi, installant ainsi une passerelle possible entre Suds et Nords. C’est ce qu’interrogent les articles de Mondon-Navazo et d’Ahmad dans ce numéro. Le premier s’attache à qualifier l’hétérogénéité de la recherche de protections pour des formes de travail indépendant 21économiquement dépendant au Brésil et en France en plaçant la focale sur le rapport subjectif à cette zone grise au croisement des mouvements de marchandisation, protection sociale et émancipation. Le second installe cette question du continuum en France au sein de la diaspora comorienne à travers l’étude de l’agencement entre emploi formel et commerce informel en étudiant les pratiques socio-économiques.
II. RECONFIGURATION DES FRONTIÈRES PAR LE « HAUT » : RÉGIME SOCIAL D’EMPLOI ET CONSTRUCTION DE LA NORME
Si l’effacement des frontières abordées sous l’angle des pratiques des acteurs est assez fructueux, il n’est toutefois pas question de délaisser l’enjeu de la production des régimes sociaux d’emploi spécifiques dans lesquels ces pratiques se situent et s’organisent. Autrement dit, il est nécessaire de tourner notre regard vers l’autre « bout de la chaine » vers les régulations sociales par le « haut », spécifiques, historicisées et institutionnalisées au sein de modes de production particuliers (Deguilhem et Frontenaud, 2016 ; Bizberg, 2019). Largement documenté parmi les Nords (Boyer, 2002), l’enjeu est de reconsidérer les régimes d’emploi comme issus des rapports sociaux spécifiques, producteurs à la fois des formes de subordination des travailleurs et des conditions sociales de reproduction propre à chaque régime. Apparaît alors une variété parmi les Suds, en particulier parmi les pays « émergents » ou « à revenu intermédiaire » plus ou moins insérés dans les chaînes globales de valeurs et de travail.
L’enjeu consiste alors à étudier la combinaison entre un rapport social d’emploi et cette insertion partielle dans un rapport international qui donne à ces pays des régimes d’emploi idiosyncratiques, objets longtemps « non-identifiés » par les différentes grilles d’analyse institutionnaliste en dehors de la socio-économie du développement. Or, l’observation de l’impossible avènement d’un salariat formel généralisé sous l’effet des vagues d’industrialisation, de modernisation et d’insertion dans le jeu international conteste une vision d’un développement linéaire qui viserait à projeter sur les Suds une histoire sociale construite dans un Nord déjà globalisé. Dans ces régimes « émergents » les formes de relations 22individuelles dans l’emploi sont moins précaires que dans les pays sous « régime d’aide3 », mais où les faiblesses structurelles se retrouvent particulièrement au niveau des systèmes de protection sociale, parcellaires et de portée restreinte. En prenant le Maroc pour cas d’étude particulièrement pertinent au regard du volontarisme des politiques industrielles et de l’emploi, l’article d’Al Hachimi et al., dans ce numéro, met au jour l’association structurelle entre modernisation et mirage d’une « société salariale » même dans la frange « insérée » des travailleurs et travailleuses marocaines. De ces observations découle directement la question du changement institutionnel dans les Suds : une transformation en faveur d’une protection sociale d’une plus large portée est-elle alors impossible ?
La réponse doit nécessairement incorporer la question du changement politique, du compromis et du processus de délibération au cœur de l’action publique (Boltanski et Thevenot, 1991). Bien que très hétérogènes entre eux, ces pays « émergents », ou « à revenu intermédiaire » selon la classification de la Banque mondiale4, apparaissent dans l’ensemble peu favorables à la formation d’un compromis social élargi, associant plutôt une frange large du capital avec une frange restreinte du travail (Rougier et Combarnous, 2017). Plus précisément, le compromis social et politique au sein de ces pays associe une forte législation sur le plan des relations individuelles de travail, souvent circonscrites aux secteurs économiques stratégiques et ineffectifs pour le reste de la population, et à l’inverse, un centralisme étatique concernant les protections et les relations collectives. Cette forte hétérogénéité alimentée par un processus de segmentation institutionnalisée se manifeste à travers la formation d’un développement inégalitaire des capacités de résilience des ménages et la faiblesse des formes d’organisation dans le champ politique.
Toutefois, loin d’être figée, cette description soulève bien l’importance d’une analyse de la gouvernance multi-acteurs et de la fabrique des politiques publiques pour mieux comprendre comment s’articulent transformations structurelles et modes effectifs de régulation des mondes 23du travail et de l’emploi dans les sociétés. Plus spécifiquement dans les Suds, lorsqu’il s’agit d’étudier ces espaces de fabrication politique de la norme et de son évolution, on observe que la gouvernance repose rarement uniquement sur les acteurs nationaux aux ressources limitées, un « limited statehood » (Risse, 2011 ; Piveteau, 2018), auquel s’ajoutent toujours la présence d’organisations internationales en recherche de relais locaux pour faire avancer des objectifs construits au sein d’arènes globalisées. Si la nature transnationale de la gouvernance et le poids des logiques de transferts sont à considérer (Hagmann et Péclard, 2010), il ne faut pas pour autant contester aux actions publiques d’être le produit de processus de négociations complexes : elles impliquent les jeux d’acteurs politiques et la relation de l’État à la société (Darbon et Provini, 2018). Ainsi, les changements institutionnels, changements législatifs réglementaires pouvant entrainer une transformation structurelle, sont permis dès lors qu’ils sont le résultat de la co-construction de programmes d’action par une pluralité et une diversité d’acteurs (publics, privés, issus de la société civile, experts, bailleurs, etc.) situés à différentes échelles d’intervention (locale, nationale et internationale), ayant des intérêts et des visions qui se coalisent (Zittoun, 2013). C’est à travers cette approche que le cas de la reconnaissance juridique du statut de salarié aux travailleuses domestiques accordé au Maroc peut être compris, comme le propose l’article de El Haddad dans ce numéro.
III. Les frontiÈres analysÉes
par les articles de ce numÉro
Ce second numéro spécial poursuit l’ambition du précédent en se saisissant des enjeux analytiques et empiriques du déplacement et de la recomposition de frontières du travail et de l’emploi pour les acteurs depuis les Suds. Il repose pour cela sur quatre articles de sociologues, d’économistes et de politistes.
Pour saisir les déplacements et reconfigurations tout au long des frontières présentées, les articles s’inscrivent pleinement dans la ligne éditoriale de la revue Socio-économie du travail, en mettant en œuvre 24une variété de méthodes de collecte et d’analyse sur la base de données qualitatives (entretiens, observations suivies), quantitatives (à partir d’informations administratives) et parfois la combinaison originale des deux comme dans l’article d’Al Hachimi et al. La question de la disparition des frontières construites géographiquement sous l’effet de l’hybridation des formes d’emploi qui transpose au Nord ce qui a lieu au Sud fait l’objet des deux premiers articles. Les deux derniers s’intéressent aux reconfigurations de frontières au Sud à travers la compréhension d’un régime d’emploi et son changement permis par la formation d’arènes politiques multi-acteurs et multiniveaux. Homogènes dans leurs approches, l’ensemble des articles de ce numéro abordent ces questions sous un angle empirique, sans pour autant négliger les enjeux théoriques posés ni de replacer chaque contribution dans une perspective plus large. Bien que parfois plus en filigrane notamment dans l’article d’Ahmad, on peut noter enfin que la question de la protection sociale, directement associée à celle de l’informalité, est centrale dans ce numéro axé sur les Suds et leurs relations aux Nords.
Dans la continuité du numéro précédent, l’article de Mathilde Mondon-Navazzo (et Camille Noûs) saisit l’hétérogénéité de la zone grise du travail indépendant économiquement dépendant en analysant les attentes et les représentations des travailleurs et travailleuses qualifiés dans le secteur des technologies et de l’information. Au travers d’entretiens, l’auteure redonne une place centrale aux représentations subjectives des individus, au regard qu’ils portent sur leur emploi et ses conditions (Murgia et Pulignano, 2021). Se faisant, elle propose une relecture qui dépasse les oppositions entre indépendance choisie et subie dans la continuité de nombreux travaux sur le rapport complexe entre conditions objectives et valorisation d’une position (Abdelnour, 2017). Elle adopte une approche comparative Sud-Nord originale entre la France et le Brésil, deux pays où le salariat représente la base historique de l’accès aux droits sociaux. On pourrait être tenté de percevoir la zone grise du travail indépendant économiquement dépendant comme une simple traduction d’une différence de régime : en France, il s’agirait de formes d’emploi atypiques qui dérogent à une norme dominante et au Brésil d’un héritage d’une informalité structurelle qui banalise le contournement du droit du travail (Cardoso, 2013). En reprenant la grille d’analyse de Nancy Fraser (2010) entre les mouvements de marchandisation et de 25protection sociale (articulé avec ceux d’émancipation/résistance), c’est bien la frontière entre des visions opposées de l’emploi pour les travailleurs et travailleuses indépendants mais économiquement dépendants que l’article se propose de questionner en entrant par les représentations des acteurs. En identifiant trois situations-types, l’auteure distingue une nouvelle séparation entre des entrepreneurs et entrepreneuses en transition, qui s’inscrivent dans un mouvement de marchandisation classique, et d’autres plus réticents, qui illustrent des situations de fausse indépendance et aspirent à retrouver la protection sociale du salariat.
Le deuxième article au cœur de ce numéro, signé Abdoul-Malik Ahmad, étudie plus directement encore l’effacement de cette frontière entre les objets travaillés au Nord et au Sud à travers l’analyse du continuum entre formalité et informalité pour des femmes comoriennes, migrantes installées à Marseille, à la fois salariées formelles au sein de segments subalternes et commerçantes informelles. Sous l’angle d’un groupe spécifique de migrants des Suds installés de façon diasporique au Nord, c’est la multiplicité, nécessaires, des activités, des vies et des connexions qui relient, connectent et finalement encastrent plusieurs espaces sociaux qui sont au centre de l’analyse. À l’aide d’une stratégie en boule de neige permettant de constituer un corpus empirique fait d’entretiens et d’observations suivies, l’auteur offre une plongée dans les stratégies de franchissement des différentes frontières – professionnelles, sociales et géographiques – motivées par des logiques de subsistance dans un contexte de précarisation du salariat formel qui touche particulièrement les femmes migrantes (Granovetter, 1995 ; Mazzella, 2014). En partant de l’idée du caractère nécessairement pluridimensionnel du continuum dans l’expression des pratiques de jonglage et/ou d’hybridation des dispositifs commerciaux, c’est le système de complémentarité/continuité entre deux formes de mise au travail qui est identifié. Loin d’être monotone au sein même de cette population, l’imbrication entre emploi salarié formel et commerce transnational informel, entre les dispositifs d’approvisionnement, et entre sphères professionnelle et domestique, s’observe de manière différente en fonction des caractéristiques et des pratiques de commerçante comorienne.
Par le « haut » désormais, la question de la stabilisation d’un régime d’emploi loin d’une société salariale attendue dans les Suds « émergents » 26qui s’accompagnerait mécaniquement de formes protectrices est étudiée par l’article de Sirine Al Hachimi, Nadia Benabdeljlil, Yolande Benarrosh et Alain Piveteau. Ces pays institutionnalisent dans leurs régimes d’emploi des cadres législatifs parfois plus protecteurs pour certaines catégories, comme le montre le dernier article du numéro à propos des travailleurs et travailleuses domestiques. Néanmoins les emplois historiquement les plus protégés, publics principalement, apparaissent de plus en plus comme des vestiges d’un État plus interventionniste dans les années 1970 (Tokman, 2007). En replaçant cet état des Suds face à la remise en question interne et externe systématique des protections du salariat dans les Nords, les auteurs y voient les traces d’un référentiel néo-libéral qui prendrait une forme particulière en fonction du contexte. En prenant le Maroc, cas particulièrement intéressant de politiques volontaristes d’industrialisation, de modernisation et d’insertion dans les chaînes de valeurs sur les dernières décennies (Piveteau, 2018), c’est bien le constat de l’absence de généralisation du salariat protecteur et de la coexistence de dispositifs de protection sociale parcellaires qui s’impose à l’issue d’un état des lieux statistique. À l’aide de récits collectés au long cours et juxtaposés complétant ce panorama statistique, c’est une approche complémentaire qui nous plonge au cœur des espérances du monde du travail à Tanger, dans les industries censées créer massivement la société salariale attendue. Les auteurs confirment alors qu’à défaut de s’imposer comme « l’épicentre des transformations [sociales] en cours », le salariat ne parvient pas davantage à s’imposer dans l’horizon des attentes des travailleurs marocains, à l’inverse de la multiplication des appels à l’émergence d’une « société entrepreneuriale » oscillant entre autoentrepreneurs de survie et start-uppeurs (Chapus et al., 2021).
Le dernier article, signé Fouad El Haddad, s’interroge enfin sur ces volontés d’expansion, limitées et parcellaires mais constatées, des droits sociaux au Sud en ouvrant les processus politiques qui les ont produits (Lavers et Hickey, 2021). Repartant au Maroc, l’auteur se focalise sur l’intégration – « formalisation » – des travailleurs domestiques dans le cadre du droit. En dépit d’une reconnaissance juridique symbolique pour des emplois exercés initialement aux confins de la vulnérabilité sans protection aucune, par des femmes invisibilisées, issues de milieux populaires et frappées par des discriminations multiples, on comprend bien qu’une transformation de ce type engage une pluralité d’acteurs, où 27les enjeux croisent les intérêts et les positions. On aurait tort de penser que la décision n’est que la résultante de la pression des organisations internationales ou d’un transfert international de politique publique (Debonneville et Diaz, 2013), en dépit de l’engagement des institutions sur la question de la protection des travailleurs domestiques. L’article substitue à cette hypothèse exogène l’interprétation endogène d’une nouvelle frontière dans la fabrique de l’action publique. L’existence d’une opposition entre les pôles contributifs et non-contributifs de la protection sociale, que l’on retrouve dans de nombreuses arènes autour la question de l’élaboration des politiques sociales indépendamment du secteur dans les Suds (Berrou et al., 2021), ouvre la porte à une diversité d’acteurs nationaux et internationaux et à une compétition entre le champ de la politique de l’emploi et celui de l’assistance sociale (Barrientos et Hulme, 2009 ; Dorlach, 2021). Au moyen d’entretiens et de sources secondaires, l’auteur met alors en évidence ce débat autour de la question de la légitimité de l’arène et des acteurs pour élaborer ce nouveau cadre plus protecteur. Au-delà de la simple question de « qui est mandaté pour agir ? », il s’agit bien in fine de l’orientation même de l’action publique qui oscille entre réglementer et freiner le travail domestique, en particulier pour les mineures. La reconstitution des séquences de l’histoire institutionnelle donne à voir comment les réformes impulsées par les acteurs transnationaux et les relais locaux sont construites au Sud et investies par les acteurs.
En conclusion, les textes de ce numéro complètent ceux proposés dans le premier numéro de Socio-économie du travail et font la preuve, s’il était nécessaire, qu’étudier les frontières du travail et de l’emploi ne peut faire l’économie d’un décentrage vers les Suds pour saisir les régularités des déplacements observés par le « bas » et leur recomposition par le « haut ».
28RÉfÉrences bibliographiques
Abdelnour, S., (2017), « Quand l’auto-entrepreneuriat se substitue au salariat-Le prix et la valeur de l’indépendance », Socio-Économie du Travail, no 2016-1, p. 29-60.
Azaïs, C., (2014), « Normes d’emploi, hybridation et zone grise chez les pilotes d’hélicoptère au Brésil », Revue Tiers Monde, vol. 218, no 2, p. 53-70.
Azaïs, C., Carleial, L., (2017), La zone grise du travail : Dynamiques d’emploi et négociation au Sud et au Nord. Bruxelles, P.I.E-Peter Lang.
Barrientos, A., Hulme, D., (2009), « Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries : Reflections on a Quiet Revolution », Oxford Development Studies, vol. 37, no 4, p. 439-456.
Berrou, J.-P., Piveteau, A., Deguilhem, T., Delpy, L., Gondard-Delcroix, C., (2021), « Who Drives if No-one Governs ? A Social Network Analysis of Social Protection Policy in Madagascar », SSRN Papers, https://ssrn.com/abstract=3811178 (consulté le 12/10/2023).
Bizberg, I., (2019), Diversity of Capitalisms in Latin America. New York, Springer International Publishing.
Boltanski, L. T., Thévenot, L., (1991), De la justification, les économies de la grandeur. Paris, Gallimard.
Boyer, R. (2002), « Vingt ans de recherches sur le rapport salarial : un bilan succinct », in Boyer, R. et Saillard Y. (dir.), Théorie de la Régulation, l’état des savoirs, Paris, La Découverte, p. 106-114.
Cardoso, A., (2013), « Brazil’s Labor Market : Limitations and Opportunities for Emancipation », in Pieterse, J. N. et Cardoso, A. (dir.), Brazil emerging : inequality and emancipation. New York/London, Routledge, p. 64-82.
Chapus, Q., Berrou, J.-P., Onibon Doubogan, Y., (2021). « Le retour du héros ? L’entrepreneur, itinéraire d’un concept chez les “développeurs” en Afrique », Revue internationale des études du développement, no 245, p. 11-39.
Collombet, C., (2014), « La protection sociale dans le monde », in REGARDS, no 45, p. 21-30.
Darbon, D., Provini, O., (2018), « “Penser l’action publique” en contextes africains : Les enjeux d’une décentration », Gouvernement et action publique, vol. 7, p. 9-29.
De Soto, H., (1994), L’autre sentier : La révolution informelle dans le tiers monde. Paris, La Découverte.
Debonneville, J., Diaz, P., (2013), « Les processus de transfert de politiques publiques et les nouvelles techniques de gouvernance : Le rôle de la Banque 29mondiale dans l’adoption des programmes de conditional cash transfers aux Philippines », Revue Tiers Monde, vol. 216, no 4, p. 161-183.
Deguilhem, T., Frontenaud, A., (2016), « Régimes de qualité de l’emploi et diversité des pays émergents », Revue de la Régulation. Capitalisme, Institutions, Pouvoirs, vol. 19, no 1, p. 1-24.
Dieuaide, P., (2017), « De quelle régulation la notion de “zone grise d’emploi” est-elle le nom ? », Revue Interventions Économiques / Papers in Political Economy, vol. 58, no 1, p. 1-21.
Dorlach, T., (2021), « The Causes of Welfare State Expansion in Democratic Middle-Income Countries : A Literature Review », Social Policy & Administration, vol. 55, no 5, p. 767-83.
Edgell, S., Gottfried, H., Granter., E., (2015), The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. London, SAGE Publications.
Esping-Andersen, G., (2007), Les trois mondes de l’État-providence : essai sur le capitalisme moderne. Paris, Presses Universitaires de France.
Fraser, N., (2010), « Marchandisation, protection sociale et émancipation », Revue de l’OFCE, no 3, p. 11-28.
Granovetter, M., (1995), « The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs », in Portes, A. (dir.), The Economic Sociology of Immigration, New York, Russel Sage Foundation, p. 128-165.
Hart, K., (1973), « Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana », The Journal of Modern African Studies, vol. 11, no 1, p. 61-89.
Hart, K., (2006), « Bureaucratic Form and the Informal Economy », in Guha-Khasnobis, B., Kanbur, R. et Ostrom, E. (dir.), Linking the Formal and Informal Economy : Concepts and Policies, Oxford : Oxford University Press. p. 21-35.
Hickey, S., Seekings, J., (2017), « The global politics of social protection », Working Paper UNU-WIDER. https://www.wider.unu.edu/publication/global-politics-social-protection (consulté le 12/10/2023).
Kucera, D., Roncolato, L., (2008), « Informal employment : Two contested policy issues », International Labour Review, vol. 147, no 4, p. 321-348.
Lallement, M., (2007), Le travail : Une sociologie contemporaine. Paris, Gallimard.
Lautier, B., (2013a), « Universalisation de la protection sociale et protection des plus vulnérables », Revue Tiers Monde, vol. 214, no 2, p. 187-217.
Lautier, B., (2013b), « Secteur informel et emploi : l’enseignement des pays sous-développés ». Revue Tiers Monde, vol. 214, no 2, p. 151-167.
Lavers, T., Hickey, S., (2021), « Alternative Routes to the Institutionalisation of Social Transfers in Sub-Saharan Africa : Political Survival Strategies and Transnational Policy Coalitions », World Development, vol. 146, 105549.
Maruani, M., Reynaud, E., (2004), Sociologie de l’emploi. Paris, La Découverte.
30Mazzella, S., (2014), Sociologie des migrations. Paris, Presses Universitaires de France.
Merrien, F.-X., (2013), « La protection sociale comme politique de développement : un nouveau programme d’action international », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, vol. 5, no 1, p. 69-88.
Murgia, A., Pulignano, V., (2021), « Neither precarious nor entrepreneur : the subjective experience of hybrid self-employed workers », Economic and Industrial Democracy, vol. 42, no 4, p. 1351-1377.
Peattie, L. R., (1980), « Anthropological perspectives on the concepts of dualism, the informal sector, and marginality in developing urban economies », International Regional Science Review, vol. 5, no 1, p. 1-31.
Perry, G., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., Saavedra-Chanduvi, et J., (2007), Informality : Exit and Exclusion. Washington, World Bank Publications.
Phélinas, P., (2014), « How to Measure Employment in Developing Economies ? », Revue Tiers Monde. vol. 2, p. 15-33.
Piveteau, A., (2018), « Au Maroc, l’épreuve politique d’une industrialisation importée », Afrique contemporaine, vol. 266, p. 75-96.
PNUD., (2022), « Long COVID : The extended effects of the pandemic on labor markets in Latin America and the Caribbean », Rapport institutionnel PNUD-Banque Mondiale, https://www.undp.org/latin-america/publications/long-covid-extended-effects-pandemic-labor-markets-latin-america-and-caribbean (consulté le 12/10/2023).
Polanyi, K., (1983), La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps[The Great Transformation, 1944] Trad. de l’anglais par M. Angeno et C. Malamoud,, Paris, Collection Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard.
Risse, T., (2011), Governance Without a State ? New York, Columbia University Press.
Rougier, E., Combarnous, F., (2017), The Diversity of Emerging Capitalisms in Developing Countries, New York, Palgrave McMillan.
Sethuraman, S. V., (1976), « The urban informal sector : Concept, measurement and policy », International Labour Review, vol. 114, no 1, p. 69-81.
Supiot, A., (1999), Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Rapport pour la Commission européenne, Paris, Flammarion.
Tokman, V. E., (2007), « The Informal Economy, Insecurity and Social Cohesion in Latin America », International Labour Review, vol. 146, no 1-2, p. 81-107.
Zittoun, P. (2013). La fabrique politique des politiques publiques. Une approche pragmatique de l’action publique. Paris, Presses de Sciences Po.
1 Le rapport social d’emploi est envisagé comme l’extension du « rapport salarial » régulationniste au-delà des frontières du salariat, des rapports et des compromis qui lui sont associés. Par cet élargissement aux situations hors du salariat, c’est bien une reconsidération des rapports particuliers qui institutionnalisent les travailleurs dans les Suds que nous proposons de saisir par cette notion (Deguilhem et Frontenaud, 2016).
2 La définition de l’économie informelle repose sur celle établie par l’OIT en 2003. Elle repose sur deux piliers que sont les activités informelles d’une part et l’emploi informel d’autre part. Les activités informelles sont définies comme étant celles menées au sein de petites entreprises comptant moins de cinq employés, non enregistrées officiellement et ne tenant pas de comptabilité écrite. L’emploi informel est défini comme étant l’emploi sans contrat ou non protégé socialement, au sein d’entreprises formelles ou informelles.
3 Pays dont le financement de l’action publique dépend principalement de l’aide au développement en provenance d’autres pays.
4 Le groupe de « pays à revenu intermédiaire » renvoie à la typologie réalisée en 2013 par la Banque mondiale en fonction du revenu national brut en dollars courants par habitant. En 2020, deux sous-catégories sont identifiées à partir de seuils : revenu intermédiaire / tranche inférieure entre 1036 et 4045 dollars, revenu intermédiaire / tranche supérieure entre 4046 et 12535 dollars.