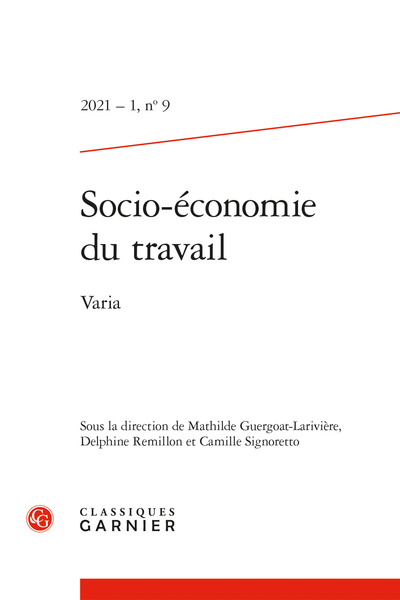
Politiques d'insertion et genre Introduction au dossier
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Socio-économie du travail
2021 – 1, n° 9. varia - Auteurs : Guergoat-Larivière (Mathilde), Remillon (Delphine)
- Pages : 15 à 20
- Revue : Socio-économie du travail
- Thème CLIL : 3319 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités -- Travail, emploi et politiques sociales
- EAN : 9782406128182
- ISBN : 978-2-406-12818-2
- ISSN : 2555-039X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12818-2.p.0015
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/02/2022
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
POLITIQUES D’INSERTION ET GENRE
Introduction au dossier
Mathilde Guergoat-Larivière
Université de Lille,
Clersé-UMR 8019,
Centre d’Études
de l’Emploi et du Travail
Delphine Remillon
Institut national d’études démographiques (INED),
LiRIS, Université de Rennes 2, Centre d’Études
de l’Emploi et du Travail
Ce dossier thématique « Politiques d’insertion et genre » fait suite à la parution d’un numéro spécial « Genre et politiques de l’emploi et du travail » de Socio-Économie du Travail (no 2020-2) et s’inscrit pleinement dans sa continuité. Les deux articles de ce dossier interrogent en effet la dimension genrée de certains dispositifs de politique publique. Si les articles du précédent numéro abordaient à la fois les politiques déployées au sein des entreprises (égalité professionnelle, rôle du dialogue social) mais aussi déjà certaines politiques publiques, aussi bien conjoncturelles (activité partielle en réaction à la crise sanitaire) que structurelles (système de retraites), les articles de ce dossier se concentrent sur des dispositifs qui ont plus directement trait à l’insertion : le Revenu de Solidarité Active (RSA) d’une part, et le service civique d’autre part.
16Toutes les politiques publiques sont susceptibles d’affecter différemment l’emploi et le travail des femmes et des hommes, y compris lorsque ces politiques sont pensées comme « neutres » du point de vue du genre. Dans le domaine de la politique de l’emploi et de la politique sociale, des travaux ont notamment montré comment l’absence d’un traitement différencié pouvait amener à un recul des femmes dans les dispositifs (Lemière et al., 2013).
Historiquement, les politiques spécifiques d’emploi et d’insertion qui se développent en France à partir des années 1980 restent marquées par la représentation de l’emploi masculin (salarié, plutôt industriel, stable et à temps plein). La place des femmes n’y est pas vraiment pensée, en lien avec la logique universaliste à l’œuvre dans les politiques de l’emploi françaises. Leur insertion sur le marché du travail est calquée sur une norme qui commence à s’effriter et qui, en outre, n’a jamais été la leur (Fouquet et Rack, 1999). Les dispositifs spécifiques de politiques d’emploi en faveur des femmes vont demeurer anecdotiques et dotés de très faibles budgets jusqu’à la fin des années 1990.
L’émergence du gender mainstreaming impulsé par l’Union Européenne à la fin des années 1990, visant à « promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des actions et des politiques, et ce à tous les niveaux » a changé la donne en proposant une nouvelle méthode d’action publique, fondée sur une « approche intégrée et préventive » (Perrier, 2006, p. 56). Toutefois, si la logique de gender mainstreaming a pu amener des améliorations dans des domaines tels que la discrimination à l’embauche, les stéréotypes de genre, le harcèlement sexuel ou encore la mise en place de quotas dans les instances de décision, sa mise en œuvre et son effectivité dans le domaine de la politique de l’emploi semble avoir été limitée (Lechevalier, 2019). Un ensemble de recherches qualitatives a en effet montré comment, dans le domaine de la politique de l’emploi et de l’insertion sociale, les dispositifs et parfois la manière dont ils sont mobilisés par les acteurs, tendaient à reproduire certaines inégalités de genre (Letablier et Perrier 2008 ; Perrier 2015 ; Clouet, 2018).
L’analyse de l’accompagnement vers l’emploi d’allocataires du RSA élevant seules leur(s) enfant(s) dans l’article de Lilian Lahieyte ainsi que l’analyse du service civique et son appropriation par les femmes et les hommes dans l’article de Florence Ihaddadene et Emily Lopez-Puyol donnent à voir de nouvelles déclinaisons de cette question.
17L’article de Lilian Lahieyte traite de l’accompagnement des mères isolées bénéficiaires du RSA, des assignations genrées qu’elles subissent et de la façon dont elles y résistent ou y adhèrent. Il montre que les mères isolées au RSA sont particulièrement motivées pour trouver un travail. Leur attrait pour l’emploi est guidé à la fois par des motivations financières (sortir de la précarité) et par des motivations intrinsèques au travail ou en négatif par rapport à la sphère domestique (sortir de l’enfermement domestique). Pourtant, dans la dichotomie entre accompagnement « professionnel » et « social », le réflexe des professionnels du RSA est le plus souvent d’orienter ces femmes vers l’accompagnement social, afin de lever les freins préalables à la reprise d’un emploi, ce que reflètent bien les statistiques présentées dans l’article relatives aux différences genrées d’orientation et d’accompagnement des allocataires. Cet accompagnement social plutôt que professionnel, avec des ateliers centrés sur leur rôle de mère, ne correspond pas à leurs aspirations. L’article montre donc les obstacles que rencontrent nombre d’allocataires, qui voient leurs aspirations professionnelles disqualifiées et empêchées par cette logique consistant à privilégier un traitement social et « familialiste » comme préalable à un éventuel accompagnement professionnel. L’auteur relève néanmoins que certaines allocataires parviennent in fine à accéder à un accompagnement professionnel. Il montre comment celui-ci vient alors modifier leur rapport à l’emploi, les allocataires incorporant en partie, et à leur manière, la féminité active promue par les professionnelles. L’article met au final en évidence un paradoxe : alors que la norme d’autonomie et l’activation sont de plus en plus prégnantes dans le domaine de l’insertion et que les allocataires enquêtées aspirent à sortir de la sphère domestique, ce qui les rapproche de cette norme, les politiques d’insertion les renvoient le plus souvent vers le social et vers leur rôle de mère. On perçoit une fois encore ici tout le paradoxe actuel des politiques de l’emploi et de l’insertion, qui mettent au cœur des référentiels d’action (et du reporting) des acteurs du champ la question du placement, ce qui conduit ces acteurs à effectuer un tri des demandeurs d’emploi entre ceux qu’ils jugent « proches de l’emploi » et les autres, avec des « chaînes d’intermédiation » qui évincent un grand nombre de publics de l’accompagnement (Fretel et al., 2016 ; Clouet, 2018).
Le second article, celui de Florence Ihaddadene et de Emily Lopez-Puyol traite d’un autre dispositif d’insertion, centré cette fois sur les jeunes, le volontariat en service civique. Ce dispositif a été 18instauré après la suppression du service militaire et s’est rapidement développé. Les auteures montrent que les femmes sont surreprésentées dans ce dispositif, en lien avec les missions et secteurs d’activités qui y sont le plus représentés (monde associatif, fonctions d’enseignement et de soin). Mais l’article met en évidence une autre logique de cette surreprésentation des femmes : en insistant sur la rhétorique de l’utilité sociale, de la citoyenneté, ce dispositif parlerait particulièrement aux femmes et s’inscrirait dans un continuum par rapport au travail gratuit du care auquel elles sont assignées. L’article distingue enfin plusieurs motivations des jeunes à réaliser un service civique, qui diffèrent selon le genre, le niveau de diplôme et l’origine. Les hommes sont plutôt dans une logique d’attente (avant de reprendre une formation par exemple) ou valorisent par ce biais une activité qu’ils pratiquaient jusqu’ici de manière bénévole (entraîneur sportif). Du côté des femmes, deux usages différents sont mis en évidence par les auteures selon le niveau de diplôme des jeunes volontaires : les femmes diplômées qui visent à s’insérer dans l’emploi associatif appréhendent le service civique comme une étape dans une stratégie d’insertion professionnelle, tandis que les peu diplômées n’ont pas d’objectif immédiat d’insertion et vivent cette expérience en service civique comme une étape parmi d’autres au sein d’un parcours précaire, avec toutefois une satisfaction mise en avant dans leurs discours d’avoir ici une « utilité sociale ». Enfin, certaines jeunes femmes racisées peuvent trouver dans le service civique une expérience professionnelle relativement valorisante, proche des métiers qu’elles souhaiteraient exercer, notamment dans l’enseignement, métiers qui leur sont sinon inaccessibles à moins de retirer leur voile.
La situation de ces jeunes femmes racisées, au capital scolaire élevé, est également abordée dans l’article de Lilian Lahieyte qui montre, là-encore, que dans l’accompagnement professionnel, certaines de ces jeunes femmes parviennent à faire valoir leurs ressources culturelles qui sont dévalorisées ailleurs… à condition qu’elles acceptent de se conformer à certaines normes de féminité active qui ne sont pas neutres pour elles puisqu’elles impliquent qu’elles retirent leur voile. Une dimension transversale à ces articles réside donc dans l’articulation qu’ils proposent entre inégalités de genre et inégalités liées au niveau de diplôme ou à l’appartenance religieuse, faisant pleinement écho aux enjeux d’intersectionnalité (Crenshaw, 1989, 1991 ; Bilge, 2009).
19RÉFÉRENCES Bibliographiques
Bilge S., 2009, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, vol. 1, no 225, p. 70-88.
Clouet H., 2018, « La construction publique du sous-emploi. L’activité des chômeurs au péril des interactions de guichet », Socio-économie du travail, vol. 1, no 3, p. 135-164.
Crenshaw K., 1989, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, Volume 1989, Issue 1, Article 8, p. 139-167.
Crenshaw K., 1991, « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, no 6, p. 1241–1299.
Fouquet A., Rack C., 1999, « Les femmes et les politiques d’emploi », Travail, genre et sociétés, 1999/2, no 2, p. 47-70.
Fretel A., Pillon J.-M., Remillon D., Tuchszirer C., Vivés C., avec la participation de Fondeur Y., 2016, « Dynamiques territorialisées du champ de l’intermédiation », in Diversité et dynamiques des intermédiaires du marché du travail, Pôle Emploi, Études et Recherches no 7, juin, p. 5-162. Repris dans Rapport de recherche no 100 Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET).
Lechevalier A., 2019, « Dynamics of Gendered Employment Regimes in France and Germany over the Last Two Decades : How Can They Be Explained ? », in Berrebi-Hoffmann I., Giraud O., Renard L., Wobbe T. (éd.), Categories in Context, Gender and Work in France and Germany, 1900–Present, Berghahn Books, International Studies in Social History Book, vol. 31, p. 155-195.
Lemière S. (dir.), Becker M., Berthoin G., Domingo P., Guergoat-Larivière M., Marc C., Maurage-Bousquet A., Silvera R., 2013, L’accès à l’emploi des femmes : une question de politiques…, Rapport pour le Ministère des droits des femmes, décembre.
Letablier M.-T., Perrier G., 2008, « La mise en œuvre du gender mainstreaming dans les politiques locales de l’emploi. L’exemple du Fonds social européen en Île-de-France », Cahiers du Genre 2008/1, no 44, p. 165-184.
Perrier G., 2006, « Genre et application du concept de gender mainstreaming. étude de cas dans la mise en œuvre du fonds social européen en Île-de-France et à Berlin depuis 2000 », Politique européenne, 3, no 20, p. 55-74.
20Perrier G., 2015, « L’objectif d’égalité des sexes dans la mise en œuvre des politiques d’emploi à Berlin. De la diffusion professionnelle aux difficiles réappropriations profanes », Politix, 1, no 109, p. 111-133.