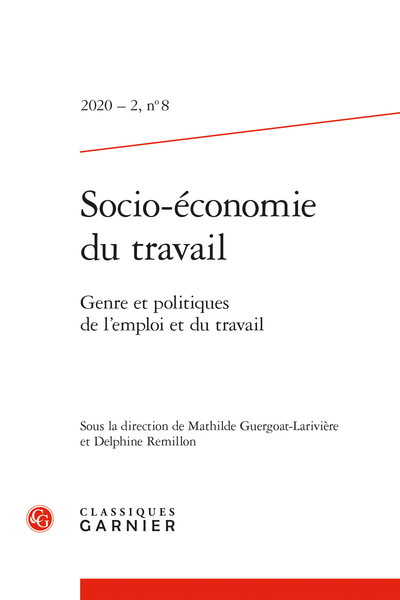
Le régime temporel du « travailleur idéal » dans les professions hautement qualifiées Une comparaison femmes-hommes en France – Suède – Royaume-Uni
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Socio-économie du travail
2020 – 2, n° 8. Genre et politiques de l’emploi et du travail - Auteurs : Bustreel (Anne), Pernod-Lemattre (Martine)
- Résumé : Cet article chercher à évaluer l’importance statistique de la sur-disponibilité temporelle parmi les professions hautement qualifiées en Europe alors que ces conditions temporelles de travail sont considérées comme plus difficiles d’accès pour les femmes. Un deuxième objectif est d'expliquer les facteurs sociétaux corrélés à sa diffusion ainsi qu’à sa composition selon le genre, en comparant trois contextes sociétaux et de genre différents : la France, la Suède, et le Royaume-Uni.
- Pages : 91 à 125
- Revue : Socio-économie du travail
- Thème CLIL : 3319 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités -- Travail, emploi et politiques sociales
- EAN : 9782406123613
- ISBN : 978-2-406-12361-3
- ISSN : 2555-039X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12361-3.p.0091
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/12/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : professions hautement qualifiées, genre, disponibilité temporelle, France-Royaume-Uni - Suède
Le régime temporel
du « travailleur idéal » dans
les professions hautement qualifiées
Une comparaison femmes-hommes
en France – Suède – Royaume-Uni
Anne Bustreel
Université de Lille
Clersé (UMR 8019)
Martine Pernod-Lemattre
Université de Lille
Clersé (UMR 8019)
La littérature sur le temps et les horaires de travail des professions qualifiées met en évidence un idéal-type du travailleur hautement qualifié structuré par un engagement fort au travail, qui articule autonomie temporelle, longues heures de travail, et débordement du travail sur la vie personnelle ou familiale. Elle montre la persistance de cette norme temporelle de travail masculine, s’inscrivant dans un système professionnel méritocratique qui récompense l’investissement temporel par des évolutions de carrières ou de salaires (Gascoigne et al., 2015). S’appuyant sur les marqueurs temporels d’une sur-disponibilité pour le travail rémunéré au détriment des autres temps sociaux, ce régime temporel est susceptible de poser des difficultés aux femmes, de plus en plus nombreuses dans ces professions très qualifiées. Cependant, ces travaux ne permettent pas d’appréhender l’importance statistique de ce modèle, ni l’ampleur du processus de féminisation parmi les professions qualifiées en Europe.
92La sur-disponibilité temporelle au travail est au cœur des attentes d’un certain nombre d’organisations, pour lesquelles elle correspond au « travailleur idéal » (Acker, 1990). Au niveau sociétal, la norme masculine du « travailleur idéal » est adossée au régime de genre du male breadwinner, aujourd’hui en déclin en Europe. Les typologies des régimes de genre offrent ainsi un cadre théorique permettant d’analyser l’influence des contextes nationaux sur la diffusion de ce régime de sur-disponibilité ainsi que sa composition selon le genre.
Cet article part d’un double constat, si l’existence d’un régime de sur-disponibilité temporelle du travail idéal fait consensus, la mesure de l’importance statistique de ce modèle parmi les professions hautement qualifiées en Europe fait défaut tout comme la connaissance des facteurs qui conduisent un tel modèle à se déployer de manière plus ou moins importante. Dans le cadre d’une comparaison France-Suède-Royaume-Uni, nous nous proposons d’évaluer l’importance statistique de ce régime et d’expliquer les facteurs sociétaux de cette diffusion : quelles sont les proportions de travailleurs affectés, et parmi ceux-ci les proportions de femmes, sont-elles homogènes ou variables selon les contextes ? Quelles sont les dimensions contextuelles qui les font varier ?
Pour cela, l’analyse s’appuie sur une comparaison entre trois régimes de genre différents dans la littérature (Lewis, 1992) : la France est considérée comme une version « modifiée » du modèle du male breadwinner, la Suède comme une version « affaiblie » et le Royaume-Uni comme une version « forte1 ». La première partie est consacrée à une revue de la littérature s’intéressant au temps et aux horaires de travail des travailleurs très qualifiés. La deuxième partie analyse les implications des régimes de genre dans chacun des trois pays sur les hommes et les femmes hautement qualifiés. Il s’agit de comprendre dans quelle mesure les contextes institutionnels favorisent ou pas la persistance de cette norme temporelle de travail au masculin. Enfin, la troisième partie propose une analyse exploratoire des profils du « travailleur idéal » dans chacun des trois pays à partir des données de l’enquête européenne sur les conditions de travail de 2015. Les liens entre les régimes temporels des professions qualifiées et la composition en fonction du sexe et de la présence d’enfants sont testés statistiquement.
93I. La sur-disponibilité temporelle
des professions hautement qualifiées
Dans les professions hautement qualifiées, la déclinaison temporelle de l’engagement au travail articule autonomie temporelle, longues heures de travail, et empiétement du travail sur la vie familiale. Elle dessine les contours d’un individu capable de travailler comme s’il n’avait pas de vie familiale ou sociale en dehors du travail, opérant une subordination complète de son temps aux temps professionnels.
I.1. Autonomie, longues heures de travail
et empiètement du travail sur la vie familiale
Au sein des organisations, les travailleurs hautement qualifiés remplissent des missions qui nécessitent souvent un travail personnel, n’ayant pas de fin clairement définie, toujours perfectible, qui peut donc conduire à un allongement de la durée du travail. Les tâches de lecture, d’écriture, d’analyse confiées aux experts ou aux managers ne sont pas attachées à un lieu de travail et peuvent être faites partout, de sorte que le travail peut facilement empiéter sur la vie personnelle ou familiale (Nätti et al., 2006). À ces activités déportées en dehors des heures et des lieux habituels de travail, Génin (2009) ajoute le prolongement des appels professionnels, marqueur de la disponibilité à l’égard de l’employeur, ou encore les voyages ou les repas professionnels. Les activités managériales, en particulier, se caractérisent par des charges de travail élevées (Tengblad et Vie, 2011), des tâches plus complexes et davantage de responsabilité, ce qui peut accroître la pression exercée par le travail sur la vie familiale (Gallie et Russell, 2009). L’effacement de la frontière entre vie professionnelle et privée qui en découle se trouve au fondement du concept de la disponibilité extensive analysé par Boni-Le Goff (2017) ou Bigi (2019).
L’autonomie temporelle, parfois revendiquée par les travailleurs hautement qualifiés (Thoemmes, 2012), va de pair avec un allongement des heures de travail et des pressions au travail accrues (Ford et Collinson (2011), Kelliher et Anderson (2010). L’absence de contrôle des heures de travail, dont l’autonomie temporelle est le versant 94positif, autorise des niveaux élevés d’investissement dans le travail, souvent présentés par les salariés comme le résultat d’un « choix personnel » (Gascoigne et al. 2015). Ceux-ci assument entièrement le fait d’allonger leurs heures de travail, de répondre aux clients ou de rédiger un rapport le week-end.
Plus encore, l’autonomie temporelle s’inscrit dans des pratiques de management « haute-performance » visant à intensifier le travail (Berg et al., 2014) et l’allonger (Lott et Chung, 2016). Si cette façon de travailler semble relativement ancienne, l’évolution des pratiques managériales (Mercure, 2013) dans les entreprises postfordistes, en accentuant l’importance accordée à l’autonomie, contribue sans doute à l’extension de ce modèle, particulièrement, mais pas seulement, pour les travailleurs hautement qualifiés. L’adhésion aux exigences d’autonomie et de responsabilité, l’engagement très élevé dans le travail deviennent constitutifs de ce que Mercure appelle l’éthos de la professionnalité. Cette culture des heures longues est constitutive de l’identité professionnelle, comme chez les cadres le fait de « travailler sans compter son temps » (Bouffartigue et Bocchino, 1998).
Enfin, cet idéal-type s’inscrit dans un système professionnel méritocratique, qui récompense l’investissement temporel par des évolutions de carrière et ou de salaires (Gascoigne et al., 2015). Guillaume et Pochic (2009) montrent comment l’accès au top management passe par le fait de faire la preuve d’une « dévotion totale » à l’organisation en occupant des postes particulièrement « time-consuming ».
L’identité professionnelle des travailleurs hautement qualifiés incorpore ainsi une forme particulière de ce que Bouffartigue (2012) appelle la disponibilité temporelle au travail, pour désigner « les formes et les échelles de la subordination du temps humain aux temps professionnels » (Bouffartigue, 2012, p. 2). Est à l’œuvre ici une subordination extrême des autres temps sociaux au temps professionnel, s’exprimant par une sur-disponibilité temporelle au travail, tant quantitativement, dans l’allongement à volonté des heures de travail, que qualitativement, dans le débordement consenti du travail sur la vie privée.
I.2. Une norme temporelle « masculine »
Selon Acker (1990), les organisations se considèrent comme neutres au genre alors que l’absence historique des femmes dans les professions les 95plus qualifiées a permis aux comportements et perspectives masculins d’être définis comme la norme. Adoptant le point de vue de l’organisation qui l’emploie, elle décrit le « travailleur idéal » comme « le travailleur masculin dont la vie est centrée sur son emploi à temps plein, pendant que sa femme ou une autre femme s’occupe de ses besoins personnels et de ses enfants » (Acker, 1990, p. 39).
La pertinence de ce modèle pour les professions hautement qualifiées est illustrée par de nombreux travaux montrant comment certains métiers, certains secteurs sont particulièrement affectés par la norme du « travailleur idéal », des managers français (Guillaume et Pochic, 2009) ou britanniques (Ford et Collinson, 2011), les consultants en Suède (Peterson, 2007), au Royaume-Uni et en Finlande (Meriläinen et al., 2004), les activités de conseil financier aux États-Unis (Bertrand et al., 2010), les universitaires britanniques (Sang et al., 2015) alors qu’aux États-Unis, les fonctions de management généralistes dans les entreprises seraient privilégiées par les femmes cherchant à fuir les longues de travail (Bertrand et al., 2010). Dans ces professions règne un modèle d’investissement au travail masculin, privilégiant le travail rémunéré aux responsabilités familiales/sociales et reposant sur la démonstration d’un engagement total au service de l’entreprise (Ford et Collinson, 2011).
Les carrières reposent sur une configuration familiale particulière « homme soutien de famille, femme inactive et nombreux enfants » (Guillaume et Pochic, 2009, p. 23). La progression du nombre de femmes dans ces professions peine à faire évoluer ce modèle, une minorité d’entre elles adoptant ce modèle masculin pour pouvoir accéder aux positions les plus élevées alors que les autres préfèrent évoluer vers des emplois moins demandeurs (Guillaume et Pochic, 2009, Bertrand et al., 2010, Bigi, 2019). Burke et Fiksenbaum (2009) notent que les femmes occupant des « extreme jobs » ne se distinguent pas en termes d’âge et d’ancienneté, de statut matrimonial, de taille d’entreprise etc., à l’exception du fait qu’elles sont plus souvent sans enfant. Cependant, pour Guillaume et Pochic (2009), les femmes adoptant un modèle de carrière masculin ont des conjoints plus atypiques, moins diplômés qu’elles par exemple.
Il est toutefois difficile de saisir le degré de diffusion de ce modèle dans les conditions de travail effectives des travailleurs hautement 96qualifiés à partir de ces travaux, dont l’objectif est d’être exemplaires d’un idéal-type plutôt que statistiquement représentatifs. Les travaux statistiquement représentatifs se sont consacrés à un champ de recherche présentant une évidente proximité avec les travaux consacrés à la norme du « travailleur idéal », celui des longues ou très longues heures de travail. Mais une durée longue de travail ne mesure ni le fait que cette durée est déterminée de manière autonome, volontaire, « personnelle » ni le débordement du travail sur la vie familiale, qui expriment la primauté attribuée au travail professionnel, éléments structurants de la sur-disponibilité temporelle du « travailleur idéal ». De plus, ces travaux utilisent souvent la catégorie professionnelle (Drago et al., 2005) et/ou le niveau de diplôme (Burger, 2018) comme variables « explicatives » des longues heures de travail mais n’abordent pas la question de savoir pourquoi les travailleurs hautement qualifiés sont eux-mêmes plus ou moins exposés à ces longues heures.
I. Une norme dépendant
des contextes nationaux
La sur-disponibilité temporelle au travail implique que les responsabilités domestiques et familiales soient prises en charge par quelqu’un d’autre. Dans le cas du travailleur idéal d’Acker, ce régime correspond à des organisations temporelles au sein de la famille dans lesquelles les hommes ont un partenaire inactif ou qui travaille à temps réduit.
La persistance de la norme du travailleur idéal dans les organisations s’appuie, au niveau sociétal, sur des institutions favorisant le surinvestissement professionnel des hommes et le sous-investissement professionnel des femmes. Dans la littérature, de nombreuses typologies se sont attachées à décrire ces institutions en mettant en exergue le partage des responsabilités entre l’État, le marché et la famille dans la prise en charge du care (Lewis, 1992), les modes de régulation du temps et des horaires de travail (Rubery et al., 1998, Figart et Mutari, 2000), ou encore les droits sociaux dans les contrats sociaux de genre 97(Letablier, 2009, Silvera, 2010). Le modèle de l’homme gagne-pain, référence de ces typologies, décline dans nombre de pays (Crompton, 1999, Pascall et Lewis, 2004) même parmi les « strong male breadwinner », rendant plus nécessaire la pensée de la sortie de ce modèle traditionnel. La typologie de Fraser (1994) décrit des tendances d’évolution des régimes de genre, qui offrent un cadre heuristique pour mieux comprendre la sur-disponibilité temporelle. La place qu’elle occupe et les caractéristiques des individus qu’elle concerne, dans un contexte sociétal donné, sont supposées être reliées aux éléments constitutifs des différents régimes de genre.
Le choix est fait de retenir trois pays aux contextes sociétaux considérés comme différents dans les démarches typologiques intégrant le genre : la Grande-Bretagne, la France et la Suède. Selon Lewis (1997), dans des pays comme le Royaume-Uni ou l’Irlande, le modèle du male breadwinner est resté fort, marqué par une idéologie libérale laissant la famille hors du champ d’intervention de l’État. Bien que le Royaume-Uni ait un peu étoffé sa politique familiale avec l’arrivée au pouvoir du New Labour en 1997, cette évolution a ciblé principalement les familles à bas revenus (Flekenstein et Seelieb-Kaiser, 2011). Ce pays présente, par ailleurs, une forte flexibilisation du temps de travail et une faible équité de genre dans la répartition des heures de travail (Figart et Mutari, 2000), impliquant des heures longues pour les hommes (Rubery et al., 1998).
En France, la reconnaissance des revendications des femmes en tant que mères et épouses et en tant que salariées, a « modifié » le modèle du male breadwinner. Elle possède une culture favorable à l’emploi à temps plein des femmes, considéré comme la condition sine qua non de l’accès à l’indépendance (Ordioni, 2013). Elle combine une faible flexibilisation du temps de travail avec une répartition équitable des heures travaillées entre hommes et femmes.
La Suède est considérée comme le pays pionnier en matière de politique familiale orientée vers les ménages « à deux apporteurs » pour en faire ce que Lewis (1992) considère comme un weak male breadwinner. Dès le début des années 1970, ont été introduits une taxation individuelle, plutôt que familialisée, de nombreux congés parentaux à destination des pères comme des mères, une offre massive de services de garde, le droit de travailler à temps partiel pour les parents.
98Cependant, comme Fraser (1994) ou Korpi et al. (2013) l’ont souligné, une des difficultés de l’évaluation des effets des régimes de genre réside dans le fait que les institutions, les politiques et les normes qui les définissent n’exercent pas des effets uniformes et identiques selon le revenu, la classe, la profession, l’origine ethnique ou l’âge. Ces régimes peuvent ainsi produire des effets différenciés sur les travailleurs hautement qualifiés, qui demandent à être définis plus précisément.
II.1. Le Royaume-Uni : un modèle qui reste maternaliste
même chez les femmes hautement qualifiées
Le Royaume-Uni représente « une version culturelle forte du modèle de l’homme pourvoyeur principal de ressources du couple » (Ordioni, 2013) : le stéréotype de « l’incapacité » des pères à s’occuper de leurs enfants y est deux fois plus élevé qu’en France et en Suède. Moins d’un tiers des femmes hautement qualifiées se disent fortement en désaccord avec l’idée que la vie de famille souffre de l’emploi à temps plein des mères (tableau 1), proportion très inférieure à celles qui sont observées pour la France et la Suède. En dépit d’une politique récente d’amélioration des congés parentaux, les pères britanniques ne les utilisent pas en raison, entre autres, des pressions ressenties au travail (Kaufman, 2018). Le maternalisme du régime de genre britannique reste prégnant parmi les femmes aux qualifications élevées. Le manque de souplesse des emplois à temps plein ainsi que les difficultés d’accès à des services de garde d’enfants abordables financièrement (tableau 2) sont considérés comme des barrières par les mères ayant les revenus les plus élevés (Alakeson, 2012). De ce fait, près d’un tiers des femmes hautement qualifiées travaillent à temps partiel (tableau 3).
Tab. 1 – Part de femmes fortement en désaccord avec l’opinion
« la vie familiale souffre quand la femme travaille à temps plein ».
|
Directeurs, cadres de direction et gérants |
Professions intellectuelles et scientifiques |
|
|
France |
39 % |
44 % |
|
Suède |
72 % |
63 % |
|
Royaume-Uni |
28 % |
25 % |
Source : calculs effectués à partir de EVS 2017
99Tab. 2 – Coûts nets de la garde d’enfants en %
du revenu net disponible du ménage en 2015.
|
Pour deux enfants âgés de 2 et 3 ans |
Pour un couple avec deux enfants, gagnant tous deux |
Pour un couple avec deux enfants, le 1er adulte gagnant le salaire moyen et son partenaire 67 % |
|
France |
12 % |
9 % |
|
Suède |
3 % |
4 % |
|
Royaume-Uni |
54 % |
41 % |
Source : OECD statistics. Note : cas-type du ménage de deux enfants âgés de 2 et 3 ans retenu par l’OCDE.
Tab. 3 – Proportion et durée moyenne du temps partiel
parmi les femmes en 2015.
|
Directeurs, cadres |
Professions intellectuelles |
|||
|
Proportion |
Durée moyenne (en heures) |
Proportion |
Durée moyenne (en heures) |
|
|
France |
10,4 % |
29,7 |
21,4 % |
24,3 |
|
Suède |
9,4 % |
26,8 |
27,9 % |
27,3 |
|
Royaume-Uni |
21,9 % |
19,9 |
29,7 % |
22,1 |
Source : Eurostat (Labour Force Survey-LFS, 2015), calculs des proportions faits à partir des effectifs.
Le Royaume-Uni laisse aux employeurs la plus grande part du pouvoir de décision en matière de temps et d’horaires de travail. Hors du cadrage de la directive européenne sur le temps de travail, ratifiée en 1998 avec l’introduction d’une possibilité « d’opt out » sur la durée maximale de travail sur demande individuelle, la réglementation du temps de travail ne donne pas de définition légale de la durée du travail, des heures supplémentaires, du temps partiel. Dans le cas général, la durée normale de travail est indiquée dans le contrat de travail. Les négociations collectives ont un rôle limité, leur couverture est faible. Cette régulation centrée sur l’employeur contribue à une forte dispersion des heures travaillées ainsi qu’à un niveau élevé d’arrangement flexibles orientés vers l’employeur (Chung et Tijdens, 2013), bien que 100depuis 2014, les salariés bénéficient d’un droit à des horaires souples. Enfin, dans le cadre du Brexit, l’actuel gouvernement envisagerait de revenir sur la directive européenne, en particulier, sur la durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
Le régime de genre britannique présente ainsi des traits favorables au régime temporel du travailleur idéal. Il n’encourage ni l’activité à temps plein des mères ni la participation des pères aux tâches domestiques et familiales, ce qui concentre la prise en charge économique de la famille sur les hommes et alimente un consentement masculin à des horaires longs, plus rémunérateurs. À l’inverse, pour les femmes qualifiées, assurer une sur-disponibilité temporelle est difficile et coûteux compte tenu des opinions en vigueur majoritairement négatives sur l’emploi à temps plein des mères et d’une offre de services de garde principalement privée qui conduit à un coût élevé. Le mode de régulation du temps de travail laisse toute liberté aux employeurs d’imposer leurs propres modalités de gestion du temps et des horaires de travail et offre ainsi une forte hétérogénéité des temps travaillés : les écarts de durée moyenne de travail entre hommes et femmes cadres sont les plus élevés des trois pays (tableau 4). L’on peut faire l’hypothèse que le profil du travailleur idéal britannique sera conforme à son idéal-type, un homme avec enfants dont l’épouse ne travaille pas ou à temps réduit.
II.2. La Suède en chemin vers le modèle
du prestataire universel de soins ?
La Suède se caractérise par un très faible coût de la garde d’enfants, même au niveau d’un couple au salaire moyen et les capacités d’accueil des jeunes enfants sont élevées (tableau 2). Les opinions négatives sur l’emploi à temps plein des mères parmi les travailleuses hautement qualifiées sont minoritaires (tableau 1). La Suède est l’un des rares pays qui encouragent les parents à partager le travail du care en accordant des congés exclusifs aux pères, indemnisés à 80 % du salaire (Evertsson et Boye, 2018). Les travailleurs les plus qualifiés semblent particulièrement sensibles à cette incitation : prendre un congé parental de plus de deux mois est surtout le fait des pères les plus diplômés, les plus urbains et plus souvent nés en Suède (Ma et al., 2020). En favorisant l’implication du père pour rééquilibrer la participation au travail du care, la Suède cherche à se rapprocher du modèle du prestataire universel de soins de 101Fraser (Castro-Garcia et Pazos-Moran, 2016). Celui-ci doit permettre aux hommes et aux femmes d’être à la fois pourvoyeurs de revenu et de soin : il opère une convergence entre leurs durées de travail dans le domaine du care mais également dans celui de l’activité professionnelle. Cependant, certaines entreprises semblent peu favorables à une réduction du temps de travail des hommes aux moments des naissances, particulièrement pour les managers (Haas et Hwang, 2016).
La Suède fait partie des pays ayant une forte tradition de négociation et de compromis en matière de régulation du temps de travail (Berg et al., 2014). La loi de 1982 sur le temps de travail fixe à 40h la durée maximale hebdomadaire du travail ainsi qu’un volume maximal d’heures supplémentaires mais elle peut être remplacée, partiellement ou complètement, par des accords collectifs au niveau des branches sans que ceux-ci puissent prévoir des dispositions moins favorables que celles prévues par la directive européenne. Les professions hautement qualifiées ne font pas l’objet d’une définition précise, légale ou conventionnelle et sont, pour la plupart, couvertes par la loi de 1982, qui est fortement inclusive (Berg et al., 2014) ainsi que par les conventions collectives classiques (Vögt et al., 2009).
Les durées moyennes de travail des hommes et des femmes qualifiés convergent dans l’ensemble vers 41h : les conditions temporelles de travail des hommes et des femmes qualifiés sont les plus homogènes des trois pays, ce qui devrait limiter la sur-disponibilité temporelle au travail. Toutefois, la distribution des heures de travail n’est pas neutre au genre à ses extrémités. D’une part, les hommes managers travaillent plus longtemps que les femmes managers même si leur durée de travail est inférieure à celle observée dans les deux autres pays (tableau 4). D’autre part, la fréquence du temps partiel féminin, même parmi les travailleurs hautement qualifiés, reste plus élevée qu’en France bien qu’associée à une durée moyenne plus élevée qu’au Royaume-Uni (tableau 3). Le profil du « travailleur idéal » pourrait ne pas être neutre au genre.
II.3. La France : vers le modèle du travailleur universel
pour les plus qualifiés ?
Les parents bénéficient du développement d’une offre diversifiée de modes d’accueil collectif et individuel soutenue par des aides publiques conséquentes et accessibles dès la fin du congé maternité (Thévenon, 1022016) (tableau 2). En particulier, la garde à domicile des enfants, plus coûteuse, est particulièrement mobilisée par les parents aux durées longues de travail car elle permet une prise en charge longue particulièrement adaptée pour les couples de cadres aux revenus élevés (Villaume et Virot, 2016). Le temps partiel féminin parmi les professions qualifiées est le plus faible des trois pays (tableau 3). De plus, en raison de son congé paternité de 2 semaines indemnisé à 100 %, qui vient d’être allongé à 28 jours, Castro-Garcia et Pazos-Moran (2016) classent la France dans un groupe de pays qui considèrent les pères comme des « incidental collaborators » en matière de travail de care. Ce rôle prépondérant de la socialisation du care par l’État, sans réelle remise en cause de la division du travail entre pères et mères, tire les plus qualifiés vers le modèle du travailleur universel de Fraser. Ce modèle, basé sur un fonctionnement masculin au travail, implique une évolution du profil du travailleur idéal dans la mesure où il consiste à étendre les arrangements temporels priorisant le travail aux hommes comme aux femmes en libérant les individus des tâches domestiques et familiales par une socialisation généralisée du travail du care soit par le marché, soit par l’État.
L’État réglemente le temps et les horaires de travail en imposant des standards minimums (Berg et al., 2014, Anxo et al., 2017, 2019) législatifs ou conventionnels mais laisse cependant une place croissante à la négociation d’entreprise, notamment en matière de temps et d’horaires de travail, qui permet d’adapter le cadre légal (Eurofound, 2016). Traditionnellement, la négociation collective a eu tendance à traiter les cadres de manière séparée, comme l’ont illustré encore les dispositions négociées lors de la réduction du temps de travail au début des années 2000. Les entreprises ont eu la possibilité de négocier collectivement une organisation du temps de travail appelée le forfait-jours pour leurs salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce décompte de la durée du travail en nombre de jours par an soustrait les salariés aux règles nationales et européennes sur la durée légale du travail. Aujourd’hui, 47 % % des cadres ont un temps de travail comptabilisé en jours et ils représentent 80 % des salariés au forfait (Létroublon, 2015).
La régulation du temps de travail des cadres oppose peu de résistance aux exigences des entreprises en matière d’implication au travail de leurs éléments les plus qualifiés. La durée du travail, comme les frontières 103entre la vie personnelle et professionnelle, sont laissées à leur discrétion, ce qui ne peut qu’alimenter la sur-disponibilité temporelle. Les durées moyennes de travail à temps plein sont élevées, particulièrement dans les fonctions de direction dont la situation n’apparaît pas différente du Royaume-Uni, mais également parmi les professions intellectuelles et scientifiques (tableau 4). Soutenus par l’externalisation des tâches de care, les temps pleins sont fréquents et les durées de travail à temps plein relativement élevées pour les femmes, ce quilaisse penser que le régime de la sur-disponibilité temporelle pourrait concerner les hommes comme les femmes. Toutefois, l’écart moyen de durée de travail entre hommes et femmes qualifiés avoisine les quatre heures, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences sur la composition genrée du haut de la distribution des heures de travail.
Tab. 4 – Durées moyennes de travail à temps plein parmi les femmes
et les hommes des professions qualifiées dans les trois pays en 2015.
|
Directeurs, cadres |
Professions intellectuelles |
|||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
France |
47,8 |
43,9 |
42,6 |
39,8 |
|
Suède |
43,5 |
40,9 |
40,9 |
40,5 |
|
Royaume-Uni |
47,6 |
43,6 |
44 |
42,6 |
Source : Eurostat (LFS, 2015)
I. Une première mesure statistique
de l’extension du régime temporel
de la sur-disponibilité professionnelle
La stratégie empirique retenue est d’essayer de repérer statistiquement ce régime temporel à partir des dimensions clés du temps et des horaires de l’idéal-type présent dans la littérature : une longue durée de travail, un débordement du travail sur le temps libre et enfin le choix de ses horaires de travail.
104Les données proviennent de la 6e enquête européenne sur les conditions de travail, couvrant 34 pays parmi lesquels la France, la Suède et le Royaume-Uni. L’intérêt de l’enquête est d’offrir une description fine des conditions de travail en général et, en particulier, de l’organisation du temps et des horaires. Les répondants de l’enquête sont âgés de 15 ans ou plus, résident dans l’un des 34 pays et ont travaillé au moins une heure durant la semaine précédant l’enquête. Parmi ceux-ci, ne sont retenus que les répondants de 25 à 64 ans ayant une profession hautement qualifiée, définie par l’appartenance aux deux catégories supérieures de la CITP : les directeurs, cadres de direction et gérants et les professions intellectuelles et scientifiques. La restriction du périmètre d’analyse aux professions hautement qualifiées impose de travailler avec des échantillons (non pondérés) de taille relativement réduite pour chacun des trois pays : 348 pour la France (sur 1503 répondants) ; 355 pour la Suède (sur 990) ; 544 pour le Royaume-Uni (sur 1608).
Avoir de longues heures de travail est la première des trois caractéristiques du régime temporel du travailleur idéal. Dans l’enquête, la mesure utilisée est la durée habituelle de travail par semaine. Mais la question posée ici est celle du seuil d’heures de travail à partir duquel un individu correspond au travailleur idéal « dont la vie est centrée2 sur son emploi à temps plein » (Acker, 1990, p. 39). C’est ainsi la centralité du travail sur les autres temps sociaux qui se trouve au cœur de cette définition. Un moyen de repérer statistiquement des travailleurs hautement qualifiés pour lesquels le travail est central, ou plus central que pour d’autres, est de s’appuyer sur la durée de travail que l’on pourrait considérer comme « normale » dans ces professions : les individus travaillant au-delà de la norme pourraient être considérés comme s’approchant du modèle du travailleur idéal. Statistiquement, une semaine de 40h est le mode et la médiane des distributions des heures des travailleurs hautement qualifiés dans les trois pays. Parmi les travailleurs hautement qualifiés, entre 42 % et 49 %, selon le pays, ont une durée habituelle de travail comprise entre 35 et 40 heures. Toutefois, au-delà des 40h, la distribution n’est pas uniforme et comporte deux pics, l’un à 45h et l’autre à 50h : 45h est le troisième quartile de la distribution dans les trois pays et constitue 105ainsi un seuil commun, ce qui n’est pas le cas des semaines des 50h3, ce qui conduit à retenir ce seuil.
Tab. 5 – Répartition des travailleurs hautement qualifiés âgés de 25 à 64 ans selon la durée du travail (en %) dans les trois pays.
|
Moins de 35 h |
35 à 39 h |
40 à 44 h |
45 h et plus |
|
|
France |
18,5 |
23,9 |
19,9 |
37,7 |
|
Suède |
14,1 |
10,1 |
47,2 |
28,6 |
|
Royaume-Uni |
19,5 |
22,5 |
26,5 |
31,6 |
Source : European Working Conditions Survey (EWCS), données pondérées
Signe du développement d’un segment du marché du travail hautement qualifié au sein duquel règne des formes de concurrence exacerbée (Wren, 2013, Burger, 2018), les longues heures de travail touchent les trois pays. La France a la proportion la plus élevée (37,7 %) de durées longues de travail parmi les travailleurs hautement qualifiés. L’absence de contrôle des heures de travail dans le code du travail français pour les salariés au forfait-jour contribue très probablement à ce niveau élevé. Bien que connu pour sa culture des longues heures de travail (Fagan, 2009), le Royaume-Uni ne compte que 31,6 % de durées longues parmi ses travailleurs hautement qualifiés, ce qui converge avec le constat d’un déclin de ce phénomène sur longue période (Devlin et Shirvani, 2014). Ce pays se caractérise surtout par une faible polarisation sur un type d’horaire qui fait écho à la quasi-complète latitude laissée aux employeurs en matière de temps et d’horaires de travail. De même, en Suède, 28,6 % des travailleurs hautement qualifiés déclarent une durée habituelle de travail supérieure ou égale à 45h. Cette proportion reste non négligeable en dépit de la très forte standardisation du temps plein à 40 h. Elle confirme un résultat d’Allard et al. (2011) qui montraient que les managers de proximité de certaines grandes entreprises suédoises étaient perçus comme favorables aux comportements présentéistes au travail et peu compréhensifs des difficultés d’articulation travail-famille que pouvaient rencontrer les pères.
Le débordement du travail sur la vie personnelle est la deuxième dimension définissant le régime temporel de la sur-disponibilité 106professionnelle. La variable utilisée est la fréquence à laquelle le répondant a dû travailler sur son temps libre pour répondre aux exigences de son travail. Le choix des modalités est fait a contrario, en excluant les individus qui ne travaillent jamais sur leur temps libre.
Tab. 6 – Proportion de travailleurs hautement qualifiés âgés de 25 à 64 ans (en %) déportant des activités professionnelles sur le temps libre.
|
Tous les jours, plusieurs fois par semaine |
|||
|
Moins de 45h |
45h et plus |
Ensemble |
|
|
France |
77,3 |
90,1 |
82,1 |
|
Suède |
63 |
82,8 |
68,7 |
|
Royaume-Uni |
69,4 |
88,9 |
75,6 |
Source : European Working Conditions Survey (EWCS), données pondérées
Note de lecture : parmi les travailleurs hautement qualifiés français, 77,3 % de ceux qui travaillent moins de 45h déportent des activités professionnelles tous les jours, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois ou moins souvent.
Parmi les travailleurs hautement qualifiés, la France se distingue par un débordement plus marqué que dans les autres pays, suivie par le Royaume-Uni, puis par la Suède. Ce débordement est toutefois beaucoup plus fréquent parmi ceux qui travaillent 45h et plus. L’interprétation de cette forme de porosité des frontières entre la vie professionnelle et personnelle oppose deux hypothèses, le surinvestissement au travail vs l’enrichissement du travail (Génin, 2017). Selon la première hypothèse, le débordement serait la conséquence d’une charge élevée de travail alors que selon la seconde hypothèse, il révélerait les zones de liberté dans l’organisation du temps de travail, qui limiterait le temps passé au bureau pour éviter les interruptions, avoir une meilleure concentration, etc. Dans le cas présent, le lien statistique évoque plutôt un surinvestissement au travail, ceux qui travaillent le plus longtemps sont également ceux qui travaillent pendant leur temps libre.
Dans les facteurs de débordement du travail sur la vie personnelle avancés par les rares travaux ayant abordé cette question figure l’intensification du travail des cadres (Pichon, 2009). Celle-ci est favorisée par la diffusion de nouveaux modèles managériaux, comme les pratiques de travail haute-performance qui visent à développer l’implication au 107travail, notamment en laissant de l’autonomie temporelle aux employés (Ortega, 2009). Bien que le rythme de diffusion de ces nouvelles pratiques puisse différer et ainsi expliquer des fréquences de débordement un peu différentes entre les trois pays, le débordement nécessite des conditions propices, comme le rappelle Goussard et Tiffon (2016), travailler sur le temps libre nécessite en effet d’être « préservés par les membres de [la] famille » : une priorité familiale accordée à l’activité professionnelle de monsieur jouerait dans le cas des hommes alors que ce serait la présence d’enfants plus âgés qui le permettrait aux femmes. Dans cette mesure, la répartition un peu plus équilibrée des tâches entre hommes et femmes en Suède pourrait y limiter la fréquence du débordement alors que la France et le Royaume-Uni se montrent plus en retrait sur ce point. Les deux facteurs, intensification du travail et configuration familiale, jouent probablement à des dosages difficiles à préciser à ce niveau d’analyse.
Une troisième dimension stratégique de la notion de « travailleur idéal » est l’autonomie temporelle. L’absence de contrôle de l’employeur sur les heures de travail, qui a pu être une revendication des cadres en France, permet en effet de laisser varier les niveaux temporels d’investissement dans le travail de manière interindividuelle. Toutefois, l’enquête ne donne pas véritablement de variable mesurant le contrôle exercé ou pas par l’employeur sur les horaires de travail individuels mais elle fournit des indications sur le mode de détermination des horaires : fixés par l’employeur, choix entre plusieurs plages fixes, horaires à la carte, déterminés entièrement par vous-mêmes. Sont considérés ici comme disposant d’une autonomie temporelle ceux qui déclarent choisir eux-mêmes leurs horaires ou bénéficier d’horaires souples.
Tab. 7 – Proportion de travailleurs hautement qualifiés âgés de 25 à 64 ans (en %) choisissant leurs horaires en fonction de la durée habituelle de travail.
|
Moins de 45 h |
45 h et plus |
45 h et plus « débordantes » |
Ensemble |
|
|
France |
52 |
81,3 |
81,5 % |
63,1 |
|
Suède |
71,9 |
87 |
90,5 % |
76,2 |
|
Royaume-Uni |
47,2 |
61,3 |
64,5 % |
51,6 |
Source : European Working Conditions Survey (EWCS), données pondérées
Note de lecture : parmi les travailleurs hautement qualifiés français travaillant moins de 45h, 52 % choisit ses horaires de travail.
108Choisir ses horaires et travailler plus longtemps sont corrélés positivement, quel que soit le pays considéré. En Suède, l’importance de la négociation collective en matière de temps et d’horaires et de travail explique le contrôle laissé aux salariés en général, et en particulier aux travailleurs hautement qualifiés, sur leurs horaires de travail. Dans le cas des travailleurs hautement qualifiés français, l’autonomie se trouve à la base de la régulation juridique de leur temps de travail. Toutefois, le poids important des horaires plus ou moins fixés par l’employeur parmi les travailleurs hautement qualifiés britanniques interroge4. Certes, la régulation du temps de travail laisse à l’employeur la plus grande latitude pour déterminer les horaires de travail. Mais la coexistence de prescriptions de l’employeur sur les horaires et d’un débordement fréquent du travail sur le temps libre est paradoxale. Elle ne cadre pas avec la diffusion de pratiques de travail à haute performance consistant notamment à laisser de l’autonomie en matière d’organisation du temps de travail. Il pourrait également s’agir d’un effet de structure dû à la surreprésentation d’horaires dictés par la nature de l’activité de l’entreprise ou du poste comme ceux des enseignants ou d’ingénieurs en production.
Le croisement des trois dimensions définissant le régime temporel d’un travailleur idéal est résumé dans le tableau 8. Les travailleurs hautement qualifiés français sont les plus touchés par la sur-disponibilité temporelle au travail, ayant des scores élevés sur les trois dimensions cumulées progressivement. Le Royaume-Uni présente des scores proches sur les longues heures de travail et le débordement mais finit avec la proportion la plus faible en raison d’une fréquence élevée d’horaires fixés par l’employeur. Enfin, en Suède, les travailleurs hautement qualifiés sont moins touchés par les durées longues et le débordement mais bénéficient plus souvent d’horaires choisis. La corrélation entre les horaires choisis et l’envahissement du travail semble donc devoir être relativisée.
109Tab. 8 – Proportion des travailleurs hautement qualifiés âgés de 25 à 64 ans présentant une, deux ou les trois caractéristiques
de la sur-disponibilité temporelle au travail dans les trois pays.
|
Royaume-Uni |
France |
Suède |
|
|
Travaillant 45 h et plus |
31,6 % |
37,7 % |
28,6 % |
|
Travaillant 45 h et plus avec débordement |
28,1 % |
33,9 % |
23,7 % |
|
Travaillant 45 h et plus avec débordement et choix de leurs horaires |
18,1 % |
27,7 % |
21,5 % |
Il s’agit maintenant d’examiner comment le fait d’être père ou mère dans un contexte institutionnel donné influence l’appartenance au régime de la sur-disponibilité temporelle. Pour répondre à cette question, des régressions logistiques binaires sont estimées par pays. En effet, ce type de régression repose sur une hypothèse d’indépendance des observations susceptible de ne pas être vérifiée dans le cas de données groupées par pays. Une partie des différences entre les individus peut être spécifique au pays alors qu’une autre partie s’explique par des différences entre les caractéristiques individuelles. Ces régressions permettent d’estimer la probabilité qu’un individu appartienne au régime de la sur-disponibilité temporelle sur un ensemble identique de variables indépendantes pour les trois pays.
L’arrivée des enfants conduit les couples à des ajustements en termes de type d’emploi occupé, de temps de travail, d’investissement au travail : les femmes s’investissant de plus en plus dans la sphère domestique et les hommes dans la sphère professionnelle (Pailhé et Solaz, 2009). Ainsi, être père ou mère devrait être corrélé à des différences d’autant plus nettes que le contexte institutionnel est maternaliste car celui-ci incite les mères au sous-investissement temporel et les pères au surinvestissement. Les hommes et les femmes sans enfant devraient être dans une situation intermédiaire, moins sous-représentés que les mères et moins surreprésentés que les pères. à l’inverse, ces ajustements devraient être plus limités dans le cas de la Suède, mais plus encore dans le cas de la France qui présente des rapprochements avec le modèle du travailleur universel.
La principale variable d’intérêt croise le genre et la présence d’enfant(s) dans le ménage pour distinguer quatre situations différentes : femme ou homme, avec ou sans enfant(s) présent. Cette mesure de la parentalité 110manque de précision : les contraintes temporelles liées à la présence d’enfant(s) exercent des effets à la fois contemporains de leur présence effective au sein de la famille mais également désynchronisés, peut-être avant leur présence effective et plus encore, après leur départ de la cellule familiale. L’anticipation de leur probable arrivée peut conduire certaines femmes à éviter des conditions de travail considérées comme peu compatibles avec la prise en charge du care. Au départ des enfants de la cellule familiale, ces orientations professionnelles sont susceptibles d’avoir des conséquences d’autant moins réversibles qu’elles ont perduré dans le temps. Ces effets décalés créent une difficulté : la présence d’enfants à un instant donné renseigne de manière satisfaisante sur les contraintes temporelles supportées par les parents mais l’absence d’enfants est plus difficile à interpréter puisqu’elle regroupe des individus qui n’ont pas encore d’enfant, des individus qui n’en auront jamais et des individus dont les enfants ne sont plus présents dans le ménage. Il serait préférable de distinguer au moins les individus sans enfant des individus avec enfant(s) non présent(s) mais l’enquête ne le permet pas. Pour limiter l’hétérogénéité de cette catégorie, le choix est fait de retenir la présence d’enfant(s) dans le ménage quel que soit l’âge des enfants, en intégrant les plus de 15 ans. L’âge du répondant est également contrôlé car il peut être lié, entre autres, aux différentes étapes de la carrière et aux types de postes occupés. Le niveau de diplôme est contrôlé par une indicatrice correspondant aux diplômés de niveau bac+5 et plus, les travaux existants ayant montré leur forte exposition à ce régime.
Tab. 9 – Part de travailleurs hautement qualifiés âgés de 25 à 64 ans sur-disponibles temporellement selon le genre et la présence d’enfant dans les trois pays.
|
Royaume-Uni |
France |
Suède |
|
|
Femmes sans enfant |
16,1 % |
21,4 % |
15,5 % |
|
Femmes avec enfant |
9,7 % |
22,2 % |
18 % |
|
Hommes sans enfant |
20,6 % |
32,2 % |
18 % |
|
Hommes avec enfant |
25,1 % |
34 % |
35,5 % |
|
Ensemble |
18,1 % |
27,7 % |
21,5 % |
Note de lecture : au Royaume-Uni, 16,1 % des femmes sans enfant sont dans la catégorie des travailleurs sur-disponibles temporellement, contre 18,1 % en moyenne. Les chiffres mis en gras indiquent une surreprésentation.
111Les statistiques descriptives montrent une sur-représentation des hommes avec enfant parmi les travailleurs sur-disponibles temporellement dans les trois pays, qui s’accompagne d’une sur-représentation des hommes sans enfant, sauf dans le cas de la Suède.
Les effets de l’inégale répartition des tâches du care et du temps de travail rémunéré entre femmes et hommes peuvent transiter par des caractéristiques de l’emploi occupé. Des contraintes temporelles anticipées ou vécues peuvent orienter les choix des femmes vers des secteurs, des professions ou des conditions d’exercice des professions moins demandeurs temporellement. Bien que les professions exercées par les travailleurs hautement qualifiés soient très variées, la taille de l’échantillon impose de se concentrer sur les groupes professionnels aux effectifs les plus conséquents. Les fonctions de direction, en particulier, sont associées à des normes masculines de travail, impliquant notamment une extensivité du temps de travail (Laufer, 2005, Boussard, 2016). Dans la classification internationale type des professions, utilisée dans l’enquête pour faciliter les comparaisons internationales, l’exercice d’une profession appartenant au groupe des « directeurs et cadres de direction » est susceptible d’être corrélé à la sur-disponibilité temporelle au travail car il regroupe des travailleurs très fortement autonomes en raison de leur niveau de responsabilité. Contrôler cette variable semble important pour évaluer la corrélation entre l’exercice de responsabilités importantes et ce type de régime temporel. Pour évaluer le niveau de responsabilité hiérarchique, une variable indicatrice correspondant à l’encadrement de 10 personnes ou plus est introduite parallèlement.
Le groupe des professions intellectuelles et scientifiques, dont le niveau élevé de compétences et de qualifications est le trait commun dans la CITP, regroupe des situations plus contrastées en termes d’autonomie, notamment temporelle. Compte tenu de son importance numérique dans chaque pays, de ses temporalités particulières et de sa forte féminisation, l’appartenance à la profession d’enseignant est également contrôlée : elle autorise, en effet, une flexibilité temporelle réputée favorable à l’articulation travail – famille et mobilisée en ce sens principalement par les femmes (Jarty, 2009). Au total, trois groupes de professions sont distingués : les directeurs et cadres de direction, les enseignants et enfin le reste des professions intellectuelles et scientifiques.
112Dans un certain nombre de professions, les conditions d’exercice du métier, en tant qu’indépendant ou en tant que salarié, peuvent influencer fortement la nature des arrangements temporels de travail. Dans certaines professions, le salariat est présenté comme un « choix de vie » féminin permettant de rester disponible pour la gestion des charges domestiques et familiales (Lapeyre et Le Feuvre, 2004). Bien que souvent considéré comme générateur de conflit travail-famille, l’exercice en tant qu’indépendant reste parfois associé à une stratégie pour mieux gérer des exigences conflictuelles entre le travail et la famille (Crompton et Le Feuvre, 1997, Sevä et Öun, 2015). Enfin, le secteur d’activité et la taille de l’entreprise sont également contrôlés.
Le premier modèle estimé (tableau 10) n’intègre que des caractéristiques individuelles : le fait d’être un homme ou une femme, avec ou sans enfant présent, ainsi que l’âge et le diplôme. Les variables de contrôle relatives aux emplois occupés sont introduites dans un deuxième temps pour examiner leur effet sur la principale variable d’intérêt, à savoir les quatre situations (femme sans enfant, femme avec enfant(s), homme sans enfant, homme avec enfant(s)). Enfin, dans un troisième temps sont introduites les variables liées à l’entreprise et à son secteur d’activité.
Ce premier modèle fait apparaître une relative convergence entre les trois pays : les hommes avec enfant(s) sont significativement plus sur-disponibles temporellement que les femmes, avec ou sans enfant(s). Le modèle du « travailleur idéal », masculin et soutien de famille, résiste ainsi à la diversité des régimes de genre envisagés. Toutefois, au-delà de ce point commun, quelques nuances s’imposent, qui s’avèrent cohérentes avec les particularités nationales.
Dans le cas du Royaume-Uni, la probabilité d’être sur-disponible relativement à la probabilité de ne pas l’être est sensiblement plus faible pour les femmes avec enfant(s) que pour les femmes sans enfant lorsqu’elles sont comparées aux hommes avec enfant(s). Le rapport de chances est ainsi réduit de 70 % pour les femmes avec enfant(s) contre 47 % pour les femmes sans enfant (tableau 10), ce qui va dans le sens du maternalisme du régime de genre britannique. Par contre, en France et en Suède, les probabilités d’être sur-disponible relativement à la probabilité de ne pas l’être sont proches pour les femmes avec ou sans enfant, lorsqu’elles sont comparées aux hommes avec enfant(s) : les rapports de 113chances sont réduits d’environ 45 % dans le cas de la France et d’environ 60 % pour la Suède (tableau 10).
En Suède, les hommes sans enfant sont significativement moins sur-disponibles temporellement que les hommes avec enfant(s) alors que ce n’est pas le cas dans les deux autres pays. Ce résultat suggère l’existence d’un surinvestissement temporel dans le travail spécifique aux hommes hautement qualifiés avec enfant(s) : les non pères et les femmes auraient des comportements d’investissement temporel au travail qui ne se distinguent pas significativement. Une interprétation possible est que l’égalitarisme du régime de genre suédois permettrait aux femmes avec enfant(s) de travailler dans des conditions relativement comparables aux personnes sans enfant présent, homme ou femme, mais n’agirait pas avec la même intensité sur la sur-disponibilité temporelle des hommes avec enfant(s).
Enfin, pour la France, le résultat est statistiquement peu robuste : la significativité du coefficient estimé est faible et le test du rapport de vraisemblance, qui évalue la significativité globale des variables de contrôle introduite dans cette première étape est non significatif, contrairement aux deux autres pays. Cela pourrait s’interpréter comme le signe d’une plus grande proximité du régime de genre de la France avec le modèle du travailleur universel.
La qualité de la mesure de la parentalité, restreinte dans l’enquête à la présence d’enfants dans le ménage, limite sans doute les résultats car parmi les individus sans enfant se trouvent sans doute des pères et des mères. Par contre, cela ne remet pas en cause l’interprétation du coefficient associé aux hommes avec enfant(s) présents. Enfin, l’âge n’est significatif dans aucun des trois pays contrairement au fait d’être au moins diplômé de master qui joue positivement sauf en France, ce qui s’explique probablement par le fait que les diplômés de master y sont bien plus fréquents qu’en Suède et au Royaume-Uni.
114Tab. 10 – Modèles logits de la probabilité d’être sur-disponible professionnellement.
|
Royaume-Uni N=544 |
France N=348 |
Suède N=355 |
|||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
Constante |
-1,702*** (0,55) |
-1,947*** (0,58) |
-3,073*** (0,72) |
-0,391 (0,61) |
-0,441 (0,65) |
-0,828 (0,85) |
-0,873 (0,68) |
-1,682** (0,76) |
-2,594*** (0,91) |
|
Femme sans enfant |
-0,630** (0,32) OR=0,53 |
-0,600* (0,33) OR=0,55 |
-0,396 (0,34) |
-0,624* (0,37) OR=0,54 |
60,430 (0,38) |
-0,278 (0,43) |
-0,992*** (0,37) OR=0,37 |
-0,778* (0,41) OR=0,46 |
-0,574 (0,42) |
|
Femme avec enfant(s) |
-1,187*** (0,38) OR=0,30 |
-0,906** (0,39) OR=0,40 |
-0,700 * (0,41) OR=0,50 |
-0,599 * (0,32) OR=0,55 |
-0,610 (0,33) |
-0,478 (0,37) |
-0,891** (0,38) OR=0,41 |
-0,683* (0,41) OR=0,50 |
-0,484 (0,43) |
|
Homme sans enfant |
-0,267 (0,29) |
-0,276 (0,31) |
-0,198 (0,32) |
-0,081 (0,33) |
-0,08 (0,35) |
-0,087 (0,37) |
-0,800** (0,40) OR=0,44 |
-0,659 (0,43) |
-0,527 (0,44) |
|
Homme avec enfant(s) |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
|
Age |
0,115 (0,11) |
0,002 (0,01) |
0,007 (0,01) |
-0,006 (0,01) |
-0,018 (0,01) |
-0,016 (0,01) |
0,000 (0,02) |
-0,003 (0,01) |
-0,004 (0,1) |
|
Bac + 5 et plus inférieur à Bac+5 |
0,480* (0,25) réf |
0,662** (0,27) réf |
0,679** (0,28) réf |
0,014 (0,25) réf |
0,175 (0,28) réf |
0,428 (0,31) réf |
0,564* (0,29) réf |
0,873*** (0,32) réf |
0,881*** (0,32) réf |
|
Indépendant Salarié |
0,794*** (0,29) réf |
0,753** (0,33) réf |
1,233*** (0,34) réf |
1,415*** (0,40) réf |
-0,630 (0,68) réf |
-0,313 (0,72) réf |
|||
| 115
Directeur et cadre de direction |
0,757*** (0,27) |
0,723** (0,28) |
0,842 (0,29) |
0,072 (0,33) |
1,715*** (0,40) |
1,648*** (0,41) |
|||
|
Enseignant |
-0,159 (0,39) |
0,512 (0,48) |
-2,234*** (0,57) |
-2,091*** (0,62) |
0,761** (0,37) |
1,212*** (0,46) |
|||
|
Autres professions intellectuelles et scientifiques |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
réf |
|||
|
Responsabilité hiérarchique 10 personnes et plus Moins de 10 |
0,646** (0,32) réf |
0,677** (0,33) réf |
1,143*** (0,39) réf |
1,104*** (0,40) réf |
0,874* (0,48) réf |
0,871* (0,49) réf |
|||
|
Entreprise de 250 salariés et plus Moins de 250 |
0,252 (0,28) réf |
0,359 (0,34) réf |
0,782** (0,34) réf |
||||||
|
Services |
1,006*** (0,38) |
0,259 (0,37) |
0,552 (0,53) |
||||||
|
Industrie |
0,656 (0,44) |
0,318 (0,50) |
0,389 (0,53) |
||||||
|
Santé, éducation, administration publique |
réf |
réf |
réf |
||||||
|
Test du rapport de vraisemblance |
*** |
*** |
*** |
ns |
*** |
*** |
** |
*** |
*** |
|
-2Log L |
476,6 |
452 |
443,2 |
389,8 |
322 |
320,2 |
314,5 |
282,7 |
276,4 |
Note : seuils de significativité : *p<0,10 ; **p<0,05 ; ***p<0,0
116Dans le second modèle estimé, où sont introduites les professions, le fait d’avoir une responsabilité hiérarchique importante est significativement et positivement corrélé à la sur-disponibilité professionnelle dans les trois pays. Par contre, les fonctions de directeur et cadre de direction accroissent la sur-disponibilité au Royaume-Uni et en Suède alors que ce n’est pas le cas en France. Du fait de ses traditions organisationnelles (Wolff, 2015), le lien entre l’encadrement et ce groupe professionnel y demeure plus prégnant5 que dans les deux autres pays.
Le fait d’être enseignant n’est pas corrélé à la sur-disponibilité professionnelle au Royaume-Uni, négativement corrélé en France et positivement corrélé en Suède. La Suède et le Royaume-Uni ont réformé leur système éducatif en laissant davantage d’autonomie aux établissements scolaires, et en ne mentionnant pas le nombre d’heures d’enseignement dans le contrat de travail (Lefresne et Rakocevic, 2016) alors que la France conserve une gestion plus traditionnelle des établissements scolaires, et sans doute, du temps et des horaires de travail.
Enfin, les indépendants, principalement des professions libérales et des chefs d’entreprise compte tenu du niveau de qualification, sont surreprésentés parmi les travailleurs sur-disponibles professionnellement en France et au Royaume-Uni. Cet effet ne se retrouve pas en Suède, sans doute parce que la proportion d’indépendants parmi les professions hautement qualifiées y est beaucoup plus faible (8 % au lieu de 18 % dans l’échantillon). En France, les variables de contrôle des professions (modèle 2) rendent non-significatif les coefficients associés aux femmes, sans et avec enfant(s). Les différences observées relèvent principalement de l’orientation des femmes vers la profession d’enseignant, inversement corrélée avec la sur-disponibilité temporelle, et de leur non orientation vers les professions libérales, l’accès aux responsabilités semblant avoir un rôle un peu plus réduit6. Au Royaume-Uni et en Suède, l’introduction des variables de professions réduit l’écart de risque d’être sur-disponible temporellement entre les femmes, particulièrement celles qui ont des 117enfants, et les hommes avec enfant(s), ainsi que la significativité des coefficients. La plus faible sur-disponibilité temporelle des femmes s’explique en partie par leur accès moins fréquent que les hommes avec enfant(s) à des fonctions de direction, à des responsabilités hiérarchiques importantes dans ces deux pays, et au non salariat au Royaume-Uni seulement.
Les contrôles supplémentaires du modèle 3 liés à l’entreprise et à son activité montrent que les emplois occupés par les travailleurs sur-disponibles se trouvent plus souvent dans les services au Royaume-Uni. Il reste toutefois une partie de la sous-représentation des femmes avec enfant(s) qui n’est pas expliquée par les variables utilisées, bien que celle-ci soit à présent faiblement significative. En Suède, ces mêmes contrôles révèlent une sous-représentation des femmes dans les entreprises de grande taille, facteur évocateur de l’existence d’un plafond de verre. L’hypothèse de départ de l’égalitarisme du régime de genre suédois est quelque peu bousculée : les hommes avec enfant(s) ont un comportement temporel significativement différent de celui des autres catégories.
Pour tester la robustesse des résultats à l’égard de la définition de la sur-disponibilité temporelle, des estimations complémentaires ont été réalisées en utilisant des définitions soit plus restrictives soit moins restrictives. La durée du travail retenue peut être 41h et plus, 45h et plus ou 50h et plus. Le débordement très fréquent (tous les jours ou plusieurs fois par semaine) est un phénomène rare, écarté à ce titre. A été testée une fréquence un peu plus forte que le choix final en retenant « tous les jours, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois » vs « souvent ou jamais ». Le choix des horaires peut être élargi en éliminant uniquement ceux dont les horaires sont choisis par l’employeur. Par exemple, avec une définition plus restrictive (50h et plus, débordement très fréquent, grande autonomie temporelle), la sur-disponibilité temporelle ne concerne que 7 % des travailleurs hautement qualifiés en France et au Royaume-Uni, 5,6 % en Suède. Avec une définition plus large (41h et plus, débordement fréquent ou occasionnel, autonomie temporelle au moins partielle), elle concerne 30 % des travailleurs en France, 27,8 % en Suède et 21,1 au Royaume-Uni. Toutes les estimations basées sur une définition plus restrictive de la sur-disponibilité temporelle conduisent à des coefficients non significatifs dans le cas de France mais conservent les coefficients à 118l’identique dans le cas du Royaume-Uni et de la Suède. Les estimations basées sur des définitions un peu plus larges donnent globalement des coefficients identiques à ceux présentés ici pour les trois pays.
La réplication de l’estimation en faisant varier la catégorie de référence permet de procéder à des comparaisons plus systématiques distinguant le rôle de la présence d’enfant pour un genre donné et le rôle du genre selon la présence d’enfant. Ainsi, on n’observe pas de différence significative entre les femmes avec ou sans enfant, les hommes avec ou sans enfant (sauf dans le cas de la Suède), les femmes et les hommes sans enfant. La seule comparaison par paire qui fait apparaître une différence significative concerne les femmes et les hommes avec enfant : l’écart significatif entre les probabilités d’être sur-disponible temporellement parmi les hommes et les femmes en présence d’enfant est le résultat le plus marquant des estimations réalisées7.
Il s’opère donc une forme de ségrégation professionnelle des pères dans des emplois exigeants temporellement plus ou moins marquée selon les pays. Il pourrait s’agir de comportements d’hyper-spécialisation parmi les pères, qu’on ne peut identifier dans notre échantillon, en raison d’une hypergamie plus fréquente parmi les hommes hautement qualifiés que parmi les femmes très qualifiées, qui dissimulerait une spécialisation plus forte que dans les couples homogames. L’hypergamie peut également donner naissance à une plus grande insatisfaction financière lorsque la famille s’agrandit et donc la recherche d’emplois plus exigeants et plus rémunérateurs que dans des couples homogames. L’enquête ne permet pas de développer des investigations sur les conjoints alors qu’il serait intéressant d’en savoir plus sur leurs temps de travail ou leurs professions. Enfin, les employeurs pourraient opérer une discrimination favorable aux hommes avec enfant(s) perçus comme plus impliqués et plus stables compte tenu de leurs responsabilités familiales et auxquels ils attribueraient des emplois à la fois plus rémunérateurs (De Linde Leonard et Stanley, 2015) mais aussi plus demandeurs temporellement. La persistance de cultures d’entreprises favorisant les pères dans l’accès aux postes à responsabilité pourrait y contribuer.
119Conclusion
Il est tentant d’en conclure que les régimes de genre auraient moins d’influence sur les comportements des pères que sur celui des mères dans la mesure où un certain nombre d’entre eux continuerait d’adopter un comportement de sur-investissement temporel au travail. Au Royaume-Uni, la sur-disponibilité professionnelle demeure un modèle masculin au sein duquel les hommes, et plus encore les hommes avec enfant(s), sont sur-représentés. Les représentations stéréotypées des rôles de genre y compris parmi les travailleurs hautement qualifiés, les faiblesses des infrastructures de garde d’enfants, la flexibilité laissée aux employeurs en matière de temps et d’horaires de travail ne permettent pas aux femmes, particulièrement celles qui ont des enfants, de suivre ce modèle tout en incitant les hommes à s’y conformer.
En Suède, les mères hautement qualifiées parviendraient à travailler dans des conditions assez proches de celles des hommes et des femmes sans enfant. Mais la spécificité du régime suédois, fondée sur la prise en charge d’une partie du travail du care par les parents, serait un frein pour assurer une disponibilité temporelle au travail suffisante dans les professions temporellement exigeantes. Le maintien des pères dans ces professions est favorisé alors par une ségrégation professionnelle et sectorielle plus marquée que dans d’autres pays, qui contribue probablement à faire perdurer le modèle de la sur-disponibilité temporelle.
Enfin, pour la France, les différences de comportement s’expliquent par des phénomènes de ségrégation principalement professionnelle, mais semblent statistiquement plus fragiles. Cette fragilité provient-elle des données ou exprime-t-elle le rapprochement du régime de genre avec le modèle du travailleur universel, qui devait permettre une convergence des comportements de sur-disponibilité professionnelle entre hommes et femmes hautement qualifiés ? La sur-disponibilité temporelle y est plus fréquente, ce qui pourrait réduire les opportunités de travailler autrement pour les moins disposés à suivre ce modèle.
L’exploration des effets de ce régime temporel sur les carrières féminines et masculines dans les professions hautement qualifiées serait un prolongement nécessaire de ce travail. En effet, la corrélation forte 120entre la sur-disponibilité temporelle et certaines professions suggère des évolutions de carrière différenciées par le temps de travail. À ce titre, la relation entre la rémunération et la sur-disponibilité professionnelle mériterait également d’être approfondie.
121Bibliographie
Acker J., 1990, “Hierarchies, Jobs, Bodies : A Theory of Gendered Organizations”, Gender and Society, 4, p. 139-158.
Alakeson V., 2012, “The price of motherhood : women and part-time work”, Briefing, Resolution Fondation, 12 p.
Allard K., Haas L., Hwang C. P., 2011, “Family-supportive organizational culture and fathers : experiences of work–family conflict in Sweden.” Gender, Work & Organization, 18(2), p. 141-157.
Anxo D., Ericson T., Miao C., 2019, “Impact of late and prolonged working life on subjective health : the Swedish experience”, The European Journal of Health Economics, 20(3), p. 389-405.
Anxo D., Boulin J. Y., Cabrita J., Vermeylen G., 2017, Working time patterns for sustainable work, Rapport de recherche, Université Paris-Dauphine, 88 p.
Berg P., Bosch G., Charest J., 2014, “Working-time configurations : A framework for analyzing diversity across countries”, ILR Review, 67(3), p. 805-837.
Bertrand M., Goldin C., Katz L.F.,2010, “Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors”, American Economic Journal : Applied Economics, vol. 2, no 3, july, p. 28-55.
Bigi M., 2019, « Les heures et les jours. Les normes genrées de la disponibilité temporelle des ingénieurs en France et en Finlande », Socio-économie du travail, 2, no 6, p. 155-185.
Boni-Le Goff I., 2017, « Le privé est professionnel ? Les consultant·e·s en couple avec enfant », La nouvelle revue du travail, no 11.
Bouffartigue P., 2012, « La disponibilité temporelle au travail : nouvelles formes, nouveaux enjeux », Colloques du CRES (Faculté des sciences sociales – Université de Strasbourg) Temps de travail et travail des temps, Strasbourg, 11 et 12 octobre.
Bouffartigue P., Bocchino M., 1998, « Travailler sans compter son temps ? Les cadres et le temps de travail », Travail et Emploi, no 74, p. 37-50.
Boussard V., 2016, « Celles qui survivent : dispositions improbables des dirigeantes dans la finance », Travail, Genre et Sociétés, no 35, p. 47-65.
Burger A.S., 2018, The Political Economy of Extreme Work Hours in Western democracies, PhD dissertation, Central European University.
Burke R.J., Fiksenbaum L., 2009, “Are managerial women in “extreme jobs” disadvantaged ?”, Gender in Management, Vol. 24, No. 1, p. 5-13.
122Castro-García C., Pazos-Moran M., 2016, “Parental Leave Policy and Gender Equality in Europe”, Feminist Economics, vol. 22, no 3, p. 51–73.
Chung H., Tijdens K., 2013, “Working time flexibility components and working time regimes in Europe : using company-level data across 21 countries”, The International Journal of Human Resource Management, 24(7), p. 1418-1434.
Crompton R., (ed), 1999, Restructuring Gender Relations and Employment : The Decline of the Male Breadwinner, Oxford University Press, 241 pages.
Crompton R., Le Feuvre, N., 1997, « Choisir une carrière, faire carrière : les femmes médecins en France et en Grande-Bretagne »in Cahiers du GEDISST (Groupe d’étude sur la division sociale et sexuelle du travail) no 19, Travail, espaces et professions, p. 49-75.
De Linde Lenoard, M., Stanley T.D., 2015, “Married with children : What remains when observable biases are removed from the reported male marriage wage premium”, Labor Economics, Vol. 33, p. 72-80.
Devlin C., Shirvani A., 2014, “The impact of the working time regulation on the UK labour market : a review of evidence”, BIS analysis paper no 5.
Drago R. W., Black D., Wooden M., 2005, “The existence and persistence of long work hours”, IZA discussion paper no 1720, 38 p.
Eurofound 2016, “Working time developments in the 21st century : Work duration and its regulation in the EU”, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Evertsson M., Boye K., 2018, “The transition to parenthood and the division of parental leave in different-sex and female same-sex couples in Sweden”. European Sociological Review, 34(5), p. 471-485.
Fagan C., 2009, “Working time in the UK–developments and debates”. The Japanese Institute for Policy and Training, p. 37-53.
Figart D. M., Mutari E., 2000, “Work time regimes in Europe : Can flexibility and gender equity coexist ?” Journal of Economic Issues, vol 34, no 4, p. 847-871.
Fleckenstein T., Seeleib-Kaiser M., 2011, “Business, skills and the welfare state : the political economy of employment-oriented family policy in Britain and Germany.” Journal of European social policy, 21(2), p. 136-149.
Ford J., and Collinson D., 2011, “In Search of the Perfect Manager ? Work-Life Balance and Managerial Work.” Work, Employment and Society, vol. 25, no 2, p. 257–273.
Fraser N., 1994 “After the Family Wage : Gender Equity and the Welfare State”, Political Theory 22, no 4, p. 591-618.
Gallie D., Russell H., 2009, “Work-Family Conflict and Working Conditions in Western Europe.” Social Indicators Research, vol. 93, no. 3, p. 445–467.
Gascoigne C., Parry E., Buchanan D., 2015, “Extreme work, gendered work ? 123How extreme jobs and the discours of “personal choice’ perpetuate gender inequality” Organization, vol 22, no 4, July, p. 457-475.
Génin É., 2009, « L’empiétement du travail des femmes et des hommes cadres sur leur vie personnelle », Gestion, vol. 34, no 3, p. 128-135.
Génin É., 2017, « Le débordement du travail sur le temps personnel des cadres français » Relations Industrielles / Industrial Relations, 72(4), p. 658-681.
Guillaume C., Pochic S., 2009, “What would you sacrifice ? Access to top management and the work–life balance”, Gender, Work & Organization, 16(1), p. 14-36.
Goussard L., Tiffon G., 2016, « Quand le travail déborde… » Travail et emploi, (3), p. 27-52.
Haas L., Hwang C. P., 2016, “It’s About Time ! : Company Support for Fathers’ Entitlement to Reduced Work Hours in Sweden”, Social Politics : International Studies in Gender, State & Society, 23(1), p. 142-167.
Jarty J., 2009, « Les usages de la flexibilité temporelle chez les enseignantes du secondaire », Temporalités, no 9.
Kaufman G., 2018, “Barriers to equality : why British fathers do not use parental leave”, Community, Work & Family, 21(3), p. 310–325.
Kelliher C., Anderson D., 2010, “Doing more with less ? Flexible working practices and the intensification of work”, Human relations, 63(1), p. 83-106.
Korpi W., Ferrarini T., Englund S., 2013, “Women’s opportunities under different family policy constellations : Gender, class, and inequality trade-offs in western countries re-examined.” Social Politics : International Studies in Gender, State & Society, 20(1), p. 1-40.
Lapeyre N., Le Feuvre N., 2004, « Concilier l’inconciliable ? Le rapport des femmes à la notion de “conciliation travail-famille” dans les professions libérales en France » Nouvelles Questions Féministes, Vol 23 no 3, p. 42-58.
Laufer J., 2005, « La construction du plafond de verre : le cas des femmes cadres à potentiel », Travail et Emploi, no 102, Avril-Juin, p. 31-44.
Lefresne F., Rakocevic R., 2016, « Le métier d’enseignant en Angleterre, aux Pays-Bas et en Suède : les voies sinueuses d’une professionnalisation », Éducation et Formations, MESR, DEP.
Letablier M.T., 2009, « Régimes d’État-Providence et conventions de genre en Europe », Informations sociales, no 151, p. 102-109.
Létroublon C., 2015, « Les salariés au forfait annuel jours », Dares Analyses, juillet no 48.
Lewis J., 1992, « Gender and the development of welfare regimes », Journal of European Social Policy, no 2, p. 159-173.
Lewis J., 1997, “Gender and welfare regimes : further thoughts”, Social Politics : International Studies in Gender, State & Society, 4(2), p. 160-177.
124Lott Y., Chung H., 2016, “Gender Discrepancies in the Outcomes of Schedule Control on Overtime Hours and Income in Germany”, European Sociological Review, p. 1–14.
Ma L., Andersson G., Duvander A., Evertsson M., 2020, “Fathers’ Uptake of Parental Leave : Forerunners and Laggards in Sweden, 1993–2010”, Journal of Social Policy, 49(2), p. 361-381.
Mercure D., 2013, « Le nouveau modèle de pouvoir et de domination au travail dans le mode de production postfordiste », SociologieS.
Meriläinen S., Tienari J., Thomas R., Davies A., 2004, “Management Consultant Talk : A Cross-Cultural Comparison of Normalizing Discourse and Resistance”, Organization, Vol 11 no 4, p. 539-564.
Nätti J., Anttila T., Väisanen M., 2006, “Managers and working time in Finland”, in J.-Y. Boulin, M. Lallement, J. C. Messenger and F. Michon (eds.), Decent Work, new trends, new issues, ILO publications.
Ordioni N., 2013, « La politique familiale à l’épreuve des stéréotypes de genre : une comparaison France, Royaume-Uni, Suède », Observatoire de la société britannique, (14), p. 119-140.
Ortega J., 2009, “Why do employers give discretion ? Family versus performance concerns”, Industrial Relations : A Journal of Economy and Society, 48(1), p. 1-26.
Pailhé A., Solaz A., 2009, « Les ajustements professionnels des couples autour des naissances : une affaire de femmes ? », in Entre famille et travail (p. 167-186), La Découverte.
Pascall G., Lewis J., 2004, “Emerging gender regimes and policies for gender equality in a wider Europe”, Journal of social policy, 33(3), p. 373-394.
Peterson H., 2007, “Gendered Work Ideals in Swedish IT Firms : Valued and Not Valued Workers”, Gender Work and Organization 14(4), p. 333-348.
Pichon A., 2009, « Cadres, managers et professionnels : crise d’identité, crise existentielle et perspectives éthiques », Éthique publique, 11 (2), p. 7-19.
Rubery J., Smith M., Fagan C., 1998, « National Working-Time Regimes and Equal Opportunities », Feminist Economics, vol. 4, no 1, p. 71-101.
Sang K., Powell A., Finkel R., Richards J., 2015, “‘Being an academic is not a 9–5 job’ : long working hours and the “ideal worker” in UK academia”, Labour & Industry : a journal of the social and economic relations of work, 25:3, p. 235-249.
Sevä I., Öun I., 2015, “Self-employment as a strategy for dealing with the competing demands of work and family ? The importance of family/lifestyle motives”, Gender, Work & Organization, 22(3), p. 256-272.
Silvera R., 2010, « Temps professionnels et familiaux en Europe : de nouvelles configurations », Travail, Genre et Sociétés, no 24, p. 63-88.
125Tengblad S., Vie E., 2011, “The legacy of research in management in practice : Overview of classic studies on managerial work”, in 27th EGOS Colloquium July, 7-9, Gothenburg, Sweden.
Thévenon O., 2016, « L’accueil de la petite enfance en France et dans les pays de l’OCDE : une politique d’investissement social ? », Revue française des affaires sociales, p. 163-188.
Thoemmes J., 2012, « La mesure des temps des cadres : une solution pour sortir des difficultés professionnelles ? », Temporalités, 16, p. 1-20.
Villaume S., Virot, P., 2016, « Travail à temps complet et jeunes enfants : comment font les couples pour tout concilier ? », Études et résultats, Drees, no 981.
Vögt M., Van Gyes G., Rousselot M., Taulu H., Lyly-Yrjänäinen M., 2009, Les cadres en Europe et leurs syndicats au 21e siècle, Eurocadres.
Wolff L., 2015, « Les différents visages de l’encadrement en Europe », Rapport de recherche du Centre d’Études de l’Emploi, No.98.
Wren A., 2013, The Political Economy of the Service Transition, Oxford University Press.
1 Ce travail s’inscrit dans l’ANR WOMAN(WOman in MANagement. Quel genre de managers avant 40 ans ? Faits et discours dans quatre pays européens, ANR-16-CE26-0010) coordonnée par Vanessa di Paola (Lest).
2 Souligné par les auteures.
3 Le 9e décile correspond à 50 h en France et en Suède et à 55 h au Royaume-Uni. De plus, prendre ce seuil réduirait fortement la taille des échantillons.
4 Dans le Labour Force Survey 2019, la proportion d’horaires fixés par l’employeur ou l’organisation parmi les professions qualifiées corrobore ces chiffres : 39 % au Royaume-Uni, 17 % en Suède et 27,5 % en France.
5 Pour la France, la variable « directeur et cadres de direction » n’est significative que si on ne lui adjoint pas l’indicatrice d’un niveau de responsabilité hiérarchique important contrairement aux deux autres pays.
6 La sous-représentation des femmes est peu robuste et cède dès qu’on introduit la profession d’enseignant ou le fait d’être indépendant dans l’estimation. On peut noter que l’accès aux fonctions de direction ne supprime la significativité du coefficient associé aux femmes avec enfant(s).
7 Ce résultat peut sembler paradoxal, il s’explique toutefois si l’on fait l’hypothèse que la fréquence de la sur-disponibilité temporelle décroît lorsqu’on passe des hommes avec enfant aux hommes sans enfant puis aux femmes sans enfant et enfin aux femmes avec enfant. Les écarts entre les catégories les plus proches ne seraient pas détectables statistiquement dans ce travail mais celui entre les deux catégories les plus éloignées le serait.