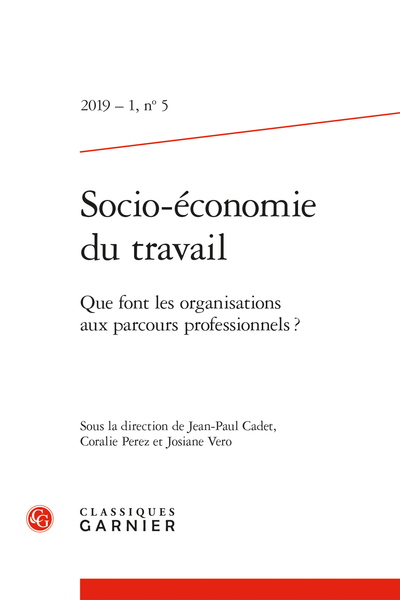
La transmission du savoir-faire de prudence sous tension Regard critique sur la professionnalisation dans les industries chimiques
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Socio-économie du travail
2019 – 1, n° 5. Que font les organisations aux parcours professionnels ? - Auteur : Sechaud (Fred)
- Résumé : L’article explore le processus qui concourt à élaborer un savoir-faire de prudence ayant pour objet la santé et la sécurité. À partir d’entretiens avec des ouvriers et des techniciens de deux ateliers de fabrication chimique, l’auteur analyse comment se transmettent les règles de métier et les compétences intégrant ce savoir-faire. Cette transmission est facilitée ou empêchée par des facteurs organisationnels. Il conclut en montrant la dimension conflictuelle du processus de professionnalisation.
- Pages : 67 à 97
- Revue : Socio-économie du travail
- Thème CLIL : 3319 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités -- Travail, emploi et politiques sociales
- EAN : 9782406095972
- ISBN : 978-2-406-09597-2
- ISSN : 2555-039X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09597-2.p.0067
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 09/10/2019
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Industries chimiques, professionnalisation, savoir-faire de prudence, transmission professionnelle
La transmission du savoir-faire
de prudence sous tension
Regard critique sur la professionnalisation
dans les industries chimiques
Fred Séchaud
Centre d’études et de recherches
sur les qualifications (Céreq)
Introduction
Le savoir-faire de prudence caractérise les professionnalités ouvrières et techniciennes de la fabrication, notamment en chimie, mais sa transmission rencontre des obstacles organisationnels et elle est l’objet de conflits au travail. Des remarques lexicologiques de Bourdoncle et Mathey-Pierre (1995) sur cette notion de professionnalité, son flou relatif et ses ambiguïtés, je retiens l’idée que la professionnalité est reliée au métier et qu’elle permet de subsumer les compétences, ou « savoirs en acte, réels et réalisés [des travailleurs] sans interférence avec une grille de classification et un salaire, et parce que liée au local, au moment, à la situation, elle peut être dénoncée » (Trépos, 1992, p. 71). Processus par lequel se construit et se reconnait la professionnalité, la professionnalisation est entendue comme la « fabrication par la formation, l’organisation et l’expérience d’un membre s’intégrant à un collectif de travail et devenant reconnu par tous ses partenaires. » (Dubar, Tripier, Boussard, 2011, p. 317). D’après des observations récentes auprès de métiers exposés aux risques dans ces industries (Séchaud et al., 2017a,b), la professionnalisation dans les emplois de la production permet d’élaborer un savoir-faire de prudence 68qui a pour objet la santé et la sécurité (Cru, 2015). Certaines questions intéressent alors autant la sociologie du travail que la sociologie de la sécurité (Dupré, 2014) : dans quelles conditions ce savoir-faire est-il transmis ? Des conditions sont-elles plus propices que d’autres à cette transmission et à sa reconnaissance comme professionnalité ? Comment alors appréhender la professionnalisation au prisme de la transmission du savoir-faire de prudence, dont la reconnaissance par les travailleurs et leur hiérarchie devrait constituer un enjeu fondamental de prévention des risques ? Répondre à ces questions conduira à analyser des configurations de la professionnalisation au travail dans les ateliers de deux usines chimiques. Il s’agira d’observer que cette reconnaissance se rapporte non seulement à la préservation d’une fonction de vigilance, dont le développement a caractérisé les professionnalités ouvrières et techniciennes depuis l’essor de l’automatisation (Mouy, 1988), mais aussi qu’elle concourt à la professionnalisation1.
Après avoir situé ces questions dans la problématique de l’évolution des professionnalités tenant compte de l’existence d’un savoir-faire de prudence et de sa transmission (1) puis présenté ces usines (2), je montrerai, à partir du récit qu’en font les différents protagonistes au sein de deux ateliers de fabrication, comment les activités par lesquelles se transmettent les règles de métier et les compétences professionnelles intégrant ce savoir-faire de prudence se trouvent facilitées ou empêchées par des facteurs organisationnels (3). Les réponses à nos questions, pourront alors être établies et discutées dans les limites de leur contextualisation empirique (4).
69I. Professionnalisation et transmission
d’un savoir de prévention
I.1. Professionnalités, professionnalisation
et transmission : de quoi parle-t-on ?
Comme y incite la sociologie des professions en se saisissant du terme de professionnalisation (Dubar et al., 2011 ; Demazière, 2009), cet article contribue à montrer que les espaces de travail forment l’arène d’un processus dialogique et intensément interactif au sujet de ce que doit être le travail, de la manière de le réaliser ou encore d’apprendre les ficelles du métier, entre les acteurs en présence. On tient pour acquis que la professionnalisation, dans l’acquisition d’une autonomie professionnelle, c’est-à-dire dans l’élaboration de règles définissant son travail et dont Demazière souligne que l’assise est collective, n’est en rien linéaire et instituée. Elle se construit en tension par rapport aux contraintes productives, car les salariés doivent surmonter un « enchevêtrement de temporalités hétérogènes » et de « normativités contradictoires » (Demazière et al. 2012) pour inventer et stabiliser les règles de métier. Dubar (2003, p. 243) a précisé que l’on pouvait entendre par « temporalités hétérogènes » à la fois des « points de vue sur le temps » et des « formes et manifestations de la diachronie ». Cette perspective s’appuie sur des descriptions qui se fondent sur une acception culturelle et identitaire de la professionnalisation qui « s’applique alors à l’activité de travail, à ses conditions de déroulement et à sa réalisation » et pour laquelle « progresser dans son travail, c’est se professionnaliser » (Demazière, 2009, p. 88). Elle permet donc aussi au plan empirique d’identifier les trames temporelles et les trames normées des processus de professionnalisation à l’échelle d’un espace productif donné.
Ce cadre théorique appréhende les professionnalités en situant, d’une part, la socialisation des travailleurs dans le cadre social de leur métier et d’autre part, les processus d’acquisition et de reconnaissance des compétences professionnelles dans cet espace productif. La notion de professionnalité a de longue date été en usage dans les études sur les métiers des industries chimiques et le sujet de la professionnalisation a aussi été nourri par de nombreuses études relatives à la formation 70et à la gestion de main d’œuvre dans les industries chimiques. Pour résumer, cette problématique interrogeait différents aspects des relations formation – emploi dans le contexte de la recomposition, voire de l’éclatement, de l’appareil productif dont le nombre d’établissements s’est constamment réduit au cours des trente dernières années (FNIC, 2013 ; OPIC, 2012). La tendance aux réductions d’effectifs, notamment en fabrication, est allée de pair avec un raccourcissement des lignes hiérarchiques qui a limité, dès lors, sensiblement les possibilités de carrière. Dans ce contexte, les instruments de gestion de l’emploi, notamment les systèmes de classification, se sont avérés de plus en plus déphasés. Des critères de recrutement qui privilégient l’embauche de jeunes diplômés en formation initiale pour chaque niveau d’emploi n’ont fait qu’accentuer le grippage des systèmes de promotion et de carrière. De nouvelles formes de mobilité, qui prendraient en compte le degré d’expertise technique et professionnelle acquis par les salariés dans le cadre de leur expérience, seraient donc à inventer (Campinos-Dubernet, Marquette, 1993). Mais avec la disjonction des espaces de qualification et de certification, les modalités internes d’acquisition de qualification apparaissent de plus en plus inopérantes. Dans ce cadre, la formation professionnelle continue a joué un rôle de « sélection positive » dans les carrières au détriment de l’ancienneté car elle valorise à la fois le diplôme des jeunes, l’expérience professionnelle et les compétences repérées indépendamment d’elle (Perisse, 1998). Avec l’analyse compréhensive du cas d’une usine de la chimie à hauts risques, Merle (2012) a démontré les limites des approches « décontextualisées » des compétences en exposant trois changements qui traduisent l’usage d’une conception des compétences émergentes et contingentes (Eymard-Duvernay et Marchal, 2000). Primo, les « pairs » des futurs embauchés deviennent les recruteurs ; secundo, des critères de recrutement « maison » (tri des CV et tests réalisés par un chef de quart) remplacent les critères « génériques » (diplômes et tests psychotechniques) appliqués par les services Ressources Humaines ; tertio, l’évaluation des candidats repose sur une logique de formation et non de sélection, en modifiant le temps de formation ou le champ de compétences évaluées. Merle constate que ces changements, in fine, ont permis de réduire un taux élevé de turn-over. Les enseignements extraits de cette étude de cas par Merle (op. cit.) nourrissent l’idée d’une construction située des professionnalités. Bien que leur objectif ne soit pas là, ils montrent aussi 71l’importance de la transmission en situation de travail qui participe à la professionnalisation et à l’intégration des « nouveaux » embauchés.
Le sociologue qui veut interroger plus précisément la professionnalisation en actes bénéficie des apports essentiels de l’ergonome Jeanne Thébault (2013, 2018) sur la transmission professionnelle, à partir de ses travaux en milieu hospitalier. Cette « circulation souple des savoirs professionnels » se structure, selon elle, autour de trois composantes principales : d’abord, la conciliation entre production et transmission, par des modalités adéquates de régulation individuelle et collective ; ensuite, la co-construction de relations au sein de binômes ; et enfin, l’élaboration/énonciation des contenus par la combinaison de différents savoirs. Pour comprendre comment se construisent les professionnalités, il convient d’autant plus d’interroger ou d’observer la transmission professionnelle que celle-ci « peut devenir l’un des (derniers ?) lieux d’élaboration collective des pratiques professionnelles en situation de travail, soit faire l’objet de conflits quand les transformations du travail ne sont pas accompagnées » (Thébault, 2016, p. 4).
I.2. De la fonction de vigilance au savoir-faire de prudence
Gagnées par la mutation des systèmes productifs, les industries chimiques se sont engagées comme d’autres dans le modèle de la « fluidité industrielle » depuis les années 1960 (Vatin, 1987). En découlent, l’automatisation massive des process porteuse d’exigences fortes pour les fabricants2 mais aussi l’émergence, puis la prévalence, de la relation technique des travailleurs aux moyens de production qui tendent à bousculer les fondements des professionnalités (Peyrard, 1992). Ces transformations font du salarié de la chimie non plus « l’agent direct de la production mais son catalyseur » (Vatin, 1987, cité par Mouy, 1988, p. 208) du fait de son rôle d’analyse et de diagnostic. L’automatisation requalifie la fonction de vigilance née du rapport direct de l’opérateur à la fabrication qui pour Mouy (1988) recouvre le fait que chacun apprend à devenir « surveillant du système productif », en recevant « la responsabilité de la gestion de l’aléatoire et de l’imprévu ». Ainsi, les travailleurs élaborent ensemble et transmettent un savoir-faire « irréductible à une 72connaissance didactique » lui permettant d’intervenir dans la « zone d’imprévu machinique » pour reprendre les termes de Vatin (1987). La généralisation du travail de contrôle-surveillance dans les industries de flux qui seraient marquées, selon Rot et Vatin, par l’accroissement d’une « distanciation entre l’homme et la matière » (2017, p. 106), le développement de l’informatisation des appareils de conduite et la diffusion du modèle de production « au plus juste » inspirée de Ohno (1988) et du modèle de lean production, ne paraissent pas devoir retirer à la « fonction de vigilance » son caractère intrinsèque aux professionnalités en chimie. La reconnaissance dans les organisations de la figure du technicien d’atelier, qui apparaît lors de cette période en complémentarité de celle du conducteur d’appareil, illustre ce mouvement de recomposition de la qualification ouvrière (Besucco, 1995 ; Campinos-Dubernet, 1995a, b). Le thème des professionnalités, que développent les travaux sur les relations formation-emploi, s’extrait du champ industriel, notamment de la chimie, pour se porter surtout vers les métiers du tertiaire (éducation, formation, santé). À partir des années 1990, les recherches en sociologie du travail et en sociologie des organisations apportent une multiplicité de regards sur le travail comme activité technique et comme objet de rapports complexes entre individus, collectifs et systèmes socio-techniques, avec une focale récente sur la chimie – du moins en France, et sur les problématiques de la sécurité et des risques industriels (Dupré M. et Le Coze J.-C., 2014).
Mais c’est un courant novateur de la psychologie du travail, la psychodynamique du travail, qui découvre qu’un ressort essentiel de toute activité de travail réside dans une « intelligence de la pratique ». Elle donne aussi à voir comment celle-ci a été pensée notamment dans les industries chimiques en observant que, « sous l’effet de la peur, les ouvriers inventaient des ficelles, grâce auxquelles ils prévenaient certains incidents et optimisaient le fonctionnement du process » (Dejours, 1993, p. 75). Le caractère local et situé de ces « ficelles » de métier en fait des éléments d’une professionnalité orientée sur la prévention et la sûreté des installations. Appuyé sur un double étayage théorique en ergonomie et en psychodynamique du travail, Damien Cru a aussi montré que les ouvriers du bâtiment élaborent et transmettent des procédures par lesquelles ils préviennent certains accidents du travail : ce sont les « savoir-faire de prudence » (Cru, 1983). A fortiori comme dans 73toute autre activité professionnelle, soit « ils ont une visée de sécurité et (…) concourent à la production », soit « ils peuvent avoir pour visée première la production tout en concourant à la santé et à la sécurité » (Cru, 2015, p. 424).
L’existence de systèmes à risques en chimie amène donc à penser des professionnalités qui intègrent ces savoir-faire de prudence. Prendre en compte deux facteurs organisationnels semble alors déterminant pour circonscrire comment ce savoir-faire s’exerce et se transmet. Résumons l’influence de ces facteurs en commençant par l’automatisation. Évoquant Dodier (1995), Colmellere (2017) souligne qu’en automatisant, « les ingénieurs ont imposé aux travailleurs des formes hybrides d’organisation du travail, articulant planification et flexibilité, pour adapter les modes de production aux exigences du marché. Les tensions entre contrôle et autonomie, prescription et improvisation se sont accrues pendant que les clivages hiérarchiques et professionnels se sont maintenus » (p. 213). Le second facteur se rapporte au modèle de l’organisation aplatie et tendue ou lean. Les méthodes issues de ce modèle visent des gains de productivité par une optimisation de l’organisation qui passe par « la détection des actes improductifs et l’amélioration continue autant tournée vers la montée en qualité que vers les objectifs de productivité » (Ughetto, 2014, p. 4). Les diverses possibilités d’interprétation de cette conception néo-taylorienne de l’organisation des entreprises peuvent conduire à des résultats contrastés en termes d’enrichissement des tâches et d’autonomie. Alors que le risque d’intensification du travail par la traque des temps apparemment improductifs et la poursuite d’un rendement optimal est dénoncé par les syndicalistes et les ergonomes comme un facteur de dégradation rapide de la santé des travailleurs, des « projets de performance » ou en « excellence organisationnelle » prétendent apporter des possibilités de développement de la polyvalence et de l’autonomie.
I.3. Cultures de sécurité et prévention des risques
À l’instar des normes issues de l’économie de la qualité, il existe des « normes de comportement », comme des démarches volontaires d’industriels en matière de maîtrise des risques industriels, élaborées à partir de l’arsenal règlementaire (Sanseverino-Godfrin, 2014, p. 118). Celles-ci alimentent le système de prescriptions sur le travail de fabrication. Les interactions entre ces normes et des « hommes au travail avec 74leurs hiérarchies, leurs solidarités, leurs oppositions » fabriquent une « sécurité en acte » dans l’atelier (Dupré, 2014, p. 127) et contribuent à la professionnalisation. Elles en constituent même une composante centrale, à travers le concept de « culture de sécurité » qui émerge depuis les années 1990 pour rendre compte de l’importance des pratiques quotidiennes visant à maîtriser et prévenir les principaux risques du métier (Boissières, Heldt, 2015). Mais le respect des consignes n’est qu’un aspect d’une « culture managériale de sécurité », mettant en exergue les procédures et les injonctions à respecter les consignes. Il coexiste avec une « culture de métier de sécurité » appuyée « sur les collectifs d’opérateurs, [sur] les métiers qui établissent leurs propres règles de sécurité, car ce sont eux qui savent » (Simard, 2010, cité par Boissières et Heldt, op. cit., p. 193).
En expliquant que la conciliation des exigences d’efficience économique et de sécurité dans les systèmes à risques n’est pas totalement prédictible, Merle (2014) montre qu’une pluralité de visions d’acteurs est possible au sujet de la transgression des règles ou bien des fonctionnements des routines au sein d’une même entreprise. Elle s’appuie notamment sur la situation d’un atelier où les employés « s’autorisent ainsi quelques écarts par rapport aux règles de conduite officiellement prescrites pour mieux répondre aux contraintes de production, parce qu’ils savent que les automatismes de sécurité se déclencheront en cas de besoin » (p. 142). Admettant aussi que « les opérateurs corrigent, par l’élaboration de règles pertinentes, les limites des prescriptions » (Dubey, 2001), un sociologue s’attend à observer les multiples signes des aménagements de la prescription que les salariés élaborent dans la réalisation de leur travail. Or, ces aménagements s’avèrent conflictuels ou peuvent ne pas être reconnus comme un facteur d’efficacité, alors même que sont critiquées les inattentions ou les erreurs des fabricants par la hiérarchie3.
Ces perspectives sociologiques sur la sécurité convergent avec des lignes de réflexion sur le savoir en acte et en situation4 et concordent avec l’ambition de comprendre d’un point de vue sociologique ce que devient la figure du travailleur dans un contexte de « démultiplication des sources de prescription et de normalisation » au travail (Martinache, Monchatre, 2017, 75p. 216). En esquissant ici une relation d’interdisciplinarité avec une sociologie de l’activité, c’est-à-dire du travail « en train de s’accomplir » (Ughetto, 2018, p. 12), cette problématique conduit à considérer la transmission d’un savoir-faire de prudence comme un enjeu nodal de la professionnalisation.
I. Terrain et matériau de l’analyse :
deux usines de chimie
La démonstration s’appuie sur une analyse transversale de deux usines de chimie de spécialités et parachimie5 (voir encadré 1), en prenant pour points de comparaison des situations spécifiques et des réponses locales aux problématiques communes de la fabrication des professionnalités dans un mode de production donné. Ces situations et réponses locales tiennent une fonction « d’analyseur » des processus de professionnalisation et de la manière dont ils sont plus ou moins facilités par des actions organisationnelles.
1. Sources et méthodologie
Les sources de cet article sont extraites d’un matériau rassemblé au cours d’une étude mixte (questionnaires passés auprès d’entreprises et enquêtes de terrain) réalisée par le Céreq en 2015 et 2016 à la demande de l’Observatoire prospectif des industries chimiques. Une enquête auprès de treize établissements industriels appartenant à onze entreprises a permis de réaliser des entretiens semi-directifs auprès de salariés, de leur encadrement direct, de cadres et responsables du site et de représentants du personnel dans les locaux des établissements. Cette étude (monographies et analyse transversale) a notamment été publiée dans la collection Études Céreq (Séchaud et al. 2017 a, b, c).
Des types de production semblables6, impliquant une proximité des opérations en fabrication (succession des « opérations unitaires » telles que distillation, cristallisation, essorage, séchage, etc.) et des équipements (réacteurs, colonnes de distillation, tuyauterie), ainsi que la convergence des profils socioprofessionnels des salariés autour 76des figures de l’ouvrier bachelier et du technicien d’atelier, permettent de réunir deux cas dans l’analyse7. Leur sélection au sein d’un corpus plus vaste est justifiée par leur complémentarité : le premier cas sert à analyser les contraintes de la transmission et le second approfondit l’analyse de sa dégradation ainsi que les actes par lesquels les salariés y résistent.
Le matériau des monographies retenues pour cette analyse est composé de quinze entretiens d’une durée de 40mn à 1h20 réalisés dans deux usines de chimie de spécialités et de formulation en 2016. Ces entretiens ont été réalisés principalement avec des salariés en fabrication au sujet de leurs pratiques professionnelles et de l’intégration des nouveaux opérateurs, mais aussi avec des représentants du management et des directions sur le cadre de prescription et d’organisation du travail de fabrication.
Entretiens Usine A : responsable des ressources humaines (cadre), formateur (ancien fabricant), une opératrice et quatre opérateurs de fabrication, deux techniciens. Ces entretiens ont été complétés par une observation du travail dans un atelier de fabrication, pendant la durée d’un quart de nuit (7h30), permettant notamment de suivre et d’interroger les fabricants dans leurs activités. Les entretiens ont eu lieu au cours de cette période à leur poste, mais aussi en salle de contrôle ou en salle de réunion.
Entretiens Usine B : directeur général adjoint, responsable des ressources humaines (cadre), responsable de production (cadre), deux techniciens (technicien méthode et coordinateur de production), un agent de maîtrise, deux opérateurs de fabrication.
La présentation qui suit de chacune des usines inclut des éléments succincts de trajectoire industrielle, d’organisation du travail et de démographie qui jouent un rôle significatif dans les représentations des acteurs que j’ai rencontrés.
II.1. L’usine A, un site important en constante évolution
L’usine A, dont l’activité a débuté dans les années 1940 et qui est dédiée à la production de produits intermédiaires ou de produits de base pour la fabrication pharmaceutique, est l’un des principaux sites chimiques parmi ceux que compte en France ce groupe français de plus de 20 000 salariés. Ce site est classé Seveso 2 « seuil haut » du fait des risques industriels induits par la présence de produits dangereux en grande quantité8. Les installations ont connu des évolutions en termes de modernisation et d’accroissement des capacités productives 77depuis le milieu du xxe siècle, permettant notamment la fabrication des produits faisant la notoriété du groupe à partir des années 1970. Le début du xxie siècle donne lieu à des investissements importants visant notamment le lancement d’une nouvelle unité et d’un nouveau procédé, l’extension d’un atelier de fabrication et la rénovation des installations dédiées au conditionnement. Mais, dans la phase actuelle, l’avenir du site est incertain, le groupe étant confronté à la concurrence des produits génériques. Lors de l’enquête, les effectifs étaient de 750 salariés, dont la moitié en production. La démographie révèle des écarts très marqués : les 18-34 ans sont surreprésentés chez les ouvriers et employés (48 %) alors que les plus de 50 ans le sont chez les techniciens et agents de maîtrise (35 %). Un seul des trois ateliers de fabrication du site a connu la mise en place récente des horaires continus en 5x8 (les autres fonctionnant en 3x8 du lundi au samedi)9 qui s’appliquent aux 55 fabricants de cet atelier. Il s’agit de l’atelier Z dans lequel s’est déroulée l’enquête sur les métiers de la fabrication du site A.
II.2. L’usine B, petite usine de chimie fine
L’usine B, 95 salariés, héberge des activités de production en chimie fine (actifs pharmaceutiques et produits dérivés de silice) et de « recherche et développement » (R&D) qui la classent comme établissement de type Seveso 2 « seuil bas ». Cet établissement appartient depuis moins de dix ans à une Petite et Moyenne Industrie (PMI) française de 420 salariés répartis sur six sites de production. La majeure partie des installations de l’usine B, qui est ouverte 5 jours sur 7, date des années 1970, mais un atelier de fabrication associant une entreprise étrangère (sous le régime de l’entreprise commune, ou joint-venture) a été aménagé beaucoup plus récemment. Au total, les ateliers de fabrication, les laboratoires et les deux « unités pilotes » (installations de taille réduite qui conçoivent et améliorent les procédés qui sont employés en fabrication) comptent environ 50 salariés, dont 33 en fabrication et conditionnement. En moyenne, les salariés de l’usine dont l’âge moyen est de 43 ans, ont 15 ans d’ancienneté (le plus ancien des salariés a 42 ans d’ancienneté). Dans 78la production, les mutations du travail tiennent à l’accélération du circuit de fabrication, à la rapidité d’adaptation au changement de procédés et à la variation des volumes de production devant globalement permettre une rentabilité immédiate. Parallèlement, l’étendue des normes et la rigueur des audits se sont également renforcées.
I. Des configurations contrastées
de la professionnalisation
III.1. Des exigences d’efficacité accrues en fabrication
Le « régime » de temporalité de l’organisation industrielle des deux usines se traduit dans la définition des rendements productifs et des variations des cycles d’un process continu. Les phases du process correspondent à la succession des charges des différents produits qui font l’objet des transformations chimiques, à la surveillance des opérations de transformation et aux phases de nettoyage ou d’entretien. L’organisation du travail en continu (travail posté en 5x8 dans l’atelier Z de l’usine A – dont la perception peut rester assez critique dans les rangs des salariés issus de la fabrication-, en 3x8 dans l’usine B) est un autre levier de productivité.
L’augmentation des rendements productifs passe aussi par des moyens de contrôle organisationnels et techniques. Il s’agit non seulement de réduire la dispersion des rendements en employant des méthodes de gestion de la qualité dans les ateliers, ou encore d’augmenter la capacité de production en réduisant le temps de cycle (notamment en agissant sur les opérations de nettoyage des équipements), mais aussi de réduire les retraitements de produits rendus non conformes pour des raisons techniques ou par « l’inattention des salariés » (responsable des ressources humaines, usine A) ou à leur manque de rigueur dans le suivi des consignes de la feuille de fabrication.
Si les outils organisationnels de la hausse de productivité ne sont pas explicités en tant que tels par les fabricants dans leur activité, un élargissement concomitant des fonctions entraîne un surcroît de tâches prescrites. Cet alourdissement de la prescription est d’autant plus ressenti 79par les techniciens de fabrication que la taille des équipes a diminué ces dernières années, dans des proportions significatives dans l’usine A comme dans l’usine B. Les fabricants sont en effet amenés à élargir leur rôle aux fonctions de contrôle en cours de fabrication, en enregistrant les résultats sur les terminaux de la salle de conduite : « ce qu’il y a, c’est que la productivité reste à peu près stable (…) mais on a un peu moins de monde et on nous demande plus de choses, parce qu’il y a tout ce qui concerne la productivité, mais les à-côtés aussi, qui concernent la productivité aussi, tout ce qui est contrôles [qualité] et labo [laboratoire]… La gestion sur le PC des contrôles labo qu’on ne faisait pas, qui étaient faits au labo avant, donc on nous demande plein de trucs qu’on ne faisait pas forcément quand on était en production, qui se rajoutent » (technicien, atelier Z, usine A).
Le discours du management valorise ces tâches de contrôle qualité au motif qu’elles sont déployées dans de vastes laboratoires opérant sur des quantités importantes et, de ce fait, ne constitueraient pas un « travail répétitif » (responsable des ressources humaines, usine A). L’activation d’un outil de management industriel de la qualité d’inspiration lean dans l’atelier Z vise, par la mobilisation des équipes, à réduire la dispersion des rendements et, ce faisant, à permettre la transmission d’un savoir relatif aux problèmes qui sont apparus dans les 24h ou 48h précédentes et aux réponses qui leur sont données. Ces retours d’expérience sont d’autant plus nécessaires que les différentes phases du process ne sont pas coordonnées avec le cycle de travail des fabricants, autrement dit avec les horaires des équipes. La logique de gestion d’un événement spécifique met ainsi à distance la routine et met en scène une régulation de l’activité, plaçant les fabricants (chefs de poste, techniciens et opérateurs) face à l’encadrement fonctionnel (qualité, production) dans un cadre spatial et temporel contraint (en station debout, dix minutes autour de tableaux et de graphiques affichés sur une cloison). Cet outil formalise des vérifications que les anciens faisaient directement sur les machines et qui ont été abandonnées avec l’introduction des commandes numériques (limitant les bascules manuelles marche-arrêt qui permettaient de suivre pas-à-pas le déroulement du process). Le « bon sens » appliqué aux tâches de contrôle du process serait ainsi rationalisé par une méthode de vérification collective mobilisant des catégories propres à la gestion de la qualité et employant des « experts » extérieurs à la 80fabrication. Une connaissance est ainsi élaborée pour être transmise, mais façonnée par des outils exogènes au process.
Pour faire face à des niveaux d’activité irréguliers, la direction de l’usine B joue sur des leviers classiques en gestion : l’organisation et lesdites « ressources humaines ». Le passage de l’organisation de la production en 3x8 s’accompagne d’une politique de gestion des stocks au plus juste et d’adaptation en matière de recrutement et de formation du personnel. La création d’emplois n’est pas l’option préférée : « soit on recrutera du personnel temporaire, soit on utilisera plutôt de la polyvalence inter-sites, avec la main-d’œuvre des autres sociétés, car toutes fonctionnent de la même façon, et il n’y a pas de changement notable de l’activité des opérateurs, ou on reportera l’activité » (responsable ressources humaines, usine B). Développer la polyvalence entre le personnel des unités pilotes (en 2x8) et la fabrication (en 3x8) est devenu un enjeu de performance mais cela suggère aussi de nouvelles activités de transmission. Pourtant, l’organisation actuelle du travail représente un frein à la productivité. Alors que les « ressources » (i.e. les salariés) étaient à l’origine très séparées avec des « prêts exceptionnels de personnel » selon les besoins, la direction cherche à disposer maintenant d’un « pool d’acteurs », permettant des affectations en production ou au pilote en fonction des priorités. Il s’agit de répondre à l’enjeu financier que représente la réalisation des activités à très haute valeur ajoutée de la co-entreprise. L’acquisition des compétences en contrôle qualité et en maintenance des opérateurs a conduit à un accord avec les organisations syndicales portant sur le développement de la formation et des augmentations salariales pour reconnaître la polyvalence qu’on leur demandait. Cet évènement signifie que la professionnalité devient qualification professionnelle dès lors qu’elle fait l’objet d’une régulation l’inscrivant dans un cadre contractuel.
III.2. Un dispositif de formation au plus près de la fabrication
Dans ces contextes où la normativité économique s’exerce au travers de différents outils de gestion, l’intégration dans le métier de fabricant repose sur la transmission des connaissances et des habiletés des salariés expérimentés vers les nouveaux entrants. Une partie fondamentale de ce processus de formation a lieu au plus près des ateliers et mobilise les fabricants et des formateurs ayant souvent une expérience ouvrière. Les 81fabricants rencontrés dans l’usine A ont particulièrement bien décrit ce processus. Pour un technicien de l’usine A, avec un jeune « qui n’a jamais vu un réacteur ou une centrifugeuse, il faut commencer par le b.a.-ba » et pratiquer un accompagnement, le plus souvent possible, en doublon. « C’est plus une formation sur le terrain (…). En fait, on le prend le plus possible “en doublette”, c’est-à-dire qu’il est avec nous, on lui montre exactement ce qu’il faut faire, on suit une feuille de travail, de fabrication avec lui, mais il y a des fois aussi où il faut qu’il se débrouille, on lui explique, on a quand même un œil sur lui mais on n’est pas 24 heures sur 24 avec lui, enfin 8 heures avec lui » (technicien, atelier Z, usine A). La portée de l’expression « sur le terrain » prend tout son sens lorsqu’on comprend qu’il faut non seulement apprendre à se repérer dans les installations et la diversité des appareils, mais aussi identifier les flux qui approvisionnent le process car « c’est plus ou moins bien étiqueté10 des fois » (technicien). Ce métier de conducteur d’appareil reste un métier « long à mettre en œuvre quand vous n’avez jamais mis les pieds dans la chimie » (responsable des ressources humaines, usine A). Dans l’usine A, il faut compter douze à dix-huit mois pour qu’un débutant en fabrication se voit reconnaître une autonomie11 après avoir effectué en doublon et sur plusieurs cycles des opérations qui ne demandent pas de technicité particulière (par exemple, essorage, distillation, séparation des liquides). La validation, par les encadrants, des compétences acquises au cours de cet apprentissage en atelier est intégrée à une base de données qui rassemble les informations individuelles relatives à la réalisation et à la maîtrise des tâches en fabrication et à la formation. Cette base répertorie les listes des différentes tâches qu’un opérateur doit accomplir pour se voir reconnaître une qualification sur les situations de travail dans l’atelier, la validation d’une tâche n’intervenant qu’après trois ou quatre répétitions réussies.
En pratique, les opérateurs d’un atelier peuvent, en rendant compte à la maîtrise de quart, exercer la fonction de tuteur à tour de rôle pour un débutant en lui permettant dès le départ de se situer dans l’atelier et dans le process, puis de progresser dans la conduite des installations. Selon le responsable des ressources humaines de l’usine A, la 82configuration des installations impose une capacité maximum de deux à trois « nouveaux » (stagiaires en formation ou salariés débutants) par atelier, soit environ un par équipe de six à sept personnes, car « il faut produire aussi » (dixit). L’acquisition de ce savoir de métier repose sur l’expérience partagée des situations de travail au cours des opérations et d’une mobilisation mentale permettant d’assimiler les informations.
En dépit de l’automatisation des process et du pilotage des installations par ordinateur, des gestes professionnels composent toujours la technicité du métier. « Toutes les informations de la feuille de fabrication ne suffisent pas si vous n’avez pas le feeling de ce qui se passe réellement. L’odorat n’est pas central12 mais la vue compte beaucoup pour obtenir les informations. C’était obligatoire avant de disposer des appareils de contrôle automatique – bien qu’on ne doive toujours pas se fier à 100 % aux capteurs aujourd’hui. Il faut comprendre ce qui se passe et être éveillé au poste de travail… des poudres mélangées par erreur ne se séparent plus ! Par exemple, il faut vérifier la propreté d’un appareil vide par un contrôle visuel approfondi. Des traces blanches montrent qu’il est en cours de refroidissement et que sa température risque encore de provoquer une non-conformité » (formateur). La formalisation des gestes et des savoirs d’atelier a été réalisée par cet ancien fabricant devenu formateur interne du site. Celui-ci intervient pour apporter, après un an environ sur le poste, une formation complémentaire à l’apprentissage en situation de travail aux nouveaux. Le contenu de la formation sur les postes de travail porte beaucoup sur les ficelles du métier et l’exercice de la vigilance qu’il dénomme « savoir-faire de prudence » et qu’il emprunte au langage de la prévention des risques : « il n’y a pas de tour de main à avoir, comme chez un boulanger : tout le monde doit toujours faire le même produit, tel que référencé par le cahier des charges. Par contre, il y a un savoir-faire de prudence13 : dans une filtration à chaud, il faut atteindre la température suffisante sinon une cristallisation va boucher les tuyaux. Sachant que certains produits peuvent cristalliser plus que d’autres, les anciens vont prévenir les nouveaux des précautions à prendre : monter la température, surveiller les transferts » (formateur).
La terminologie du savoir-faire de prudence employée par le formateur révèle une appropriation du vocable ergonomique par un expert 83professionnel. Son usage ici en indique aussi la double connotation relevée par Cru (2015), à la fois orientée sur la qualité et la production et sur la sécurité des travailleurs.
III.3. Les pratiques de transmission des fabricants sous tension
En dépit d’une apparente routinisation de la formation des « nouveaux », le régime de temporalité de l’organisation industrielle percute les pratiques de transmission professionnelle. L’accompagnement par les opérateurs expérimentés, qui doivent assumer un rôle particulier dans la gestion des risques, est souvent bousculé par les exigences liées à la production. Anticipant les variations de production, la priorité est d’ailleurs donnée à l’apprentissage des comportements de prévention et de sécurité (les jeunes sont d’abord écartés des produits les plus dangereux) mais des contraintes telles que la réduction des équipes et les délais de fabrication pèsent sur la transmission. Ces contraintes obligent les techniciens à placer les jeunes sur des tâches « un peu faciles mais pas toujours gratifiantes », qu’ils pourront effectuer seuls. La rotation des équipes ajoute un effet pervers : « par contre dans la cellule là-bas (…) c’est une fabrication qui est assez longue, et pour connaître toutes les étapes, ce n’est pas évident parce que souvent, c’est répétitif. Au changement de poste, on va souvent retomber où l’on connaît. » Le risque, pour un débutant, est de devenir un bouche-trou : « on le fait le moins possible, mais c’est arrivé qu’il fasse une cellule un jour, le lendemain il en fasse une autre, voire la même journée, il change d’une cellule à une autre » (technicien, usine A).
La pression de la temporalité industrielle aboutit à une tension majeure sur le sens de la formation destinée aux nouveaux. La responsable des ressources humaines rapporte que pour les cadres du management de l’usine, il importe « d’avoir en permanence à l’esprit la sécurité de soi et des autres… Savoir respecter des procédures, savoir alerter en cas de doute, c’est à dire être en vigilance ». Selon la logique d’efficience qui préside a priori à la direction de l’usine, la comparaison entre sécurité et qualité est tout à fait de mise lorsqu’il est question des compétences requises : « ce qui est développé sur la sécurité se retrouve dans la qualité sur un site FDA14 comme celui-ci ». Il est donc évident que, puisque 84« les compétences techniques pour conduire un réacteur impliquent un apprentissage relativement long, on ne laisse pas seul aux commandes un nouvel arrivant dans un atelier, il est mis en doublon avec un tuteur ». D’ailleurs, les formations au tutorat ont été développées, mais elles restent encore à dispenser à certains tuteurs en fonction. De plus, si la formation à la fonction tutorale est organisée en tant que telle, sa mise en œuvre pose la délicate question du système de contraintes : « on ne peut pas toujours détacher une personne pour la mettre en doublon à cause des plannings ou bien si on a juste les bonnes personnes aux bons endroits » (coordonnateur de production, usine B)15.
D’une certaine manière, la formation est envisagée comme un travail excédentaire pour les fabricants expérimentés : « On a du boulot, donc ça nous fait un surplus de travail de former. Et on n’a pas toujours le temps, et souvent même, pour des tâches qui sont un peu faciles mais pas toujours gratifiantes pour la personne qui rentre, eh bien le gars, on le laisse tout seul ! Déprotéiner une essoreuse par exemple, c’est le jeune qui va se le payer parce qu’il n’y a pas trop de risques ! Au maximum, on essaie de ne pas le faire mais de toute façon, c’est la réalité ! On serait deux par équipe de plus, je pense que ce serait bien…. Mais bon, ça, ils le savent [et] ils disent qu’on est trop nombreux » (technicien, usine A). Dans les deux usines, ce sont généralement les chefs de poste qui arbitrent sur la capacité d’une personne à faire seule une tâche et de l’apprendre, alors que pèsent déjà sur eux la surveillance globale et la vérification des contrôles des opérations de fabrication.
Les contraintes sur l’activité de transmission des connaissances désorganisent la logique de progression dans les savoirs de métier et conduisent à limiter l’apprentissage sur les questions de sécurité. « Ce n’est pas évident, quand on est livré à soi-même, sur des produits dangereux, encore ! Le plus dangereux, on ne les met pas, mais ça ne fait rien ! Quand on débarque dans un atelier et que l’on n’a jamais travaillé dans ce contexte-là, on se pose des questions, ce ne sont pas des bonbons qu’on fabrique ! Alors on est très à cheval sur la sécurité, parce que c’est notre rôle de les former là-dessus, c’est la priorité ! » (technicien, usine A).
85Toutes ces tensions donnent à voir les contradictions entre la temporalité industrielle et la temporalité de l’intégration dans le métier. La gestion de l’emploi impose d’autres contraintes en contribuant à définir la trame sociale de la professionnalisation. Au cours des vingt dernières années, la présence humaine a progressivement diminué dans les ateliers et ce, encore plus récemment, du fait des départs des anciens qui n’avaient pas été anticipés. La flexibilité externe se traduit par le recrutement d’opérateurs en contrat à durée déterminée, dont les entrées et sorties constituent une contrainte sur la régulation du travail au sein des équipes16. Elle pèse sur la disponibilité des fabricants pour la formation en « doublon » : « c’est ce qui est un peu dommage, car maintenant les jeunes sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes que moi quand je suis rentré. Quand je suis rentré, déjà, pour former un gars ici, pour qu’il connaisse une cellule, il faut compter un an et demi, 2 ans même, donc c’est assez long ! Dans l’idéal, ce serait de le suivre pendant un mois sur une fabrication, le problème, c’est que l’on n’a pas toujours le monde effectif pour pouvoir se le permettre » (technicien, usine A).
Ce dialogue avec ce technicien à propos de la (dé-)composition des équipes, illustre à nouveau cette disjonction des temporalités.
– C’est un peu déséquilibré, parce qu’on a eu beaucoup d’anciens qui sont partis, pas mal de savoir-faire qui est aussi parti avec eux… On l’avait vu venir, et on avait dit que ce serait bien de former des jeunes, d’en faire entrer avant pour les former, ce qui ne s’est pas fait. Ils ont embauché les jeunes quand les anciens étaient partis… Il y a eu pas mal de problèmes ! (technicien, usine A)
– Donc il y a eu des problèmes de qualité, de non-conformité ? (enquêteur)
– Ou des erreurs faites, des fabrications qu’on maîtrisait très bien et qui du jour au lendemain étaient non conformes. En plus, il y a eu pas mal de travaux dans l’atelier, en même temps qu’on fabriquait, ce qui fait qu’il fallait être assez vigilant… On a eu de la chance, parce que ça ne s’est pas trop mal passé (…).
– Ça fait des facteurs de risques, à la fois renouvellement des anciens, pertes de connaissances et travaux ?
– Plus changements des appareils et du mode opératoire de certains trucs, changement des feuilles de travail aussi à une époque, ça faisait beaucoup. On a cumulé à un moment.
Le recueil d’évènements et de situations dans des ateliers de fabrication permet l’analyse de contraintes pesant sur la transmission, mais 86il ouvre aussi des perspectives sur la compréhension des modalités de contestation par les personnels.
III.4. La résistance des personnels de fabrication contre
le risque accidentel à partir du savoir-faire de prudence
Le volontarisme managérial de la direction de l’usine B, qui s’exprime aussi par la redéfinition des compétences requises dans l’encadrement intermédiaire en fabrication (depuis celles d’experts à celles d’animateurs d’équipes), s’exerce cependant dans un contexte où une certaine conflictualité marque les relations professionnelles. La cristallisation d’un conflit de normes s’est réalisée autour des interventions d’un représentant du personnel en réaction à un risque d’accident.
Cette attention à la rigueur et à la vigilance en matière de sécurité et au respect des consignes dont doivent faire preuve les opérateurs se décline dans l’atelier dans les actions de la maîtrise et de l’encadrement technique. Le technicien « méthodes » commence d’ailleurs toujours la présentation d’un nouveau procédé par ses propriétés en termes de sécurité et de produits dangereux. La formulation « du terrain » indique que l’exercice en est permanent, notamment lors de la présence de nouveaux dans l’atelier : « il y a toujours l’œil d’un ancien ou de quelqu’un pouvant parer à toute éventualité ou à tout problème » (responsable d’atelier, usine B). Deux raisons rendent cette surveillance d’autant plus nécessaire. La première tient au fait que, l’effectif en production s’étant réduit, « le sous-effectif peut nous faire faire des erreurs, et produit du stress » (opérateur, usine B), notamment au moment des approvisionnements en matières premières (qui rappelons-le, sont gérés en « flux tendus ») lors des baisses d’activité. Il peut n’y avoir alors qu’une seule personne dans l’atelier, quand l’équipe compte normalement quatre ou cinq salariés. Pour un ancien opérateur, l’usage du dispositif de l’« homme mort17 » est un « pis-aller » car il ne remplace pas ce qui fait défaut, c’est-à-dire « une main-d’œuvre suffisante pour faire le travail ». La seconde raison se rapporte aux équipements, qui sont jugés vétustes en dehors de ceux du nouvel atelier en co-entreprise. Les pannes récurrentes peuvent provoquer des problèmes de qualité ou de sécurité et, « généralement, les matériels sont exploités au maximum ou récupérés pour aller plus vite » 87(opérateur). La prudence doit aussi s’exercer dans l’attribution des postes de travail. Elle s’effectue en « évitant l’accoutumance », c’est-à-dire en déplaçant les opérateurs pour empêcher que s’installent des routines, qui sont connues pour constituer des facteurs de risque, car « on n’est jamais plus prudent et concentré que lorsqu’on fait quelque chose de nouveau » (responsable d’atelier, usine B).
Les récits des personnels de fabrication et des cadres de l’usine B permettent d’appréhender le mode d’implication des uns et des autres dans la « culture de sécurité » de l’usine. En fabrication, selon les anciens, la vulnérabilité des installations n’est généralement pas connue avec exactitude par les supérieurs hiérarchiques. Ce constat est a fortiori soulevé par les agents de maîtrise et leur adjoint en situation de responsabilité qui vérifient, par exemple, les procédures d’utilisation des produits dangereux. La maîtrise a une connaissance des capacités du matériel et des limites de sûreté à ne pas dépasser sans risquer un danger pour les opérateurs. « J’encadre des collègues » signifie, pour ce technicien, responsable d’atelier, qu’il situe la santé de ses collègues à un niveau de valeur plus élevé que celui de la production. Ce sens de la responsabilité collective, selon ce technicien, s’acquiert par l’expérience. Il conduit aussi à contester des décisions du management qui menaceraient la santé et la sécurité. Cette contestation peut s’appuyer sur les outils collectifs de la santé au travail : avec le cahier spécial du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui permet d’apposer une décision relative au refus de travailler sur un matériel défectueux ou dangereux ; avec le droit de retrait qui est activé lorsque cela est nécessaire. Un autre technicien explique clairement cet usage : « quand on ne veut pas nous écouter, on va passer à l’étage au-dessus (…) avec motion de droit de retrait et faire intervenir le CHSCT, de façon à être entendu » (technicien, usine B).
Des épisodes conflictuels, rapportés par un responsable d’atelier, représentant du personnel au CHSCT de l’usine, sont significatifs d’un conflit de normes, entre le référentiel de la prescription et celui du travail réel, mobilisant l’intelligence de la professionnalité ouvrière. Ils aboutissent à des expressions radicalisées du savoir-faire de prudence, sous la forme d’actes de résistance à la prescription. Le premier conflit porte sur l’opposition par deux agents de maîtrise au démarrage rapide et sous la pression de délais à respecter, d’une fabrication devant dégager 88un gaz toxique alors que des capteurs ont été retirés de l’installation (en panne, ils étaient alors en réparation chez le fournisseur et le problème avait déjà été soulevé par l’un des responsables d’atelier depuis plusieurs mois). L’opposition au démarrage de la campagne a été unanime, chez les opérateurs et la maîtrise. Le CHSCT a été consulté ; un délai d’une semaine pour réinstaller des capteurs a été réclamé et obtenu comme condition de démarrage. Les termes de l’escalade verbale expriment non seulement la pugnacité de l’agent de maîtrise, mais aussi l’agencement d’un rapport de force, faisant appel à des acteurs périphériques18, à un savoir de métier des plus informels et au registre de la ruse et de la menace : « j’ai dit qu’on ne démarrerai pas et, si vous voulez vraiment qu’on démarre (…) j’irai voir qui de droit [inspection du travail], mais vous n’utiliserez pas le matériel car je casserai une partie du matériel de façon à ne pas démarrer, volontairement. [D’ailleurs] en faisant juste une petite bricole, on n’aurait pas pu démarrer quand même » (technicien, usine B). Le second conflit porte sur une accélération des rendements jugée trop importante et amenant le responsable d’atelier à poser des conditions restrictives. Il ne s’agissait plus de définir l’incident et le risque en termes de qualité, dans le registre de l’efficience productive et selon des considérations pécuniaires, mais en termes de sécurité et de risques d’accident grave : « ça sera comme ça et pas autrement et si vous voulez faire autrement, vous venez le faire, ou sinon appelez les pompiers, ou le personnel adapté, tout de suite. Si vous voulez jouer, on ne jouera pas longtemps et on tient à vous préciser que ceux qui sont à côté des appareils, c’est nous, et que nous, la maîtrise, sommes responsables de nos opérateurs et de notre matériel, de notre outil de travail… alors que dans d’autres métiers, ça va accélérer [la cadence] jusqu’à ce qu’il y ait un pépin. Mais nous on ne peut pas se le permettre » (technicien, usine B).
89I. Discussion
Il était admis au départ que le processus de professionnalisation s’observe lorsque des acteurs pluriels s’engagent dans des pratiques informelles pour étayer l’acquisition d’une professionnalité, sans suivre en cela de trame ordonnée, ni instituée. L’observation des conditions dans lesquelles se fait la transmission professionnelle en matière de vigilance, en participant à ce processus, doit renseigner sur le statut du savoir-faire de prudence et sur sa reconnaissance. Les observations réalisées permettent de confirmer que la « fonction de vigilance » apparaît toujours au cœur de la professionnalité des personnels de fabrication. Les interactions dans les collectifs de travail comme l’utilisation des outils de gestion (action de communication sur un retour d’expérience, répertoire des habilitations), qui ont été identifiés dans l’atelier Z, confirment que la professionnalisation intègre cette fonction de vigilance : il s’agit bien « d’intégrer et de révéler les connaissances ouvrières et le travail réel des opérateurs dans l’utilisation des équipements comme une composante de leur qualification » (Mouy, 1988). Mais il apparaît aussi que la trame sociale de ce processus reste perturbée par des facteurs organisationnels orientés vers des exigences de productivité et de rentabilité, ou par une gestion des emplois s’affranchissant de cet enjeu. La transmission des savoir-faire de prudence subit alors un coup de frein et sa « mise entre parenthèses » (Thébault, 2018) semble si fréquente qu’elle se déroule désormais en pointillé. La professionnalité est aussi mise en question, voire dénoncée comme elle pouvait théoriquement l’être, par les arguments péjoratifs de la « division morale du travail » (Colmellere, 2017).
Ce faisant, la montée en généralité à partir d’un repérage empirique des trames temporelles et des systèmes de normes dans lesquels s’inscrit la professionnalisation, rencontre certaines limites. La première d’entre elles tient au manque de contextualisation des configurations sociales, à travers un approfondissement des rapports entre l’histoire des entreprises et la biographie des individus au travail. En effet, si je compare l’usine A et l’usine B, le statut du savoir-faire de prudence est apparu fortement lié à des modalités de reconnaissance formelle (des actions de formation en atelier leur sont dédiées dans l’atelier Z) et à une régulation sociale 90de la prévention assez problématique (usine B). Les pratiques de transmission devraient aussi être considérées comme évolutives au regard des changements dans la composition sociale des collectifs de travail et des trajectoires des salariés impliqués. Malgré ces limites, les enseignements généraux qui ressortent de notre investigation auprès des personnels de fabrication de deux usines chimiques confirment cette hypothèse et interrogent certains contours de la professionnalisation définis en introduction. En effet, les pratiques managériales de rationalisation des temps productifs influencent le déroulement des activités collectives de formation au poste de « nouveaux » arrivant dans les ateliers. Cette formation organise la transmission du savoir-faire et des gestes techniques sur un modèle qui reste assez proche du compagnonnage tel que Le Roux (2006) l’a analysé auprès des techniciens de maintenance d’une centrale nucléaire. Elle rencontre aussi les limites connues des dispositifs formalisés tels que le tutorat ou l’alternance19.
IV.1. Professionnalisation empêchée,
savoir-faire de prudence sous tension
En premier lieu, il apparaît que la confrontation bien connue de la prescription avec le travail réel fait relever la professionnalisation d’une logique conflictuelle dont l’enjeu est la reconnaissance de l’autonomie. Comme l’enquête dans l’usine A l’a montré, les possibilités d’une professionnalisation empêchée naissent, d’une part, des contradictions entre la temporalité industrielle et la norme de rendement et d’autre part, de l’étayage de l’apprentissage de la fonction de vigilance par la progression des expériences accompagnées par les pairs. Les équipes postées rencontrent des difficultés à former les nouveaux venus lorsque le niveau des effectifs ne permet pas aux « anciens » de les former en situation de travail alors que leurs pratiques doivent être coordonnées pour permettre une transmission qui « se réalise dans, par et pour l’activité productive » (Thébault, 2018, p. 67). Si plusieurs facteurs de contraintes se combinent, la situation formatrice de travail, vecteur de l’autonomie professionnelle, est alors mise « sous tension ».
En second lieu, dans l’espace socio-productif d’une usine, les situations qui correspondent à la « diffusion de normes de professionnalité » 91s’avèrent, elles aussi, conflictuelles. Ces situations montrent des divergences tenaces entre le registre des attentes des salariés et les exigences du management. Ou, comme le résume autrement un technicien de l’usine A, « il ne faut pas se laisser faire, sinon on peut dériver sur n’importe quoi. » Les normes de professionnalité s’opposent sur plusieurs plans. Cet antagonisme n’apparaît jamais plus clairement que lorsque l’expertise technique s’exprime dans l’affirmation radicale d’un savoir-faire de prudence, sous la forme d’une résistance d’autant plus efficace qu’elle est légitimée par l’exercice d’un mandat d’ordre public, celui de membre du CHSCT. On note ici que, dans le domaine sanitaire, la prégnance de la réglementation dans les activités opérationnelles dépend aussi de la capacité des organisations syndicales de salariés à s’approprier les enjeux et les outils de la préservation de la santé au travail. À l’instar des anciens « diables rouges » de la réparation navale marseillaise20, ces pratiques montrent encore l’existence d’un système de légitimation de la capacité d’agir du professionnel qui « résulte de la reconnaissance par des ouvriers des capacités militantes et techniques d’un des leurs » (Bleitrach, Chenu, 1979).
IV.2. La transmission participe
au développement de la capacité d’agir
Les exigences du management expriment nombre des croyances à partir desquelles Thébault (2016, p. 2) appelle à un « déplacement » pour penser la transmission. Ainsi, lorsque la responsable des ressources humaines de l’usine B juge que les caractéristiques des individus expliquent les attitudes intervenant sur la qualité de l’intégration, elle réduit d’autant le rôle des conditions d’organisation collective de la transmission. Nos observations sur la transmission du savoir-faire de prudence montrent aussi combien le décalage peut être grand entre, d’une part, une vision de la transmission relative à des savoirs techniques et à des procédures homogènes et, d’autre part, des capacités d’arbitrage et de prise en compte de la spécificité ou de la variabilité, des situations – c’est-à-dire le propre des professionnalités en fabrication.
92La question du conflit de normes et de la disjonction des temporalités dans le processus de professionnalisation amène finalement à une autre interrogation. Comment les salariés peuvent-ils résister aux effets antagonistes de la logique de rentabilité et de l’accroissement des rendements productifs sur la transmission de leur savoir-faire de prudence et la préservation de leur santé ? La professionnalisation dans l’emploi apparaît comme l’un des processus par lesquels les salariés acquièrent des ressources pour accomplir un travail de qualité et, ce faisant, développer leur capacité d’agir21. Ainsi, en assimilant la professionnalisation à un mouvement non linéaire, non institué, de développement de la capacité d’agir, on peut interpréter les épisodes de confrontation entre un représentant du personnel de fabrication et le management en matière de sécurité (usine B) comme des situations de résistance à l’usure prématurée par laquelle « les salariés résistent à tout ce qui est susceptible de mettre à mal leur corps, de faire obstacle à l’actualisation de leur puissance d’agir » (Roche, 2016, p. 201)22. Mais, à côté de la résistance comme action d’étayage des professionnalités, doivent nécessairement exister des espaces de discussion, des temps d’échanges et de transmission des connaissances permettant aux salariés de se reconnaître experts de leur propre travail.
Conclusion
À travers les récits par lesquels des salariés de deux usines, représentant des figures significatives des métiers de la fabrication chimique, rendent compte de leurs pratiques de transmission professionnelle autour de la fonction de vigilance et de prévention, j’ai cherché à expliquer comment se déroule la professionnalisation au savoir-faire de prudence. L’enjeu de la reconnaissance de ce savoir-faire a été explicité sur plusieurs aspects, le situant au cœur de la « diffusion de normes de professionnalité sous 93la double impulsion de demande de reconnaissance de travailleurs et de formulations d’exigences de la part de leurs partenaires » (Demazière, 2009, p. 88). Pour ce faire, j’ai effectué un rapprochement entre sociologie et ergonomie. Ce rapprochement mériterait d’être approfondi pour apporter un éclairage à la compréhension des enjeux de la transmission professionnelle dans les entreprises chimiques, notamment pour tenir compte des effets de socialisation générationnelle et genrée (côté sociologie) et de ceux du vieillissement des individus et des collectifs de travail (côté ergonomie). Il s’agirait alors de voir comment la transmission professionnelle « cristallise les enjeux des organisations, des métiers et des acteurs dans un contexte d’évolutions permanentes » (Thébault, 2018, p. 87) en relation avec les processus de co-construction des parcours et en référence à la place qu’y tient l’acquisition de l’autonomie professionnelle, dans le cadre des rapports sociaux du travail en entreprise. Du point de vue sociologique, une nouvelle analyse de configurations sociales de la transmission permettra de travailler, comme y incite Michel Lallement, sur le développement de capacités individuelles et collectives à produire de l’autonomie, c’est-à-dire de la liberté au travail (Lallement, 2015).
94Bibliographie
Besucco N., 1995, Transformation des marchés et gestion des compétences. Le cas d’une entreprise de chimie fine, Céreq, Marseille.
Bleitrach D., Chenu A., 1979, L’usine et la vie. Luttes régionales : Marseille et Fos, Maspero, Paris.
Boissières I., Heldt B., 2015, « La sécurité industrielle, une affaire de métier et de management », in A. Thébaud-Mony, Les risques du travail : pour ne pas perdre sa vie à la gagner, La Découverte, Paris, p. 192-195.
Bourdoncle R., Mathey-Pierre C., 1995, « Autour du mot Professionnalité », Recherche & formation, vol. 19, no 1, p. 137-148.
Campinos-Dubernet M., 1995a, « Baccalauréat professionnel : une innovation ? », Formation Emploi, no 49, p. 3-29.
Campinos-Dubernet M., 1995b, « Organisation qualifiante et mobilité. Les techniciens d’exploitation dans la chimie », Formation Professionnelle, no 5, p. 17-25.
Campinos-Dubernet M. Marquette C., 1993, « Prospective du travail et des qualifications dans les industries chimiques », BREF : bulletin de recherches sur l’emploi et la formation, Céreq, no 85.
Colmellere C., 2017, « Contrôler le travail et les relations sociales ? », L’Homme et la société, vol. 3, no 205, p. 211-243.
Cru D., 1983, « Savoir-faire de prudence dans les métiers du bâtiment. Nouvelles contributions de la psychopathologie du travail à l’étude de la prévention », Les Cahiers médico-sociaux, no 27, p. 239-247.
Cru D., 2015, « Les savoir-faire de prudence : un enjeu pour la prévention. Consignes formelles et pratiques informelles de sécurité », in A. Thébaud-Mony, Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, La Découverte, Paris, p. 419-426.
Dejours C., 1993, « Intelligence pratique et sagesse pratique : deux dimensions méconnues du travail réel », Éducation permanente, no 116, p. 47-70.
Demazière D., 2009, « Postface : professionnalisation problématique et problématiques de la professionnalisation », Formation Emploi, no 108, p. 83-90.
Demazière D., Roquet P., Wittorski R., 2012, La professionnalisation mise en objet, L’Harmattan, Paris.
Dodier N., 1995, Des hommes et des machines. La conscience collective dans les sociétés technicisées, Métaillé, Paris.
Dubar C., 2003, « Régimes de temporalités et temps sociaux », in Collectif GRIOT, Figures du temps : les nouvelles temporalités du travail et de la formation, L’Harmattan, Paris.
95Dubar C., Tripier P., Boussard V., 2011, Sociologie des professions, 3e éd., Armand Colin, Paris.
Dubey G., 2001, « La simulation à l’épreuve du lien social », Le travail humain, vol. 64, no 1, p. 3-28.
Dupré M., 2014, « D’une sociologie de l’atelier de chimie de spécialité à une sociologie de la sécurité » in M. Dupré, J. – C. Le Coze, Réactions à risque : regards croisés sur la sécurité dans la chimie, Lavoisier, Paris, p. 115-131.
Dupré M., Le Coze J. – C., 2014, Réactions à risque : regards croisés sur la sécurité dans la chimie, Lavoisier, Paris.
Eymard-Duvernay F, Marchal E., 2000, « Qui calcule trop finit par déraisonner : les experts du marché du travail », Sociologie du travail, vol. 3, no 42, p. 411-432.
Fédération nationale des industries chimiques (FNIC), 2013, Conférence sur les industries de la chimie. 9-10 octobre 2013, CGT, Montreuil, 30 p.
Granaux S., 2010, Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les établissements de fabrication de produits chimiques : étude comparative des pratiques d’une institution de santé au travail méconnue, Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 519 p.
Lallement M., 2015, “Work and the challenge of autonomy”, Social Science Information, vol. 54, no 2, p. 229-248.
Le Roux D., 2006, « Les processus sociaux de la transmission intergénérationnelle des compétences : le cas d’une centrale nucléaire », Sociologies pratiques, no 12, p. 23-36.
Martinache I. et Monchatre S., 2017, « Le savant et le travailleur. Comment parler du travail au-delà du “geste” ? », Revue Française de Socio-Économie, no 19, p. 205-218.
Maurines B., 1991, « La compétence : enjeux et stratégies d’institutions et d’acteurs », Travail et emploi, vol. 50, p. 4-14.
Merle I., 2012, « Le recrutement des opérateurs dans une usine chimique à haut risque : le paradoxe du charcutier », Sociologie du Travail, vol. 54, no 4, p. 475-494.
Merle I., 2014, « Qualité, prix, délais et sécurité : comment concilier l’inconciliable dans une usine chimique innovante ? », in M. Dupré, J. – C. Le Coze, Réactions à risque : regards croisés sur la sécurité dans la chimie, Lavoisier, Paris, p. 133-152.
Mouy P., 1988, « L’organisation de la fonction de vigilance dans la chimie : un modèle pour l’économie de la fluidité ? » in Bercot R. et alii, Ouvriers qualifiés, maîtrise et techniciens de production dans les industries chimiques en cours d’automatisation. Volume 2. Céreq, Marseille, p. 199-219.
Ohno T., 1988, The Toyota Production System : Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland.
96Observatoire prospectif des industries chimiques (OPIC), 2012, L’emploi dans les industries chimiques 2000-2010, Union des Industries Chimiques, Puteaux, 21 p.
Périsse M., 1998, « La certification d’entreprise : héritage ou nouvelle règle de gestion de la main d’œuvre ? », Formation Emploi, no 63, p. 27-41.
Peyrard C., 1992, « Crise des groupes socioprofessionnels : émergence de la relation technique et transformation des fondements des professionnalités. » in Bercot R. et alii, Ouvriers qualifiés, maîtrise et techniciens de production dans les industries chimiques en cours d’automatisation. Volume 3. Céreq, Marseille, p. 151-253.
Peyrard C., 2009, « Construction des connaissances professionnelles et collectifs de travail : stabilité et instabilité dans l’emploi et le travail. L’exemple des industries chimiques », in B. Appay, S. Jefferys, Restructurations, précarisation, valeurs, Octarès, Toulouse, p. 339-349.
Roche P., 2016, La puissance d’agir au travail. Recherches et interventions cliniques, Erès, Paris.
Rot G., Vatin F., 2017, Au fil du flux : Le travail de surveillance-contrôle dans les industries chimique et nucléaire, Presses de l’École des Mines, Paris.
Sanseverino-Godfrin V., 2014, « L’encadrement juridique des activités de chimie : d’un droit prescriptif à une nouvelle gouvernance de la sécurité » in M. Dupré, J.-C. Le Coze, Réactions à risque : regards croisés sur la sécurité dans la chimie, Lavoisier, Paris, p. 55-72.
Séchaud F., Amarillo H., Brochier D., Delanoë A. et Legay A., 2017a, Évolution des métiers et des emplois non-cadre dans les industries chimiques : volume 1 : Analyses, Céreq, Marseille.
Séchaud F., Amarillo H., Brochier D., Delanoë A., Legay A., 2017b, Évolution des métiers et des emplois non-cadres dans les industries chimiques – Volume 2, Monographies, Céreq, Marseille.
Séchaud F., Legay A., 2017c, « Dans les industries chimiques, on capte, on forme, on embauche », BREF : bulletin de recherches sur l’emploi et la formation, Céreq, no 335.
Simard M., 2010, « La culture de sécurité », in F. Daniellou, M. Simard, I. Boissières, Facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielles. Un état de l’art. Fondation pour une culture de sécurité industrielle, Toulouse.
Thébault J., 2013, La transmission professionnelle : processus d’élaboration d’interactions formatives en situation de travail. Une recherche auprès de personnels soignants dans un Centre Hospitalier Universitaire, thèse de doctorat en ergonomie, CNAM, Paris.
Thébault J., 2016, « La transmission professionnelle : mettre à distance les idées reçues », Connaissance de l’emploi, no 130.
97Thébault J., 2018, « La transmission professionnelle en situation de travail », Formation Emploi, no 141, p. 67-87.
Trépos J.-Y., 1992, Sociologie de la compétence professionnelle, Presses universitaires de Nancy, Nancy.
Trinquet P., 1996, Maîtriser les risques du travail, Presses universitaires de France, Paris.
Ughetto P., 2014, « Le travail à l’heure du lean », colloque L’industrie, notre avenir, Cerisy-la-Salle.
Ughetto P., 2018, Les nouvelles sociologies du travail. Introduction à la sociologie de l’activité, DeBoeck, Louvain-La-Neuve.
Vatin F., 1987, La fluidité industrielle, Méridiens Klincksieck, Paris.
Zimmermann B., 2011, Ce que travailler veut dire. Une sociologie des capacités et des parcours professionnels, Éditions Economica, Paris.
1 L’auteur remercie ses collègues du Céreq (qui se reconnaîtront) pour avoir pris le temps de lui faire part de très précieuses remarques sur les versions successives de ce texte.
2 Dans le jargon de métier, le fabricant désigne un personnel de la fabrication chimique, notamment le conducteur d’appareil des industries chimiques (CAIC).
3 Ce sont là des éléments constitutifs d’un modèle de la « division morale du travail » qu’a analysé Colemellere (2017, p. 107) dans une usine chimique et dans une usine pharmaceutique, dont on trouve par ailleurs des traces dans les deux cas étudiés ici.
4 Voir supra, la citation de Trépos (1992).
5 La chimie de spécialités répond à des besoins très précis et de faible volume de production. La chimie de formulation (ou parachimie) élabore des produits issus de processus chimiques sous une forme utilisable par des consommateurs ou des industriels.
6 Les deux sites sont néanmoins de tailles différentes : avec comme point de comparaison le volume de production, l’usine A est quatre fois plus important que l’usine B.
7 Il n’est pas possible ici de revenir sur l’importante littérature qui existe sur ces deux figures professionnelles, dont des références sont présentes en bibliographie de cet article.
8 La directive européenne dite « Seveso 2 » prévoit des mesures de sécurité et des procédures qui consacrent les « bonnes pratiques » en matière de gestion des risques, en distinguant deux types d’établissement selon la quantité totale de produits dangereux sur site.
9 L’organisation en 5x8 répartit les salariés en cinq équipes de façon à obtenir un fonctionnement continu sur 24h et pendant 7 jours, en intercalant deux jours de repos tous les cinq jours. La rotation sur des horaires différents est donc plus rapide qu’en régime des 3x8.
10 Des étiquettes amovibles sont fixées à des vannes ou à des tubes de transfert indiquant les produits qui circulent.
11 Cette durée, déjà évaluée par Maurines (1991), est assez consensuelle parmi les experts. Un technicien de l’atelier Z l’estime plus longue sur le terrain (jusqu’à deux années, voir infra.)
12 Les odeurs ambiantes, surtout celles des solvants, sont caractéristiques.
13 Souligné par l’auteur.
14 Food and Drug Administration. L’administration nord-américaine de l’alimentation et des médicaments réalise des audits dans les entreprises françaises exportatrices.
15 Il en résulte d’ailleurs que le poste de conditionnement (activités de manutention, port de charges avec combinaison et équipement respiratoire), qui est l’un des plus contraignants en fabrication dans cette usine, peut être occupé de façon durable par un jeune opérateur bachelier, ressentant alors un sentiment de déclassement et vivant mal la pénibilité des tâches.
16 Pour un approfondissement de ce problème, voir C. Peyrard (2009).
17 Ce terme est ici utilisé pour désigner un système de détection et d’alarme visant à protéger le travailleur isolé.
18 Voir la thèse de Granaux (2010) sur les stratégies de mobilisation des acteurs externes à l’entreprise par les CHSCT dans la chimie.
19 Cf. Formation Emploi, dossier « Quand le tutorat questionne le travail et son analyse », no 141, 1/2018.
20 Par un accord d’entreprise, des membres du CHSCT sont devenus agents « permanents de sécurité » entre 1972 et 1978. Leurs interventions ont réduit drastiquement le nombre d’accidents mortels (voir Trinquet, 1996). Je remercie Pierre Roche de m’avoir mis sur la piste de ces « diables rouges ».
21 La notion de capacité d’agir chez Zimmerman (2011) permet ici de comprendre comment peuvent s’articuler l’expression individuelle et directe de salariés et leur expression collective.
22 La puissance d’agir est « puissance de produire, grâce à son activité, des effets dont on est la cause adéquate » (Spinoza, cité par Roche, 2016).