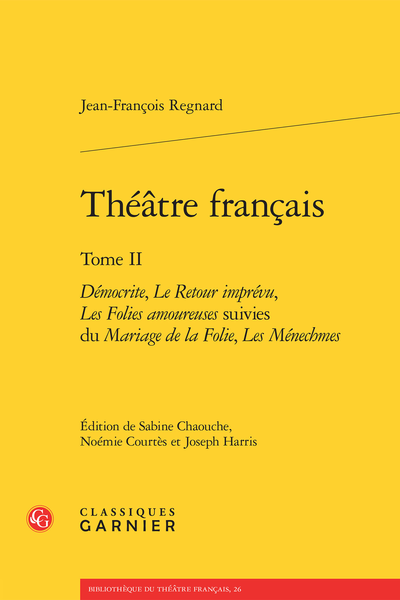
Rappel des principes d'édition
- Publication type: Book chapter
- Book: Théâtre français. Tome II. Démocrite, Le Retour imprévu, Les Folies amoureuses suivies du Mariage de la Folie, Les Ménechmes
- Pages: 7 to 12
- Collection: French Theatre Library, n° 26
- CLIL theme: 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN: 9782812433085
- ISBN: 978-2-8124-3308-5
- ISSN: 2261-575X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3308-5.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-24-2015
- Language: French
RAPPEL DES PRINCIPES D’ÉDITION
Le texte
Le texte qui sert de base est l’édition originale.
Pagination
La pagination originale a été incluse dans chaque pièce sous la forme suivante « [numéro de page] » de même que les signets des différents cahiers (figurant au bas de la page, toujours côté recto), de la manière suivante « [numéro de cahier] ». On les trouvera à droite du texte entre crochets ou dans le texte.
Les majuscules et minuscules
L’usage ancien des majuscules a été conservé au début d’un nom commun ou d’un adjectif.
La graphie et l’orthographe
La typographie originale de la page de titre a été respectée. Les lettres en italiques lorsqu’elles figuraient sur la page de titre, du privilège du roi ou de la liste des acteurs ont été conservées, de même que les lettres italiques pour la retranscription de lettres ou de chansons (ex : Les Folies amoureuses).
La graphie a été systématiquement modernisée selon les normes des Éditions classiques Garnier. Pour une étude de la graphie originale des pièces on se reportera directement à la version princeps de chaque pièce.
Les principaux changements concernent :
1. L’accentuation des mots :
Les corrections concernant l’accentuation des voyelles ont été systématisées : a devenant à ; a devenant â ; e devenant é ; e devenant è. L’accent a été rectifié : é devenant è, é devenant ê, ë devenant e, ï devenant i, ô devenant o, û devenant u, ü devenant u. A été systématiquement modernisée la voyelle ï en y, u en û et y en i lorsque l’usage moderne le requerrait. Nous résumons les principales modifications relatives à l’accentuation s devenant ^ en donnant quelques exemples courants :
–es devenant ê : en particulier les verbes comme estre devenant être, démesler devenant démêler, arrester devenant arrêter, certains adjectifs comme prest devenant prêt ; certains noms comme par exemple forest devenant forêt, tempeste devenant tempête, interest devenant intérêt ; ou certains adjectifs comme honneste devenant honnête, prest devenant prêt ou mesme devenant même ;
–eu devenant û : comme dans meur devenant mûr, seur devenant sûr ;
–is devenant î : en particulier le nom maistre devenant maître et le verbe plaire à la troisième personne du singulier (plaist devenant plaît) ;
–os devenant ô : en particulier dans les noms communs comme par exemple costé devenant côté, hospital devenant hôpital, hostel devenant hôtel, impost devenant impôt, les verbes oster devenant ôter ou les adverbes plutost devenant plutôt ou tantost devenant tantôt ;
–us devient û : dans certains noms communs comme goust devenant goût.
2. La modernisation de la graphie :
a) Groupements de consonnes et/ou de voyelles pouvant entraîner ou non un changement dans la prononciation. Les cas les plus fréquents sont :
–ez devient és : certains noms au pluriel (ex : dez devenant dés), notamment ceux qui sont terminés en « té » (ex : difficultez devenant difficultés, futilitez devenant futilités, beautez devenant beautés). Les occurrences sont nombreuses ;
–eu(e) devient u(e) : généralement dans les participes passés (ex : emeu devient ému, veu devenant vu, receu devenant reçu) ;
–oe devient oî : plus rare, dans certains verbes (ex : coeffée devenant coiffée) ou noms communs (ex : boete devenant boîte) ;
–oi devient ai : les modifications concernent plus particulièrement les verbes à l’imparfait et au conditionnel présent (ex : ronflerois devenant ronflerais, feroit devenant ferait, serois devenant serais), certains noms comme foiblesse devenant faiblesse ou connoisseur devenant connaisseur. Les corrections sont multiples ;
–oye devient oie : généralement dans les noms communs (ex : oye devenant oie, monnoye devenant monnaie, joye devenant joie) ou dans les verbes en -er au présent de l’indicatif ou au subjonctif (ex : envoye devenant envoie ; voye devenant voie, deploye devenant déploie) ;
–sç devient s : en particulier le verbe savoir orthographié à l’époque « sçavoir » récurrent dans les pièces.
b) Usage du tiret
Nous avons introduit l’usage du tiret selon l’usage moderne (ex : peut estre devenant peut-être), en particulier pour les formes verbales interrogatives et impératives (tiret entre le verbe et le sujet), ou les tournures avec l’adverbe là.
c) Mots agglutinés
À l’inverse nous avons supprimé le tiret lorsque la forme moderne d’un mot le nécessitait et agglutiné deux mots, le plus souvent des noms communs, des adjectifs ou des adverbes (ex : bien-seance devenant bienséance, bon homme devenant bonhomme, bon heur devenant bonheur, contre-temps devenant contretemps, justau-corps devenant justaucorps, mal-aisé devenant malaisé ; long-temps devenant longtemps, bien-tost devenant bientôt, si-tost devenant sitôt etc.). D’autres termes ne comportant pas de tirets ont été agglutinés comme le veut l’usage : par exemple par tout devenant partout, par fois devenant parfois.
d) Mots désagglutinés
Deux termes (adverbes ou nom communs en grande majorité) agglutinés ont été désagglutinés en fonction de leur orthographe moderne
(ex : tres-exprés devenant très exprès, dequoy devenant de quoi, soufermier devenant sous-fermier).
e) Ajout d’une consonne :
–dans certains verbes, adjectifs ou noms (ex : seau devenant sceau), et en particulier les mots au pluriel se terminant par -ens/ans devenant -ents/ants comme par exemple : prudens devenant prudents, déréglemens devenant dérèglements, raisonnemens devenant raisonnements, sermens devenant serments, sentimens devenant sentiments ; lians devenant liants, brillans devenant brillants etc. ;
–lorsque l’orthographe moderne exigeait un redoublement de la consonne comme par exemple : fole devenant folle, intermitante devenant intermittente, chifonné devenant chiffonné, nipes devenant nippes, cofre devenant coffre, rabatre devenant rabattre, enflamer devenant enflammer etc. Les exemples sont innombrables ;
–lorsque l’orthographe moderne exigeait une consonne supplémentaire comme par exemple noeu devenant nœud. Les exemples sont plus rares ;
–lorsque la conjugaison l’exigeait, notamment dans les impératifs : « vien » devenant viens, prens devenant prends, revien devenant reviens.
f) Suppression d’une consonne redondante
En particulier nostre/vostre devenant notre/votre, dans certains mots comme rejetter devenant rejeter, rappeller devenant rappeler, fidelles devenant fidèles.
g) Remplacement d’une consonne par une autre comme dans les cas suivants : flus et reflus devenant flux et reflux, maraut devenant maraud, galands devenant galants, hazard devenant hasard.
h) Modification des voyelles comme par exemple sincope devenant syncope.
i) Les lettres minuscules « ſ » à l’initiale des mots ou devant la consonne « t » ont été modernisée en « s ». La ligature « & » a été systématiquement remplacée par « et ».
j) Résolution de rares abréviations présentes dans les textes : en particulier dans le Le Joueur : ő devient on, v. 40, 250, 299 ; ě devient en, v. 198, 483.
k) Certaines apostrophes ont également été supprimées (ex : grand’chose devenant grand-chose).
l) Conventions typographiques : « Me » a été systématiquement remplacé par Mme selon le code typographique contemporain en vigueur, de même que « Mr » a été remplacé par « M. ».
On ne trouvera pas de relevé systématique des changements effectués en matière de modernisation de la graphie dans la mesure où ils sont récurrents d’une pièce à l’autre (ainsi des accents ou de la simplification de l’orthographe par l’amuïssement de certaines lettres).
Les fautes de langue ou de composition ont été systématiquement corrigées (voir les exemples donnés à la fin de la présentation de chacune des pièces).
Rime pour l’œil et décompte des vers
Le principe de la rime pour l’œil n’a pas été respecté lorsque cette dernière ne gênait pas la lecture de la pièce. Nous avons veillé à ce que les vers respectent les douze syllabes de l’alexandrin, les éditions originales étant parfois fautives. Le nombre de vers est inclus dans la marge à gauche du texte.
La ponctuation
La ponctuation des xviie et xviiie siècles se faisait en fonction de la respiration et avait son importance. Elle ne suivait pas forcément de règles grammaticales. Par ailleurs les imprimeurs se chargeant de la mise en page des textes pouvaient laisser des erreurs présentes dans la copie manuscrite ou prendre des initiatives visant à ponctuer les pièces selon leurs propres normes. Nous avons respecté la ponctuation originale. Cependant, tout signe de ponctuation incohérent par rapport aux modalités de la phrase (interrogation, exclamation, affirmation) qui étaient sous-entendues par le dialogue ou ne respectant pas la structure
syntaxique de la phrase, a été corrigé. Les virgules, point virgules ou deux points à la fin d’une réplique ont été supprimés et des changements ont été opérés sur le texte lorsque les signes mineurs de ponctuation étaient insuffisants (ils ont été remplacés par une ponctuation plus forte). Les deux points marquant une pause intermédiaire entre le point et la virgule ont été modernisés et remplacés par une virgule, un point-virgule ou un point. Voir les informations données par les éditeurs à la fin de l’introduction de chaque pièce.
Variantes
Elles apparaissent en notes à la fin du texte.
Sabine Chaouche