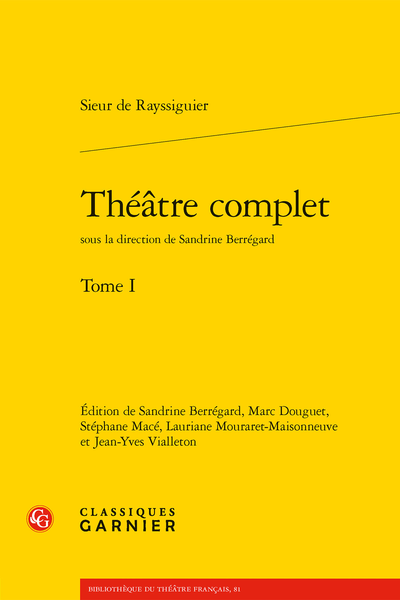
Établissement du texte
- Publication type: Book chapter
- Book: Théâtre complet. Tome I
- Pages: 491 to 496
- Collection: French Theatre Library, n° 81
- CLIL theme: 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN: 9782406120667
- ISBN: 978-2-406-12066-7
- ISSN: 2261-575X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12066-7.p.0491
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-03-2021
- Language: French
Établissement du texte
L’édition ancienne
Le texte a fait l’objet d’une seule édition au xviie siècle (Paris, Sommaville, 1634) :
PALINICE / CIRCEINE / ET / FLORICE. / TRAGI-COMÉDIE. / Tirée de l’Astrée de Mre. Honoré d’Urfé. / Par le sieur de R. / [vignette] / À PARIS, / Chez ANTOINE DE SOMMAVILLE, au Palais / dans la petite Salle, à l’Écu de France. / [filet] / M. DC. XXXIIII. / AVEC PRIVILÈGE DU ROI.
Format : in-8o par demi-feuille
Pagination : [16]-110
Signatures : ã-ẽ4 A-O4[3]
Contenu : ã2ro-ã1vo : pages blanches ; ã2ro : page de titre ; ã2vo : page blanche ; ã3ro-ã4vo : épître dédicatoire ; ẽ1ro : avis au lecteur ; ẽ1vo-ẽ3vo : argument ; ẽ4ro : page blanche ; ẽ4vo : liste des personnages ; A1ro-O3vo, p. 1-110 : texte de la pièce.
D’après les recherches d’Alain Riffaud1, les cahiers ã et ẽ ont été imprimés par Jacques Bessin. Les cahiers suivants proviennent de l’atelier de Claude Griset. L’ouvrage est dépourvu d’achevé d’imprimer et de privilège.
492Exemplaires consultés
–Bibliothèque Nationale de France (Tolbiac) : YF-4809. Manque le cahier ẽ. « de R. » est développé en « de Rayssiguier » par une mention manuscrite sur la page de titre. Reproduit sur Gallica [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73905b].
–Bibliothèque Nationale de France (Tolbiac) : YF-6861. Manque le cahier ẽ. Sur la page de titre, on lit « Par le sieur de Rayssiguier » au lieude « de R. ».
–Bibliothèque Nationale de France (Arsenal) : 8 BL 12663 (1). Manque le cahier ẽ.
–Bibliothèque nationale de France (Arsenal) : GD-1686 (2). Manque le cahier ẽ. « de R. » est développé en « de Rayssiguier » par une mention manuscrite sur la page de titre.
–Bibliothèque de Bordeaux, B 7076/2.
–University of California, Davis, Shields Library : PQ1912.R6 P3. Reproduit sur Google livres [https://books.google.fr/books?id=A646AQAAMAAJ].
–Autre exemplaire connu : British Library 242.h.16.(4.)
Nous avons pris pour référence l’exemplaire Tolbiac YF-4809, et, pour les caractères difficilement lisibles, l’exemplaire Arsenal GD-1686 (2). Nous reproduisons le cahier ẽ d’après l’exemplaire conservé à la bibliothèque de Bordeaux.
La pièce n’a fait l’objet que d’une seule réédition moderne (mémoire de Master de Fallom Tay sous la direction de Georges Forestier, Université Paris-Sorbonne, 2012), disponible en ligne sur le site Bibliothèque dramatique [http://bibdramatique.huma-num.fr/rayssiguier_palinice].
493Mise en forme
L’ouvrage porte les titres courants suivants, imprimés en majuscules : « Épître » (ã3vo-ã4vo) ; « Argument » (ẽ2ro-ẽ3vo) ; « Palinice, Circeine, » (pages paires du texte) ; « et Florice. Tragicom. » ou « et Florice. Tragico. » (pages impaires du texte), avec les exceptions suivantes : « Florice. Tragicom » (p. 67, 83 et 99), « Palin. Circ. et Flor. Trag. » (p. 110, dernière page du texte). On note enfin trois coquilles dues à une confusion avec le nom des personnages présents dans la scène : « Arimant, seul. Tragicom. » (p. 35), « Arimant, Alcandre. » (p. 38), « et Alcandre. Tragi-com. » (p. 39). Ces trois coquilles ne sont pas présentes dans Arsenal 8 BL 12663 (1) et Bordeaux B 7076/2, où en figurent en revanche deux autres : « Arimant. » (p. 36) et « et Alcandre. Tragico. » (p. 37).
Nous conservons la distinction entre caractères italiques et caractères romains, à l’exception du texte de la dédicace, de sa signature et de son adresse, et du texte des répliques (originellement en italiques, à l’exception du titre et du texte des lettres en prose insérées) et des didascalies (originellement en romains). Au vers 1262, la didascalie est exceptionnellement en italiques et placée sur la même ligne que le texte de la réplique : nous uniformisons.
Modernisation de la ponctuation
et de l’orthographe
Conformément aux principes de la présente édition, nous avons modernisé l’usage des capitales2, ainsi que la ponctuation quand celle-ci pouvait gêner la lecture.
Nous avons également systématiquement modernisé la typographie (« & » remplacé par « et » ; « ß » par « ss » ; « ã », « ẽ » et « õ » par « an », 494« en », « em », « on » ou « om » ; « u » et « v », « i » et « j » dissimilés ; une occurrence de l’abréviation « vo9 » développée en « vous », v. 1313), l’orthographe, l’accentuation3 et l’emploi du tiret, de l’apostrophe ou de l’espace4. Notamment, nous écrivons « puisque », « lorsque », « quoique », « bientôt », « ensuite » etc. là où l’on trouve le plus souvent « puis que », « lors que », « quoi que », « bien tôt », « en suite » etc. dans le texte d’origine5. Nous modernisons « et bien » en « eh bien ». Nous remplaçons également « de » par « des » selon l’usage actuel dans certaines occurrences6 (v. 31, 492, 533, 539, 690, 709 et 808). Nous ajoutons un s aux formes de la deuxième personne du singulier qui en sont dépourvues7 (« asseure », v. 1316 ; « ose », v. 1260 ; « montre », v. 1244). Le t euphonique est suivi ou précédé tantôt d’un tiret, tantôt d’une espace, tantôt d’une apostrophe (« sera t’elle », v. 900 ; « verra-t’on », v. 190 ; « a-il », v. 420) : nous uniformisons et modernisons8. Nous modernisons également le nom propre « Meudon », écrit « Medon » dans l’argument (ẽ1vo).
Nous avons cependant conservé la graphie d’origine quand la modernisation aurait faussé la rime ou le vers : « die » (v. 26 et 518) ; « désirerois » (v. 373) ; « treuve » (v. 827) ; « confesserois » (v. 850) ; « désirois » (v. 1356). Nous avons de même conservé les graphies « encor », « avecque », « avecques », et « doncques9 », y compris dans les quelques occurrences où « encor » est employé sans nécessité, avant une voyelle (« encor état », v. 771 ; « encor en », v. 888 ; « encor, et », v. 1005 ; « encor apporter », v. 1038 ; « encor appris », v. 1402).
Ces modifications altèrent parfois la rime pour l’œil : « Escoutés/difficultés » (v. 87-88) ; « flame/Dame » (v. 93-94 et 1482-1483) ; « obligés/soulagés » (v. 95-96) ; « flame/ame » (v. 183-184, 247-248, 399-400, 440-442, 533-534, 719-721, 1159-1160, 1326-1327, 1426-1427 et 1550-1551) ; « croy/moy » (v. 233-234) ; « elle/infidelle » (v. 239-240, 4951031-1032 et 1227-1228) ; « loix/voix » (v. 285-286) ; « conte/honte » (v. 323-324) ; « pas/apas » (v. 349-350, 801-802, 961-962, 1284-1287 et 1508-1509) ; « attente/consentente » (v. 407-408) ; « puissans/sens » (v. 424-425 et 603-604) ; « dedans/ardans » (v. 491-492) ; « tresors/ressors » (v. 543-544) ; « regrette/discrette10 » (v. 677-678) ; « faict/effaict11 » (v. 777-778) ; « advancé/recompencé » (v. 809-810) ; « labirinte/Cerinte » (v. 1015-1016) ; « place/face » (v. 1183-1184) ; « belle/fidelle » (v. 1316-1319) ; « cruelle/fidelle » (v. 1506-1507).
Coquilles
Comme le reconnaît l’avis au lecteur, le texte comporte de nombreuses erreurs. Tous les exemplaires présentent les coquilles suivantes, que nous avons corrigées : « Medoun » (avis au lecteur, ẽ1ro) ; « Polinice » (argument, ẽ1vo) ; « Alexandre » (argument, ẽ2ro) ; « il engage » (argument, ẽ2ro) ; « la désabuse » (argument, ẽ3vo) ; « obligée » (argument, ẽ3vo) ; « à » (v. 22) ; « réver » (v. 57) ; « honheur » (v. 57) ; « SCEINE » (p. 10, entête de scène) ; « à » (v. 215) ; « soupconnons » (v. 265) ; « Quelle » (v. 302) ; « Au » (v. 303) ; « Cerinthe » (v. 459) ; « essez » (v. 578) ; « suivi » (v. 619) ; « allez-la » (v. 635) ; « parle mieux » (v. 704) ; « se » (v. 758) ; « où » (v. 762) ; « leur » (v. 768) ; « qui » (v. 789) ; « donnée » (v. 842) ; « qui lui » (v. 861-862) ; « méprisait » (v. 934) ; « assise » (v. 940) ; « puplier » (v. 941) ; « A » (v. 941) ; « né » (v. 947) ; « innutiles » (v. 971) ; « ces » (v. 978) ; « à » (v. 995) ; « mescontement » (v. 1018) ; « contente » (v. 1037) ; « croit en amour » (v. 1061) ; « quelque » (v. 1082) ; « à » (v. 1115) ; « entretenir » (v. 1120) ; « encore » (v. 1143) ; « face » (v. 1184) ; « donc » (v. 1195) ; « reproches » (v. 1232) ; « cest » (v. 1320) ; « d’extrement » (v. 1320) ; « put » (v. 1331) ; « inhumain » (v. 1345) ; « fâchée » (v. 1376) ; « tous deux » (v. 1386) ; « Tournons » (v. 1405) ; « d’eux » (v. 1407) ; « saurait » (v. 1413) ; « viens » (v. 1416) ; « cher » (v. 1419) ; « servi » (v. 1432) ; « á » (v. 1506) ; « cét » (v. 1587).
496Nous corrigeons les entêtes des scènes de l’acte V, dont le numéro est décalé à partir de la scène 3 (numérotée « SCÈNE II. »). Les entêtes des répliques suivantes sont également erronés : « Cerinte » au lieu de « Circeine » (v. 810-811 et 814-815) ; « Sileine » au lieu de « Clorian » (v. 832) ; « Clorian » au lieu de « Circeine » (v. 1435-1436) ; l’entête « Alcandre » manque aux vers 569-570 ; l’entête « Florice » est inséré sans distinction de mise en forme dans le corps du vers 1411 au lieu d’être placé au-dessus (« Les voilà sur Florice le point d’une action barbare. »). Les vers 1432-1433 et 1434-1435 sont par ailleurs intervertis, de sorte que l’alternance des rimes masculines et féminines n’est pas respectée : il est aisé de rétablir l’ordre correct dans la mesure où ces deux distiques correspondent chacun à une réplique qui exprime la même idée que l’autre. Enfin, la troisième feuille du cahier ẽ est signée ẽ ij au lieu de ẽ iij et la page 160 est numérotée 106.
1 Alain Riffaud, Répertoire du théâtre français imprimé entre 1630 et 1660, Genève, Droz, « Travaux du Grand siècle », 2009, p. 61. Notice en ligne sur https://repertoiretheatreimprime.yale.edu/, no 3422.
2 Celui-ci n’est guère uniforme dans le texte d’origine : on rencontre par exemple aussi bien « Amant » (v. 238, 274, 275 etc.) que « amant » (v. 143, 982, 1073 etc.), « Amour » (v. 157) que « amour » (v. 1022).
3 Y compris pour le nom propre « Cerinte ». Nous ne listons donc parmi les coquilles que les occurrences où a et ou sont écrits « à » et « où ».
4 Nous ne listons pas non plus parmi les coquilles les quelques occurrences où l’apostrophe manque : « N ont » (v. 14), « qu aux » (v. 30), « d excellent » (v. 345) etc.
5 On rencontre « Puisque » v. 1508.
6 Sur cet emploi de de, voir Haase, § 119.
7 Sur l’alternance es/e, voir Spillebout, p. 185-186.
8 Sur cette question, voir Vaugelas, p. 275-276.
9 Vaugelas (p. 600) condamne les formes doncque (sans s, qui est absente du texte) et avecques (avec un s, que l’on rencontre minoritairement, v. 83, 383).
10 Notons qu’on trouve dans le texte aussi bien « discrete » (v. 1236) et « secrete » (v. 1235) que « discrette » (v. 678) et « secrette » (v. 50).
11 Notons qu’effet est majoritairement écrit effect dans le reste du texte.