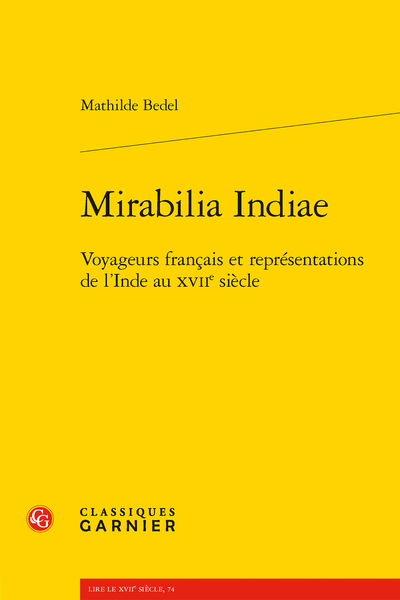
Préface
- Publication type: Book chapter
- Book: Mirabilia Indiae. Voyageurs français et représentations de l’Inde au xviie siècle
- Pages: 11 to 18
- Collection: Reading the Seventeenth Century, n° 74
- Series: Voyages réels et voyages imaginaires, n° 5
- CLIL theme: 3388 -- HISTOIRE -- Les Temps Modernes (avant 1799)
- EAN: 9782406121558
- ISBN: 978-2-406-12155-8
- ISSN: 2257-915X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12155-8.p.0011
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-10-2021
- Language: French
Préface
Représenter l’Inde, pour le xviie siècle français, c’est la recréer à partir des informations transmises par les voyageurs. Intrinsèquement liée au contexte politique et commercial, mais aussi à l’art et à la culture antique, la littérature de voyage de la première modernité précise les traits d’une Inde française. Cette étude, tournée vers le domaine littéraire, prend en compte l’interdisciplinarité du sujet traité pour tenter de mieux souligner la complexité des problématiques abordées. La période considérée s’étend des premiers voyageurs français à découvrir l’Inde jusqu’aux débuts de la fondation de Pondichéry en tant que principale base commerciale française. Centrée autour de la représentation de l’Autre et de soi, cette étude s’intéresse également à l’écriture de l’image, en tant que ce qui est donné à voir pour servir des enjeux commerciaux, religieux, politiques mais surtout littéraires des voyageurs. Il s’agit alors de réfléchir sur les textes à partir de leur inscription dans la modernité c’est-à-dire de leur matière transgénérique réactualisant l’imaginaire antique et prolongeant l’imaginaire oriental.
Afin de comprendre la mise en place de l’indianité dans les textes sources de cette étude, plusieurs ouvrages critiques ont été porteurs. Les problématiques mises à jour par Sylvie Requemora-Gros et Sophie Linon-Chipon ont permis d’aborder les récits à partir de la fictionnnalisation de l’écriture du voyage. Il est important de préciser que, dans ce sens, le Centre de recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV, Sorbonne), fondé par François Moureau a été une ressource capitale grâce aux nombreuses conférences accessibles en ligne. La thèse de Sylvie Requemora-Gros, intitulée : Littérature et voyage au xviie siècle, ouvre d’importantes pistes d’étude concernant l’analyse des récits de voyageurs français en Inde au xviie siècle. Ses travaux sur l’écriture du voyage, analysée à partir des interférences entre le récit de voyage, le roman, le théâtre et la poésie dévoilant les enjeux d’un enrichissement mutuel des 12genres littéraires, les questions de la mise en espace et son examen des Turqueries, sont une source importante de réflexion pour notre étude. Plus particulièrement, en cherchant à comprendre ce qui caractérise la représentation de l’Orient au xviie siècle, la thèse de Sophie Linon-Chipon Gallia orientalis. Voyages aux Indes orientales, 1529-1722. Poétique et imaginaire d’un genre littéraire en formation, permet d’entrer dans l’aire géographique orientale, en continuité de laquelle s’inscrit cette étude. En effet, fondée sur une soixantaine de récits de voyage, son travail s’intéresse à la tension narrative, caractéristique de ce genre littéraire qui alterne volonté d’objectivité et anecdotes digressives. Les travaux de Frédéric Tinguely sur la littérature de voyage des xve et xviie siècles ainsi que son intérêt pour une possible ou impossible interculturalité littéraire jouent également un rôle important dans notre réflexion1.En effet, le roman, pendant la période « baroque », tend à évoluer vers le réalisme en se détachant de l’imagination traditionnelle. Ainsi le genre des relations de voyage commence à se développer à partir des années 1650, en parallèle du genre romanesque. Jean-Michel Racault2 souligne d’ailleurs qu’à cette période, se déclenche la « crise de la fiction », où l’intérêt pour le roman décline alors que celui pour la littérature de voyage s’épanouit grandement. Pourtant, Jacques Chupeau, remarquant les interventions narratives des voyageurs, interroge les frontières entre ces deux genres3. Enfin, les recherches de Marie-Christine Pioffet concernant l’écriture viatique et la cartographie de l’imaginaire ont été particulièrement structurantes et inspirantes. La dimension interdisciplinaire de cette étude nécessite également des connaissances historiques, géographiques et culturelles. Ainsi, spécialiste polyglotte de l’Inde du Sud aux xvie et xviie siècles, Sanjay Subrahmanyam veut rendre compte de ce qu’il appelle l’Histoire connectée, en croisant diverses archives. Ses travaux, ainsi que ceux de Serge Gruzinski, qui s’intéresse aux colonisations de 13l’Amérique et de l’Asie, nous ont permis d’aborder la mise en place des premiers mouvements et échanges entre l’Europe et le reste du monde, particulièrement avec l’Inde. Par ailleurs, l’introduction de L’Inde des Lumières4 écrite par Marie Fourcade et Ines G. Županov permet de dresser un tour d’horizon critique concernant l’influence de l’Asie du Sud sur la pensée européenne des Lumières et inversement. S’inscrivant à la suite des réflexions de Sylvia Murr, à laquelle l’ouvrage rend hommage, les divers exposés croisent les analyses historiques et historiographiques afin de mettre au jour de nouvelles perspectives théoriques, incitant à l’interdisciplinarité5. Enfin, le site French books on India, fondé par Ian Magedera est un véritable outil de travail qui recense les ouvrages français s’intéressant à l’Inde durant la période allant de 1530 à 2016.Cependant, si l’Inde a été un objet de recherches passionnant pour la plupart des domaines des sciences humaines, il apparaît que la critique littéraire concernant la période pré-coloniale de la première modernité a négligé cette source d’intérêt.
C’est grâce à un croisement interdisciplinaire des méthodes que seront mis en valeur les éléments constitutifs de la représentation indienne renouvelée et recréée par la littérature de voyage aux prémices de la modernité. Il s’agit par cette étude de montrer que malgré l’hétérogénéité des textes du corpus, un continuum littéraire se met en place, notamment à travers les interférences des différents genres et élabore le portrait de l’homo indianus. Les voyageurs divisent l’espace indien en trois grands blocs religieux avec l’observation des tentatives de conversions à la chrétienté, la présence de l’Islam notamment incarnée par les figures royales et ce qu’ils nomment la gentilité des autochtones. C’est principalement dans ce dernier ensemble qu’ils trouvent la nouveauté chère au lectorat français. Cette « gentilité » indienne est donc exploitée pour satisfaire les enjeux narratifs des récits de voyage mais le terme renvoyant à l’hindouisme* est préféré dans cette étude. En effet, les voyageurs qui 14perçoivent la diversité cultuelle hindoue, tentent, à travers le prisme chrétien, de transposer l’uniformité religieuse propre à leurs croyances. Or, la littérature française semble commencer à puiser dans les ressources indiennes, alors transmises par les voyageurs, dès le xviie siècle. De cette manière, c’est en contrepoint de l’étude de Guillaume Bridet6 qu’il s’agit d’analyser la naissance de l’intérêt littéraire pour l’Inde, dans un contexte pré-colonial.
Au cours du xviie siècle, la tradition des merveilles indiennes influence la dynamique des mutations et des rencontres du monde connecté. La rencontre des voyageurs français avec ce nouvel ailleurs indien les conduit à reporter certaines des considérations apportées par leurs prédecesseurs antiques et médiévaux. Ainsi, le « monde hindou », incarné par un ensemble de personnages indiens prototypiques, est décrit selon un attrait viatique paradoxal entre fascination et horreur. Avec le système des castes, les voyageurs trouvent dans la société indienne un écho à leur volonté de classer et de hiérarchiser : à la manière de dramaturges, ils exposent ce qu’ils comprennent comme étant les diverses catégories sociales. Pour ce faire, ils élaborent une série de personnages stéréotypés grâce à une mise en scène réductrice de l’Autre. L’Hindou apparaît alors bien souvent immoral et pervers : il faut se méfier de la perfidie des hautes castes et de la ruse malintentionnée des basses. De leur côté, les femmes sont décrites comme des êtres doubles pouvant se montrer à la fois lubriques et naïves au point d’honorer le rite de satī, c’est-à-dire leur immolation volontaire sur le bûcher de leur défunt mari. Portée par une théâtralisation du discours, l’écriture du voyage en Inde repousse la voix de l’Autre et n’accorde souvent à la parole indienne qu’une place d’arrière-plan. Les frontières de l’espace indien dessinent un décor sous les traits d’un monde antipodique au sein duquel se confrontent les représentants du Paradis et de l’Enfer chrétiens. D’un côté les voyageurs témoignent, au fil de leurs pérégrinations, des splendeurs commercialisables et des dangers liés à la présence portugaise qui conduit sur les routes infernales des prisons inquisitoriales.
L’Inde des récits de voyage français est également un espace dont les voyageurs recréent la cartographie à partir de leur imaginaire. Les 15personnages historiques indiens deviennent sous leurs plume les représentants souverains de royaumes supplantés par la présence française. Ainsi, les figures du Grand Moghol et de son ennemi Shivaji deviennent les parangons fictifs de la lutte française face à l’absolutisme monarchique et face à l’invasion musulmane. Grâce aux intrigues de cour et aux rebondissements épiques, la figure d’Aurangzeb émerge pour mieux être interrogée par François Bernier. L’observation aiguisée du penseur libertin donne à son récit la dimension pamphlétaire d’une critique du pouvoir français. A contrario, sous la plume des voyageurs, le personnage de Shivaji intervient pour incarner l’opposition à la tyrannie moghole, donnant à la France un nouveau modèle narratif de héros national et combattant indirectement la menace ottomane. C’est finalement la figure française qui s’impose avec l’écriture du « je » représentant le voyageur qui détient les informations récoltées en Inde et les diffuse au lectorat français. Si cet aspect de la relation de voyage est présent tout au long de cette étude sous différents points d’analyse, c’est avec François Martin qu’il est examiné. En effet, par ses Mémoires, il met en place une écriture de l’intime et propose un récit aux allures d’intrigue policière qui le place progressivement au premier rang de la narration. Passant de personnage secondaire à protagoniste avisé, le voyageur révèle que le pouvoir se trouve là où se cache l’information.
Enfin, l’écriture du voyage en Inde demande d’avoir une attention particulière pour le thème de l’animal. Alors qu’elles occupent une place privilégiée au sein du panthéon hindou, les bêtes deviennent un outil servant à la description de la population et de ses pratiques religieuses. Aborder la variété zoologique en vue de la classer permet alors aux voyageurs de révéler certains animaux, chers à la tradition hindoue, afin de mieux interroger la bestialité du peuple indien. Par le biais du bestiaire, ils présentent indirectement une partie des croyances religieuses de ceux qu’ils observent. Plus globalement, les voyageurs français du xviie siècle, trouvent dans le récit de voyage un intermédiaire qui leur permet d’introduire la culture hindoue en France. La curiosité qu’ils éveillent au sein du lectorat français incite les auteurs sédentaires à développer le motif indien dans leur travail de fictionnalisation. Le voyage en Inde s’impose alors à travers la traduction de textes antiques mais aussi par la mise en récit de traductions fictives. L’Inde du Grand Siècle est aussi un espace exploité pour transposer des récits satiriques 16ou peut être sollicité en vue de réactualiser le souvenir d’une gloire nationale éteinte. Quoiqu’il en soit, il est bien question de trouver son inspiration dans les curiosités indiennes en vue d’élaborer une intrigue franco-indienne. Le dernier chapitre de cette étude propose la juxtaposition de plusieurs vignettes fictionnelles caractéristiques de la situation littéraire du motif indien. L’objectif de ce panel est de montrer l’influence de la littérature de voyage qui a favorisé la place grandissante de l’Inde au sein de l’histoire littéraire française et ce, dès le xviie siècle.
Divisée en trois parties et huit chapitres cette étude s’intéresse principalement à la construction littéraire de l’Indien qui devient, sous la plume des auteurs français, le représentant de la domination culturelle de l’Europe sur les pays d’Outre-mer. Il ne s’agit pas de considérer ces représentations comme des images arbitrairement accolées aux Indiens par les Français. En effet, il faut prendre en compte la relation entre l’accumulation d’informations recueillies par les voyageurs et la concision nécessaire à leurs retransmission textuelle pour le public sédentaire. Placée au centre de la vie mondaine et laïque, l’Asie déclenche un engouement intellectuel à partir du milieu du xvie siècle. De fait, il devient central de traduire le monde indien à partir de collectes d’objets précieux mais aussi de textes authentiques. Toutefois, la diversité culturelle à laquelle les Européens se trouvèrent confrontés les conduisit à compléter les interprétations de certaines données en s’appuyant sur les travaux de leurs prédécesseurs. Les récits de voyage en Inde donnent ainsi à leurs auteurs la possibilité d’amasser une quantité intéressante de nouvelles informations utiles à l’établissement commercial français, tout en attisant la curiosité du public intellectuel mondain. Les voyageurs français peuvent alors, grâce à l’écriture, associer leur nom au processus de représentation de l’Inde en Europe, amorcé au xvie siècle7. Comme l’a démontré Sanjay Subrahmanyam, « les deux sphères les plus importantes de la vie indienne représentées au début du xviiie siècle furent assurément celles relevant du “politique” et du “religieux”8. » C’est donc inspiré de cette analyse que le plan de notre étude a été construit. À ces deux pôles, nous ajoutons l’imagologie indienne mise en place par les voyageurs et leurs contemporains sédentaires. D’un 17côté, les voyageurs développent un bestiaire caractéristique du monde indien. Par ailleurs, l’Inde fournit à l’écriture viatique un ensemble de figures typiques qui seront exploitées par les auteurs français. Il s’agit en dernier lieu de s’intéresser à cette réécriture du voyage par des écrivains qui ne connaissent de l’Inde que ce qu’ils en ont lu.
Le choix du corpus viatique sur lequel se construit cette étude s’établit à partir de trois critères majeurs : la datation des voyages, tous effectués par voie maritime, leur itinéraire, faisant intervenir l’Inde au sein des Indes orientales dans leur ensemble et l’authenticité avérée des écrits étudiés. Partant du postulat que ces récits de voyage relèvent de la littérature9, un ensemble de questions problématiques apparaissent. En effet, les voyageurs français inspirés par leurs pairs antiques, semblent reprendre un ensemble de topoï littéraires, propres au genre du récit de voyage, en s’appuyant sur un ensemble de préjugés perpétués de siècle en siècle. Ils élaborent des observations souvent teintées d’une objectivité biaisée par leurs attentes et par l’impératif de répondre à celles du public. Par ailleurs, les libertins tissent des récits généralement portés par un double discours, au centre duquel le voyageur, dans un état d’esprit cathartique oscille entre adhésion et opposition face à cet ailleurs lointain.
Le choix de la période qui séquence cette étude s’attache à l’avant Pondichéry en tant qu’établissement français en Inde. Elle commence 18avec le voyage de Pyrard de Laval en 1601 et se clôture sur les Mémoires de François Martin rédigés entre 1665 et 1696. En effet, le découpage choisi obéit aux mouvements charnières de l’Histoire des débuts de la présence française en Inde. Ce sont bien les travaux précurseurs de Pyrard de Laval et François Martin de Vitré qui raniment l’intérêt de Henri IV pour le développement d’une Compagnie des Indes. Inspiré du modèle hollandais, Richelieu relance l’activité française, commerciale et missionnaire, vers l’Asie10. Alors que l’Inde française n’existe pas encore et que les voyageurs sont, pour la plupart, motivés par des intentions commerciales ou politique : ils participent à l’appel de l’Inde, national et prometteur, tant du point de vue commercial que littéraire. Choisir d’arrêter la période d’étude au tout début du xviiie siècle, c’est s’adapter au tournant historique marqué par l’éclatement de l’empire moghol en 1707 et la mort de François Martin, en 1706, suite à laquelle le développement de Pondichéry est fortement ralenti. D’un point de vue littéraire, on assiste à la volonté de valoriser le territoire indien tout en développant le portrait du Grand Moghol, perçu comme un tyran fanatique dont les ressorts absolutistes, inspirés du Moyen-Orient, sont bien connu du lecteur. Enfin, les principaux adversaires européens au xviie siècle sont incarnés par les Portugais, les Hollandais et les Anglais. Toutefois, le rôle de ces derniers n’est pas encore central dans la rivalité contre la France qui ne souffrira de leur influence qu’à partir des années 1730.
Malgré leur part de fictionnalisation, tous les voyages étudiés sont reconnus authentiques au moment de leur parution et encore considérés comme tels par la critique moderne. Par ailleurs, la durée du séjour et la sensibilité du voyageur modifient souvent la conception que se fait ce dernier de l’Inde, tandis que certains thèmes, descriptifs ou narratifs, souvent repris au modèle antique, sont communs à tous les écrits viatiques. Étudier l’écriture de l’altérité, à partir d’un ensemble de textes publiés durant tout le Grand siècle, met au jour les stratégies discursives développées par les auteurs français pour valoriser l’espace indien. Ainsi, les merveilles indiennes stimulent à la fois les ambitions marchandes des commerçants mais elles comblent aussi les aspirations littéraires et idéologiques de leurs plus habiles observateurs.
1 Frédéric Tinguely, L’Écriture du Levant à la Renaissance. Enquête sur les voyageurs français dans l’Empire de Soliman le Magnifique, Genève : Droz, 2000. –, Le Fakir et le Taj Mahal. L’Inde au prisme des voyageurs français du xviie siècle, éd. Baconnière Arts / BGE, 2011. –, Le voyageur aux mille tours. Les ruses de l’écriture du monde à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2014. –, La Lecture complice. Culture libertine et geste critique, Genève, Droz, « Les seuils de la modernité », 2016.
2 Marie-Françoise Bosquet (dir.), Aux confins de l’ailleurs : Voyage, altérité, utopie, Hommages offerts au professeur Jean-Michel Racault, Paris, Klinckieck, 2006.
3 Jacques Chupeau, « Les Récits de voyage aux lisières du roman », Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 77, no 3-4 (mai-août), p. 536-553.
4 Marie Fourcade, Ines G. Županov (dir.), L’Inde des Lumières. Discours, histoire, savoirs (xviie-xixe siècle), Paris, EHESS, coll. « Puruṣārtha », 2013.
5 « Leur approche à la plupart des historiens français empirique, positiviste des archives et des monuments a été et demeure assurément louable, mais elle s’est limitée à la description et à un horizon d’interprétation très étroit. Le refus de l’interdisciplinarité les a également coupés d’une plus grande communauté intellectuelle de lecteurs qui, lorsqu’ils ont utilisé leur travail l’ont traité comme une sorte de monument d’antiquité. », Marie Fourcade, Ines Županov (dir.), L’Inde des Lumière, Ibid., p. 18.
6 Guillaume Bridet, L’Événement indien de la littérature française, ELLUG, coll. « Vers l’Orient », 2015.
7 Sanjay Subrahmanyam, L’Inde sous les yeux de l’Europe. Mots, Peuples, Empires, Paris, Alma Éditeur, 2018, p. 42.
8 Ibid., p. 63.
9 « Les années 1660 marquent la promotion de la littérature des voyages “au rang d’une littérature de masse” du public cultivé ». (Sylvie Requemora-Gros, « L’espace dans la littérature de voyages », Études littéraires, 341-2, 2002, p. 249) Ainsi, bien qu’étant considérés comme des ouvrages de documentation et d’information durant la période du xvie au xviiie siècle, les récits de voyage intéressent la critique littéraire depuis la fin des années 1970. En effet, le voyage s’écrit suivant deux pôles : le récit réel narrant l’expérience authentique du voyageur ou le récit imaginaire dont le voyage devient un thème littéraire. Dans le premier cas, le récit se définit grâce à un voyageur-référent véritable qui est contraint de reproduire le monde tel qu’il est pour en transmettre les informations à son lectorat. C’est dans cet effort didactique que se développe le récit de voyage authentique : « il inscrit donc en littérature le refus même de la littérature, en proclamant la primauté de l’expérience et de la vérité sur l’imaginaition et ses fictions. » (Pierre Rajotte, « Aux frontières du littéraire : récits de voyageurs canadiens-français au xixe siècle », Voix et Images 193, 1994, p. 548.) Cependant, étant donné que les intentions des voyageurs-auteurs sont particulières à chacun d’entre eux, leur travail d’écriture met au jour une poétique caractéristique de la littérature de voyage. Ainsi, définissant cette dernière comme une littérature hybride, empreinte d’interférences littaires, Sylvie Requemora-Gros propose notamment « d’étudier l’art d’écrire le voyage, c’est-à-dire d’analyser les procédés littéraires servant à exprimer le voyage, du point de vue des genres et de leurs structures. », Voguer vers la modernité. Le voyage à travers les genres au xviie siècle, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012, p. 33.
10 Claude Markovits (dir.), Histoire de l’Inde moderne, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1994, p. 172.