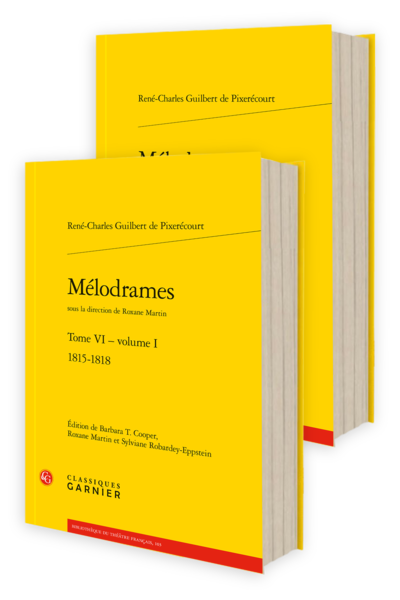
Avant-propos
- Publication type: Book chapter
- Book: Mélodrames. Tome VI. 1815-1818
- Pages: 9 to 11
- Collection: French Theatre Library, n° 103
- CLIL theme: 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN: 9782406158776
- ISBN: 978-2-406-15877-6
- ISSN: 2261-575X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15877-6.p.0009
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 05-22-2024
- Language: French
avant-propos
Les années 1815-1818, couvertes par ce sixième tome, constituent une période de transition dans la carrière de Pixerécourt, qui se voit désormais malmené par une partie de la critique dramatique. Son ralliement à la monarchie restaurée, assumé dès 1814 avec Charles le Téméraire, mélodrame aux accents antinapoléoniens1, lui vaut les attaques féroces des opposants au nouveau régime. Associé aux ultras, l’auteur peine à faire représenter ses mélodrames, au point qu’il choisisse de recourir à l’anonymat. Le pseudonyme « M. Charles », qu’il utilise pour les deux mélodrames joués en 1816, ne parvient toutefois pas à l’épargner des fureurs de la cabale. Les premières représentations sont l’enjeu d’affrontements violents entre ultras et libéraux, et le théâtre de la Gaîté doit endosser les frais engagés pour des pièces qui tiennent laborieusement l’affiche.
Christophe Colomb ou la Découverte du Nouveau Monde (1815), pour lequel la paternité de Pixerécourt a été dévoilée et où l’attraction du public est assurée par la construction d’un imposant décor représentant le pont d’un navire, réussit difficilement à être joué 48 fois. Le Suicide ou le Vieux Sergent (1816), mélodrame au royalisme affiché que Pixerécourt choisit de produire sous couvert d’anonymat, fait un four mémorable de telle manière que l’auteur envisage la fin de sa carrière. La pièce, bruyamment sifflée lors de la première et rapidement remaniée en deux actes, est retirée de l’affiche au bout de la 24e représentation. Le Monastère abandonné ou la Malédiction paternelle (1816), joué sous pseudonyme, connaît un meilleur sort. Malgré les tumultes orchestrés par les détracteurs de l’auteur, le mélodrame reçoit le soutien de critiques qui désormais admettent le caractère infondé des contestations vociférées au parterre pour chaque production nouvelle. Le Monastère abandonné atteint les 267 représentations à Paris et permet à Pixerécourt de renouer 10avec le succès. La Chapelle des bois ou le Témoin invisible (1818), dont le sujet est puisé dans l’actualité judiciaire, confirme l’apaisement des relations entre l’auteur et son public. Le mélodrame est joué 157 fois à Paris. Le Belvédère ou la Vallée de l’Etna (1818), qui marque le retour de Pixerécourt au théâtre de l’Ambigu-Comique, remporte un triomphe tout aussi exemplaire. La paternité de l’auteur reste toutefois masquée jusqu’au soir de la première représentation.
Les attaques contre la formule du mélodrame pixerécourtien, avec lesquelles l’auteur devra désormais composer, se fondent sur deux arguments. Le premier est d’ordre politique. Le mélodramaturge ne cache nullement son soutien à la couronne. Rédacteur au journal ultra La Quotidienne en 1815, membre de la garde nationale en 1816, il s’affiche dans les banquets organisés par la garde royale créée par Louis XVIII et prononce des couplets sur la scène de l’Odéon lors d’une fête donnée en présence du roi et de sa famille. Jamais explicitement évoquée dans les papiers à charge pour des raisons évidentes de censure, l’alliance de Pixerécourt aux Bourbons arme la plume de la presse libérale. L’autre argument qu’elle fait prévaloir réside dans la promotion d’une nouvelle génération d’auteurs, empêchée selon elle par l’autorité toute puissante de Pixerécourt sur les scènes secondaires. Des pamphlets sont mis en circulation sur les boulevards du Temple et Saint-Martin dont l’un d’entre eux annonce clairement le motif de l’attaque, puisqu’il s’agit d’un Jugement définitif et sans appel du tribunal invisible et redoutable, portant déchéance de l’usurpateur-mélodramaturge et nomination d’un nouveau prince régnant (1815).
Le contexte de réception, certes tumultueux, des cinq mélodrames de ce tome ne doit cependant pas occulter les expérimentations que Pixerécourt sait encore entreprendre. Contraint par une cabale persistante, il décline son écriture mélodramatique sous des formules variées. Dans Christophe Colomb, il travaille la couleur locale jusqu’à introduire la langue caraïbe dans ses dialogues. Mal reçu par la critique, le procédé n’en reste pas moins audacieux et présente les caractéristiques finalement très « modernes » d’un mélodrame polyglotte. Avec Le Suicide, pièce à thèse, l’auteur évacue les traditionnels personnages-types du mélodrame et intègre, dans Le Belvédère, une toute nouvelle technique de décoration théâtrale, le diorama, mis au point par Louis Daguerre. Dans Le Monastère abandonné, il invente la formule du « mélodrame 11judiciaire », annonciatrice du « drame en habit noir », qu’il parachève avec La Chapelle des bois. Autant dire que notre édition critique, qui s’appuie sur l’ensemble des documents conservés (manuscrits de l’auteur, de la censure, du souffleur, éditions, matériels d’orchestre manuscrits), offre un panel intéressant pour apprécier la modernité de l’écriture pixerécourtienne à l’orée de la Restauration. Les cinq mélodrames de ce tome, dont quatre ont été enrichis de leur musique de scène originale, présentent des dispositifs dramatiques précurseurs, révélant combien Pixerécourt est loin d’apparaître comme un auteur suranné, en dépit de l’image façonnée par quelques contemporains et perpétuée jusqu’à nous.
Roxane Martin
1 Voir la « Présentation » de la pièce, par Barbara T. Cooper, dans cette édition (t. 5).