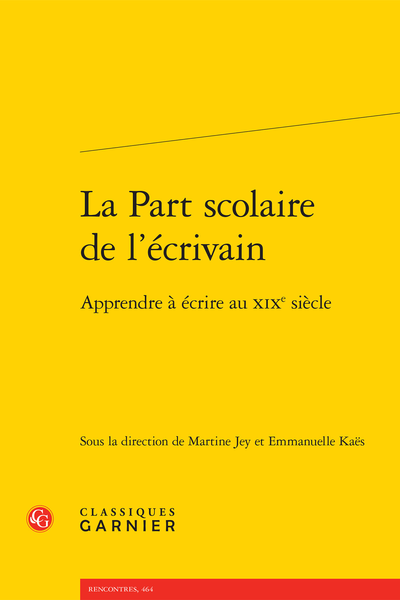
Présentation
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Part scolaire de l’écrivain. Apprendre à écrire au xixe siècle
- Auteurs : Jey (Martine), Kaës (Emmanuelle)
- Résumé : Quel discours doxique l’école construit-elle sur la littérature par les exercices, les manuels, les examens ? La première partie de cet ouvrage dessine les contours des modèles scolaires, soumis à l’imitation des lycéens. Dans la seconde partie est retracée l’entrée en littérature d’écrivains, de Sainte-Beuve à Marcel Pagnol.
- Pages : 15 à 22
- Collection : Rencontres, n° 464
- Série : Études dix-neuviémistes, n° 54
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406105022
- ISBN : 978-2-406-10502-2
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10502-2.p.0015
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/12/2020
- Langue : Français
- Mots-clés : Doxa, baccalauréat, ouvrages scolaires, premiers écrits, parcours, écrivains
PRÉSENTATION
Quel discours doxique l’École construit-elle sur la littérature par le biais d’ouvrages scolaires, d’examens ? Quel modèle façonné par l’École est soumis à l’imitation des lycéens ? S’emploie à en dessiner les contours la première partie de cet ouvrage, déclinée en trois temps.
Les sujets de baccalauréat constituent un terrain d’observation privilégié pour appréhender la nature des pratiques d’écriture dans le secondaire. Marie Humeau et Martine Jey s’attachent d’abord à comparer les compositions latine et française données de 1853 à 1857 au baccalauréat. Cette comparaison établit, au delà des divergences et des similitudes, la filiation avec les exercices de rhétorique antique. En ressortent aussi les qualités exigées dans ces compositions : connaissances étendues et diverses, labilité dans la posture énonciative et dans l’expression. Marie Humeau porte ensuite son attention sur la composition latine, seule composition au baccalauréat de 1857 à 1879. Pourquoi et comment apprenait-on alors aux jeunes Français à composer en latin ? La finalité principale, la construction d’un ethos, irrigue l’ensemble. Est défini le rôle attribué aux auteurs, aux modèles littéraires et aux valeurs portées par la res litteraria dans cet apprentissage du « bien écrire ». C’est par le prisme des auteurs enfin que Martine Jey interroge la notion de modèle. Sur quels auteurs les lycéens composent-ils ? De quelles autorités sont-ils invités à examiner ou à développer les adages ou les jugements littéraires ? Quels sont les modèles d’auteurs, de genres, de styles, ainsi proposés en exemples à imiter ? L’École par la sélection des auteurs, les liens qu’elle établit entre eux, édifie un bon usage de la littérature : matrice d’artefact et de stéréotypes.
L’École, par le biais des manuels, construit son discours sur les formes en fonction des transformations des exercices qu’elle fait pratiquer et selon des critères idéologiques et moraux. C’est l’objet des travaux consacrés aux formes du portrait et de la satire.
16Trois contributions éclairent les enjeux scolaires d’un genre aux frontières floues, celui du portrait. Laetitia Perret s’attache aux Leçonsdelittérature et de morale de Noël et Delaplace, recueil de morceaux choisis réédité de 1804 à 18621. En s’appuyant sur les tables des matières de neuf éditions successives, ellemet en évidence l’éloignement progressif des cadres de la rhétorique et les prémices d’un enseignement de la littérature. Les « caractères » permettent à l’élève d’appréhender les contraintes rédactionnelles du portrait, et de connaître les grandes figures littéraires, politiques et historiques. Le genre du parallèle donne à voir une autre évolution de l’enseignement des Belles-Lettres vers la littérature : la part de l’antiquité gréco-romaine se réduit au profit des œuvres nationales. C’est cette reconfiguration de l’enseignement de la littérature qu’aborde Nathalie Denizot. Dans le discours scolaire du xixe siècle, le portrait, loin d’être un genre autonome, est corrélé aux catégories de la description et de l’hypotypose ainsi qu’à celles du parallèle et du caractère, catégories avec lesquelles il entretient des rapports fluctuants de voisinage ou d’inclusion. Propre à la sociabilité mondaine, le portrait « littéraire2 » est resté aux marges de l’enseignement de la rhétorique qui lui a préféré le portrait historique et le caractère. Vers 1890 encore, les portraits dans les manuels restent majoritairement tirés de textes de mémorialistes et d’historiens ; leur origine épidictique les rend plus conformes aux visées morales de l’enseignement. Par le privilège accordé à l’individu sur le type, le genre du portrait s’infléchira ensuite vers plus de « réalisme ». Sont ainsi mis en évidence l’historicité des genres scolaires, leur genèse par « sédimentation ». Ce diptyque tourné vers l’enseignement secondaire s’enrichit de la réflexion d’Anne-Marie Chartier : autour du portrait s’opposent deux conceptions de l’écriture et deux usages scolaires de la littérature. Au lycée, les « grands auteurs » ; à l’école primaire, des exercices de rédaction ancrés dans l’expérience vécue pour lesquels les écrivains sont moins des modèles littéraires que des pourvoyeurs de ressources langagières. Si, vers 1920, les manuels du primaire supérieur proposent encore des exercices de rédaction en relation avec des portraits littéraires de Lamartine et de Balzac, dans les années 1940-1950, le portrait disparaît définitivement comme exercice d’écriture séparé.
17La satire est au centre de deux études complémentaires qui font dialoguer l’approche scolaire de la satire au xixe siècle et le texte d’un élève de rhétorique, « La satire et l’esprit français » de Marcel Proust. Pauline Bruley et Romain Benini livrent les résultats de leur enquête sur les enjeux scolaires de la satire littéraire, menée à partir d’un large corpus de manuels et de sujets d’examens du xixe siècle. Comment l’institution scolaire s’approprie-t-elle le corpus satirique ? Les auteurs proposent d’abord une réflexion définitionnelle et typologique sur le genre et ses auteurs. Tout au long du xixe siècle, la satire peut être un genre, un type de texte ou se réduire à une tonalité proche de la raillerie. Les auteurs de satire se répartissent en trois catégories : modèles, repères, jalons de l’histoire scolaire du genre, et exemples. Les contours de la satire, inscrite dans le style bas, sont ensuite délimités du point de vue moral et idéologique. Le genre pose un problème majeur à l’institution. Condamnée lorsqu’elle n’est pas subordonnée à un projet d’édification, la satire est le seul genre soustrait à l’impératif scolaire d’imitation des modèles. Enfin, de Nisard à Lanson, la satire se voit inscrite dans la tradition de « l’esprit de critique railleuse » caractéristique de « l’esprit français ». C’est à partir de cette catégorie de l’entendement littéraire, commune à l’École et à la critique, que la satire est abordée en 1887 par le jeune Proust dans une esquisse sans doute destinée à un journal lycéen. Il y aborde l’esprit satirique comme l’une des facettes de « l’esprit français » « léger, ironique et piquant ». Emmanuelle Kaës montre que le texte du lycéen intègre la culture scolaire, par l’évocation d’« auteurs de manuels » et de morceaux choisis, tout en reconfigurant l’histoire scolaire du genre. Silencieux sur la satire de l’époque classique, il approfondit deux moments que l’École efface ou relègue à l’arrière-plan, le Moyen Âge et « la littérature d’aujourd’hui ». C’est en réalité un récit de la naissance de l’écrivain que le rhétoricien inscrit dans le filigrane de son histoire. Il y projette sa propre entrée en littérature par la critique littéraire constituée en terminus ad quem de cette histoire de la satire.
De l’inculcation des normes grammaticales à l’apprentissage de la « belle langue », fondé sur l’imitation des grands auteurs et structuré par la maîtrise des genres d’écriture, l’École est le lieu des apprentissages linguistiques. Les pratiques scolaires de la langue ou d’analyse de la langue sont au cœur des trois contributions suivantes.
18Pauline Bruley montre qu’en classe, dans la seconde moitié du xixe siècle, la phrase comme notion et comme production écrite correspond à des définitions et à des réalités plurielles. À l’école primaire ou en cours élémentaire, il s’agit surtout d’enseigner un modèle analysable de la phrase donnant lieu à une composition guidée. Pour les élèves du lycée, entraînés au latin, la phrase est aussi une unité pédagogique, un découpage du texte pourvu d’une unité sémantique. Ceci explique la concurrence persistante entre phrase et proposition. Même si l’on considère plus couramment la phrase comme l’intégrant des propositions, la différence entre approche logique et grammaticale n’est pas unanimement résolue. Au lycée, en français, le flottement entre proposition, phrase et période s’observe encore, mais la phrase s’offre désormais comme un cadre non-marqué d’intégration, tandis que l’on promeut un nouveau modèle de phrase claire. La transmission scolaire de la langue de la littérature favorise la stéréotypie. Emmanuelle Kaës s’intéresse à la réflexion de Remy de Gourmont au tournant des xixe et xxe siècles qui met en évidence le lien unissant les clichés littéraires à l’enseignement de la rhétorique. Par le rôle central qu’il accorde à la citation, à la mémorisation de formules, l’enseignement secondaire est, selon le critique, l’un des principaux vecteurs de la stéréotypie. Deux ressources fondamentales des apprentissages rhétoriques, la mémorisation et l’imitation, sollicitées par l’enseignement du xixe siècle, vont être redéfinies par Gourmont à la lumière des sciences contemporaines : la théorie de l’amnésie de Ribot et « les lois de l’imitation » de Tarde. Si Gourmont disqualifie le cliché du point de vue de la valeur littéraire, il lui reconnaît un rôle positif dans la communication, renouant ainsi avec la défense rhétorique des lieux communs.
Peut-on mettre en évidence l’effet d’une pratique scolaire d’écriture sur le style d’un écrivain ? C’est la question que pose Stéphanie Bertrand au sujet de l’écriture aphoristique d’André Gide, fréquente dans ses textes d’idées, en particulier dans le genre didactique du traité. Phrase généralisante, ciselée et brève, à sujet moral ou esthétique, l’aphorisme ne correspond pas à un « genre scolaire » identifié comme tel. Il s’inscrit néanmoins dans une culture scolaire qui continue à diffuser l’art du bon mot et du « trait », de la littérature moraliste de La Fontaine et de Boileau. L’aphorisme intervient aussi dans les apprentissages secondaires à la fin du xixe siècle : l’écriture de maximes figure parmi les exercices 19préparatoires au baccalauréat proposés aux élèves de rhétorique. Or plusieurs textes de Gide se présentent comme la discussion d’un aphorisme ou comme son expansion narrative. C’est contre les procédés du « bien écrire » scolaire que l’écrivain définira son idéal stylistique.
Dans la seconde partie est retracée l’entrée en littérature d’écrivains, de Sainte-Beuve à Marcel Pagnol. Sans que soient établis liens de causalités ou schémas explicatifs, sont ici rapportées les premières expériences littéraires, aussi bien les premiers contacts scolaires avec la littérature que les premiers écrits d’écrivains. Autant de témoignages divers, parcours et formations scolaires, positions critiques et textes d’écrivains, autant d’esquisses, autant d’échos aux analyses précédentes. Cette partie est structurée en trois temps, suivant un itinéraire chronologique, du critique tôt reconnu de l’institution littéraire au provincial dont la reconnaissance a suivi d’autres modes de légitimation.
Élève exceptionnel, Sainte-Beuve fit de brillantes études à Boulogne-sur-Mer puis à Paris, où le désir de savoir le grec amena ce fervent des études classiques. Deux documents permettent à Romain Jalabert de cerner les contours de la culture scolaire d’un collégien de la Restauration. Tout d’abord, le carnet manuscrit tenu entre 1812 et 1818 : relevés de chries, thèmes latins, anecdotes morales tirées des auteurs antiques ou citations classées par thèmes. Au collège Bourbon, pendant sa seconde année de rhétorique, Sainte-Beuve se distingue auprès de son professeur Pierrot-Deseilligny, qui publie, dans un Choix de compositions françaises et latines, treize discours français et quinze discours latins de son élève en 1821-1822. Romain Jalabert en examine les dominantes thématiques et stylistiques : ses compositions en latin sont « correctes et sûres », tandis que ses devoirs français sont teintés de romantisme et parfois tirés vers la prose romanesque. Un continuum unit ces productions scolaires aux premiers essais littéraires de Sainte-Beuve, à ses réflexions sur la jeunesse et la gloire, et aussi aux Causeries du lundi.
Quelle place, en retour, le critique accorde-t-il à la formation scolaire des écrivains ? Alors que la biographie est au cœur de la méthode critique beuvienne, les années de formation occupent une place mineure et souvent allusive dans les portraits des Causeries du lundi. En revanche, les réflexions théoriques sur l’enseignement jalonnent son œuvre, du « système d’éducation » de Rabelais à la monumentale étude sur Port-Royal dans laquelle il met en perspective le lycée de son époque marqué 20par le Traité des études de Charles Rollin et les innovations pédagogiques tentées dans les Petites-Écoles. S’appuyant sur les témoignages d’anciens camarades de l’écrivain, Marianne Berissi retrace le parcours scolaire sans éclat d’Hector Malot, fils de notaire, élève du collège Corneille de Rouen entre 1842 et 1847. Elle met en évidence les tensions qui traversent son rapport à l’écriture : ses options politiques progressistes d’écrivain engagé entrent en contradiction avec la facture académique de son œuvre. L’École a laissé une empreinte théorique et formelle forte sur ses écrits de jeunesse. Dans sa première chronique, une défense du roman dressée contre l’École et l’Université, Malot, contre toute attente, met en œuvre les « patrons » du bien-écrire scolaire, reprenant les modèles oratoires de la déploration et du sermon. Le style de ses contributions sur la botanique dans le Journal pour tous porte trace de ses apprentissages secondaires, faisant apparaître ces fragments de « belle langue » scolaire.
Le deuxième temps est consacré à deux auteurs de la même génération, issus d’un même milieu social de grande bourgeoisie cultivée, André Suarès (1868-1948) et André Gide (1869-1951) : ils mènent une partie de leurs études secondaires dans les établissements de la capitale, dans une période de transition entre deux modèles, celui des Humanités modernes et celui des Humanités classiques. Leurs trajectoires scolaires présentent des traits communs : importance du socle culturel familial incarné par l’un des parents ; rôle capital du préceptorat propre à l’instruction des enfants de la bourgeoisie. Antoine de Rosny retrace la trajectoire scolaire de l’auteur du Voyage du Condottiere. Après une scolarité brillante au lycée Thiers de Marseille, il arrive en 1883-1884 au lycée Henri-IV où se maintiennent les fortes exigences des Humanités classiques, dans le prolongement de sa formation initiale et de l’élitisme intellectuel dans lequel son père l’a élevé. Un travail acharné lui permet d’accéder aux premiers rangs de sa classe de rhétorique puis du Concours général. Suarès intègre l’année suivante l’École Normale Supérieure qu’il quittera après un échec à l’écrit de l’agrégation d’histoire : il avait rédigé une composition sur Dioclétien en « style mallarméen », détail symptomatique de l’éthos discursif de Suarès. Quant à André Gide, son parcours scolaire, retracé par Stéphanie Bertrand, est irrégulier et désordonné. À l’instruction bourgeoise dispensée dans le cadre familial (marquée par le préceptorat d’Élie Allégret) succèdent des établissements 21parisiens, l’École alsacienne et le lycée Henri-IV, ce parcours parisien étant entrecoupé de plusieurs séjours dans des lycées de province. De cette « instruction si brisée », Gide retient avant tout le rapport maître-élève dans lequel l’écrivain ne peut se projeter que dans le rôle du Maître et élabore une figure auctoriale fondée sur l’autodidaxie qui apparaît dans le paratexte et dans l’œuvre elle-même.
Deux études, enfin, interrogent le rapport à l’institution scolaire d’auteurs provinciaux, Marie Noël, poétesse catholique auxerroise, et Marcel Pagnol. Leur reconnaissance par l’institution littéraire s’accomplit soit par la grande diffusion – les récits autobiographiques de Pagnol connaissent un succès immédiat –, soit par leur insertion dans les programmes scolaires : l’auteur de La gloire de mon père figure dans les manuels des premières classes du secondaire tandis que les poèmes de Marie Noël apparaissent dans les anthologies scolaires du xxe siècle. Le parcours scolaire de cette écrivaine est abordé dans l’étude de Cécile Vanderpelen-Diagre. Retenus comme exemple d’une poésie chrétienne simple et quotidienne, les poèmes de Marie Noël (1883-1967), tirés principalement du recueil LesChansons et les heures, figurent dans certaines histoires de la littérature et manuels scolaires comme le Lagarde et Michard. Fille d’un agrégé de philosophie, élève de l’enseignement secondaire féminin à Auxerre, elle construit pourtant sa posture d’auteur sur son illégitimité : « Je ne suis qu’une bonne femme qui, de sa cuisine à son église, n’a rencontré que par hasard un encrier3 ». Fort éloignée du monde littéraire, son écriture est marquée par le canon stylistique de l’enseignement secondaire public féminin français ainsi que par les hommes qui l’entourent, très impliqués dans l’institution scolaire républicaine. Mettre en regard ces codes prescrits et les œuvres de Marie Noël éclaire l’histoire peu connue de l’entrée en littérature pour les filles de l’école publique en France. C’est la notion de posture qu’Hélène Rivière place au cœur de son étude sur Marcel Pagnol, fils d’instituteur, élève boursier puis professeur d’anglais au lycée Condorcet jusqu’en 1925. Dans les cinq volumes de ses Souvenirs d’enfance (1957-1977), son éthos auctorial de « conteur nostalgique » est lié à la « présentation » plaisante de ses apprentissages scolaires. Sa trajectoire sociale est celle d’un « transfuge de classe » qui, dans la première phase, parisienne, de sa carrière théâtrale 22et cinématographique, efface ses origines méridionales et populaires. Lorsqu’à la fin de sa vie, il se retourne vers sa jeunesse, la part scolaire des Souvenirs sert un processus de réidentification.
Martine Jey
Sorbonne Université INSPÉ
CELLF (UMR 8599)
Emmanuelle Kaës
Université de Tours-ICD (EA 6297)
1 Avant 1840, les manuels ont un impact fort sur les contenus d’enseignement : le baccalauréat ne concernant qu’une infime partie de la population, les professeurs se sentent peu liés par les programmes officiels.
2 Sur ce point voir Jacqueline Plantié, La mode du portrait littéraire en France, Paris, Honoré Champion, 1994.
3 Cité par Raymond Escholier, Marie Noël. La Neige qui brûle [1957], Association Marie Noël-Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 2010, p. 112.