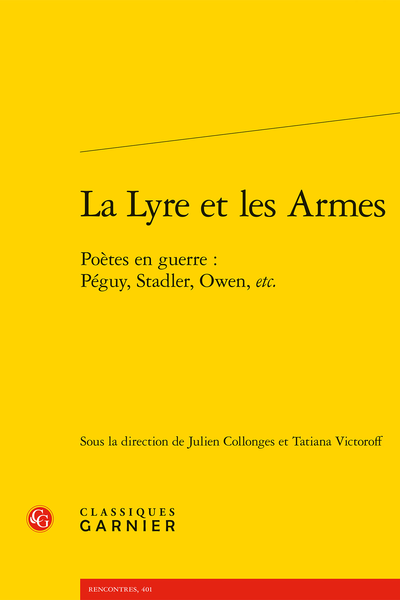
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Lyre et les Armes. Poètes en guerre : Péguy, Stadler, Owen, etc.
- Pages : 489 à 502
- Collection : Rencontres, n° 401
- Série : Littérature générale et comparée, n° 30
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782406083078
- ISBN : 978-2-406-08307-8
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08307-8.p.0489
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/09/2019
- Langue : Français
Résumés
Tatiana Victoroff, « Introduction »
« Envoyer un poète à la guerre – c’est comme faire cuire un rossignol » s’exclamait Nicolas Goumilev, à l’été 1914. La poésie et la guerre paraissent contradictoires : l’une nous rend sensible l’harmonie du monde, l’autre la détruit ; la première opère par la parole et la subtilité des mots, la seconde par la brutalité des armes qui sèment la mort. Comment le poète pourrait-il trouver sa place parmi les combattants ? Et peut-on, quand la guerre éclate, continuer à écrire de la poésie ?
Salah Stétié, « Guerre et poésie (entretien avec Jean-Yves Masson) »
Tout poète est, en temps de guerre comme en temps de paix, un résistant par nature. Il aide les combattants par l’espérance qu’il porte en lui d’une victoire sur l’extravagance aveugle de la guerre. Mais en temps de paix ils sont là également, ces hommes inspirés, qui se battent, dans le plus profond de l’inculte nuit tombée, pour que la lumière reprenne. Il n’y a pas de poète de guerre. Toute poésie est une inspiration d’amour et chante la paix même si celle-ci apparaît voilée : cendre et sang.
Stephen Romer, « La guerre, une parenthèse ? »
La Grande Guerre continue de fasciner. Mais à côté d’Apollinaire s’efforçant de contrer l’horreur et la désolation par l’image et la fantaisie, au-delà de la protestation moralisante des poètes de guerre anglais consacrés comme Owen ou Sassoon, il y eut durant la Grande Guerre de nombreux poètes et artistes pour estimer que la guerre et la poésie n’avaient strictement rien à se dire et que la guerre demeurait « une parenthèse » effroyable qu’ils auraient aimé fermer le plus tôt possible.
490Michèle Finck, « Poésie et musique face à la guerre. Trakl, Ungaretti, Britten »
L’étude compare le poème « Grodek » de Georg Trakl, redoutable face à face avec la Grande Guerre, le poème « Veillée » de Giuseppe Ungaretti, écrit lui aussi depuis la Grande Guerre, mais avec la seule arme verbale de l’épure, du laconisme et du blanc typographique, et enfin le War Requiem de Britten, sur des poèmes de guerre d’Owen, qui élargit la synthèse : la poésie mais aussi la correspondance de la poésie et de la musique ne permettent-elles pas une catharsis régénératrice et sotériologique ?
Olga Sedakova, « Le poète et la guerre »
La guerre poétique, c’est la guerre d’antan, le combat singulier. Mais les moyens d’extermination massive de la Grande Guerre ont fait de ses participants des anonymes, des soldats inconnus. Ils sont devenus cibles plutôt qu’acteurs et cela est incompatible avec le destin du poète. Non que le poète soit plus « précieux » que les autres, mais simplement parce qu’il est « porteur de sens ». Penser aux poètes « morts à si bas prix » suscite la révolte et le désir de faire « la guerre à la guerre ».
Jacques Darras, « La poésie dans la commémoration de 14-18 ou l’impasse de la patience »
Comment commémorer la guerre de 14-18 sinon dans et par la poésie ? La guerre de 14-18 a créé une crise immense, béante, dans l’imagination humaine. Cet article pose l’hypothèse que les poètes sont les seuls à avoir accompagné le conflit dans toutes ses dimensions contradictoires, les seuls à avoir livré une appréciation honnête et sensible, sinon une explication définitive, de l’ampleur du désastre.
Olivier-Henri Bonnerot, « Ceux qui tiraient dans les étoiles »
Les hommes disparaissent par milliers dans les « Orages d’acier » que multiplient l’intransigeance et la bêtise aveugle. Il s’agit de regarder comment deux motifs poétiques – le chant, la lyre – et – le feu, les armes – muent à travers une suite de représentations : le feu agressif, cruel, meurtrier, puis le feu fraternel des « cessez-le-feu », enfin le feu des Hommes répondant au feu des Dieux, feu de la conflagration cosmique qui métamorphose le guerrier en poète et réunit les frères ennemis.
491Jennifer Kilgore-Caradec, « Blessures profondes dans les œuvres d’Owen, Péguy et Stadler »
Charles Péguy et Ernest Stadler sont des poètes mûrs quand ils partent au front, Wilfred Owen, de la génération suivante, fera de la guerre toute son inspiration. Pour des raisons différentes, la blessure est un motif de leur poésie, souvent avec la notion chrétienne d’expiation en toile de fond, même si celle-ci est parfois détournée. Tous trois modernistes à leur manière, le classicisme et l’architecture ecclésiale sont d’autres motifs communs à leur poésie.
Charles Fichter, « Ernst Stadler, Charles Péguy et la guerre, ou Parzival contre Jeanne d’Arc »
La légende selon laquelle Charles Péguy et son traducteur Ernst Stadler se seraient salués de tranchée à tranchée, avant de mourir à quelques semaines d’intervalle à l’automne 1914, cache un malentendu. Les Mystères de Péguy nous plongent dans une troublante méditation chrétienne sur un massacre annoncé par les pacifistes de l’époque. Et certains poèmes de Stadler montrent pourquoi l’intelligence pacifiste résiste mal à un retour d’une culture plus ancienne au moment du déferlement nationaliste.
Jean-Pierre Rioux, « Péguy en lieutenant d’infanterie »
Charles Péguy n’est pas mort en poète. Il a été « tué à l’ennemi », avec tant et trop d’autres, d’une mort réglementaire, disciplinée, d’officier menant sa troupe et d’une mort restée d’abord sans victoire. Mort sur horizon de mort et de consentement au risque de la mort. Et pourtant, malgré les honneurs officiels et les récupérations honteuses de Vichy, il est resté depuis l’été 1914 ce soldat apaisé, ce patriote pour désarmement général, espérant en poète, comme il l’avait été et le sera toujours.
Maurice Godé, « Les poètes et la Grande Guerre dans les revues expressionnistes allemandes Der Sturm, Die Aktion et Die Weißen Blätter »
Poète-phare du Sturm, Stramm traduit par le « mimétisme exacerbé » de sa poésie la réduction du combattant à un instinct de survie. La poésie publiée dans Die Weißen Blätter reflète l’idéalisme de la jeune génération (Stadler), puis se fait critique (Ehrenstein) et appelle les belligérants à abjurer toute violence 492(Schickele). L’écriture violente de Heym reflète l’aspiration de la jeunesse à changer le monde. Die Aktion s’ouvre à des poètes qu’inspire le message de paix du christianisme (Klemm).
Michèle Finck, « Georg Trakl, un poète assassiné par la guerre. Lecture de “Humanité”, “Grodek” et “Plainte” »
Si Georg Trakl n’est pas mort au front, il compte bien parmi les poètes assassinés par la première guerre mondiale. Sa mort en novembre 1914 est fondamentalement liée aux troubles psychiques graves causés par l’épreuve de la bataille de Grodek. Cet article propose une étude des poèmes « Humanité », « Grodek » et « Plainte » qui condensent les enjeux majeurs du face à face de Trakl avec la guerre. Il y va d’une remise en cause par la guerre de la légitimité et de la fonction de la poésie.
Yann Tholoniat, « “All the arts of hurting”. Souffrance et transcendance dans la poésie britannique de la Grande Guerre »
La guerre est un moment où le corps se risque, est susceptible d’être brisé, démembré, diminué. Les poètes anglais ont dû adapter leur écriture à cette violence concrète, afin d’en faire saisir les enjeux – et la violence – à travers les mots. De l’idéalisation du corps chez Brooke, à la destruction-déconstruction du corps chez Sassoon, Gurney et Owen notamment, le corps subit une transformation qui, de physique, dans l’espace poétique, vise une métaphysique, une transcendance impossible.
Tatiana Victoroff, « Mystère et guerre. Charles Péguy et Richard Brunck de Freundeck »
Au cours de l’année 1944, le graveur alsacien Richard Brunck de Freundeck illustre Le Porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy. Le choix des épisodes et des images comme la technique de l’eau-forte explicitent la volonté de l’artiste d’inscrire la marche de la petite fille Espérance, dont le poète écrit qu’elle seule « traversera les mondes révolus », dans le présent de la Seconde Guerre mondiale. L’album de Brunck est achevé d’imprimer le 25 août 1944, jour de la libération de Paris.
493Franck Knoery, « La blessure et la chute. Renouveau et paradoxes de l’iconographie du héros de guerre dans les arts graphiques en Allemagne lors du premier conflit mondial »
Si l’imagerie officielle de l’Empire allemand s’était employée à présenter la Première Guerre mondiale sous un jour victorieux, convoquant une iconographie du héros traditionnel, l’avant-garde artistique avait façonné d’autres représentations. Au héros teutonique immuable s’était substitué le corps fragilisé et diminué du sacrifié moderne. Cette imagerie nouvelle continuait cependant de véhiculer les mythes apocalyptiques apparus avant-guerre, associés à l’aspiration au renouveau de l’humanité.
Gilles Couderc, « Wilfred Owen, poète de guerre. La construction du mythe en littérature et dans les arts »
Dans le « Coin des Poètes » de l’abbatiale de Westminster, le mémorial aux poètes de la Grande Guerre donne la première place à Wilfred Owen, poète le plus étudié en Grande-Bretagne après Shakespeare. On retracera ici les étapes de la construction du mythe du poète, avec les premières publications de ses œuvres dans les années 1920 et 1960, mais aussi leurs résonnances dans la littérature et les arts, avec notamment le War Requiem de Britten qui a contribué plus que tout à la célébrité d’Owen.
Sophie Aymes-Stokes et Brigitte Friant-Kessler, « Entre traces et mémoire.Illustrer la poésie de la Grande Guerre »
L’article s’attache à définir la manière dont la gravure, qui relève d’un paradigme de l’inscription et de la trace, contribue à l’élaboration d’un imaginaire mémoriel en lien avec les poètes anglais de la Grande Guerre. Les illustrations de Paul Nash pour Images of War de Richard Aldington (1919), celles de Harry Brockway (2007) et de William Utermohlen (1997) pour les poèmes de Wilfred Owen permettent d’interroger les notions de témoignage et de commémoration, de monumentalité et d’évanescence.
Anne Mounic, « Poètes de la Grande Guerre. Le germe d’une pensée du singulier »
Le poème, chez les poètes de guerre, revient au sujet. Et celui-ci inverse son rapport à l’Histoire, qu’il se permet de juger. Cette étude envisage 494les modalités de cette pensée du singulier et de la subjectivité durant la Grande Guerre et ensuite. On opposera empathie et catharsis, épique et tragique. Est exploré ensuite le lien, éthique avant d’être esthétique, de l’œuvre et de la réalité selon le renversement des valeurs qu’induit une pensée du singulier.
Geraldi Leroy, « Du patriotisme de Péguy »
Les excès du « bourrage de crâne » ont compromis l’interprétation du patriotisme de Charles Péguy. Certaines déclarations de l’auteur ont certes pu prêter à confusion. Mais elles surprennent moins quand on les replace dans leur contexte. Fondamentalement, ce patriotisme est défensif et républicain et s’inscrit dans la tradition de la Révolution française. Il réactive l’enseignement civique de l’école primaire, renforcé par l’exaltation de l’héroïsme militaire voué à la défense de la patrie en danger.
Claire Daudin, « Les mises en récit de la mort de Péguy. Maurice Barrès, Georges Bernanos, Geoffrey Hill »
L’hommage rendu à Charles Péguy par Maurice Barrès dans son article nécrologique de L’Écho de Paris a fixé l’image d’un écrivain tombé en héros de la patrie, et lié la valeur de son œuvre aux circonstances de sa mort. Deux textes se sont inspirés de ce récit de propagande : Les Enfants humiliés de Georges Bernanos et The Mystery of the charity of Charles Péguy de Sir Geoffrey Hill, pour rétablir la vérité de l’homme et de l’œuvre.
Lioudmila Chvedova, « “Блажен, кто пал в бою за плоть земли родную” : traductions de Péguy en russe »
Cet article est consacré aux traductions de Charles Péguy en russe et aux sources de l’intérêt du traducteur et du lecteur russes pour le poète. Il s’agit en outre d’analyser la manière dont les traducteurs russes abordent les textes de Péguy sur la guerre. Mort en septembre 1914, Péguy n’a connu que le début de la tragédie, mais ses poèmes prophétiques annoncent des événements douloureux et le révèlent comme un auteur de dimension universelle, très proche de la mentalité russe.
495Tatiana Taïmanova, « Péguy sur la toile russe en 2014 »
L’article est consacré à une analyse critique de la présence de Charles Péguy sur la toile russe en 2014. Plusieurs sites sont analysés, comme Sensus Novus, revue en ligne qui cite Péguy et publie une abondante critique sur le poète, ou l’almanach Art de la Guerre, dans lequel a paru le texte d’Evguéni Loukine Deux soldats : Charles Péguy et Benedikt Livchits. Ce tour d’horizon permet de mettre en évidence des altérations et des méprises, mais aussi des publications remarquables et des tendances.
René Schickele, « “Abschwur” / “Abjuration” (traduction Maurice Godé) »
Né en 1883 d’une mère française et d’un père allemand, le poète alsacien René Schickele fut avec Ernst Stadler l’infatigable promoteur d’un rapprochement – via l’Alsace – entre les cultures romane et germanique de l’Europe. Aussi perçut-il la guerre comme une catastrophe personnelle, un déchirement entre deux parties de son être. Dans le poème « Abschwur » il tente, humblement et sans emphase, de tirer les enseignements de la guerre pour changer sa propre vie et son rapport au monde.
Ernst Stadler, « “Ballhaus” / “Dancing”, “Die Dirne” / “La putain” (traductions Julien Collonges) »
Militant dès 1902 avec René Schickele, Otto Flake et Hans Arp pour une « renaissance culturelle alsacienne » sous le signe de la double culture franco-allemande, traducteur de Péguy et Jammes, le poète alsacien Ernst Stadler fut profondément ébranlé par l’annonce de la guerre avec sa « douce terre de France ». Mobilisé en août 1914, il fut tué le 30 octobre dans les Flandres. Les deux poèmes traduits ici, publiés en 1912 et 1913, témoignent de son ralliement à l’expressionnisme naissant.
Albert Ehrenstein, « “Stimme über Barbaropa” / “Voix au-dessus de Barbaropa” (traduction Maurice Godé) »
Aussi bien dans les poèmes pacifistes publiés dans les revues Die Weißen Blätter ou Der Friede que dans les recueils Der Mensch schreit, Die rote Zeit et Den ermordeten Brüdern qu’il publie pendant la Grande Guerre, le poète autrichien Albert Ehrenstein n’en finit pas d’accabler de ses sarcasmes les habitants de 496« Barbaropa ». Le poème ici traduit est un réquisitoire implacable contre une civilisation qui se détruit elle-même et contre une guerre qui est comme le suicide collectif de l’Europe.
Kurt Heynicke, « “Die Ballade vom Trommelfeuer” / “La ballade du feu roulant” (traduction Nicolas Beaupré) »
Engagé volontaire en 1914 pour servir comme infirmier, le poète allemand Kurt Heynicke fait toute la guerre dans le service de santé puis dans d’autres corps sur les fronts est et ouest. Il publie ses premiers poèmes en 1914 dans la revue d’Herwarth Walden Der Sturm, qui édite aussi son premier recueil de poèmes de guerre en 1917, Rings fallen Sterne. « Die Ballade vom Trommelfeuer » est extrait du recueil Das namenlose Angesicht publié au lendemain de la guerre par l’éditeur Kurt Wolff.
Oskar Kanehl, « “Auf dem Marsch” / “Pendant la marche” (traduction Maurice Godé) »
Mobilisé d’abord en France, puis en Roumanie et en Macédoine, Oskar Kanehl se fit remarquer par la diffusion d’écrits critiques sur le conflit et composa plusieurs poèmes de guerre réunis en 1922 dans le recueil Die Schande. Gedichte eines dienstpflichtigen Soldaten aus der Mordsaison 1914-1918. Ils se caractérisent par le refus de toute forme d’idéalisation de la guerre. Le poème « Auf dem Marsch » illustre cette volonté de témoigner sans emphase ni artifices rhétoriques de l’expérience du front.
Wilhelm Klemm, « “Schlacht an der Marne” / “Bataille de la Marne”, “Herbst” / “Automne” (traductions Maurice Godé et Nicolas Beaupré) »
Mobilisé pendant toute la guerre sur le front de l’ouest comme médecin militaire, Wilhelm Klemm accueillit d’abord le conflit avec enthousiasme, confiant à sa femme en août 1914 : « Nous vivons à une grande époque ». Mais la bataille de la Marne et la retraite qui s’ensuit marquent pour lui un tournant décisif. L’euphorie se change brusquement en horreur et en désespoir, comme en témoignent aussi bien sa correspondance que les deux poèmes « Schlacht an der Marne » et « Herbst ».
497Alfred Lichtenstein, « “Sommerfrische” / “Villégiature” (traduction Maurice Godé) »
Alfred Lichtenstein publia ses premiers poèmes à partir de 1910 dans les revues Der Sturm et Die Aktion. Incorporé dans un régiment d’infanterie de Bavière pour son service militaire, il est envoyé sur le front en août 1914 et tué le 25 septembre près de Péronne. Le poème « Sommerfrische » est caractéristique d’un état d’esprit typique de la jeunesse allemande de l’époque : l’ennui suscité par la société wilhelminienne et ses rites engendre des fantasmes de destruction et de renouveau.
August Stramm, « “Sturmangriff” / “Assaut”, “Wunde” / “Blessure”, “Shrapnell” / “Shrapnell” (traductions Maurice Godé et Nicolas Beaupré) »
Mobilisé en août 1914, August Stramm est d’abord stationné en Alsace, puis engagé au printemps 1915 dans la Somme et combat enfin sur le front russe jusqu’à sa mort en septembre 1915. Pas d’apologie de la guerre dans ses poèmes du front, d’abord publiés dans la revue Der Sturm puis rassemblés en 1919 dans le recueil Tropfblut. Les protagonistes sont indistinctement mêlés dans la souffrance et la mort et l’assaut est une mêlée confuse, résultant de la volonté de survivre et de la peur de mourir.
Ernst Toller, « “Mütter” / “Mères” (traduction Nicolas Beaupré) »
Engagé en août 1914, Ernst Toller est d’abord stationné à Strasbourg avant de combattre sur le front, notamment à Verdun. Souffrant d’un choc traumatique, il est déclaré inapte en janvier 1917. Il se rapproche alors d’écrivains (Thomas Mann, Rilke) et d’intellectuels engagés à gauche ou pacifistes (Kurt Eisner), et participe à la révolution bavaroise en 1918-1919. Arrêté en 1919, il condamné à cinq ans de forteresse. Son poème « Mütter » est un appel déchirant aux mères des soldats tombés au front.
Georg Trakl, « “Grodek” / “Grodek” (traduction Maurice Godé) »
Influencé tant par Baudelaire que par Hofmannsthal, Rimbaud ou Hölderlin, Georg Trakl est l’auteur d’une œuvre profondément originale caractérisée par l’effacement du moi lyrique devant un « chaos infernal de rythmes et d’images ». Dépressif, il part sur le front de Galicie dans une unité sanitaire, et meurt en novembre 1914 d’une overdose à l’hôpital militaire de Cracovie, où il avait été admis pour examen psychiatrique. Achevés une semaine plus tôt, « Klage » et « Grodek » sont ses derniers poèmes.
498Francis Andrews, « “The Cost” / “Ce qu’il en coûte” (traduction Anne Mounic) »
Peu connu parmi les poètes de guerre britanniques, Francis Andrews publia en 1923, dans une revue dont il était rédacteur, The Pillar Box, une série de poèmes intitulée « Un paysage ». La situation de guerre s’y introduit comme par effraction dans un paysage rural fait pour la charrue plutôt que pour le maniement des armes. Cet aspect frappa également un poète comme Charles H. Sorley, et d’autres. Le poème « The Cost » fut écrit et publié en 1915.
Robert Graves, « “La maison hantée” (traduction Anne Mounic) »
Robert Graves, parlant de la Grande Guerre, utilisait le terme de « meurtre ». Rentré neurasthénique des tranchées, il partit vivre à la campagne et publia en 1920 Country Sentiment, comme un antidote au chaos auquel, bien que blessé gravement le 20 juillet 1916 et annoncé comme mort dans le Times, il avait échappé. Il se considéra par la suite comme revenu, à la façon des héros antiques, du monde souterrain, aguerri dès lors aux cruautés du destin, qu’il refusa d’ignorer en exaltant l’idéal.
Ivor Gurney, « “Pain” / “Douleur” (traduction Anne Mounic) »
Ivor Gurney, musicien et poète, né dans la vallée de la Severn en Angleterre, était très attaché à l’univers pastoral, qui occupe une place centrale dans la poésie anglaise. Dans ses poèmes, la situation de guerre, véritable aliénation, s’oppose à la tranquillité du paysage campagnard et de la pratique des arts, musique et poésie. Il publia le recueil La Severn et la Somme en 1917. Souffrant de dépression avant la guerre, il fut interné en 1922 jusqu’à sa mort, en 1937, de tuberculose.
Wilfred Owen, « “The Parable of the Old Man and the Young” / “La parabole du vieil homme et du jeune” (traduction Anne Mounic) »
Dans sa réécriture de la parabole biblique, Wilfred Owen tente de surmonter la rupture tragique qui pervertit le récit, puisque le sacrifice d’Isaac a lieu et que Abram ne devient pas Abraham, en appelant par ses vers à revenir à la compassion, seule ouverture possible à l’avenir. Il songe aussi à renouer avec la réciprocité reniée dans un poème comme « Strange Meeting ». Pénétré de la tradition poétique anglaise, il mesure dans ses vers à quel point le cataclysme est irréparable.
499Isaac Rosenberg, « “Daughters Of War” / “Filles de la guerre” (traduction Anne Mounic) »
Élève de la célèbre Slade School, à Londres, peintre et poète, Isaac Rosenberg ne trouva pas de travail à son retour d’un séjour en Afrique du Sud. Il se fit soldat. Il écrivit une pièce intitulée Moïse, alors qu’il était cantonné à Bury-St-Edmunds, puis, une fois en France, choisit le personnage de Lilith, figure de dissolution. Dans « Daughters of War », il montre à quel point le chaos créé par la guerre menace l’arbre de Vie et rompt avec la continuité du temps, que supplante la tragédie.
Siegfried Sassoon, « “Permission de convalescence” (traduction Nicolas Beaupré) »
Issu d’une famille bourgeoise, Siegfried Sassoon s’engage dès le début de la guerre. Distingué pour sa bravoure au combat, il rencontre Robert Graves pendant la bataille de la Somme. Ses poèmes de guerre deviennent alors plus acerbes, exprimant sa colère contre la guerre et contre les généraux et hommes politiques qui la prolongent. En convalescence en Écosse, il écrit une lettre ouverte pacifiste au Times et rencontre Wilfred Owen, qu’il incite à continuer à écrire des poèmes de guerre.
Charles Hamilton Sorley, « “When You See Millions of the Mouthless Dead” / “Quand vous voyez ces millions de morts dénués de bouche” (traduction Anne Mounic) »
Charles Hamilton Sorley se trouvait en Allemagne durant la période qui précéda la guerre et fut arrêté en août 1914 dans la vallée de la Moselle, soupçonné d’espionnage. Il ne demeura que quelques heures en prison et, au retour, s’engagea, tout en considérant le conflit comme un antagonisme entre sœurs, entre Marthe et Marie. Sensible à la transformation guerrière du monde pastoral, la guerre lui paraît une blessure, atteignant à la fois l’âme humaine, le paysage et la continuité du devenir.
Keith Douglas, « “Desert Flowers” / “Fleurs du désert” (traduction Xavier Hanotte) »
D’origine modeste mais doué de talents artistiques multiples, Keith Douglas interrompit ses études à Oxford pour s’engager dès 1940. En qualité d’officier de chars, il prit part à la bataille d’El-Alamein, où il fut blessé. C’est à l’hôpital militaire d’El Ballah qu’il composa en 1943 le poème « Desert 500Flowers ». Il fut tué à Saint-Pierre, en Normandie, le 9 juin 1944. Ses Collected Poems furent publiés en 1951.
Sidney Keyes, « “War Poet” / “Poète de guerre” (traduction Xavier Hanotte) »
Ancien étudiant d’Oxford, Sidney Keyes a déjà publié deux recueils (The Cruel Solstice et The Iron Laurel) lorsqu’il est mobilisé en 1942. Jeune lieutenant de 20 ans, il est tué lors de son premier engagement pendant la campagne de Tunisie. « War Poet » est un texte prophétique, écrit avant que Keyes ne soit mobilisé : tous les poèmes qu’il écrivit sous l’uniforme ont en effet été perdus.
Bruce Weigl, « “Elegy” / “Élégie” (traduction Xavier Hanotte) »
Né en 1949, Bruce Weigl s’engagea à 18 ans dans l’armée américaine. Il servit au Vietnam de décembre 1967 à décembre 1968 et fut décoré de la Bronze Star. Cette expérience marqua à jamais sa vie et sa poésie, depuis son premier recueil A Romance (1979) jusqu’à Song of Napalm (1988) et The Abundance of Nothing (2012). Diplômé de l’université du New Hampshire, il enseigne depuis 1975 au Lorain County Community College d’Elyria, dans l’Ohio.
Nicolas Goumilev, « “Война” / “La Guerre”, “Наступление” / “La marche” (traductions Hélène Henry) »
Fondateur, avec Ossip Mandelstam et Anna Akhmatova, de L’Atelier des poètes et de l’école « acméiste » dans la Saint-Pétersbourg des années 1910, Nicolas Goumilev s’engagea dès l’été 1914, acceptant la guerre « avec une totale simplicité, avec une ardeur non feinte », selon les mots de son ami André Levinson. Le poème « La marche » fut composé dans les premiers jours d’octobre sur la ligne de front ; « La Guerre » fut écrit un mois plus tard et aussitôt publié dans la revue Otečestvo (Patrie).
Ossip Mandelstam, « “Стихи о неизвестном солдате” / “Vers du soldat inconnu” (traduction Nikita Struve) »
Les « Vers du Soldat Inconnu », poème le plus ample, le plus énergique, le plus tragique de Mandelstam, furent écrit en 1937, à la veille de sa disparition dans les camps staliniens. Ils font le bilan des morts de masse de la Première 501Guerre mondiale au seuil de la Seconde. L’image centrale renvoie à la tombe du Soldat inconnu à Paris, qui ressurgit avec le pressentiment de la mort toute proche du poète, un de ces « millions d’hommes tués pour rien ». Mais « de moi sur le monde va jaillir la lumière ».
Adrien Finck, « “Am Grab Ernst Stadlers” / “À la tombe d’Ernst Stadler”(traduction Michèle Finck) »
Universitaire spécialiste de littérature alsacienne et allemande – notamment de Schickele, Stadler, Vigée ou Trakl –, lui-même écrivain et poète, Adrien Finck fut un ardent promoteur de la culture alsacienne. Dans le poème-hommage « À la tombe d’Ernst Stadler », traduit par sa fille Michèle Finck, il s’adresse directement au poète tombé près d’Ypres en octobre 1914 depuis la tombe que ce dernier occupe dans le cimetière strasbourgeois de la Robertsau.
Michèle Finck, « Benjamin Britten : War Requiem »
Publié dans le recueil Connaissance par les larmes qui parut aux éditions Arfuyen en 2017 et reçut cette année-là le Prix Max-Jacob, le poème de Michèle Finck « Benjamin Britten : War Requiem » est un hommage au War Requiem de Britten, qui fait alterner le Requiem traditionnel en latin avec les poèmes de guerre de Wilfred Owen.
Anne Mounic, « En décochant le chant. Poèmes pour une utopie de plénitude »
Maître de conférences à l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3, Anne Mounic est l’auteur de plusieurs études sur la poésie, dans lesquelles les poètes de guerre – notamment anglo-saxons – occupent une place centrale. Elle est aussi écrivaine, poète, traductrice et membre active de plusieurs revues littéraires (Temporel, Peut-être, Europe). La suite de poèmes En décochant le chant est un écho contemporain à la voix irréductiblement singulière des poètes de la Grande Guerre.
Stephen Romer, « “A Thought from Apollinaire ” / “Une pensée d’Apollinaire”, “Veillée d’armes”, “XI/XI/XI” / “XI/XI/XI”, “Markie” (traductions Martine Thomas) »
Universitaire et poète, Stephen Romer est l’auteur de quatre recueils. Si comme le montrent les quatre poèmes réunis ici, le thème de la Grande Guerre 502et de sa mémoire revient à plusieurs reprises sous sa plume, l’hommage au poète (« Une pensée d’Apollinaire ») ou à l’aïeul (« Markie ») ne s’y départissent pas d’une certaine distance, comme si l’empathie et l’admiration pour les hommes n’allait pas sans le refus de se laisser prendre au piège d’une fascination pour la catastrophe.
Olga Sedakova, « “Ангел Реймса” / “L’Ange de Reims”, “Элегия, переходящая в реквием” / “Élégie se transformant en Requiem” (traductions Philippe Arjakovsky et Marie-Noëlle Pane) »
Vibrante de références à la culture spirituelle et littéraire multiséculaire de l’Europe, la poésie d’Olga Sedakova s’attache à ressaisir en-deçà – ou au-delà – de la brisure définitive que furent les grandes guerres de masse mécanisées du xxe siècle, ce que fut le regard originel de la poésie sur le tragique et la beauté du monde. Les deux poèmes publiés et traduits ici participent de ce rappel d’une civilisation que la plus inhumaine des guerres ne saurait mettre à genoux.
Jeffrey Wainwright, « “Aucune harpe ne peut réveiller le guerrier”, “Récupération (Coda…)” (traductions Paloma Winling) »
Poète et traducteur (il fut l’auteur d’une adaptation pour la scène du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy), Jeffrey Wainwright a publié six recueils de poésies dans lesquels l’histoire et notamment les guerres qui ont façonné l’Europe – de la guerre des paysans allemands aux guerres napoléoniennes et à la première guerre mondiale – dessinent un motif récurrent. Les deux poèmes traduits ici sont issus de la section « Six War Poems » qui clôt le recueil Out of the Air publié en 1999.
Anne Mounic, « “Homère est nouveau ce matin”. La parole poétique comme futur du présent et du passé »
Les poètes ont parlé de la Grande Guerre dans l’intimité de leur souffrance personnelle mais partagée, quelle que fut leur nationalité. Ils sont porteurs d’une pensée de vie, qui devrait éclairer le choix, éthique et politique, de leurs lecteurs. À les lire, nous reconnaissons désormais que les ennemis d’alors disent maintenant pour nous la même chose que le poème d’Owen : « Je suis l’ennemi que tu as tué, mon ami, / Dans le noir, je t’ai reconnu ». Leur parole est porteuse de notre avenir.