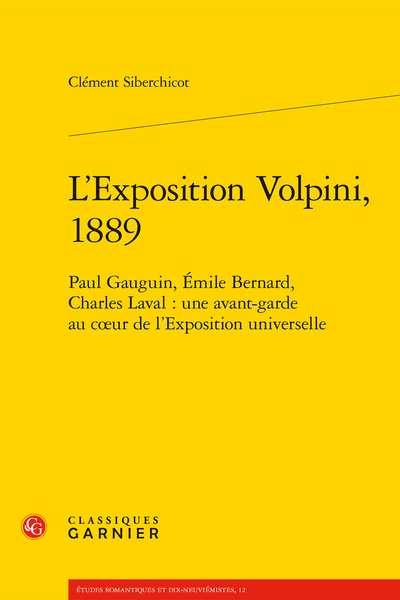
Préface Une exposition de « casseur d’assiette »
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : L’Exposition Volpini, 1889. Paul Gauguin, Émile Bernard, Charles Laval : une avant-garde au cœur de l’Exposition universelle
- Auteur : Le Men (Ségolène)
- Pages : 11 à 16
- Collection : Études romantiques et dix-neuviémistes, n° 12
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812440564
- ISBN : 978-2-8124-4056-4
- ISSN : 2258-4943
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4056-4.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 06/04/2011
- Langue : Français
Préface
Une exposition de « casseur d’assiette »
1889 : à Paris, les touristes affluent pour visiter l’Exposition universelle. Pour les jeunes peintres groupés autour de Gauguin, c’est une occasion irremplaçable de tenter d’attirer l’attention d’un public élargi, par une exposition qui est à la fois défi aux institutions et manifeste pictural. Comme l’annonce une affichette d’intérieur, le « groupe impressionniste et synthétiste » propose son « Exposition de peintres / Paul Gauguin, Émile Schuffenecker, Émile Bernard / Charles Laval, Louis Anquetin, Louis Roy / Léon Fauché, Daniel, Némo » au « Café des Arts, Volpini directeur / Exposition universelle Champ-de-mars, en face le Pavillon de la Presse ». Un nom conduit le « groupe », celui de Gauguin, et deux adjectifs, allant du général au particulier, le qualifient pour marquer la volonté d’un renouvellement par le synthétisme de l’impressionnisme (déjà transformé par le néo-impressionnisme). « Oui, il y a un peu de casseur d’assiette », reconnaît Paul Gauguin depuis Pont-Aven dans une lettre à Théo Van Gogh du 10 juin 1889, avant de poursuivre en invoquant l’exemple de Degas : « depuis que j’expose j’ai toujours agi de même ». Cet évènement d’une exposition de café, toujours rappelé mais peu étudié jusqu’ici, connut de faibles retombées immédiates, malgré la proximité du pavillon de la Presse et du Palais des Beaux-Arts : le terme obscur et baudelairien de « synthétiste » ne pouvait appâter les familles Fenouillard en visite ! Pourtant ses effets artistiques à moyen et long terme ont été très importants. Clément Siberchicot consacre une monographie fort documentée à l’exposition Volpini, parallèlement réexaminée par Belinda Thomson avec qui il a bénéficié de fructueux échanges dans la progression de son travail.
Une telle recherche s’inscrit dans une thématique, celle de la mise en exposition et des « musées imaginaires », développée à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par l’Institut universitaire de France. L’histoire des expositions combinée à celle des livrets, des catalogues, ainsi que des affiches, prospectus et
autres imprimés d’annonce, permet une approche très intéressante des transformations du système des arts au cours du dix-neuvième siècle, qui est indissociable de la redéfinition du statut et des attitudes de l’artiste dans la modernité. Selon la thèse de Harrison et Cynthia White, le « système académique », fondé sur le Salon, est progressivement remplacé par le « système marchand-critique », qui accompagne la mise en place des galeries et le développement de la presse artistique et de la critique d’art, et ce basculement spectaculaire s’accomplit dans l’impressionnisme tandis que va disparaître le monopole du Salon1. Opposant toiles et carrières (« Canvases and Careers »), les auteurs démontrent le passage d’un système de reconnaissance fondé sur le morceau de réception académique puis sur le grand tableau de Salon, à un autre régime, dans lequel l’artiste se reconnaît à la signature de son œuvre entière, marque de son originalité. Le nouveau régime, celui de l’art moderne, a été défini par Nathalie Heinich, comme un régime de singularité2, dont le corollaire est l’émergence du mythe de l’artiste maudit, forgé autour de Van Gogh dans l’impressionnisme, – terme d’acception large qui, selon Gauguin, réunit tous les indépendants. L’exaltation du singulier l’emporte, la transgression des normes l’accompagne.
Dans cette configuration générale, l’exposition Volpini procède de deux facteurs. D’une part, puisque les Expositions universelles apportent à l’art officiel de la seconde moitié du siècle une plate-forme importante, l’avant-garde cherche à se rendre visible dans son environnement comme une alternative aux voies tracées et reconnues du grand public. D’autre part les artistes qui veulent exposer hors du Salon et des galeries choisissent d’être par eux-mêmes les instigateurs de leurs expositions qui sont installées dans des lieux inattendus et marquent de façon provocatrice, non sans rapport avec les attitudes de la bohème artistique, leur volonté de rupture. L’exposition Volpini qui se tient dans le café où chante une princesse russe fait partie du Paris de la Belle Epoque où les cafés-concerts et les cirques deviennent des lieux culturels fréquentés par les artistes, à commencer par Seurat. Sa matrice est l’exposition du Chalet, puis celle du Grand-Bouillon que se remémore alors Émile Bernard, qui s’était tenue deux ans plus tôt « dans un grand restaurant populaire
de l’avenue de Clichy », comme « une manière d’exposition impressionniste » à l’initiative de Vincent Van Gogh, avec Louis Anquetin, Arnold Koning et Émile Bernard.
L’initiative d’expositions organisées par les artistes n’est pas sans précédent. En 1798, David avait présenté Les Sabines à Paris avec un dispositif scénographique original qui utilisait un miroir en psyché, et un livret explicatif. Il avait par la suite renouvelé l’expérience avec le Sacre. Après l’échec du Salon de 1819, Géricault avait fait voyager le Radeau de la Méduse à l’Egyptian Hall de William Bullock à Londres en avril 1820, où il avait connu un grand succès populaire avec 50 000 visiteurs payants. Delacroix lui-même a accepté que La Liberté guidant le peuple fût exposée à Lyon en 1848. Ce type de manifestation avait pris le sens, depuis l’exposition des tableaux refusés au Salon, organisée dans l’atelier de Vernet en 1824, d’un acte d’opposition politique autant que de manifestation artistique. Mais le Salon n’en restait pas moins un lieu d’exposition privilégié pour lequel étaient peints les grands tableaux-manifestes, où se marquait l’affrontement entre écoles. Lancée en 1824 comme l’a montré l’ouvrage de Dorothea Beard sur l’émergence du conflit de l’ancienne et de la nouvelle école, la bataille romantique s’est poursuivie sur les cimaises en 1827, l’année même où Victor Hugo publiait la Préface de Cromwell. Ce fut une année de manifestes, en art comme en littérature. Au Salon, étudié par Eva Bouillo dans sa thèse qui vient d’être publiée aux Presses de l’université de Rennes3, le face à face de Delacroix et d’Ingres, qui avait déjà eu lieu en 1824, s’intensifiait ; les visiteurs purent découvrir La mort de Sardanapale de Delacroix d’un côté, et de l’autre L’apothéose d’Homère d’Ingres, plafond du musée Charles X tout aussi déconcertant. À la fin des années 1840, la fronde des artistes contre les oukases du jury et le monopole d’exposition détenu par le Salon gouvernemental aboutit à l’organisation d’une manifestation d’opposants, l’exposition du Bazar Bonne-Nouvelle, présentée dans les locaux d’un immeuble commercial où se trouvaient parfois organisés de grands concerts. Celle-ci se tint pendant plusieurs années à l’initiative de l’Association des artistes, peintres, dessinateurs et sculpteurs qui fonctionnait entre eux comme une association de secours mutuel ; celle de 1846, où David et Ingres étaient réunis, préparait l’avènement du réalisme4.
Le phénomène des « contre-expositions5 » s’est renforcé dans la seconde moitié du siècle, et le Salon des Incohérents, cette « académie du dérisoire6 », en marque dans les années 1880 tout à la fois l’hyperbole et la dérision. Les contre-expositions se tiennent notamment en marge des Expositions universelles. Dès la première exposition universelle organisée en France, Courbet déclenchait la bataille du réalisme en 1855 en présentant la sienne dans un pavillon qu’il avait fait construire, et en l’accompagnant d’un livret introduit par un manifeste. Il renouvela l’expérience en 1867 et fit alors connaître ses paysages de mer et de neige déjà sériels, comme le fait apparaître la numérotation du catalogue. Manet en faisait alors autant, ce qui scellait, face à Courbet, l’entrée en scène d’une génération artistique, celle de la « nouvelle peinture » qui prendrait nom d’impressionnisme à l’occasion, – de nouveau ! –, d’une exposition, non plus individuelle, mais collective, dans un local du boulevard des Capucines ayant servi d’atelier à Nadar en 1874. L’histoire de l’art contemporain s’est ainsi construite par une succession d’expositions-manifestes marquées chacune par la singularité d’artistes qui montraient leur œuvre soit seuls, soit avec d’autres, c’est-à-dire en « groupe ». En décembre 1888, Gauguin est allé voir les Courbet de la collection Bruyas au musée Fabre, lui qui avait eu le regard formé par ceux de son tuteur Arosa qui les collectionnait et les présentait aux murs de son appartement. L’exposition du café Volpini, qui correspond à l’émergence du synthétisme, dont les effets se ressentent jusqu’en 1905, lorsque la salle des Fauves est présentée au Salon d’Automne, procède de la seconde catégorie (l’exposition collective) mais n’ignore pas l’exemple de Courbet.
D’autres manifestations devaient être organisées dans des lieux alternatifs au cours de la dernière décennie du siècle où les grandes galeries, Durand-Ruel, Georges Petit et Bernheim, comptaient de plus en plus. En 1889, tandis qu’à l’Exposition universelle avait lieu la Centennale, l’affichiste Chéret exposait au théâtre La Bodinière ; le catalogue préfacé par Roger Marx signifiait l’avènement du nouvel art mural et polychrome de l’affiche contrastant avec les murailles grises des grandes villes autant qu’avec la peinture bitumineuse du Salon, comme le soulignait Félix Fénéon, tandis qu’à l’Exposition universelle se tenait la première
rétrospective d’affiches artistiques. Quelques années après l’exposition Volpini, les expositions du Salon des Cent, de 1894 à 1900, étaient annoncées par des affiches et organisées, en parallèle avec un numéro spécial, par la revue La Plume fondée en 1889 par Émile Deschamps, qui s’était donné pour mission de « lancer » de jeunes écrivains et de jeunes artistes. Enfin les affiches de Toulouse-Lautrec, entre autres, ont décoré le cabaret du Chat noir.
L’étude de l’exposition Volpini, avec son catalogue de 96 œuvres à la fin duquel est annoncé un « album de lithographies de Paul Gauguin et Émile Bernard » qui est « visible sur demande » offre un cas de micro-histoire de l’art particulièrement significatif. Il est exemplaire du foisonnement de manifestations de la fin du siècle par lesquelles les artistes ont expérimenté de nouvelles formules de diffusion vers le public, tandis que l’avant-garde ne se dissociait plus seulement de l’Académie, mais se scindait et se recomposait fréquemment elle-même, selon des clivages qui pouvaient s’avérer idéologiques, politiques ou générationnels. L’ouvrage de Clément Siberchicot étudie la genèse de l’évènement, parvient à identifier un certain nombre d’œuvres exposées, -tâche que le système des titres ne simplifie pas-, et rappelle le lancement publicitaire et la réclame de l’exposition, ainsi que sa réception critique. Il nous montre les artistes accrochant eux-mêmes, perchés sur des échelles, leurs tableaux aux cadres blancs dans le « café des arts » tendu de tissu rouge, avant de parcourir Paris pour procéder à un affichage sauvage sur les murs. Il rappelle l’importance des arts graphiques pour la diffusion de l’art des peintres, ce qui est une leçon que les mouvements de peintres-graveurs ont tirée du groupe des aquafortistes, et commente l’album publié, ainsi que le catalogue d’exposition introduit en guise de frontispice par une reproduction originale de Gauguin combinant deux des œuvres présentées. Sont aussi restitués de rares témoignages sur l’accrochage et l’ambiance sonore et pittoresque du Café des Arts, dont le directeur Volpini s’avère avoir été le propriétaire du Grand Café de la rue Scribe, bien connu dans l’histoire du cinématographe pour avoir accueilli en sous-sol la première projection publique payante des frères Lumière en 1895. En 1889, Émile Schuffenecker lui avait proposé des tableaux à la place des luxueux miroirs de Saint-Gobain initialement prévus pour décorer son éphémère « café des arts » ! En dépouillant les correspondances d’artistes et les souvenirs publiés ultérieurement, Clément Siberchicot a su montrer l’ampleur des répercussions de l’évènement. Il a mis en évidence la façon dont l’exposition Volpini cristallise le jeu des
relations entre peintres, depuis les échanges entre Gauguin et les frères Van Gogh jusqu’aux visites des critiques d’art et des peintres.
L’intérêt, inattendu, de Meissonier pour cette exposition qu’il est allé voir peut se comprendre comme un jalon inédit dans la genèse de la Société nationale des beaux-arts, elle aussi née en 1889, institution toujours existante, – et qui n’a rien de commun à part le nom avec la société fondée par le galeriste Martinet au début des années 1860. Or la thèse d’Olivia Tolède a récemment démontré que ses débuts, jusqu’à la création du Salon d’automne en 1903, pouvaient s’interpréter dans la perspective de l’émergence du modèle sécessionniste appelé à se développer dans le monde germanique7 : ne peut-on supposer que l’exposition Volpini pourrait procéder d’un horizon d’attente similaire ?
Telle n’est pas la moindre découverte suggérée par la lecture de ce petit livre stimulant et passionnant, issu d’une enquête qui apporte une précieuse moisson de citations et d’informations à tous ceux qu’intéresse l’histoire du synthétisme et du cloisonnisme, ainsi que celle de la mise en exposition.
Ségolène Le Men
[1] H. et C. White, La carrière des peintres au xixe siècle, Paris, 1991, préface de Jean-Paul Bouillon (éd. originale 1965 : Canvases and Careers : Institutional Change in the French Painting World). P. Mainardi, The End of the Salon. Art and the State in the Early Third Republic, Cambridge et New York, Cambridge U P, 1993.
[2] N. Heinich, La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, 1991.
[3] E. Bouillo, Le Salon de 1827 : classique ou romantique ?, Rennes, 2009.
[4] Exp. Le baron Taylor, l’Association des Artistes et l’exposition du Bazar Bonne-Nouvelle en 1846, Paris, 1995.
[5] W. Hauptmann, « Juries, protest, and counter-exhibitions before 1850 », The Art Bulletin, 67, no 1, 1985, p. 95-109.
[6] Exp. Arts incohérents, académie du dérisoire, catalogue établi par L. Abélès et C. Charpin, Les dossiers du Musée d’Orsay, Paris, 1992.
[7] O. Tolède, Une Sécession française : la Société nationale des beaux-arts (1889-1903), thèse de doctorat en cotutelle de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’université de Genève (codir. S. Le Men et P. Vaisse).