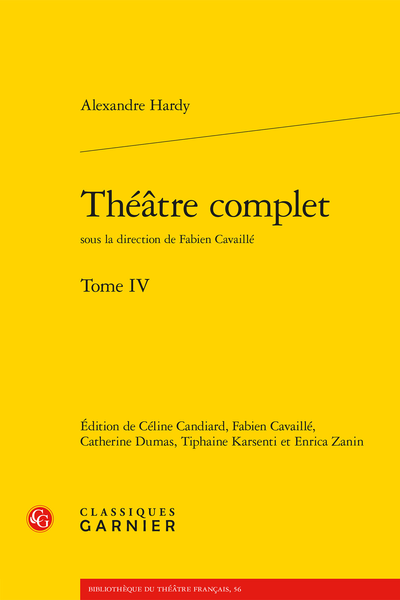
Établissement du texte
- Publication type: Book chapter
- Book: Théâtre complet. Tome IV
- Pages: 709 to 712
- Collection: French Theatre Library, n° 56
- CLIL theme: 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN: 9782406086826
- ISBN: 978-2-406-08682-6
- ISSN: 2261-575X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-08682-6.p.0709
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-13-2019
- Language: French
Établissement du texte
Hardy lui-même suggère1 dans son avis « Au lecteur » placé au début du tome IV que ce volume a été imprimé avec beaucoup plus de soin que les trois précédents. De fait, l’édition originale de 1626 est aisément lisible, avec très peu de coquilles et une distribution sûre des dialogues entre les personnages. Conformément aux principes d’édition de la collection « Classiques Garnier » et ceux qui ont été présentés et justifiés à la fin de l’introduction générale, nous avons modernisé l’orthographe et la graphie ; nous avons tâché de rester le plus près possible du texte initial s’agissant de la ponctuation, tant que cela ne nuisait pas à la compréhension du sens, mais nous avons modernisé lorsque cela contrevenait trop à notre usage actuel. Nous énumérons ci-dessous les principes que nous avons appliqués dans la correction et la modernisation du texte.
Orthographe
Nous avons procédé à toutes les substitutions habituelles pour passer de l’orthographe ancienne à l’orthographe moderne : à titre d’exemples, le i consonne (comme dans « iugemens ») est devenu j, le u consonne (comme dans « yurognes ») v, le ſ (comme dans « ſeulement ») s, le ß (comme dans außi) a été remplacé par le double s, le & par et, le õ par on, le ã par an, certains y (comme dans « moy ») par des i, certains –ei (« il meine ») par des –è, certains s (comme dans « le pris de la beauté ») par des x et vice versa, certains s (« desjà ») ont laissé place à un accent sur la voyelle qui les précédait. Les désinences verbales en –oi (« rompoit ») 710ont été changées en –ai, les participes passés pluriels en –ez (« les esprits conjurez ») sont devenus –és et les désinences de l’impératif (« retien bien ») ont pris leur terminaison moderne.
Ont été supprimés certains trémas (« déçeuë ») et c cédilles (« sçavoir »), certains redoublements de consonnes (« fidelle »), certains s ou e surnuméraires (« jusques là », « veu »), et certaines séparations de mots (« entre-voyant », « r’assurer »).
L’orthographe originale a cependant été conservée toutes les fois qu’elle était nécessaire à la compréhension de la rime : « peu »/« peu » (v. 349-350), « prévaudroit »/« droit » (v. 357-358), « abjette »/« rejette » (v. 877-878), « ravisseur »/« seur » (v. 947-948), « heure »/« asseure » (v. 985-986 et 2106-2107), « dédagne »/« compagne » (v. 1946-1947), « lois »/« voudrois » (v. 2072-2073), « demeure »/« seure » (v. 2206-2207).
Coquilles
Nous donnons ci-dessous la liste des formes que nous avons considérées comme des coquilles manifestes, suivies de la correction que nous avons proposée :
–v. 50 : « mouverait », corrigé en « mouvrait » afin que la métrique soit respectée ;
–v. 135 : « J’espèrerai », corrigé en « J’espèrerais » ;
–v. 589 : « Épiés », corrigé en « Épiées » ;
–v. 963 : « Je ferai ferme », corrigé en « Je serai ferme » ;
–v. 1402 : « Et plût, ô Dieux, que… », corrigé en « Et plût aux Dieux que … »
–v. 1683 : « honnêté » corrigé en « honnête »
–v. 1820 : « A » corrigé en « Ah »
–v. 2351 : « promets-tu » corrigé en « permets-tu »
711Majuscules
Nous avons systématisé l’usage des majuscules à l’initiale de certains noms propres où elles se trouvaient de manière irrégulière (par exemple sur « Parque », écrit avec une majuscule au v. 1563 mais une minuscule aux v. 102 et 1994 de l’édition originale). Nous avons également mis une majuscule à l’initiale d’Amour toutes les fois qu’il s’agissait manifestement du dieu (par exemple v. 471, 789, 1043), de Nature pour les emplois allégoriques (v. 694, 1499, 1938, 2240, 2374), de Terre et de Dieux en cas d’adresse (v. 761 et 1033).
Ponctuation
La ponctuation originale a été conservée autant que possible, dans le souci de ne pas altérer les indications de pauses, d’accents et de respiration qu’elle donne en vue de l’interprétation du texte par les acteurs. Nous avons cependant procédé à des modifications dans les cas où le maintien de la ponctuation originale pouvait nuire à la compréhension.
Ainsi, nous avons occasionnellement ajouté des virgules lorsqu’elles permettaient de clarifier le sens de la phrase (par exemple v. 1145, « Ce qu’un autre a le moyen de le rendre » est devenu « Ce qu’un autre a, le moyen de le rendre ? ») ; à l’inverse, nous en avons supprimé dans les cas où elles séparaient le sujet du verbe ou le verbe de l’objet (par exemple v. 64, « Mes vœux, Clitie, agréables reçoit » est devenu « Mes vœux Clitie agréables reçoit »).
Nous avons également modifié la ponctuation toutes les fois où l’usage de la ponctuation dans le théâtre du xviie siècle n’est plus compréhensible au lecteur du xxie siècle, et donc perd son efficacité. Ainsi, dans les cas de phrases ou de répliques interrompues, nous avons systématisé l’emploi de points de suspension en lieu et place des virgules, points-virgules ou points de l’édition originale afin de signaler clairement au lecteur l’inachèvement de l’unité syntaxique. De même, les phrases interrogatives 712ont toutes été terminées par un point d’interrogation, même lorsque l’édition originale portait un point ou une virgule. Et à l’inverse, les points d’interrogation ont été convertis en simples points lorsqu’ils se trouvaient abusivement placés à la fin de phrases manifestement non interrogatives, probablement du fait d’une erreur d’imprimerie, par contamination avec un vers proche comportant un point d’interrogation (v. 897 et 2124). Nous avons enfin remplacé systématiquement en points les ponctuations faibles ou semi-fortes (virgules, deux points, points-virgules) situées en fin de réplique lorsque celle-ci était manifestement achevée (par exemple v. 510 ou 592).
S’agissant des signes de ponctuation servant de transition entre deux propositions, nous avons dû également procéder à plusieurs ajustements. Les deux-points, toutes les fois où ils n’indiquaient pas un lien logique mais une simple pause, la valeur du signe étant plus respiratoire que sémantique dans le théâtre du xviie siècle, ont été remplacés par des points-virgules (par exemple, v. 484). Lorsqu’une virgule séparait deux propositions indépendantes, elle a été remplacée par un point-virgule, la parataxe étant plus facilement admise en français moderne lorsqu’elle est appuyée par une ponctuation forte ou semi-forte. À l’inverse, dans le souci de clarifier une syntaxe souvent complexe chez Hardy, nous avons changé le point-virgule en virgule lorsqu’il séparait des propositions subordonnées (par exemple, au v. 474).
1 Voir supra, p. 43.