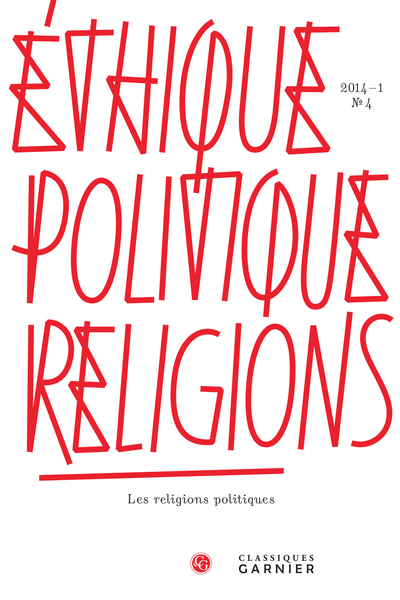
D’un puits à l’autre Politique, histoire, promesse
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2014 – 1, n° 4. Les religions politiques - Auteur : Buhot de Launay (Marc-André)
- Résumé : Malgré l’extraordinaire perspicacité herméneutique dont Voegelin fait preuve en imputant à Genèse 2 la formation de la notion d’histoire ouverte et l’introduction, dans la culture, du récit comme « forme symbolique », il passe à côté du sens de Genèse 22, que l’on s’attachera à dégager en montrant l’articulation entre droit formel et vie politique qui s’y élabore à travers la notion de promesse.
- Pages : 113 à 129
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812429392
- ISBN : 978-2-8124-2939-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2939-2.p.0113
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/07/2014
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
D’un puits à l’autre
Politique, histoire, promesse
Lorsqu’il se fait historien des idées, Voegelin garde une singularité qui le distingue, dans sa génération, de tous les autres ; à l’époque où il écrit Anamnesis, Gerhardt von Rad règne sur les études vétérotestamentaires – jamais un Paul Ricœur n’osera transgresser voire discuter ses conclusions ; or Voegelin prend d’emblée son contrepied. Lorsque le théologien luthérien avance que ce qu’Israël « a appris de Yahveh et vécu grâce à lui se déroule exclusivement dans un espace historique », Voegelin le cite pour retourner la proposition : « C’est dans ce qu’Israël apprend de Yahveh que l’histoire se constitue et qu’alors est introduite la table des peuples de Genèse 101. » Order and History apporte une confirmation sans équivoque dans le sous-titre de la partie consacrée à Israël et la Révélation : il s’agit bien, pour Voegelin d’un contexte culturel où l’on assiste à la « naissance de l’histoire » : « sans Israël, il n’y aurait pas eu d’histoire, mais seulement le retour éternel de sociétés sous une forme cosmologique2 » ; ce qui ne veut pas suggérer qu’il y aurait des sociétés plus historiques que d’autres ni que la Grèce ou l’Assyro-babylonie eussent vécu dans le temps mais, en quelque sorte, sans histoire, cela veut dire qu’au sein de ces cultures l’histoire ne s’est pas encore clairement différenciée au même titre que la spéculation métaphysique. La quête d’un ordre ontologique vrai peut fort bien s’en tenir à une démarche qui formule ses certitudes à l’aide de symboles cosmologiques, et Voegelin écrit que « grâce à Israël, cette étape est passée à un autre niveau3 ». Il fonde cette conviction sur une analyse très remarquable et tout à fait unique de Genèse 2, 4 au cours de laquelle il comprend que l’introduction du terme toledot (génération, récit)
dans un contexte où ce mot ne peut se référer au processus de création (qui n’a rien d’un engendrement divin) alors que le texte semble le charger d’en donner la synthèse. Loin d’y voir, comme la plupart des commentateurs, une anomalie dans l’usage terminologique, Voegelin comprend la portée de cet écart : « Nous devons donc supposer que cette singularité était intentionnelle pour révéler précisément une liaison plus profonde entre création et reproduction4. » Contre l’opinion générale – celle de von Rad notamment – qui voit dans le compte rendu de la création, les histoires de Noé et du déluge, la tour de Babel, autant de mythes5, Voegelin articule toledot, berith et torot en les concevant comme les trois grands symboles de la pensée historienne d’Israël6. Même si son analyse ne pousse pas plus avant la reconstruction de la metanoïa qui s’opère à travers une tout autre conception des rapports entre langage et réalité, et qui débouche sur une autre conception de la temporalité dont procède l’histoire ouverte, Voegelin ne se trompe nullement lorsqu’il affirme que dans le Pentateuque « le récit devient une forme symbolique sui generis, et que dans le Deutéronome on rencontre une singulière intrication de l’histoire, du mythe et de la mise en scène du mythe7 ». Pourtant, cette formidable perspicacité cède le pas à une reconstruction plus traditionnelle, plus soucieuse de répondre aux buts didactiques de l’ouvrage lorsqu’il aborde la question d’Abraham. Ce qui alors est frappant, c’est que l’examen de la notion d’Alliance s’attache bien aux premières étapes d’un processus qui débute en Gen. 12, se poursuit effectivement en Gen. 14 et 15, mais ne s’arrête pas là puisque son point culminant est Gen. 22. Or Voegelin ne commente pas ce passage. La « ligature » d’Isaac est à l’évidence un épisode qui a certainement dû aiguiser son appétence herméneutique, outre qu’il y avait sans doute là une occasion de prendre position à l’égard de l’interprétation kierkegaardienne, largement partagée en terre catholique.
En quoi ces quelques versets intéressent-ils la réflexion sur la politique et les conditions de la formation d’un « ordre » dans ses rapports avec l’« histoire » précisément ? Genèse 22 est le point culminant et le terme
d’une série d’annonces faites à Abraham qui l’assurent que sa descendance sera un grand peuple, et dont la finalité est d’établir l’élection de ce peuple. Ces promesses ne seront d’ailleurs plus répétées par la suite.
L’Alliance
Après le déluge, l’Alliance redevient possible avec l’humanité en général : c’est le sens des lois noakhiques qui s’adressent à toutes les nations. Mais cette Alliance va prendre une forme dont la précision va croissant entre Genèse 12 et Genèse 22. L’annonce de l’élection est toutefois une promesse conditionnelle, elle implique qu’Abraham souscrive à un certain nombre d’exigences jusqu’à l’épreuve conclusive, celle du faux sacrifice de son fils Isaac. La série de ces exigences apparaît comme une suite de spécifications qui sont comme autant de conditions de possibilité de l’existence d’un peuple. En outre, l’élection accordée in fine à la descendance d’Abraham ne saurait faire oublier l’annonce faite à Agar que la descendance d’Ismaël, le premier fils d’Abraham, « sera si nombreuse qu’on ne pourra la compter » (Gen. 16, 10). Le processus qui débouche sur l’élection est donc plutôt l’énoncé des conditions idéales requises pour qu’un peuple ne soit plus simplement le résultat de causes historiques naturelles, qu’il ne soit plus constitué par ce qui le précède dans le temps, mais pour qu’il soit déterminé par une tâche, par un devoir-être dont l’horizon est en quelque sorte l’idée régulatrice de la vie dans l’histoire, c’est-à-dire la réconciliation à titre d’idéal de l’humanité. Rien de surnaturel n’est promis ou annoncé de Genèse 12 à Genèse 228. De même, ce qui est promis n’est pas la félicité, mais simplement l’existence à venir d’un peuple, sa survie dans le temps de l’histoire.
Sept annonces se succèdent. La première, Gen. 12, 1-3, exige qu’Abraham – qui s’appelle encore Abram – quitte le pays où il est
né pour aller vers le pays que Dieu « lui montrera » ; il lui est dit qu’il sera à l’origine d’un peuple ; la deuxième annonce (Gen. 12, 7) a lieu en Canaan, le pays promis que Dieu lui montre comme devant être celui du peuple à venir, mais qui est, pour l’heure, habité par d’autres ; ce qui explique le détour que fait Abraham par l’Égypte avant de revenir s’installer dans une partie du pays. La troisième (Gen. 13, 15) exige d’Abraham qu’il se sépare de son neveu, Lot, qu’il renonce davantage à ce qui le liait encore à la naturalité familiale de son origine ; en même temps, Dieu lui montre la totalité du pays à venir, promis pour toujours. L’espace historique est d’emblée lié à la durée d’une histoire anticipée. La quatrième annonce, en Gen. 15, qui a lieu à travers une vision, récapitule les précédentes : Abraham aura une postérité, un fils de sa chair, le pays promis sera celui de cette postérité, mais elle devra d’abord subir l’esclavage d’une autre nation, faire l’expérience de la dépossession de tout ce qui lui est propre. Dans la troisième annonce, Dieu enjoignait à Abraham de regarder toute l’étendue de la terre promise (« Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre… », Gen. 13, 16) ; Abraham doit maintenant regarder vers le ciel (« Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter… », Gen. 15, 5). C’est alors qu’intervient l’épisode d’Agar qui mettra au monde Ismaël (« Dieu a entendu »), et bénéficiera elle aussi d’une promesse (Gen. 16, 10), en même temps qu’est nommée, à travers un jeu de mots sur le nom d’un puits, la vision de cette promesse : « Elle appela le nom de Iahvé qui lui parlait : “Tu es Dieu qui me voit” (El-roï), Car elle avait dit : “N’est-ce pas véritablement ici que j’ai vu la trace de celui qui me voyait ?” C’est pourquoi le puits fut appelé “Au vivant qui me voit” (Lakhaï-roi). » (Gen. 16, 13-14). La cinquième annonce, qui débute par le fait que « Dieu se fait voir » d’Abraham, a pour condition une rupture plus intime et plus radicale avec toute la naturalité précédente : Abraham doit se circoncire, modifier symboliquement l’un des adjuvants de l’engendrement, en signe d’une alliance qui n’est plus représentable pour tous grâce à l’arc-en-ciel de l’alliance noahide, mais spécifiée davantage pour une lignée Gen. 17, 10-14). Même dans l’acte naturel d’engendrer, le signe de l’alliance doit se substituer à l’état de choses donné ; de plus, Abram et Saraï doivent changer de nom : Abraham et Sara se coupent encore plus nettement de ce qu’ils étaient dès leur naissance, du monde de leur héritage symbolique, par cette modification de leur identité (Gen. 17,
5 ; 15). La sixième annonce débute elle aussi par une vision au chêne de Mamré : il s’agit de promettre la naissance d’Isaac, c’est-à-dire d’un avenir effectif et concret, vivant et unique. Et c’est alors seulement que cette naissance est possible, car les conditions établies à chaque étape sont désormais réunies : Isaac ne naîtra pas dans son pays, mais sur la terre qui le deviendra ; il ne sera pas engendré sans que son père ait auparavant été circoncis – sa conception est elle-même marquée d’un sceau symbolique non naturel –, sans que, symboliquement encore, l’héritage naturel de la culture familiale ait été modifié à la fois par le fait qu’Abraham aura quitté sa propre terre natale, et par cet autre fait que ses parents auront changé l’un et l’autre de nom. La naissance d’Isaac récapitule en quelque sorte la relativisation de la causalité naturelle au profit d’une causalité d’ordre symbolique.
Que se passe-t-il avant la dernière annonce pour qu’elle prenne l’allure si singulière d’un sacrifice qui semble compromettre l’ensemble du processus ? Par deux fois Abraham s’est opposé à Dieu : une première fois pour intercéder en faveur de Sodome à la destruction de laquelle seul Lot et sa famille échapperont ; une seconde pour dire sa réprobation quand Agar et Ismaël sont chassés au désert.
Mais surtout, en Genèse 21, 22-34, Abraham règle avec Abimélekh un différend à propos d’un puits. Ces quelques versets ont ceci de remarquable qu’ils vont se répéter presque à l’identique, un peu plus loin, en Genèse 26, 23-33, avec, pour protagoniste, non plus Abraham, mais Isaac. Le nom du puits change également, et de Beer-shéva (le puits des sept) devient Beer-shiva (le puits du serment). En Genèse 21, 27-31, Abraham règle le conflit en offrant à Abimélekh, outre des brebis et des bœufs pour conclure leur pacte, un sacrifice supplémentaire, qui surprend Abimélekh, de sept agnelles ; mais il ne s’en tient pas là : il plante un tamaris et invoque Dieu en l’appelant Dieu d’éternité (El olam), alors que son fils Isaac se contentera de conclure un pacte identique, pour régler un même différend sur un puits, en offrant au roi philistin un simple repas, sans procéder à un sacrifice ni invoquer le nom de Dieu ni bâtir d’autel. La conduite d’Isaac est donc celle qui, dans le registre politique, est considérée comme la manière juste d’agir.
La formule initiale du verset 1 de Genèse 22 (vayéhi akhar hadvarim haélé, « et il arriva après ces événements que… ») a beau être une cheville fréquente de liaison, elle signifie pourtant bien que ce qui va se passer est
en raison directe des événements qui précèdent, c’est-à-dire cette alliance de type politique conclue entre Abimélekh et Abraham, ce sacrifice superflu d’Abraham des sept agnelles, l’arbre planté pour pérenniser ce pacte tandis qu’il évoque le nom de Dieu sous la forme exceptionnelle de « l’Éternel ». La concision de la suite du verset 1 (vé haélohim nissha et abraham vaiomer élav abraham vaiomer hineni : « et il imposa une épreuve à Abraham, lui dit : “Abraham”, et Abraham répondit : “Me voici”. ») anticipe l’absence de protestation d’Abraham au verset 2 et sa réaction d’obéissance immédiate au verset 3. Si l’on met entre parenthèses toute explication de type psychologique, l’enchaînement des versets 1, 2, 3 donne à entendre, d’un point de vue littéral, qu’Abraham obéit non par grandeur d’âme insigne, non plus parce qu’il serait « obéissant » (en Genèse 18, 23-26, il ne craint pas d’intercéder en faveur des justes de Sodome, en protestant contre l’arrêt divin qui les condamne), mais parce qu’il est conscient d’avoir compromis le sens de la promesse en Genèse 21, 30-33.
Le verset 2 est l’explicitation de l’épreuve imposée. On peut évidemment référer les redondances apparentes qui précèdent la mention du nom d’Isaac au fait qu’il pourrait y avoir confusion entre Ismaël et Isaac : « ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ». Or la progression fils, unique, chéri insiste plutôt sur ce que symbolise Isaac, c’est-à-dire la possibilité de l’Alliance et de sa réalisation. Isaac est l’avenir d’Abraham, ce qu’il a d’unique et qu’il chérit puisque cet avenir est l’accomplissement de l’élection. On peut mettre en parallèle le passage de l’Exode (4, 24-26) où Dieu menace de mort le fils de Séphora parce que Moïse a négligé de le circoncire, alors qu’il vient d’apprendre que Dieu considèrera Israël comme « son premier-né » face à Pharaon : ce que le Pentateuque maintient de manière cohérente, c’est l’idée que méconnaître le sens de l’Alliance entraîne la « mort », le « sacrifice » de l’avenir. En outre, ce passage de l’Exode anticipe, d’un point de vue « politique » lato sensu sur ce qui se produira en Nombres 16, lorsque Qora’h refusera l’observance de prescriptions qu’ils juge vaines au nom d’une « sainteté » acquise : tout le travail impliqué par l’orthopraxie ritualiste et les symboles complexes qui les sous-tendent peut s’entendre comme une didactique juridico-politique de l’observance de la norme. Refuser la norme au motif qu’on bénéficierait en quelque sorte d’une grâce d’état liée à l’appartenance à telle communauté supposée « élue »
conduit à des dérives chiliastiques, et, finalement, au pouvoir réellement arbitraire, fondé sur la force, d’un chef de secte. La prescription de la circoncision est rappelée avec gravité et solennité, dans ce passage, au nom de ce à quoi renvoie le symbole à la fois du point de vue de son contenu de sens que d’un point de vue formel : le sens du symbole est de rappeler ne rien devoir à la « nature » jusque et y compris dans le phénomène qui semble le plus naturel, la procréation – car même cette spontanéité de l’instinct doit tomber sous la règle qui l’encadre – un enfant est d’abord le gage d’un avenir dans la réalisation d’une promesse, d’un futur dans la perpétuation d’un ordre qui repose sur une loi, avant d’être un être vivant. Du point de vue formel, la règle doit être respectée précisément parce que, refusant toute dette à l’égard de la nature, elle tient sa justification et, partant, sa légitimité du fait qu’elle ne soit pas déductible de la sphère empirique, mais relève d’un autre processus d’élaboration qui met au premier plan le versant formel de tout symbole.
Quelle est donc la faute commise par Abraham ? De toutes les promesses d’Alliance, Genèse 22 est l’ultime : c’est là que cette Alliance est définitivement scellée, et par un serment que Dieu se fait d’abord à lui-même (verset 16). Elle est donc le point culminant d’un processus qui a commencé avec Noé en fixant les conditions générales de possibilité de l’humanité, et ce processus se poursuit à travers Abraham et à travers les conditions successives qu’on a évoquées.
L’Alliance, la distinction élective qui permet d’affirmer qu’Abraham est patriarche, est prononcée précisément en Gen. 22 après la ligature d’Isaac qu’elle a exigée à titre de tribut ; elle n’est Alliance avec un peuple, celui dont Abraham est le « père » désigné, qu’à la condition qu’il se soumette à l’épreuve imposée non pas en raison d’un décret divin arbitraire ni pour témoigner de son obéissance ou de sa grandeur d’âme, pas davantage de sa « foi », mais parce qu’il a commis une faute qui compromet la possibilité de cette Alliance. Parmi les grands commentateurs, le rabbin Samuel ben Meïr (le « Rachbam », petit-fils de Rachi)9 fait presque figure d’exception en avançant que « la colère divine éclata contre Abraham. Car l’Éternel avait donné le pays des
Philistins […] au Patriarche, mais celui-ci conclut le pacte d’amitié pour trois générations avec Abimélékh […] Aussi l’Éternel ordonna-t-il à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice pour lui montrer ce qu’il pourrait advenir de son initiative personnelle relative à la conclusion d’une alliance engageant les futures destinées de la Terre Promise. » La confusion des alliances résume la faute d’Abraham ; elle est détaillée, comme on l’a vu en Gen. 21, et soulignée par trois actes : un sacrifice superflu10, la plantation d’un arbre (alors que, jusqu’à présent, il bâtissait un autel en prononçant le nom habituel de Dieu11) et l’invocation de Dieu sous une désignation tout à fait singulière : el-olam, le tout (du monde) ou l’éternel12. Si l’on suit le texte dans la logique de sa composition, c’est cette action d’Abraham qui déclenche la réaction divine et justifie l’épreuve à laquelle il est soumis : sacrifier Isaac, c’est-à-dire ce qu’il a d’unique et qu’il chérit, donc, comme il le sait pertinemment, l’avenir de l’Alliance13. Pour lui, l’ordre n’est ni surprenant, ni monstrueux, ni absurde14.
La promesse
La faute d’Abraham, et pour la réparation de laquelle pas moins que le sacrifice de son propre avenir est exigé, consiste à confondre le registre politique contingent et celui de l’Alliance fondatrice d’un peuple, c’est-à-dire celui d’une distinction élective qui se situe d’emblée à un niveau a priori sans pour autant être supranaturelle puisqu’elle s’inscrit dans une durée historique, celle de la réalisation de cette promesse à travers la vie et la survie d’un peuple. Par son serment fait à Abimélékh, en Genèse 21, 23-24, par son sacrifice superflu des sept agnelles, etc., Abraham a trahi les exigences de la promesse : il méconnaît la nature tout à fait particulière du caractère a priori de la promesse et confond l’ordre empirique de la politique (ses propres intérêts hic et nunc) et l’ordre transcendant de ce qui est l’un des fondements du droit, la promesse, ou, si l’on veut, il régresse vers le registre de l’enchaînement des événements dans la temporalité chronologique, faute d’avoir compris la différence radicale qui en distingue la temporalité de la promesse. Sa « faute » peut d’abord être comprise comme le fait de succomber à cette sorte de sécularisation qui consiste à rabattre dans le domaine immanent de la réalisation politique tout ce qui est fondateur de la cause finale de cette réalisation, et qui échappe, précisément à cette immanence ; il agit en quelque sorte par impatience, et confond, ce qui est plus grave, le sens historique de la promesse et sa propre attente qui voudrait éterniser pour ainsi dire en le sanctifiant le contenu de cette promesse. Il ne reconnaît pas, ensuite, le sens de la promesse, et la transforme en une donnée de la coutume.
La promesse n’existe, en fait, que parce qu’elle est exprimée et adressée à quelqu’un. L’acte de promettre crée effectivement une contrainte dès qu’il est exprimé et que la personne à qui il s’adresse en a pris connaissance ; il s’agit de ce que Adolf Reinach qui a été le premier à en faire la théorie dès 1911, appelait un « acte social », et que nous appelons un acte de langage (et, dans le cas de la promesse, même si elle est conditionnelle, un performatif). Le caractère contraignant de cet acte – indépendamment du contenu de la promesse – ne peut être déduit ni des intérêts de celui qui promet ni de ceux de la personne à
qui s’adresse la promesse. En effet, cette contrainte n’a d’autre source que l’acte même de la promesse ; peu importe que le contexte de cette promesse soit amical ou égoïste, car le fait de promettre crée d’emblée à la fois une obligation (qu’elle soit respectée ou non ne retire rien à son caractère de contrainte) et une exigence chez la personne à qui cette promesse est adressée (que la personne qui a promis oublie ou non sa promesse ne retire rien à la légitimité de l’exigence suscitée par elle). Cette exigence ne disparaît qu’une fois la promesse réalisée : or cela n’est pas une déduction de l’expérience, mais une loi fondée dans la nature même de l’exigence et dans celle de la promesse. Il s’agit d’une proposition a priori, et même d’une proposition synthétique, car le fait que l’exigence disparaisse dans certaines circonstances (notamment celle de la réalisation de la promesse) n’est pas contenu dans le concept ni n’est produit par une expérience quelconque. L’exigence ne disparaît que s’il y a réalisation de la promesse ou renoncement explicite de la part de celui à qui s’adresse la promesse, et il faut qu’il exprime, à l’endroit du contenu de cette promesse, ce renoncement, dégageant ainsi de ses obligations celui qui avait promis. De même, pour qu’il y ait exigence véritable, il faut que celui à qui s’adresse la promesse le déclare explicitement, et jamais le renoncement ne concerne le caractère contraignant de la promesse, mais seulement son contenu. Il existe ainsi, dans le domaine juridique, des propositions a priori qui sont fondatrices du droit, et, parmi elles, la promesse dont le statut est assez singulier puisque l’acte de promettre comporte d’emblée l’existence d’une contrainte et celle, simultanée, d’une exigence, lesquelles ne dépendent que de cet acte lui-même et d’aucune circonstance empirique ; le droit positif découvre donc une antériorité radicale puisqu’elle est a priori des rapports juridiques, et c’est bien de cette source qu’il procède ensuite. Que la coutume et les règles effectives de tel ou tel système de droit positif s’écartent ou tiennent compte de la légalité essentielle des propositions a priori est indifférent au fait que ces notions juridiques essentielles ont un être hors de tout droit positif et antérieur à son élaboration ; c’est, inversement, le droit positif qui intégrera (ou non) ces notions a priori qu’il découvre lui préexister15. Cette compréhension de la promesse comme performatif s’oppose à toutes les conceptions contractualistes.
Pour rétablir le sens de la promesse reçue, Abraham doit donc payer de sa personne – offrir ce qui n’appartient qu’à lui, son avenir – en accomplissant un geste par lequel il montre qu’il replace à son vrai niveau transcendant son propre futur tel qu’il a accepté explicitement qu’il soit défini : il « élève » son fils en l’« exposant16 » sur le mont Moriya17. Cette exposition qui élève place son « avenir » à sa juste place : au-dessus de ce qui est immanent et sous le regard du principe transcendantal. Ce qui importe n’est pas la localisation de ce lieu, mais tout le jeu formel qu’il introduit à partir de la racine du verbe raah (voir) : Moriya peut être rendu par « lieu de la vision » ; au verset 4 Abraham voit de loin ce lieu ; au verset 8, en répondant à Isaac, Abraham dit Elohim yiréh-lo (Dieu y pourvoira ou Dieu verra) ; au verset 12, « parce que tu crains Dieu » joue de la proximité entre yéré (craignant) et yiréh (il verra) ; enfin, au verset 14, la symétrie est accomplie par la juxtaposition de yhaveh yiréh (Dieu verra) et de yhaveh yiéraéh (Dieu sera vu). L’accomplissement des étapes précédentes où la vision était toujours unilatérale (même dans le cas d’Agar) a précisément lieu dans cette réciprocité qui scelle l’intelligence de la dualité propre à la promesse : exigence et obligation vont de pair, comme vont de pair les deux registres temporels révélés par la promesse. En outre l’indication que tout sacrifice agréé symbolise la juste compréhension de la contrainte spécifiquement liée à l’acceptation d’une promesse, cette symétrie qui vient en conclusion d’un jeu formel sur les modalités du voir, rappelle le caractère nécessairement patent de la promesse, associe crainte révérencielle et « publicité » nécessaire de l’acte de promettre ; le sens exotérique du sacrifice n’est pas autre chose que la reconnaissance patente, démonstrative, à travers un rituel obéissant à des formes, d’une dette à l’égard d’un principe accepté comme antérieur et transcendant et dont la réalisation implique qu’on rentre dans une temporalité d’un autre ordre : celle de l’histoire. La politique peut trahir le droit, mais le droit s’effondre certainement dès qu’on veut le confondre avec elle alors qu’il en est l’instance critique
pour peu qu’on reconnaisse l’imprescriptibilité de la contrainte qui la fonde ; et la politique cantonnée aux impératifs immanents n’a pas plus d’avenir que ceux qui vivent sans promesse. Le fait que la promesse n’ait aucun contenu surnaturel renvoie à l’idée qu’entre causalité naturelle et causalité par liberté la synthèse n’est en rien une réconciliation sans reste, n’autorise aucun messianisme eschatologique, mais seulement une vision de l’histoire qui admet, pour le dire dans les termes de Humboldt, des renaissances permanentes sans pour autant qu’il y ait répétition.
Le sacrifice
Abraham n’est ainsi pas au sens strict un héros « tragique », qui ignore le destin auquel il est inexorablement voué, car, précisément, il se doute bien de la raison qui lui vaut l’épreuve à laquelle il est soumis ; en revanche, Isaac rentre en quelque sorte dans le cadre esthétique tragique, et personne ne peut rester insensible à la sobriété dramatique de la partie du texte qui est écrite comme un récit. L’analyse qu’en donne Walter Vogels18 met bien en évidence une symétrie dont le centre est la question posée par Isaac (verset 7, première moitié du verset 8), encadrée par les secondes moitiés des versets 6 et 8 (« tous deux s’en allèrent ensemble »), elles-mêmes encadrées par la seconde moitié du verset 3 (« il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué ») et la première moitié du verset 9 (« lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué ») ; en outre, à la première moitié du verset 3, Abraham prend son fils et fend des bûches, de même qu’à la seconde moitié du verset 9, il lie son fils au-dessus des bûches. La qualité de ce récit n’a pas échappé non plus à Erich Auerbach qui a choisi d’introduire son grand ouvrage, Mimésis19, par une comparaison entre les récits homériques et ceux de l’Ancien Testament. Tandis que le style homérique a recours aux épithètes et aux digressions descriptives, détournant ainsi l’esprit du lecteur d’une crise actuelle, « au cours du sacrifice d’Abraham,
cette tension oppressante existe ; ce qui pour Schiller était réservé au poète tragique – nous ravir notre liberté d’esprit, diriger et concentrer nos énergies intérieures […] dans une seule direction –, cet effet-là est atteint dans cet épisode de la Bible20 ». La qualité littéraire de ces versets tout autant que la force poignante de leur contenu a certainement eu pour conséquence qu’il se fixe comme tel dans la mémoire et la culture vulgaires de la transmission, qu’elle soit juive ou chrétienne, au détriment du commentaire plus soucieux de rattacher cet épisode à la continuité d’une démarche plus savante : les conditions nécessaires à l’élaboration de l’Alliance.
La qualité du récit ne fait pas douter que le sacrifice de son propre fils est bien exigé d’Abraham. Ce n’est pas sans raison que Raphaël Shimshon Hirsch fulmine, dans son Commentaire sur le Pentateuque21, contre l’interprétation normalisante de la Wissenschaft des Judentums : « Une folie se qualifiant de “science du judaïsme” a osé aborder cet événement qui représente la gloire et le summum non seulement du judaïsme, mais encore, somme toute, de toute la grandeur morale humaine. Elle a déformé la vérité de cet événement au point d’en faire un mensonge et de le transformer en son contraire. Elle affirme ainsi : “La grandeur d’Avraham ne réside pas dans le fait qu’il est prêt à sacrifier son fils sur l’ordre de Dieu, mais dans le fait qu’il a obéi à l’appel de l’ange lui enjoignant de ne pas effectuer le sacrifice, c’est-à-dire dans le fait qu’il a pris conscience à temps de l’insatisfaction divine relativement aux sacrifices humains !” Avraham devient ainsi le grand réformateur de son temps, le premier à abolir tout sacrifice humain et à lui substituer l’offrande animale… ». C’est un point de commentaire qui oppose traditionnellement ceux qui tiennent pour le sens révélé du Pentateuque et ceux qui n’y voient qu’un document historique : le sacrifice des premier-nés aurait été coutumier dans la région à l’époque, et le passage révélerait la volonté de mettre fin à cette coutume jugée révoltante ou ruineuse. L’alternative serait entre sens sacré et sens archéologique ; or l’une comme l’autre des branches de cette alternative se fondent en quelque sorte sur une même distance prise avec le texte comme tel : l’hypothèse du miracle, comme toute hypothèse de ce type, ne peut
être discutée de manière convaincante d’un point de vue strictement réaliste, et n’a que faire d’arguments tirés du texte comme tel puisqu’ils présupposent que le miracle du sacrifice interrompu est une métaphore renvoyant à un sens rationnel transposé ; quant à l’orientation historienne, elle ne juge la signification du texte qu’en fonction des connaissances dont elle dispose sur la réalité de l’époque, le texte du Pentateuque n’étant en quelque sorte que le reflet a posteriori de cette réalité reconstituée et considérée implicitement comme préalable et critère justes. On comprend donc bien la colère du rabbin Hirsch visant la volonté bien intentionnée de ses coreligionnaires qui cherchaient un appui du côté de l’histoire tout en portant au crédit de la Torah qu’elle ait voulu rompre avec la tradition des sacrifices humains. Il en va de même dans l’édition, d’ailleurs splendide, de la traduction de la Bible des Septante22 : le commentaire de Genèse 22 est intitulé « Le sacrifice d’Abraham : la foi dans l’épreuve », et tranche d’emblée : « L’objet de l’épisode, outre l’interdiction du sacrifice humain, est l’identification d’un lieu cultuel (Jérusalem). […] Dans les deux traditions, juive et chrétienne, le sens de l’épisode est avant tout la foi d’Abraham “éprouvé” par Dieu. » Est-il besoin de rappeler que le thème de la « foi » n’est pas présent comme tel dans la tradition juive – tout au plus y serait-il question de l’obéissance ou de la crainte révérencielle. En outre, l’identification du mont Moryah à Jérusalem reste conjecturale, même si elle est fréquemment faite. La comparaison de Genèse 22, 9-11 avec Exode 34, 19-20, à laquelle on a souvent eu recours, oublie que ce dernier passage insiste sur les premiers-nés des troupeaux, et que le contenu du sacrifice exigé pour le premier-né des fils n’est nullement précisé : il s’agit moins d’un sacrifice que d’une offrande pour « racheter » à Dieu ces premiers-nés. C’est bien évidemment le maintien d’une Alliance qui prévaut et non un écho à des rites sacrificiels dont la cruauté se serait peu à peu atténuée.
Que les rédacteurs aient puisé tout naturellement dans le stock des termes et des références immédiatement lisibles par leurs contemporains n’a évidemment rien d’étonnant. Ce qui devrait, en revanche, attirer l’attention c’est la présence de termes ou de tournures particulières qui infléchissent nécessairement la perception du lecteur. Si l’on se place uniquement au niveau des informations proprement textuelles,
la présence, au cœur de ce récit, d’un hapax – laakod, « lier23 » – et d’un autre terme exceptionnel – maakhelet, « couteau24 » –, ainsi que la première occurrence, dans le Pentateuque, du terme lichkhot (« abattre ») signalent assez au lecteur attentif que la forme du récit ne délivre ni le sens de ce à quoi il renvoie ni la référence directe de ce qu’il met en scène ; mais c’est elle qui signale, par la répétition des raretés terminologiques, l’impossibilité d’inscrire l’épisode dans une réalité effective ou dans un ethos coutumier ; cette impossibilité n’oblitérant aucunement la vérité de l’exigence divine. La forme du texte a pour signification immédiate et globale l’idée d’exceptionnalité : il ne s’agit ni d’un sacrifice ordinaire, ni d’un sacrifice mimant un rite courant, ni d’une pratique rituelle qui soit achèverait soit inaugurerait une coutume. Il ne s’agit pas d’un sacrifice au sens littéral de ce que pourront nous donner par la suite à voir des représentations plastiques. Qu’Abraham ait commis une faute, que la conséquence de cette faute soit représentée de manière didactique et démonstrative comme le fait d’avoir à payer tribut de ce qu’il a de plus « cher » en sacrifiant son avenir, son fils, que ce « sacrifice » soit dramatisé par le recours à une forme narrative qui fixe dans les esprits une représentation bien plus sûrement qu’un exposé abstrait des conditions de l’Alliance et de l’accueil de la promesse, voilà qui illustre de manière frappante toute l’erreur de son comportement en Genèse 21, 28-34 ; et le sacrifice du bélier (verset 13) qui suit immédiatement, l’intervention de l’ange (verset 12) vient renforcer l’exceptionnalité du faux sacrifice d’Isaac (outre que l’image du bélier pris par ses cornes dans un fourré apporte un contrepoint presque humoristique au drame qui vient de se jouer : on peut y voir Abraham sacrifiant sa propre conduite passée qui le faisait se fourvoyer en fonçant tête baissée dans l’hypostase d’une alliance politique – la lecture typologique qui voit dans le bélier l’antitype de Jésus, et dans le bois des cornes ou du fourré la préfiguration de la croix relève de la pure interprétation allégorique ou tropologique). Le
sacrifice d’un bélier sera par la suite exigé pour racheter une infidélité ou pour réparer le fait qu’on ait retenu des offrandes destinées à un sacrifice divin (cf. Lévitique V, 14-19).
Il est enfin remarquable que Dieu n’intervienne ni pour arrêter la main d’Abraham (verset 12) ni pour confirmer l’Alliance (versets 15-18). L’ordre divin du verset 2 n’était pas abscons – comme le confirme par avance Genèse 18, 17-19 –, et si l’intervention divine était justifiée par le contresens où Abraham avait donné, elle ne l’est plus si le « sacrifice » n’a rien d’effectif, s’il ne s’agit pas, comme en Genèse 11, 5, d’une action concrète ; car le mouvement par lequel Abraham retrouve la signification juste de la promesse et de ce à quoi elle l’engage, grâce auquel il comprend qu’il sacrifie son avenir en confondant l’action politique et la source du droit, ce mouvement suffit à rétablir la différence ouvrant la voie à l’élection : la différence entre le registre de la promesse et celui des nécessités immanentes. Un messager de Dieu suffit à mettre fin au « récit » du faux sacrifice. De même, Dieu n’a plus à confirmer sa promesse ; un messager y pourvoit, et, outre la confirmation de l’avenir désormais possible de nouveau, le verset 16 offre un symétrique à ce que doit être l’engagement personnel d’Abraham face à la promesse qu’il a reçue et qui l’engage : l’ange jure par lui-même. En effet, la promesse engage personnellement à la fois celui qui promet et celui qui doit se placer et se maintenir à la hauteur de l’exigence ainsi créée, de l’exigence dont il ne peut témoigner également que par sa personne. L’idée de réflexivité introduite par ce serment de l’ange est la réponse à la réflexivité qui a permis à Abraham de se ressaisir en comprenant qu’il risquait de sacrifier son avenir. Elle est la confirmation de sa justesse (la deuxième partie du verset 16 et la première moitié de verset 17 sont explicites : « Parce que tu as fait cela et n’as pas épargné ton fils unique, je m’engage à te bénir »), elle est à la fois le pendant et le reflet du retour sur soi effectué par Abraham, le rétablissement du sens tout à la fois événementiel et idéal de l’Alliance. Du point de vue de la formation des engagements politiques en général, la question de la promesse devient centrale si l’in veut bien considérer ce qui change avec l’apparition des textes dont la nature commune, par-delà les différences géographiques et culturelles souvent considérables, est d’être mytho-logiques, c’est-à-dire qu’ils procèdent à une relecture critique de leur héritage et à une refonte de l’ordre politique ou normatif jusque-là en vigueur ; cette caractéristique
commune confortée par la quasi simultanéité chronologique de ce mouvement critique dans notre histoire. En effet, la Théogonie d’Hésiode est quasi contemporaine de la rédaction du Pentateuque, et ces deux mouvements correspondent au développement de la poésie védique qui procède de même à l’égard de son fonds mythique. La distance réflexive prise à l’égard de la sphère mythique a pour corollaire un statut nouveau acquis par le langage qui s’affirme contre un monde « naturel » régi par des forces innervant toute réalité. Ce n’est pas que les sociétés antérieures aient fonctionné sans règles, mais leur justification, leur formulation et les conditions de leur application ne restent plus les mêmes. La promesse est un exemple éminent, parce qu’il montre ce qui est à l’arrière-plan de la formation des règles lorsque l’on passe ou tente de passer à un niveau où pacta sunt servanda constitue la base de toute normativité. Le respect des serments a sans doute toujours existé ; mais sa justification en raison de son caractère formel, d’une part, sa formulation sur une base qui veut s’affranchir absolument d’un univers régi par des forces échappant à tout contrôle humain au profit d’une cohérence intralinguistique, systématique et formelle, d’autre part, et, de même, finalement, l’autorité des pactes fondée non sur celle de la tradition, mais sur le simple fait qu’ils ont été conclu, voilà autant de linéaments nécessaires à l’élaboration du droit moderne.
Marc de Launay
Archives Husserl de Paris (ENS-Ulm)
1 E. Voegelin, Anamnesis, Munich, Piper, 1966, p. 100.
2 Ordnung und Geschichte, vol. 2, Munich, Fink, 2005, p. 43.
3 Ibid., p. 44.
4 Ibid., p. 93.
5 Ibid., p. 98.
6 Ibid., p. 95.
7 Ibid., p. 99 sq.
8 Pas davantage chez les prophètes : voir par exemple, Isaïe 19, 21-25, ainsi que 25, 6-8 associe l’Égypte, Assur et Israël dans la bénédiction à venir de la terre ; plus nettement encore, 42, 2 donne pour mission au serviteur de l’Éternel d’« apporter le droit » « pour l’alliance des peuples » (de même 49, 5-8). Zacharie 9, 9-10 fait du messie un roi qui apportera la paix aux peuples.
9 Commentaire (courant xiie siècle, Breslau, 1882), 21, 30, cité in E. Munk, La Voix de la Torah, Paris, Fondation Samuel Lévy, 1981, p. 220 (ce commentaire est repris par B. Jacob, Das erste Buch der Tora. Genesis, Berlin, Schocken, 1934, p. 492 : « Abraham doit apprendre qu’il ne faut pas conclure d’Alliance éternelle avec les choses de ce monde. »).
10 Voir le commentaire du Midrach, Béréchit Rabba, Vayéra, 54, 4 : « Abraham, tu as donné sept agnelles sans mon consentement. » ; cf., ibid., 55, 4 : « Je [Abraham] me suis réjoui et j’ai réjoui tous les autres, mais je n’ai pas mis de côté un seul taureau ou un seul bélier pour le Saint béni soit-il. »
11 Voir par exemple, Genèse 13, 4.
12 B. Jacob, op. cit., p. 492, relève que le geste de planter un arbre connote l’illusion d’une durée qui est en fait incommensurable avec l’éternité de Dieu invoquée conjointement. Raphaël Hirsch, Commentaire du Pentateuque, (1868) vol. I, Paris, Kountrass, 1995, p. 538 (trad. fr. N. Gangloff), remarque que cette désignation de Dieu ne se retrouve nulle part dans le Pentateuque (voir Isaïe 40, 28), et il traduit par « Dieu de l’avenir » ; voir également Maïmonide, Le Guide des égarés, II, 13, qui refuse de donner un sens spatial à ce terme.
13 Dans son de Abrahamo, Philon admet que « les faits rapportés [en Gen. 22] ne se réduisent pas aux limites du sens littéral et apparent » § 200, et propose une interprétation allégorique fondée sur l’étymologie du nom d’Isaac (qui signifie joie), § 202.
14 Dans la partie critique de son commentaire (Genesis, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins, 1979-1982), C. Westermann s’oppose résolument à la majorité des interprétations (von Rad, Delitzsch, Skinner, etc.) parce qu’elles soulignent « la gloire d’un homme […] Il me semble qu’un tel panégyrique d’Abraham passe à côté du sens de ce récit […] Il n’a pas pour finalité d’établir la gloire d’un homme, mais celle de Dieu », p. 447.
15 Voir A. Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (1913), in Sämtliche Werke, Munich, Philosophia, 1989, p. 141-278.
16 M. Buber et F. Rosenzweig traduisent par l’all. Darhöhung (ce terme forgé par eux n’existe pas en allemand, et connote à la fois l’idée d’exposition et d’élévation) l’hébreu ola (l’un des termes employés pour un « sacrifice »). Voir le commentaire de R. Hirsch, op. cit., p. 544.
17 R.-S. Hirsch met en rapport le terme hébreu nissayon, l’épreuve – qu’il glose en soulignant que ce terme a pour connotations le dépassement, le fait de soustraire quelque chose à un ordre empirique pour l’élever – et le sens de Moriya : le niveau transcendant de l’a priori.
18 Walter Vogels, Abraham et sa légende, Montréal-Paris, Éd. du Cerf, 1996, p. 285-300.
19 Cf. trad. fr. C. Heim, Paris, Gallimard, 1968 (l’ouvrage, d’abord paru en 1946 à Berne, fut rédigé par l’auteur en exil à Istanbul entre mai 1942 et avril 1945).
20 Ibid., p. 19. Voir également, p. 23-26.
21 Commentaire sur le Pentateuque (1868), trad. fr., Néhémia Gangloff, Jérusalem, 1995, p. 550 sq.
22 La Bible d’Alexandrie, éd. Marguerite Harl, Paris, Éd. du Cerf, 1994.
23 Marguerite Harl, « La “ligature” d’Isaac dans la Septante et chez les Pères grecs », in Hellenica et Judaïca. Hommage à Valentin Nikiprowetzky, Louvain-Paris, Peeters, 1986 (A. Caquot, M. Hadas-Lebel et J. Riaud, eds.), p. 457, note 1, affirme que « nulle part dans la Bible, semble-t-il, il n’est dit que la victime doit être attachée », mais interprète immédiatement cet hapax dans un sens lexical restrictif : « Il ne s’agit pas exactement d’un mot de l’hébreu biblique. »
24 C’est d’ailleurs la seule occurrence du terme dans tout le Pentateuque lorsqu’il est question de sacrifice.