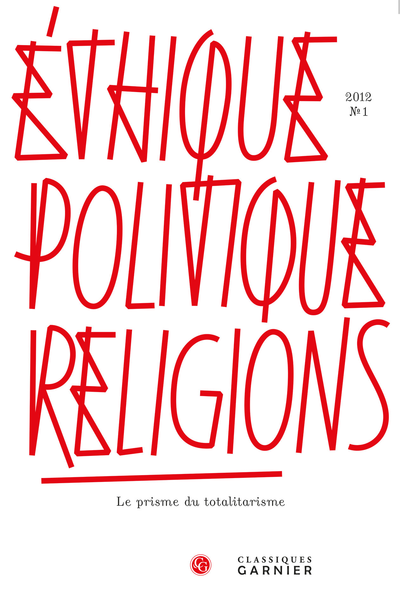
De la fondation à la conservation de l’État de droit La notion de violence chez Schmitt et Benjamin
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2012, n° 1. Le prisme du totalitarisme - Auteur : Storme (Tristan)
- Résumé : Durant les années weimariennes, Carl Schmitt et Walter Benjamin posent la question de l’origine de l’ordre juridico-politique, ainsi que celle de sa préservation. Les deux auteurs semblent s’accorder sur le fait que la fondation de l’État de droit résulterait toujours d’un acte de violence. Tandis que Benjamin caractérise ce geste inaugural de « violence fondatrice de droit », Schmitt soutient l’idée qu’une « décision politique » originelle qui incomberait au pouvoir constituant serait à la racine de tout ordre juridique. Se déclinant sous la forme de mesures d’exception, la violence se ferait ensuite « conservatrice de droit », elle chercherait à maintenir en l’état l’ordre institué. Cet article vise ainsi à éclairer l’importance que revêt la notion de violence dans les réflexions développées par ces deux penseurs allemands au cours des années 1920.
- Pages : 41 à 56
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812408823
- ISBN : 978-2-8124-0882-3
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-0882-3.p.0041
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Carl Schmitt, Walter Benjamin, État de droit, violence politique, ordre juridique, état d’exception, décision politique
De la fondation
à la conservation de l’État de droit
La notion de violence chez Schmitt et Benjamin
Au début des années 1920, tandis que la république de Weimar connaît une longue série de troubles intérieurs, deux penseurs, installés du même côté du Rhin, s’interrogent quant aux origines de l’ordre juridico-politique et aux modalités de sa préservation. La violence leur apparaît alors comme une notion centrale, approchée dans les écrits qu’ils rédigent durant cette période tumultueuse, et qu’il s’agira pour nous d’examiner de plus près et de percer à jour. En dépit de leur divergences politiques manifestes, Carl Schmitt, juriste conservateur reconnu qui se compromit avec le nazisme jusqu’en 1942, et Walter Benjamin, philosophe converti au marxisme dès 1924, ami de Scholem et d’Adorno, ont tous deux en commun d’avoir concentré certaines de leurs réflexions vers un objet d’étude similaire : la naissance violente de l’État (ou domaine du droit public) et les conditions relatives à sa perpétuation.
I
D’abord refusé par la revue Die weissen Blätter en raison de sa longueur et de sa complexité, l’essai de Benjamin sur la violence, intitulé Zur Kritik der Gewalt, paraît en 1921 dans l’Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, soit une année avant la publication de la première Théologie politique de Carl Schmitt où celui-ci jette les fondements de son décisionnisme juridique. Le terme allemand « Gewalt » ne se laisse pas traduire facilement en français ; il signifie « violence », mais aussi « force » ou « pouvoir » – « violence autorisée, pouvoir légal, comme lorsqu’on parle de
Staatsgewalt, le pouvoir d’État1 », écrit Derrida. L’essai en question témoigne de l’ambition benjaminienne de poser les jalons d’une « philosophie de la politique » et inaugure les réflexions du philosophe de Francfort à ce sujet2. Benjamin commence par récuser les termes dans lesquels s’est posée historiquement la critique philosophique de la violence. La tâche que l’auteur allemand attribue à une critique véritable de la violence est de « décrire la relation de la violence au droit et à la justice », étant donné qu’une cause « ne devient violence, au sens prégnant du terme, qu’à partir du moment où elle touche à des rapports moraux3. » La question primordiale de toute critique de la violence consisterait alors à saisir les cas déterminés où elle se justifie au nom de la moralité ; ce que deux grandes traditions en philosophie du droit ont bonnement été inaptes à réaliser. « Jusqu’ici cette critique s’est toujours inscrite dans l’espace de distinction entre moyen et fin4. » En suivant de près l’exposé spinozien du xvie chapitre du Traité théologico-politique, Benjamin conclut que, pour les tenants de la doctrine jusnaturaliste, le recours à des moyens violents n’apparaît aucunement problématique dès lors que les fins à atteindre sont justes. Par conséquent, on ne saurait stipuler si de tels moyens en eux-mêmes – si la violence en tant que moyen – s’avèrent conformes à la moralité, puisque le droit naturel fait uniquement grand cas de sa liaison à un but spécifique, juste ou injuste. La seconde orientation théorique que Walter Benjamin s’applique à écarter dans les premières pages de son essai est celle du droit positif, qui ne saurait considérer le droit naissant que par la critique, non plus de ses fins, mais de ses moyens. Elle assurerait la justice des buts par l’usage de moyens conformes au droit. L’auteur conclut par suite que « les deux écoles se rejoignent dans le dogme fondamental commun selon lequel on peut atteindre par des moyens légitimes à des fins justes et employer des moyens légitimes pour réaliser des fins justes5. » Benjamin appelle à sortir de ce « cercle » funeste et à évaluer la violence en elle-même, quel que soit son but.
D’après Jacques Derrida, « Carl Schmitt, que Benjamin admira et avec lequel il entretint une correspondance, le félicita pour cet essai6. » Même si le juriste a prétendu dans un courrier adressé à l’anarchiste berlinois Hansjörg Viesel que tous deux « entretenaient des contacts quotidiens (we were in daily contact)7 », rien ne permet d’affirmer l’existence de la relation épistolaire entre Schmitt et le philosophe marxiste8. À vrai dire, on ne connaît que la lettre, restée fameuse au demeurant, que Benjamin envoya le 9 décembre 1930 à l’attention du juriste conservateur et que ce dernier, semble-t-il, laissa sans réponse. Le penseur y reconnaît explicitement sa dette envers la présentation schmittienne « de la théorie de la souveraineté au xviie siècle […] [et les] modes de recherche9 » développés dans La Dictature – ce qui explique sans doute les raisons pour lesquelles Scholem et Adorno écartèrent la missive en question de la Correspondance du philosophe, publiée en deux volumes durant l’année 1966. Vraisemblablement, une telle lettre aurait altéré l’image de Benjamin que ses anciens amis cherchaient à diffuser. De tels éloges ne laissèrent pas Schmitt insensible, qui, pour la peine, mentionna ce courrier dans Hamlet oder Hekuba, ouvrage dans lequel il souligne, d’autre part, la grande valeur intellectuelle du travail de son collègue10.
Benjamin était, en effet, séduit par la théorie de la souveraineté développée par Carl Schmitt au début des années 1920, si bien que, dans son Origine du drame baroque allemand (Trauerspielbuch), il lui emprunte
ses réflexions autour du souverain et de l’état d’exception, citant à trois reprises le premier chapitre de la Politische Theologie11. Jean-Michel Palmier soutient à ce propos qu’à l’instar de Schmitt, Benjamin « voit dans la conception de la souveraineté absolue du prince, le meilleur remède12 » à la situation exceptionnelle. Qu’une part de l’exposé du Trauerspielbuch converge avec l’analyse schmittienne de la situation du droit au xviie siècle n’aurait rien d’étonnant, dans la mesure où les deux auteurs partageaient un intérêt similaire pour les soubassements théologiques de la philosophie de l’histoire13. On peut d’ailleurs reconnaître, avec Giorgio Agamben, que la relation entre la violence révolutionnaire benjaminienne, sur laquelle débouche l’essai de 1921, et l’état d’exception schmittien se révèle particulièrement étroite d’un point de vue architectonique, à tel point « que les deux joueurs qui s’affrontent sur l’échiquier de l’histoire [Benjamin et Schmitt] semblent bouger le même pion14 ». L’allégorie de la partie d’échecs renvoie à la première thèse du philosophe marxiste Sur le concept d’histoire, où « un nain bossu » théologique tire les ficelles de la marionnette appelée « matérialisme historique » pour lui permettre de gagner à tous les coups15. Le concept de « rédemption (Erlösung) » permettrait de briser la temporalité évolutionniste inhérente au progrès et d’ainsi reformuler le matérialisme suivant la dimension théologique du messianisme qui récuserait la conception irréversible, inévitable et linéaire du temps. La lutte des classes serait à repenser, dans une alliance avec la théologie, au sens d’un messianisme séculier. Walter Benjamin paraît acquis au théorème de la sécularisation défendu par Schmitt en 1922, à tout le moins dans son interprétation la plus « faible16 ». Tous
deux partagent l’idée qu’une politique devient impossible dès l’instant où on la coupe de ses fondements théologiques, voire messianiques. Schmitt et Benjamin donnent ainsi l’impression de se situer sur le même terrain théorique, ils parlaient sur le même plan et s’exprimaient dans un langage théologico-politique analogue.
II
L’une des distinctions analytiques principales qui occupent le cœur du texte de Benjamin témoigne de l’importance de l’impact des Réflexions sur la violence de Georges Sorel sur la rédaction de Zur Kritik der Gewalt : « Toute violence est, en tant que moyen, soit fondatrice, soit conservatrice de droit17. » Entendons qu’attachée à la sphère des moyens, la violence est nécessairement, tantôt fondatrice de droit, dans la mesure où elle instaure, institue l’ordre juridique, tantôt conservatrice de droit, dès lors qu’elle maintient l’autorité de la légalité en place. « La fondation de droit est une fondation de pouvoir et, dans cette mesure, un acte de manifestation immédiate de la violence18. » La violence originaire, celle qui instaure l’autorité juridique, est une violence sans fondement, puisque, par définition, en tant qu’ultime fondement du droit elle demeure infondée. On peut donc dire qu’elle ne se justifie elle-même à partir d’aucune légitimité préalable – elle ne reconnaît, bien sûr, aucun droit antérieur, elle consiste en un coup de force, en « une force performative19 » qui n’est ni juste ni injuste, ni légale ni illégale (elle vise précisément à instruire la légalité). Benjamin rapproche la violence fondatrice de la « violence mythique », en stipulant que la violence des dieux grecs à l’encontre de Niobé, par exemple, mère de douze enfants selon l’Iliade (quatorze
selon d’autres traditions), et qui s’était moquée de la fécondité de Léto, peut effectivement être regardée comme fondatrice de droit. La violence d’Artémis et d’Apollon tuant les Niobides à coup de flèches « fonde un droit bien plutôt qu’elle ne punit une infraction à un droit existant20. » Niobé n’a pas violé le droit, c’est plus exactement par le triomphe des dieux qu’un droit est institué.
Pareille compréhension de la naissance de l’ordre juridique n’est pas sans évoquer le scepticisme de Montaigne pour qui ce qui pousse les individus à obéir aux lois n’est certainement pas la justice de celles-ci, mais le fait qu’elles disposent de l’autorité – les lois ne sont pas « justes », mais elles ont l’autorité. L’autorité des lois repose, en conséquence, sur la croyance en cette autorité, bien plus que sur la conviction de leur caractère juste. Si bien qu’il apparaît que le droit repose, en dernière instance, sur un fondement que Montaigne appelle « mystique » : « Or les loix se maintiennent en crédit, non par ce qu’elles sont justes, mais par ce qu’elles sont loix. C’est le fondement mystique de leur autorité ; elles n’en ont poinct d’autre. […] Quiconque leur obeyt parce qu’elles sont justes, ne leur obeyt pas justement par où il doibt21. »
La fondation des États se fait donc toujours dans la violence. Cette idée, on la retrouve également dans Der Stern der Erlösung, le maître-œuvre de Franz Rosenzweig qui paraît la même année que l’essai de Benjamin : « C’est le sens de toute violence que de fonder un nouveau droit. Elle n’est pas une négation du droit, comme on le croit souvent, fasciné qu’on est par ses allures subversives : bien au contraire, elle le fonde22. » Carl Schmitt nous apprendra, une année plus tard, que cette violence fondatrice de droit peut se ramener à la décision originelle, à la « décision politique (politische Entscheidung) » qui incombe au pouvoir constituant.
Dans Homo sacer, Agamben soutient que le penseur marxiste présenta « le rapport entre pouvoir constituant et pouvoir constitué comme le rapport entre la violence qui fonde le droit et la violence qui le conserve23 ». À
l’instar de la rechtsetzende Gewalt benjaminienne, le pouvoir constituant que Schmitt approche avec minutie dans sa Théorie de la Constitution – et qui se dit « verfassunggebende Gewalt » en allemand – ne découlerait d’aucune norme antérieure. C’est plutôt la constitution qui reposerait sur « une volonté politique, c’est-à-dire un être politique concret24 » que le pouvoir constituant serait le seul à exprimer. Elle prendrait appui sur une décision politique qui émane de ce pouvoir non constitué « qui ne peut être aboli par aucune constitution s’opposant à lui25. » La question de l’origine de tout ordre normatif ou du fondement de la normativité de la norme est au centre du conflit juridico-philosophique qui oppose Schmitt au normativisme kelsénien durant les années weimariennes. Le juriste néo-kantien Hans Kelsen entend, pour sa part, « considérer le droit comme un ordre clos sur lui-même26. » En affirmant l’irréductibilité du Sein au Sollen, de l’être au devoir-être, Kelsen croit démontrer la non-juridicité des effets qu’un acte de volonté est susceptible d’occasionner. En d’autres mots, « ce qui est juridique n’est explicable que juridiquement […], l’existence d’une règle découlant toujours de l’existence préalable d’une autre règle27 » ; seul le droit est donc, dans ce cas, habilité à créer du droit. Pour Schmitt, le normativisme kelsénien s’enliserait dans la fiction de l’autofondation de l’ordre juridique, alors que la norme ne serait aucunement en mesure de fonder le droit. Dans sa Théologie politique de 1922, Schmitt radicalise ses positions décisionnistes en affirmant le caractère fondateur de l’instant de la décision pour ce qui concerne la normativité juridique elle-même :
Car tout ordre (Ordnung) repose sur une décision (Entscheidung), et même le concept d’ordre juridique (Begriff der Rechtsordnung) qu’on emploie sans réflexion comme une chose allant de soi renferme l’opposition des deux composantes du juridique. Même l’ordre juridique repose, à l’instar de tout ordre, sur une décision et non sur une norme28.
La qualité spécifique du droit doit être trouvée dans une décision suprême et fondatrice ; c’est parce que celle-ci existe que les règles juridiques pourront ensuite exister. On comprend qu’aux yeux du juriste conservateur, ce qui préexiste au système juridique en vue de permettre son existence, est un élément de décision « pure » qu’on ne peut déduire du contenu d’une norme. Cette décision pure – pure, car elle compose un fondement ultime non fondé ou infondé – est à la fois expression et négation de considérations irrationnelles. Si « la réalité se trouve soustraite à toute forme de rationalisme29 », elle autorise simultanément l’instauration d’un ordre juridique rationnel. Tout semble indiquer que, pour Schmitt, le politique détermine le droit, au sens où le droit est nécessairement d’origine politique ; il résulte de cette décision politique qui échoit au pouvoir constituant. Hans Kelsen était d’ailleurs persuadé que son confrère avait « toujours eu un point de vue exclusivement politique sur le droit30. » Le politique préexisterait au système juridique, dont la qualité spécifique doit être trouvée dans une décision constituante.
Dans les écrits weimariens de Carl Schmitt, la décision représente un réquisit de l’effectivité de la démocratie – elle procède d’une véritable conception du régime démocratique, là où le parlementarisme libéral se perdrait en discussions et recourrait à « la dynamique d’une concurrence perpétuelle et de débats sans fin31. » Pour une critique de la violence témoigne également d’un certain refus, ou d’une certaine contestation, de l’institution parlementaire qui vivrait dans l’oubli de la violence originaire dont elle est née : « Que disparaisse la conscience de cette présence latente de la violence dans l’institution juridique, cette dernière alors périclite (verfällt). Les parlements aujourd’hui en donnent un exemple32. » On assisterait à un déclin, à une déchéance – au Verfall de l’histoire du droit, dont l’origine révolutionnaire se serait peu à peu effacée de la conscience de la démocratie parlementaire libérale. Tandis que la grève générale prolétarienne, concept emprunté à Sorel, vient « suspendre » le droit en vigueur dans l’objectif d’en créer un nouveau, agissant comme « pouvoir constituant »
pourrait-on dire, les réformes bourgeoises aboutiraient aux compromis parlementaires, à ce « pouvoir constitué » qui a perdu toute conscience du caractère fondateur de la violence qui l’a engendré. Car l’institution de tout État dépend d’un moment de violence révolutionnaire. On le voit, Schmitt et Benjamin s’accordent pour défendre que le domaine du droit public naît de et dans la violence. Le moment de la décision, « der Moment der Entscheidung », est cet instant fondateur du droit auquel on ne peut opposer aucune contre-indication juste ou légale. « Il y a là un silence muré dans la structure violente de l’acte fondateur33. » L’État de droit est toujours d’abord un État de violence. Mais si, pour le philosophe marxiste, la démocratie libérale a oublié cette violence révolutionnaire qui siège à sa racine, l’État ne se perpétue pas pour autant en dehors de toute violence et de toute brutalité.
III
Le droit aurait ensuite un « intérêt » à accaparer la violence et à en interdire l’usage aux individus, de peur que ceux-ci ne viennent menacer l’ordre juridique – Benjamin évoque « l’intérêt du droit à monopoliser la violence34 ». Chaque fois que la personne individuelle comme sujet de droit pourrait viser ses fins naturelles « de façon appropriée » en engendrant la violence, l’ordre juridique incline à instituer des fins légales. Il refuse l’usage des moyens violents aux individus, cherchant à limiter leurs buts naturels par l’instauration de buts légaux « dès lors que ces fins naturelles sont visées de façon trop violente35 ». Or l’intention de protéger les fins légales n’explique en aucun cas l’intérêt qu’a le droit à confisquer la violence ; c’est en réalité la protection du droit lui-même, du Rechtsordnung en tant que tel, qui en constitue l’objectif in fine. La peine de mort représente sans doute l’exemple le plus paradigmatique d’un exercice de la violence qui permettrait de maintenir, voire d’affermir, l’applicabilité du droit. Confirmant l’idée d’une déchéance progressive
de l’historicité du droit, Benjamin constate que s’en prendre à la peine de mort revient non pas à attaquer « le quantum de la peine », mais à attaquer « le droit lui-même dans son origine36. » Son abolition ne signifierait nullement le démantèlement d’« un dispositif parmi d’autres », c’est bien plutôt « le principe même du droit37 » que l’on désavouerait.
La violence tenue à l’écart des mains des individus ne cesse pas pour autant de représenter une menace aux yeux des citoyens (la possibilité de la peine de mort vient d’ailleurs l’attester). La violence se fait conservatrice de droit – la rechtserhaltende Gewalt est cette menace qui procède du droit dans l’optique de protéger l’ordre juridique. À ce propos, le prolétariat fait office de sujet privilégié ; les travailleurs sont en effet le seul sujet de droit à bénéficier d’un droit à la violence à côté de l’État, garanti sous la forme du droit de grève. Néanmoins s’il se sent menacé, l’État condamnera la grève comme illégale, stipulant qu’elle outrepasse les limites établies par le législateur. Il la renverra dans l’illégalité, tant il craint le surgissement d’une violence fondatrice de droit, capable de « se présenter comme un ayant droit au droit38. » Le droit de grève, à travers le cas sorélien de la grève générale révolutionnaire, menace de suspendre le droit, et il le fait – il est habilité à le faire – parce qu’il appartient déjà au droit. Lors de la grève générale révolutionnaire, « les travailleurs invoqueront toujours leur droit de grève, tandis que l’État qualifiera cette invocation d’abus, car, à ses yeux, le droit de grève n’a pas été entendu “ainsi”, et il édictera ses mesures d’exception39. » Parce que l’appareil étatique s’appuie sur une interprétation ambivalente – puisque l’État reconnaît ce droit aux travailleurs en fonction de la « situation » du droit lui-même –, Benjamin peut parler d’une « contradiction objective » de l’ordre juridique qui admet très souvent une violence dont les buts naturels sont regardés avec indifférence mais qui, « dans un cas critique (Ernstfall)40 », occasionne pourtant sa répression via des mesures exceptionnelles. Le philosophe marxiste radicalisera cette référence à l’exception et au cas critique dans sa huitième thèse Sur le concept d’histoire, d’après laquelle l’état d’exception serait devenu la règle41. Une
fois encore, Benjamin fait écho à la première Théologie politique de Carl Schmitt, comme c’était déjà le cas dans le Trauerspielbuch, avec pour ambition désormais d’opérer un renversement radical de la notion de souveraineté que le juriste allemand avançait sous la scansion suivante : « Est souverain celui qui décide de l’état d’exception (Ausnahmezustand)42. » La confusion tendancielle de l’anomalie et de la norme que Benjamin croyait observer en son temps réclamait l’établissement d’une politique pensée sur les bases d’une exception « véritable » ou « effective » (wirklich). Il devenait impératif, selon lui, de « renverser les rapports entre la règle et l’exception, pour construire un concept d’histoire qui dépasse les catégories de légalité et de régularité propres au positivisme du xixe siècle43 ». Il n’est pas faux d’affirmer, par ailleurs, qu’une pareille entreprise prenant le contre-pied de la théorie schmittienne de la souveraineté ne déstabilise pas pour autant les présupposés théoriques, la systématicité et l’orientation méthodologique que l’auteur de Über den Begriff der Geschichte doit manifestement au juriste conservateur – Rainer Rochlitz va même jusqu’à percevoir, dans cette huitième thèse, « le recours à une politique autoritaire, indissociable du concept d’état d’exception forgé par Carl Schmitt44. »
Dans sa Politische Theologie de 1922, Schmitt reprochait au normativisme kelsénien d’avoir non seulement consacré l’autofondation fictive de la normativité juridique, mais également d’avoir écarté le cas exceptionnel dont il nie l’existence d’abord « en adhérant à la thèse positiviste de l’absence principielle de lacunes dans l’ordre normatif45 », ensuite en supportant l’idée de la prévision d’une autosuspension de l’ordre par lui-même. L’exception, la situation a-normale que ne prévoit pas la
Constitution, priverait la validité normative de son sens, puisque, chez Kelsen, le souverain n’est pas du tout en mesure de s’extraire du système, il n’est aucunement disposé à décider de la suspension des normes. Dans une optique normativiste, « l’État se trouve alors pris au dépourvu par la situation exceptionnelle – celle précisément où il faut “décider”46. » S’opposant vigoureusement aux conceptions de Kelsen, la définition schmittienne de la souveraineté signifie que l’ordre juridique est, en dernier ressort, garanti par la déclaration d’un état d’exception, par une « décision en un sens éminent47 » qui rendrait la norme de nouveau applicable à l’avenir du fait de la suspension de son efficacité. Si l’apparition du droit semble dépendre d’une décision, la préservation de l’ordre normatif repose lui aussi, « dans le cas critique », sur un acte similaire. Non sans évoquer la rechtserhaltende Gewalt benjaminienne, le juriste allemand écrit : « Dans le cas d’exception (Im Ausnahmefall), l’État suspend le droit en vertu d’un droit d’autoconservation (Selbsterhaltungsrecht), comme on dit48. » Si elle semble en soi extrajuridique, la violence souveraine qui s’exprime par l’entremise de la décision au sujet de l’exception a toutefois pour dessein de conserver le droit en le suspendant. Ce qui est pour ainsi dire « en question dans cette suspension », c’est « la création d’une situation rendant possible l’application de la norme49 ». Comme l’avait déjà laissé entendre Walter Benjamin un an auparavant, afin de conserver le droit devant le cas critique qui en menace l’existence – devant l’Ernstfall que représente la grève générale prolétarienne –, l’État souverain n’a d’autre choix que de recourir à des mesures exceptionnelles. D’après Schmitt, c’est au souverain qu’incombe la proclamation de l’Ausnahmezustand, en vue d’assurer la situation dont le droit a besoin pour redevenir valide, c’est-à-dire de rétablir les conditions de possibilité de la validité de l’ordre normatif.
Déjà dans La Dictature, Schmitt tenta d’approcher la notion d’exception. La pierre angulaire de cet ouvrage, paru la même année que l’essai de Benjamin sur la violence, réside dans l’opposition entre une « dictature de commissaire » qui suspend concrètement et provisoirement la Constitution pour en garantir la pérennité, et une « dictature
souveraine » qui viserait, quant à elle, à abolir la Constitution en vigueur afin d’en instaurer une nouvelle50. Le juriste conservateur voyait dans la possibilité d’une dictature commissariale, prévue par l’article 48 de la Constitution de Weimar, le meilleur moyen d’empêcher l’accomplissement du danger révolutionnaire, de prévenir l’instauration d’une dictature du prolétariat qui recourrait de façon abusive au pouvoir constituant du peuple. Schmitt est d’avis que « la dictature est nécessairement l’“état d’exception”51 », elle ne survient qu’à titre exceptionnel dans l’objectif de suspendre provisoirement la Constitution, le temps de rétablir les conditions indispensables à son existence.
Dans un enthousiasme partagé pour les textes de Georges Sorel, Schmitt et Benjamin interprétaient la révolution prolétarienne comme une violence « fondatrice de droit », capable de surgir et d’abroger l’ordre en place. Face à ce péril, la violence de l’État se ferait « conservatrice de droit », dans le but de préserver son origine – elle n’est donc certainement pas coupée de la violence fondatrice dont il s’agit de conserver ce qu’elle a institué. Au lieu de congédier la violence une fois le droit posé, ce qui constituait pourtant l’objectif de la décision originaire, la violence conservatrice la réitère, afin d’empêcher les individus et les travailleurs de mettre à mal l’ordre en vigueur – elle n’est que réitération de l’origine par le pouvoir constitué. C’est ce que Jacques Derrida nomme « le paradoxe de l’itérabilité », paradoxe qui « menace la rigueur de la distinction entre les deux violences52 » proposée par Walter Benjamin. L’itérabilité « fait que l’origine doit originairement se répéter et s’altérer pour valoir comme origine, c’est-à-dire pour se conserver53. » Tant que l’exception se distingue logiquement de la règle, distinction que le philosophe marxiste ébranlera dans ses Thèses en 1940, la dialectique entre les deux types de violence ne saurait être brisée.
Dans son affection particulière pour l’anthropologie négative, Carl Schmitt était persuadé qu’il y aurait toujours des guerres et que chercher à les abolir plutôt qu’à les limiter ou à les réglementer conduirait à une
hostilité absolue, à une « guerre d’extermination (Vernichtungskrieg) », que Benjamin avait d’ailleurs prophétisée dans certains de ses écrits54. Si le politique est issu de la possibilité réelle d’une violence mortifère, son effectivité assurerait, en retour, une limitation des conflits guerriers. Schmitt et Benjamin étaient d’accord pour reconnaître que le droit naissait et se conservait dans la violence. Mais dans la pensée du juriste westphalien, le droit, une fois établi, permet d’écarter la violence révolutionnaire sur le plan intérieur et l’escalade belliqueuse sur celui des relations internationales. Tandis que le philosophe marxiste tentera de développer le concept de « violence pure (reine Gewalt) », étrangère au droit, possédant une existence en dehors des limites juridiques, Schmitt s’appliquera à réinscrire la violence au sein de la sphère du droit, largement subordonnée au politique.
Aujourd’hui, depuis les attentats du 11 septembre, ces deux auteurs sont souvent présentés comme des penseurs « visionnaires » ; leurs réflexions respectives auraient, entre autres, autorisé la préhension des tendances actuelles à la banalisation de l’exception, pathologie qu’aurait engendrée la démocratie libérale, que Schmitt et Benjamin ne regardaient pas d’un très bon œil. On peut sans doute affirmer que nos deux théoriciens éprouvaient la même suspicion à l’égard de l’« idéologie libérale » et de ses hypocrisies présumées, ce qui a peut-être permis que « le juif Walter Benjamin » soit « convoqué par Giorgio Agamben sur le même plan que le nazi Carl Schmitt55 ». Mais, on l’a vu, contrairement à ce qui se joue chez Benjamin, le souverain schmittien qui agit en dehors du cadre légal tenterait, à partir de l’espace que crée l’état d’exception, d’enfermer et d’inscrire l’anomie dans le corps même du droit. Il a la capacité d’imposer des normes à l’encontre de la vie anomique qui n’est donc pas complètement libre de toute violence, mais qui peut devenir sujet de la vie exceptionnelle devenue nouvel état normalisé. En faisant du « camp » le symbole de l’état d’exception, un lieu au sein duquel l’ordre normal est de fait suspendu – un lieu dans lequel ce qu’est une
atrocité ne dépend plus de la loi, mais de la civilité et du sens moral de la « police » qui agit temporairement comme souverain –, Agamben introduit l’alternative entre le camp et l’anomie dépourvue de tout lien avec la violence juridique comme l’enjeu définitoire principal des conceptions politiques modernes.
Dans État d’exception, traitant de la situations des détenus sur la base navale de Guantánamo, Agamben soutient que « la seule comparaison possible est la situation juridique des juifs dans les Lager nazis56 ». Parce que le camp de concentration est interprété comme l’espace où règne l’état d’exception devenu la règle, celui-ci composerait « la matrice secrète, le nomos de l’espace politique dans lequel nous vivons encore57. » La généralisation et la banalisation des pratiques exceptionnelles témoigneraient de l’avènement d’un nouveau paradigme de gouvernement. Définissant le régime hitlérien comme celui qui aurait consacré l’état d’exception par l’intermédiaire du système concentrationnaire, Agamben défend que la démocratie libérale occidentale, qui vivrait prétendument sous la houlette de l’a-normalité devenue norme, relèverait « du même paradigme d’analyse ». Il n’existerait aucune limite solide à même de séparer l’État de droit libéral démocratique des dictatures totalitaires, le camp constituant la matrice cachée de toute politique dévoyée par la systématique propre au droit.
À bien y regarder, Walter Benjamin a pourtant énoncé sa thèse d’un état d’exception généralisé dans un contexte très particulier : celui de la montée du nazisme et de l’avènement réel de l’état d’exception, compris dans son acception juridique, avec le régime hitlérien. En étendant cette thèse aux systèmes juridiques contemporains, Giorgio Agamben s’empêche, semble-t-il, de comprendre ce qui relève à proprement parler de la situation exceptionnelle de ce qui participe du fonctionnement habituel et quotidien des États de droits libéraux d’aujourd’hui. Peut-on sérieusement affirmer que l’immense majorité des pratiques conformes à la logique intrinsèque du libéralisme démocratique ne représenterait qu’un paravent pour l’instauration d’un état d’exception permanent ? Ne serait-il pas plus avisé d’évoquer, comme le fait Étienne Balibar, la « face d’exception » de cet État libéral, qui participerait à l’exclusion
des anormaux et des déviants58 ? La normalité « cuirassée » de l’ordre libéral entraîne une réaction exceptionnelle de ce dernier, vouée à neutraliser les conflits sociaux et à « constituer l’espace légal du pluralisme légitime59 ». On ne peut nier que la naissance de la légalité charrie une part d’ombre intrinsèque à la fonction de l’État qui est le garant d’intérêts communautaires et particuliers – et qui, par conséquent, s’avance aussi sous les traits d’un État sécurisant –, mais analyser la politique actuelle comme étant une simple question d’exceptionnalisme, c’est courir le risque inévitable de reproduire un « jargon » qui donne naissance à des concepts politiques marginalisant, voire éliminant, les catégories essentielles de la pratique politique démocratique, telle qu’elle s’est développée à travers l’histoire et la pensée modernes60.
Tristan Storme
FRS – FNRS
Université libre de Bruxelles
1 J. Derrida, Force de loi. Le « Fondement mystique de l’autorité », Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2005, p. 74.
2 G. Scholem, Walter Benjamin. Histoire d’une amitié, trad. P. Kessler, Paris, Calmann-Lévy, 1989, p. 114.
3 W. Benjamin, « Critique de la violence » (1921), trad. M. de Gandillac et R. Rochlitz, Œuvres I, Paris, Gallimard, coll. « Folio – Essais », 2000, p. 210.
4 J. Derrida, Force de loi, p. 80.
5 W. Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, p. 212.
6 J. Derrida, Force de loi, p. 69.
7 C. Schmitt cité par H. Bredekamp, « From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes », trad. M. Thorson Hause et J. Bond, Critical Inquiry, vol. 25, no 2, hiver 1999, p. 261.
8 Jean-Michel Palmier, qui est l’auteur d’une somme considérable consacrée à Benjamin, est d’avis que « les tentatives pour restaurer entre eux un dialogue à peu près inexistant sont risquées », d’autant que leur correspondance semble se restreindre à une seule et unique lettre (Walter Benjamin. Le chiffonnier, l’Ange et le Petit Bossu, Paris, Klincksieck, coll. « Collection d’esthétique », 2006, p. 253).
9 W. Benjamin cité par J. Taubes, En divergent accord. À propos de Carl Schmitt, trad. P. Ivernel, Paris, Payot & Rivages, coll. « Rivages poche », 2003, p. 52.
10 Carl Schmitt écrit : « Walter Benjamin se réfère dans son livre […] à ma définition de la souveraineté ; il m’a exprimé sa reconnaissance dans une lettre personnelle en 1930 » (Hamlet ou Hécube. L’irruption du temps dans le jeu [1956], trad. J. L. Besson et J. Jourdheuil, Paris, L’Arche, 1992, p. 103). Dans le même opuscule, le publiciste de Weimar cite Ursprung des deutschen Trauerspiels de Benjamin comme l’un des « trois livres qui [lui apportèrent] des informations précieuses et des éléments d’interprétations essentiels » pour ce qui concerne la question de l’origine de l’action tragique (ibid., p. 9).
11 W. Benjamin, Origine du drame baroque allemand (1928), trad. S. Muller et A. Hirt, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2000, p. 65-66.
12 J. M. Palmier, Walter Benjamin. Le chiffonnier, l’Ange et le Petit Bossu, p. 251.
13 Ibid. Le philosophe italien Giorgio Agamben soutient une thèse bien différente : « La description benjaminienne du souverain baroque dans l’Origine du drame baroque allemand peut être lue comme une réponse à la théorie schmittienne de la souveraineté » (État d’exception. Homo sacer, II, 1, trad. J. Gayraud, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2003, p. 94). Benjamin aurait ouvertement déclaré, dans cet ouvrage, la caducité du dispositif théorique mis en place par son contemporain.
14 Ibid., p. 107.
15 W. Benjamin, « Sur le concept d’histoire » (1942), trad. M. de Gandillac et P. Rusch, Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « Folio – Essais », 2000, p. 427-428.
16 Jean-François Kervégan souligne que, dans la version la plus « forte » du théorème, « la pensée moderne du politique reproduit la structure de la théologie (et plus particulièrement de l’eschatologie) chrétienne », tandis que dans une mouture plus « faible », on a affaire à « une “influence” souvent méconnue ou refoulée de la théologie sur la philosophie juridique et politique moderne » (« Les ambiguïtés d’un théorème. La sécularisation, de Schmitt à Löwith et retour », Modernité et sécularisation. Hans Blumenberg, Karl Löwith, Carl Schmitt, Leo Strauss, M. Fœssel, J. F Kervégan et M. Revault d’Allonnes [dir.], Paris, CNRS Éditions, coll. « CNRS philosophie », 2007, p. 109).
17 W. Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, p. 224.
18 Ibid., p. 236.
19 J. Derrida, Force de loi, p. 32.
20 W. Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, p. 234.
21 M. de Montaigne, « De l’expérience », Essais III, cité par J. Derrida, Force de loi, p. 29.
22 F. Rosenzweig, L’Étoile de la rédemption, trad. A. Derczanski et J. L. Schlegel, Paris, Seuil, coll. « Esprit », 1982, p. 393-394.
23 G. Agamben, Homo sacer, I. Le pouvoir souverain et la vie nue, trad. M. Raiola, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1997, p. 50.
24 C. Schmitt, Théorie de la Constitution (1928), trad. L. Deroche, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1993, p. 212.
25 Ibid.
26 J. F. Kervégan, « La critique schmittienne du normativisme kelsénien », Le droit, le politique. Autour de Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt, C. M. Herrera (dir.), Paris, L’Harmattan, 1995, p. 238.
27 O. Pfersmann, « Normativisme et décisionnisme », Dictionnaire de philosophie politique, P. Raynaud et S. Rials (dir.), Paris, PUF, coll. « Quadrige – Dicos poche », 2003, p. 509.
28 C. Schmitt, Théologie politique. Quatre chapitres sur la théorie de la souveraineté (1922), dans Théologie politique, trad. J. L. Schlegel, Paris, Gallimard, coll. « Nrf », 1988, p. 20.
29 H. Rabault, « Carl Schmitt et la mystique de l’État total », Critique, no 654, novembre 2001, p. 876.
30 J. F. Kervégan, « Carl Schmitt, un théologien du droit ? », Archives de philosophie du droit, tome 38, 1993, p. 124.
31 C. Schmitt, La Notion de politique (1932), dans La Notion de politique suivi de Théorie du partisan, trad. M. L. Steinhauser, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2004, p. 117.
32 W. Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, p. 225.
33 J. Derrida, Force de loi, p. 33 (nous soulignons).
34 W. Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, p. 215.
35 Ibid.
36 Ibid., p. 222.
37 J. Derrida, Force de loi, p. 101.
38 Ibid., p. 87.
39 W. Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, p. 217 (nous soulignons).
40 Ibid.
41 « La tradition des opprimés nous enseigne que l’“état d’exception” dans lequel nous vivons est la règle » (W. Benjamin, « Sur le concept d’histoire », Œuvres III, p. 433).
42 C. Schmitt, Théologie politique I, p. 15 (traduction modifiée). Schmitt utilise aussi bien le terme de « Ernstfall » que de « Ausnahmefall » ou de « Ausnahmezustand » pour désigner le cas critique, la situation exceptionnelle.
43 C. Buci-Glucksmann, « BENJAMIN Walter, 1892-1940. Thèses sur le Concept d’histoire », Dictionnaire des œuvres politiques, F. Châtelet, O. Duhamel et É. Pisier (dir.), Paris, PUF, coll. « Quadrige – Référence », 2001, p. 94.
44 R. Rochlitz, Le Désenchantement de l’art. La philosophie de Walter Benjamin, Paris, Gallimard, coll. « Nrf – Essais », 1992, p. 271. Susanne Heil, qui rédigea l’une des premières monographies consacrées à Schmitt et Benjamin, soutient pour sa part que les deux penseurs partageraient la même conviction méthodologique suivant laquelle la prise en considération du « cas extrême » constituerait un passage obligé, si l’on entend découvrir l’essence de l’ordre juridico-politique (« Gefährliche Beziehungen » : Walter Benjamin und Carl Schmitt, Stuttgart – Weimar, Metzler, 1996).
45 J. F. Kervégan, « La critique schmittienne du normativisme kelsénien », Le droit, le politique, C. M. Herrera (dir.), p. 239.
46 J. L. Schlegel, « Introduction à C. Schmitt », dans Théologie politique I, p. viii.
47 C. Schmitt, Théologie politique I, p. 16.
48 Ibid., p. 22.
49 G. Agamben, État d’exception, p. 64.
50 C. Schmitt, avant-propos à La Dictature (1921), trad. M. Köller et D. Séglard, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2000, p. 20.
51 Ibid., p. 16. Quelques pages plus loin, le juriste affirme d’ailleurs : « Pour le dire de manière abstraite, le problème de la dictature se ramènerait au problème de l’exception concrète » (ibid., p. 19).
52 J. Derrida, Force de loi, p. 104.
53 Ibid. (nous soulignons).
54 Par exemple, dans « Théories du fascisme allemand » (1930), trad. P. Rusch, Œuvre II, Paris, Gallimard, coll. « Folio – Essais », 2000, p. 198-215. Benjamin écrit notamment que « la guerre future » présentera « un visage qui abolira définitivement les catégories guerrières » et que « sa spécificité stratégique la plus saillante sera d’être une pure et radicale guerre d’agression » (ibid., p. 200).
55 G. Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2009, p. 77.
56 G. Agamben, État d’exception, p. 13.
57 G. Agamben, Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Payot & Rivages, coll. « Rivages poche », 2002, p. 47.
58 É. Balibar, « Le Hobbes de Schmitt, le Schmitt de Hobbes », préface à C. Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes, trad. D. Trierweiler, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2002, p. 11.
59 Ibid. (l’auteur souligne).
60 J. Huysmans, « The Jargon of the Exception. On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society », International Political Sociology, no 2, 2008, p. 165-183.