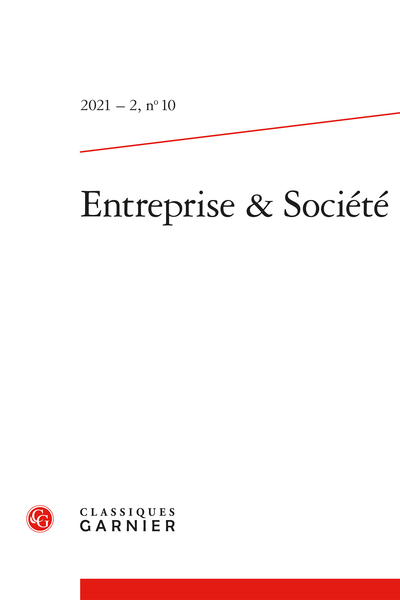
Présentation du numéro
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Entreprise & Société
2021 – 2, n° 10. varia - Auteur : Jardat (Rémi)
- Pages : 15 à 17
- Revue : Entreprise & Société
- Thème CLIL : 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN : 9782406126980
- ISBN : 978-2-406-12698-0
- ISSN : 2554-9626
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12698-0.p.0015
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/01/2022
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
PRéSENTATION DU NUMéRO
Rémi Jardat
LITEM –
Université d’Évry-Paris-Saclay
La philosophie de notre revue, devons-nous le rappeler, est de favoriser un dialogue entre les générations de chercheurs dont les travaux interrogent les relations entre le monde économique et la société. Ce numéro est construit autour d’un hommage à un auteur disparu il y a fort longtemps. En 1972 s’éteignait Frank Knight, dont l’œuvre majeure, Risk, Uncertainty and Profit, devait entrer dans la postérité, certes pour de bonnes raisons (la distinction entre incertitude et risque), mais aussi sous la forme d’un héritage tronqué et déformé. La focalisation sur la première partie de son ouvrage, vouée à la décision en contexte certain, est le lot de la plupart des utilisations mainstream de la pensée de Knight.
À quel projet un tel hommage répond-il ? Il y a exactement un siècle paraissait donc Risk, Uncertainty and Profit de Frank H. Knight, publié par les presses universitaires de Chicago. Cet ouvrage, par sa construction et la réflexion qui y préside, devait placer l’incertitude au centre de l’analyse économique. Est-il besoin de dire que cette notion – l’incertitude – n’a en rien perdu de son actualité. Le développement des risques majeurs dont les pandémies, le réchauffement climatique, les crises économiques remet en cause, quand il ne l’interrompe pas, le fonctionnement des économies et des sociétés.
La distinction entre risque et incertitude est l’arbre qui cache la forêt. L’arbre d’une reconnaissance pour une distinction, certes essentielle, mais rabâchée entre risque et incertitude. Surtout une forêt d’oubli de ce que 16Knight nous apprend, esquisse, prophétise, lorsqu’il analyse l’économie et la société en contexte incertain. Loin de l’image que l’histoire des traités et batailles voudrait donner de lui – un des fondateurs de l’école de Chicago – Knight adopte un regard prospectif sur ce que l’entreprise, le management, le marketing notamment doivent prendre dans le courant du siècle. Il annonce le développement des théories comportementales de la décision et de l’organisation, il interroge la notion de responsabilité du dirigeant. En inscrivant la pensée économique dans une histoire (une approche remise au goût du jour notamment par les travaux actuels de Thomas Piketty), il montre comment l’idéal qui prévalait au xixe siècle est mis à mal par l’avènement de la grande entreprise, lequel induit une incertitude qui devient, qu’on le veuille ou pas, la seule pensée possible du moment. Ce faisant, loin de fermer sa pensée à un constat par trop pessimiste, il ouvre la voie d’une pensée et d’une science humaine nouvelles.
Romain Laufer et Jérôme Méric s’attachent à cet hommage, à rendre compte des propos de Risk, Uncertainty and Profit sous un angle qui n’a pas toujours été abordé, et surtout à résoudre l’énigme knightienne que pose une postérité justement fondée sur des raisons partielle et partiales, quand elles ne sont pas mauvaises. Le dossier thématique s’inscrit dans la même logique. Emmanuelle Dubocage perçoit dans Risk, Uncertainty and Profit les prémisses du capital risque. Jean-Luc Gaffard montre comment l’incertitude knightienne constitue une, sinon la raison pour laquelle l’entreprise, la figure managériale et le contrôle sont nécessaires. Stéphane Mottet rappelle que Knight esquisse une théorie comportementale de l’économie, très loin des schèmes scientifiques auxquels on l’a traditionnellement rattaché.
Knight, dans la troisième partie de son ouvrage, insiste sur le caractère partiel des connaissances et remet en cause, en grande partie, la généralisation de ce qu’il qualifie d’inférences. Le mimétisme y est vu comme une réponse à l’inconnue, réponse quelque peu dérisoire comme le laisse entendre Risk-Uncertainty and Profit. À ce titre, le varia de ce numéro, sous la plume de Sigismond Hervey Mvele, interroge la transposition de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au contexte africain des Très Petites Entreprises (TPE), dont la mise en œuvre se révèle très éloignée des schèmes et des inférences dominantes.
17Au terme de ce numéro, deux recensions sont proposées. Dans la première, Roland Pérez rend compte de Société, Économies et Civilisation – Vers une seconde modernité écologique et solidaire ? proposé par Bernard Billaudot. Dans la seconde, Elisabeth Walliser nous livre son regard sur le monumental ouvrage qu’Alain Burlaud et Franck Bournois ont dirigé sur L’enseignement de la gestion en France : identité, défis et enjeux.