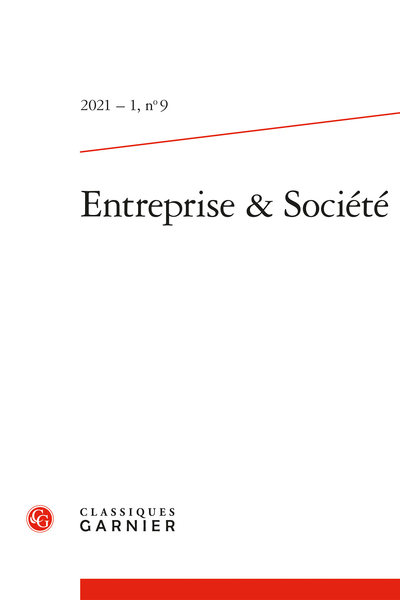
Recensions d'ouvrages
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Entreprise & Société
2021 – 1, n° 9. varia - Auteurs : Méric (Jérôme), Pérez (Roland)
- Pages : 247 à 259
- Revue : Entreprise & Société
- Thème CLIL : 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN : 9782406122036
- ISBN : 978-2-406-12203-6
- ISSN : 2554-9626
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12203-6.p.0247
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/08/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Romain Laufer (2020), Tocqueville au pays du management. Crise dans la démocratie, Collection les Grands auteurs francophones, Caen, éditions EMS, 128 p.
Recension par Jérôme Méric
À l’heure où d’aucuns affirment que le management est né dans l’Allemagne nazie et a été mis en œuvre avec succès par les grandes entreprises au lendemain de la guerre, il était temps que des contre-propositions viennent à élargir la chronologie du concept, au-delà de faits certes probables mais dont l’interprétation demeure discutable. Visiblement, une telle interprétation s’élabore dans l’ignorance – ou le mépris – de l’ancrage culturel, philosophique et culturel du management. Il conviendrait de remettre en cause la prétendue neutralité axiologique de ce qui ne serait que de l’ordre de l’outil pour revenir à l’examen de ce qui en est tout le contraire. Le management est le produit d’une pensée, qui lui assigne deux grandes fonctions et deux risques corollaires majeurs. Il est tout à la fois censé : garantir la démocratie en occultant le lien hiérarchique par sa dispersion tout en étant porteur de sévères inégalités ; accompagner des révolutions émancipatrices tout en engendrant des crises politiques propres à remettre en cause ce pour quoi il a été pensé. Cet examen approfondi et pondéré, érudit et audacieux dans les articulations qu’il propose, c’est Romain Laufer qui le livre ici dans une relecture des deux ouvrages majeurs de Tocqueville, De la démocratie en Amérique et L’Ancien Régime et la Révolution.
Romain Laufer aime les prophètes : Weber, Hegel, Knight…et Tocqueville. Que cherche-t-il au juste dans leurs prophéties ? Cette capacité à éclairer, à légitimer, à porter un regard critique et vigilant sur la société contemporaine, avec ce plaisir non dissimulé de nous dire, le regard en coin : « Il ou elle vous l’avait bien dit ! ». Partageons avec nos lecteurs le plaisir que nous avons eu à lire le récit de la prophétie tocquevillienne et en même temps l’inquiétude – à tout le moins l’intranquillité – que ces pages suscitent.
248Les prophètes de Romain Laufer sont des passeurs et des « dépasseurs ». Ils transmettent des savoirs, ils passent les frontières, ils vont au-delà des limites du temps dans lequel ils inscrivent leurs analyses.
Avec Tocqueville, passons avant tout la frontière artificielle (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas) que nous érigeons entre la France et les États-Unis. Le premier chapitre de l’ouvrage opportunément intitulé « est-il bon, est-il méchant ? » creuse les paradoxes du management à la française. Le management…honni parce qu’importé par un pays souffrant du complexe du colonisé depuis la seconde guerre mondiale, célébré comme l’alternative à une culture de l’administration étatique réputée sclérosante depuis au moins le 19e siècle. Et si ce retour en arrière, la lecture du Littré, qui nous rappelle très opportunément que « ménagement » au 19e siècle est précisément désigné comme « administration, conduite de soins », n’était pas à relier avec la révolution de 1968 ? Quel rapport, me direz-vous ? Romain Laufer le rend limpide. Au moment où l’on souhaite s’affranchir du poids des traditions d’État, on assiste à la création – initiative de Michel Debré – de la FNEGE et à la fondation par la loi Faure du Centre universitaire Dauphine. Révolution il y a bien en cela que ces mesures font en sorte que l’intendance vienne à précéder le politique. L’étymologie du terme de management traduit bien cette ambiguïté : celle du « ménagement » déjà évoqué, ou celle du maneggiare, un synonyme de diriger en italien. Alors, bras séculier de la volonté ou sujétion de cette dernière à la pragmatique ?
Les Français sont définitivement mal à l’aise avec le management mais quid outre-Atlantique ? Le chapitre deux nous montre que l’Amérique du 19e siècle et du début du 20e siècle n’est pas plus à l’aise avec la notion de management que les Français. En 1881, la Wharton est une school of commerce, rien de plus. Les revues suivent la même tendance que les universités : le mot management apparaît dans leur dénomination au tournant des années 1950 et 1960. Le terme est tellement courant qu’il dérange les académiques. En 1957, le futur éditeur de l’Academy of Management Journal propose de préciser le concept avec le néologisme de planaction (plan d’action dans l’action). C’est bien la terminologie qui est problématique. On sait ce que sont les sciences physiques, les langues, la philosophie, la médecine mais sait-on ce qu’est le management ? Toute l’ambiguïté du management est là : il affranchit les Business Schools d’une visée strictement professionnelle pour privilégier l’orientation 249scientifique centrée sur la question de savoir ce qu’est cet objet. Vient un second débat sur l’orientation de cette recherche. Doit-elle fondamentalement servir la pratique ou contribuer à conscientiser les structures de domination qu’elle révèle ? Le management à la française et la pensée 68 seraient donc bien les enfants d’une même époque.
Après que les propos préliminaires ont fait le constat d’un malaise bilatéral à l’égard du management, le chapitre trois revient au prophète, celui qui, justement, compare les deux rives de l’atlantique, analyse une révolution qui a servi de référence à l’esprit 68 et a révélé le phénomène administratif aux yeux du monde. Pour Tocqueville, l’administration ne peut être qu’ancillaire. Portant le principe de hiérarchie, elle se doit d’être discrète dans une démocratie égalitaire. Cette discrétion, Tocqueville constate qu’elle s’assure par la division des missions administratives. Telle la grammaire, elle est là pour qu’on l’oublie. Mais Tocqueville se rend vite compte que la stabilité de cette administration décentralisée doit passer par le développement d’une science propre et de l’éducation propre à l’accompagner. Selon Romain Laufer, il s’agit là d’une première prophétie sur la nécessité, dans une société décentralisée, de recourir à ce que l’on appelle aujourd’hui la science managériale. L’état pré-révolutionnaire que décrit Tocqueville en disant qu’il est le moment où l’esprit des hommes vacille entre la notion aristocratique de la sujétion et la notion démocratique de l’obéissance peut tout autant décrire l’aube d’un renversement politique que les prémices de la prise de pouvoir de l’intendance sur la volonté.
Le chapitre quatre franchit le cap. Et si l’esprit de 68 n’avait pas été marqué par l’impensé managérial ? Tocqueville construit son propos sur la démocratie autour de la dialectique de l’égalité et de la liberté. Romain Laufer en fait son angle d’attaque. Chacun percevra qu’entre liberté et égalité, la poursuite de l’une fait peser immanquablement une menace sur l’autre. Tocqueville entrevoit pour ce motif l’abolition de l’esclavage. Il anticipe aussi à la même aune les effets de l’industrialisation, en particulier la division du travail et la dilution de la propriété. Les capitaines d’industrie ont beau être riches, ils ne constituent pas un corps aristocratique. L’équilibre qui résultera de cette révolution américaine demeurera toutefois précaire, tant le poids de la hiérarchie contribuera à reformer les sociétés aristocratiques. Le management, à la fois fils et porteur de révolutions, porte en son sein le potentiel d’une contre-révolution.
250Le chapitre cinq s’attache à étudier cette troisième prophétie, celle de la révolution managériale. Elle tarde à se nommer, cette révolution. Voyez les réticences d’un Barnard ou de Berle et Means à inclure le terme de management dans leurs titres respectifs. Il faudra attendre Burnham dans les années 1940, Chandler dans les années 1970… Romain Laufer de reprendre les expressions de la révolution managériale une à une chez chacun d’eux, par une analyse systématique et structurée en quatre thèmes : la disparition de la petite société au bénéfice de grandes structures plus égalitaires ; la possibilité du basculement de la propriété privée vers l’institution publique ; la présence de la notion de révolution ; la centralité et la domination de la représentation managériale.
Demeure la question délicate de la relation du pouvoir et du management. Comme Chandler le fait remarquer, aux États-Unis, il est difficile d’admettre que l’on détient un pouvoir contrairement à ce qui peut se passer en Europe. Tant que le capitalisme n’est pas remis en cause par la révolution managériale (au sens de Burnham), rien ne viendra cependant écorner cette bonne conscience. Attentif au relais que se passent ces grands auteurs comme à la mise sous silence de certains par d’autres, Romain Laufer s’interroge dans son chapitre six sur la signification de l’oubli de Barnard par Chandler. Ce questionnement l’amène à prendre Cochran en considération. Cochran dénonce, contrairement à Chandler, l’hypocrisie d’un système qui se déclare être fondé sur la liberté et l’égalité alors que s’y forgent des formes de domination de plus en plus fortes. Cochran voit 1968 venir, quand Chandler porte a posteriori son regard au-delà de ce qu’il doit considérer comme une modeste colline de l’histoire.
Ayant permis un saut dans le temps grâce aux prophéties sur les sociétés démocratiques de Tocqueville et un saut dans l’espace grâce à l’articulation de la Démocratie en Amérique et de l’Ancien Régime et la Révolution, l’ouvrage a montré comment l’implantation du management en France devient possible en 1968. C’est l’objet du chapitre sept. Si, avec Tocqueville, on pense que le changement profond de structure juridique n’a pas pour autant chamboulé les pratiques administratives françaises en 1789, alors on peut se permettre, avec un soupçon de provocation, de penser que 1968 a eu un impact bien plus fort en cela qu’il a profondément modifié notre fonctionnement administratif. 1968 tel que décrit au début de l’ouvrage, c’est le début de la révolution 251managériale en France. Si l’on reprend les catégories tocquevilliennes de révolutions, il apparaît selon Romain Laufer que 1968 est une révolution religieuse qui porte aux nues l’égalité des conditions. 1968, c’est aussi un moment où la tendance à la démocratisation se heurte à la dure réalité de l’administration centralisée. L’esprit 68 se manifeste donc dans des grandes décisions (Dauphine, FNEGE, agrégation en Sciences de Gestion) qui ont voulu porter, comme Tocqueville le suggérait, une science de l’administration propre à répondre aux tensions inhérentes à cette dernière dès lors qu’elle sert un projet démocratique.
Retour à Burnham dans un chapitre entièrement consacré à la réception de son ouvrage sur les deux rives de l’Atlantique. Quoi que l’on dise du contexte de guerre froide dans lequel il s’est diffusé, quoi que l’on reproche à la posture de Burnham, chacun des analystes cités, même les plus hostiles, reconnait l’émergence d’une technocratie consécutive à la révolution managériale et s’en inquiète. Impossible d’ignorer dans ce texte de 1941 ce qui relève – c’est une obsession de Romain Laufer – de la prophétie : dans la société directoriale, la souveraineté est localisée dans les bureaux administratifs. Ce sont eux qui établissent les règles, promulguent les lois et publient des décrets et, dans le monde entier, ils supplantent le parlement. La révolution managériale, un impensé pourtant à l’œuvre.
On pourrait suggérer à Romain Laufer que l’écologie des populations, depuis trois décennies, tente – avec peu de succès il est vrai – de décentrer le propos. Mais comment comprendrait-il un tel phénomène, au juste ? Comme une tentative avortée, ou au contraire comme une révolution à bas bruit à la Kuhn ?
En guise d’épilogue, Romain Laufer revient sur la notion barnardienne d’ennui, à la source des grandes crises. Ici, l’ennui n’est autre que la remise en cause latente d’un régime de légitimité – un terme bien moins présent dans cet ouvrage que dans le Prince bureaucrate, alors que le concept, pour sa part, sous-tend toute la ligne réflexive du propos. Il faut en reconnaître la capacité à éclairer l’histoire et l’actualité d’un jour particulièrement efficace : les Américains des années 1920 s’ennuyaient de la confiscation du marché par les grandes entreprises, les Français de 1968 s’ennuyaient d’avoir été tenus à l’écart des grands événements qui font le monde aujourd’hui. Aujourd’hui, de part et d’autre de l’Atlantique, les citoyens s’ennuient du management…Romain Laufer, prophète à son tour – et surtout fin analyste – de la crise à venir.
252*
* *
Edgar Morin (2020), Changeons de voie – Les leçons du coronavirus, Denoël, Paris, 155 p.
Jacques Richard (2020), Révolution comptable. Pour une entreprise écologique et sociale, Les éditions de l’Atelier, Ivry sur Seine, 143 p.
Florence Rhodain (2019), La nouvelle religion du numérique – Le numérique est-il écologique ?, Caen, éditions EMS, 130 p.
Recensions par Roland Pérez
L’époque troublée que nous vivons appelle, plus que jamais, des analyses et témoignages permettant à chacun de nous de mieux comprendre les évolutions en cours, d’en saisir les enjeux et de tenter d’y adapter son propre comportement. Pour nous y aider, nous disposons d’un nombre impressionnant de publications de toutes sortes, tant en termes de thématiques traitées que de format ou de support d’expression. Pour la présente rubrique de recensions pour la revue Entreprise & Société, nous avons choisi de nous limiter à trois essais, venant d’auteurs distincts par leur personnalité, leur notoriété et les thématiques traitées, mais qui nous sont apparus particulièrement pertinents dans le débat scientifique et sociétal contemporain auquel la revue ENSO souhaite contribuer dans son champ éditorial.
Le premier essai est celui d’Edgar Morin : Changeons de voie – Les leçons du coranavirus (Paris, Denoël, 2020, 155 p.). La pandémie que le monde connait depuis fin 2019 a pris une telle ampleur, tant par ses effets directs, que par ceux des politiques mises en œuvre pour y faire face, qu’elle a suscité – et continue à susciter – des analyses nombreuses, notamment des chercheurs les plus confirmés dont l’avis est suscité en ces temps incertains. Le grand intellectuel qu’est Edgar Morin ne pouvait que se sentir concerné, lui qui depuis des décennies s’efforce de rapprocher les sciences humaines et sociales des sciences de la vie et, au-delà des spécialisations disciplinaires, plaide pour une approche intégrée de la relation Homme-Nature. 253Dès le printemps 2020, Edgar Morin a entrepris cet essai, paru dès juin 20201, Son objet, déjà apparent dans le titre, est explicité en 4e de couverture : « À défaut de donner un sens à la pandémie, sachons en tirer les leçons pour l’avenir ».
La structure de l’ouvrage est simple et claire : après un préambule autobiographique que l’auteur, pratiquant l’auto-dérision, intitule « Cent ans de vicissitudes2 », l’introduction donne le ton : « un minuscule virus apparu dans une lointaine ville de Chine a créé un cataclysme mondial » (p. 25). Suit un exposé en trois temps, chacun étant représenté par un chapitre :
Dans un premier temps, Edgar Morin tire les « leçons du coronavirus ». Il en énumère une quinzaine, allant d’une réflexion philosophique sur les contraintes du confinement sur nos existences3, à un constat géopolitique sur la crise de la mondialisation4, en passant par des considérations sur diverses thématiques : rapport à la mort, réveil des solidarités, inégalités sociales dans le confinement, …sans parler de commentaires sur la crise de l’intelligence ou les carences de pensée et d’action politique…
Dans un second temps, l’auteur, se projetant au-delà de la période pandémique actuelle, présente « les défis de l’après-Covid ». Il en présente une dizaine, allant du défi de type existentiel (nouveau rapport au temps, nouvelles solidarités) au danger d’une régression généralisée affectant les divers éléments de la société (intellectuel, politique, étatique).
Enfin, pour ne pas rester sur ce constat négatif, Edgar Morin propose de « Changer de voie »., reprenant et précisant les lignes directrices d’un « nouvelle Voie politique-écologique-économiques-sociale » qu’il avait exposée dans un précédent ouvrage5. L’auteur aborde tout d’abord la politique nationale, en prenant le cas de la France, proposant de conjuguer « souveraineté et mondialité », « unité et diversité », et souhaitant des réformes tant sur le plan économique que politique. Il appelle de ses vœux ce qu’il 254nomme « une politique de civilisation » qui se « pratiquerait contre les caractères négatifs de notre civilisation tout en développant ses caractères positifs » (p 108), ainsi qu’une « politique de l’humanité » qui « donnerait à chaque nation le sens de la communauté humaine » (p 117), couplée à une « politique de la Terre » (eaux, énergie, …) compte tenu de « la communauté du destin terrestre entre la Nature vivante et l’aventure humaine » (p 129) ; le tout permettant un « humanisme régénéré » reposant sur la prise de conscience de ce qu’il avait déjà dénommé « Terre-patrie » (p 142).
En conclusion, Edgar Morin nous livre une dernière réflexion, concernant « l’aventure hominisante commencée il y a sept millions d’années », évènement qu’il replace « au sein de l’aventure, elle-même stupéfiante, de l’univers » (p 149).
Tout lecteur, après avoir lu cet essai – en général d’une seule traite – est tenté d’en reprendre les différents éléments pour les commenter, y compris parfois lorsqu’ils sont présentés d’une manière cursive, voire péremptoire.
In fine, on est impressionné par la variété et la pertinence de ces réflexions (« leçons », « défis », Voie) sachant qu’elles ont été formulées quelques mois seulement après le début de la pandémie, laquelle n’avait pas encore atteint les dimensions qu’elle a connues depuis. Formulées par un scientifique respecté, au soir de sa vie, de tels propos résonnent comme un message adressé, dans une époque exceptionnelle, par un homme également hors normes. Chacun de nous se sentira concerné et tachera d’en tirer des éléments nourrissant sa propre réflexion.
Le second essai est celui Jacques Richard, intitulé « Révolution comptable – Pour une entreprise écologique et sociale6 »(Les éditions de l’Atelier, Ivry/Seine, 2020, 143 pages). Ce petit ouvrage se veut être un manifeste exprimant le point de vue de son auteur principal et, à travers lui, du courant de pensée auquel il se rattache et qu’il a contribué à créer et façonner, depuis plusieurs dizaines d’années maintenant7. Pour Jacques Richard, « il est impossible de changer le cours des choses sans s’attaquer au cœur du système actuel : la comptabilité des grandes sociétés capitalistes » 255(p. 6) ; par-là, « pour changer le monde, il faut avant tout changer le mode de calcul des performances des grandes firmes » (p. 7).
La démonstration se déroule en quatre chapitres dont chacun est centré sur un thème précis :
Le chapitre 1 est d’ordre historique. Son intitulé, « l’origine du système capitaliste actuel et de son mode de calcul malfaisant » est volontairement incisif pour convaincre le lecteur que « pour comprendre le capitalisme, il faut absolument connaitre sa comptabilité » (p. 7). L’auteur, à partir d’un exemple pédagogique situé près de Florence à la fin du 14o siècle, montre que « l’apparition du concept moderne de capital est liée à une question de conservation et non d’usage » (p. 14). Le développement économique qui a marqué les siècles suivants jusqu’à nos jours, n’a pas modifié ce statut fondamental qui fait que « le capital en comptabilité classique est une dette à l’égard du capitaliste » (p 23).
Le chapitre 2 a un titre également provocant : « comment ce mode de calcul malfaisant est entériné dans une constitution mondiale ». Son contenu est au diapason et se décline en neuf « thèses » successives qui se présentent comme un réquisitoire8. L’auteur en conclut que « ce ne sont pas la mondialisation ni le marché mondial qui sont les causes des problèmes actuels, mais une certaine mondialisation sous l’égide des lois comptables capitalistes » (p 66)
Dans le chapitre 3, l’auteur, ne souhaitant pas rester sur ce constat négatif, propose de « remplacer la comptabilité capitaliste destructive par une comptabilité écologique ». Il présente, à cet effet, douze « propositions9 », 256lesquelles sont à la base de modèle CARE/TDL10 qu’il a proposé et développe actuellement, notamment avec son co-auteur. Cela permet de proposer un « nouveau schéma comptable de l’entreprise en commun11 ». En complément de cette présentation du modèle qu’il a construit, l’auteur rappelle, pour les critiquer, divers travaux concurrents, comme ceux relatifs à l’internalisation des externalités, à la taxe carbone ou au reporting intégré ; il les qualifie de « fausses solutions » (p. 100).
Dans le dernier chapitre, l’auteur parle de « la réforme des droits constitutionnels et législatifs au niveau de l’État » ; réforme qui lui parait souhaitable pour mettre en œuvre ses propositions, Il propose notamment un « bicaméralisme systématique », dans lequel, « la chambre des représentants des citoyens… serait doublée d’une chambre des représentants des trois capitaux (naturel, humain, et financier » (p 115).
Après une brève conclusion dans laquelle sont évoqués Aristote, Marx-Engels et le Pape François, deux annexes présentent successivement, un exemple d’application de la méthode CARE-TDL à une entreprise (p. 125) et une extension possible vers une nouvelle comptabilité nationale écologique (p. 131).
La lecture de cet essai appelle, de notre part, un commentaire distinguant la forme du fond. Sur la forme, on peut regretter le ton volontairement polémique, des critiques parfois excessives (ou qui nous semblent l’avoir été) ; quelques propositions peu utiles ou à la limite du sujet12. L’auteur a voulu marquer les esprits, mais risque de se voir répliquer par ceux-là même qu’il critique : « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Ce serait dommage, car, sur le fond, ce petit ouvrage apporte une contribution de premier plan, tant sur le rôle important de la comptabilité dans le fonctionnement d’un régime économique et la critique ancrée dans l’histoire du système comptable, que par les propositions qu’il présente pour un nouveau système intégrant le capital 257humain et le capital naturel au même titre que le capital financier. Car c’est bien dans cette direction qu’il est souhaitable d’avancer.
Le troisième essai est celui de Florence Rodhain : « La nouvelle religion du numérique – Le numérique est-il écologique ? », co-édité en 2019 par les éditions Management & Société (EMS, Caen) et par les éditions Libre et Solidaire (ELS, Paris), 130 pages. La question posée est importante s’il en est ; en effet si l’écologie est devenue le défi majeur que rencontrent les sociétés humaines contemporaines et si le numérique est le vecteur le plus actif de l’évolution de celles-ci, alors il est légitime de se demander si ce vecteur est de nature à surmonter le défi posé. Si la réponse était positive, le monde pourrait être sauvé ; en cas contraire, nous avons des soucis à nous faire….
L’auteure qui est une universitaire, spécialiste des systèmes d’information, n’a pas voulu ajouter une publication supplémentaire à un curriculum scientifique déjà bien fourni, mais, comme elle l’écrit, son essai « se veut pamphlet, étayé par la vulgarisation scientifique, délaissant le jargon académique… » (p. 15). Dans cette perspective, elle a organisé son ouvrage en deux parties distinctes et structurées de manière spécifique.
Dans la première partie, elle tente de répondre à la question posée – « Le numérique est-il écologique ? » – en produisant une série de « chroniques » (une vingtaine au total) présentant différentes situations et des exemples montrant que, à l’inverse des idées reçues, le numérique ne rime pas vraiment avec l’écologie et qu’au contraire, il contribue à accentuer l’empreinte des activités humaines sur l’écosystème planétaire. Ainsi sont pointées les illusions portées par la novlangue du numérique sur la dématérialisation, le « cloud », le « zéro papier », le « zéro déchet », le « zéro déplacement », etc. Toutes ces petites histoires sont contées sur un ton badin, accessible à tout lecteur ; elles reposent néanmoins sur des observations corroborées par des études scientifiques, notamment en ce qui concerne la part de l’industrie du numérique dans certains domaines sensibles au plan écologique (comme l’utilisation des terres rares, le coût en énergie des data centers et la prolifération des déchets constitués par les appareils obsolètes)13.
258Dans la seconde partie, intitulée : « contextualisation : la nouvelle religion du numérique » l’auteure propose un essai autour d’une idée centrale : les bienfaits supposés du numérique sont tellement vantés qu’ils lui semblent relever de la religiosité : « Le Dieu numérique représente une aubaine qui vient à propos dans une société de consommation exposant des signes d’essoufflement » (p. 16). L’auteur développe cette métaphore tant au long de son essai, proposant « les dix commandements de la nouvelle religion » (p. 85), parlant ici de « genèse » (p. 88), là d’« apôtres » (p. 84), ailleurs de « curés » (p. 100) ; s’interrogeant même sur la possibilité d’une « laïcité numérique » (p. 102), sur le « baptême » via la biométrie (p. 108), allant jusqu’à « l’extrême onction » (p. 111).
En conclusion, Florence Rodhain, s’appuyant sur une leçon du grand résistant Raymond Aubrac pour qui « comprendre, c’est rendre la lutte possible » (p. 113), conseille de « se réveiller, penser, résister, oser l’hérésie » (p. 115). Elle oppose au « faux changement » que constituent les politiques dites de « développement durable », le « vrai changement » qui correspondrait à une politique de « croissance de la conscience » (p. 120). Selon son expression imagée, « il s’agit de passer du vert à la vertu » (p. 121) ou encore, parodiant Rabelais, « croissance sans conscience n’est que ruines et larmes » (p. 122).
Dans une « Postface », l’auteure revient sur cette position philosophique et recommande d’« ouvrir les yeux et prendre le risque de tourner le regard vers l’intérieur » (p. 123). Elle exhorte chacun de nous de « faire preuve de discernement en laissant le numérique à sa juste place en refusant sa domination » (p. 130).
Comme on a pu le voir, cet essai s’est volontairement démarqué d’une publication conventionnelle tant en termes de problématique que sur la forme rédactionnelle. Cette double distanciation était-elle nécessaire pour convaincre le lecteur ? L’auteure en était probablement persuadée, pensant, par son style décalé, atteindre plus de lecteurs et mieux les convaincre. C’est probable et on ne peut que se réjouir de pouvoir intéresser ainsi un public non spécialisé, donnant ainsi au concept de « vulgarisation » un statut de « popularisation ». Cependant, il ne faudrait pas qu’une lecture agréable laisse seulement le souvenir des bons 259mots qui émaillent les chroniques de la première partie et l’allégorie développée en seconde partie, et que le lecteur en oublie le fond. Ce serait dommage, car, à l’instar de certaines œuvres théâtrales, on peut dire que le ton est léger sur un sujet qui ne l’est pas ; Florence Rodhain nous amène, avec le sourire, à réfléchir à une question majeure. Le sujet traité de la relation entre numérique et écologie est et restera prégnant, car, même si la crise majeure que le monde connait actuellement en modifiera certains paramètres, il nous parait clair que le débat auquel cet essai participe va continuer et s’amplifier.
In fine, les trois ouvrages sous revue, au-delà de la spécificité de chacun en termes d’auteurs, de thèmes traités et de styles rédactionnels, présentent quelques points communs qui justifient peut-être, si besoin était, d’avoir ainsi été réunis dans la présente recension.
Le premier trait commun est qu’il s’agit de « petits » ouvrages en termes physiques (130 à 150 pages), format qui est souvent celui d’un essai personnel, dans lesquels l’auteur vise à faire passer quelques idées fortes plutôt qu’une longue étude. C’est le cas de chacun des trois présents essais lesquels, une fois de plus, démontrent que l’impact d’un écrit n’est pas proportionnel à son nombre de pages….
Toujours au niveau formel, chaque auteur s’est, à des degrés divers, affranchi des conventions académiques usuelles au profit d’un ton plus direct, plus engagé, faisant apparaitre, peu ou prou, ses positions idéologiques et doctrinales – sa weltanschauung –, ce qui est finalement plus honnête que des présentations apparemment neutres, mais qui sont souvent, comme le rappelait François Perroux, « implicitement normatives ».
En effet, sur le fond, les différents sujets traités sont trop importants pour permettre aux chercheurs qui en parlent de le faire avec un total détachement. Chacun des ouvrages porte, pour une part, une partie des questions qui nous concernent tous.
1 Avec la collaboration de Salah Abouessalam, qui co-anime la chaire UNESCO sur la complexité.
2 Edgar Morin né le 8 juillet 1921, est en effet devenu centenaire en 2021.
3 « Le confinement doit surtout ouvrir sur l’essentiel de l’existence » (p 30)
4 Crise qui lui parait refléter une boucle d récursivité : « la pandémie mondial a créé une crise violente de la mondialisation. On peut se demander aussi si la mondialisation n’a pas contribué à la pandémie » (p 58)
5 E. Morin (2011), La Voie, Paris, Fayard.
6 Avec la collaboration d’Alexandre Rambaud, qui coanime la chaire UNESCO « Comptabilité écologique » créée à AgroParisTech avec le concours de l’université Paris Dauphine (où était en poste Jacques Richard), ainsi que l’université de Reims où est en poste Yulia Ailtukova (ancienne thésarde de Jacques Richard)
7 Cf le « Grand Angle » consacré à Jacques Richard dans ce même numéro.
8 1 – « Les marchés et toute l’économie actuelle sont dominés par des lois comptables » (p. 41). 2 – « Vers une constitution économique mondiale sur la base d’une loi comptable internationale » (p. 44). 3 – « L’amour des libéraux et des capitalistes pour certaines contraintes » (p. 49). 4 – « La domination de la comptabilité capitaliste américaine dans le monde entier » (p. 51). 5 – « Le traitement inique des droits humains et environnementaux » (p. 55). 6 – « La monopolisation des organes de législation économique et comptable par les capitalistes et leurs alliés » (p. 57). 7 – « Le façonnage des esprits par la comptabilité » (p. 60). 8 – « Il n’y a pas de loi des nombres, mais certaines lois couplées avec certains nombres » (p. 61). 9 – « Il y a toujours eu une intervention du politique dans la comptabilité capitaliste » (p. 63)
9 1 - « La définition du concept de capital » (p. 72). 2 – « Le choix des capitaux » (p. 74). 3 - « La réalisation d’études ontologiques » (p. 76). 4 – « La mise en place de normes et de standards scientifiques humains et écologiques » (p. 78). 5 – « Le maintien d’une comptabilité à partie double » (p. 82). 6 – « L’imposition du nouveau modèle par des lois comptables » (p. 83). 7 – « L’établissement d’écarts de conservation (ou de soutenabilité) » (p. 84). 8 – « La tenue de budgets de coûts de maintien des trois capitaux » (p. 84). 9 – « L’inscription des budgets de coûts de maintien au passif en tant que capitaux » (p 86). 10 – « La comptabilisation d’un coût complet écologique et humain permettant le maintien des trois capitaux » (p. 86). 11 – « Un nouveau type de profit commun » (p. 89). 12 – « Une cogestion écologique des entreprises » (p. 92)
10 CARE, acronyme de « Comptabilité Adaptée à une Restauration de l’Environnement » fait un clin d’œil au « care » anglo-saxon, synonyme de « soin ». – TDL, acronyme de « Triple Depreciation Line » faisant une autre allusion au « Triple Bottom Line » (TBL)
11 Cf figure page 93. Le qualificatif « en commun » fait référence aux travaux d’E. Ostrom sur les « Common-Pool Resources » pour lesquels l’auteur pense que le modèle CARE-TDL serai pertinent.
12 Ainsi sur la demande de « Référendum d’initiative populaire » (RIC) (p. 116)
13 Nous serons un peu plus réservés sur l’argument relatif aux déplacements ; en effet, si pendant longtemps, les rencontres dites en « distanciel » n’ont eu que peu d’incidence sur celles dites en « présentiel » et donc sur le rythme des déplacements des personnes concernées, la pandémie que le monde subit depuis fin 2019 a entrainé des mesures régaliennes restreignant drastiquement ces déplacements, et maintes réunions n’ont pas se tenir qu’en distanciel, redonnant à l’outil numérique un rôle salvateur… Mais cette crise mondiale était postérieure à l’ouvrage sous revue…