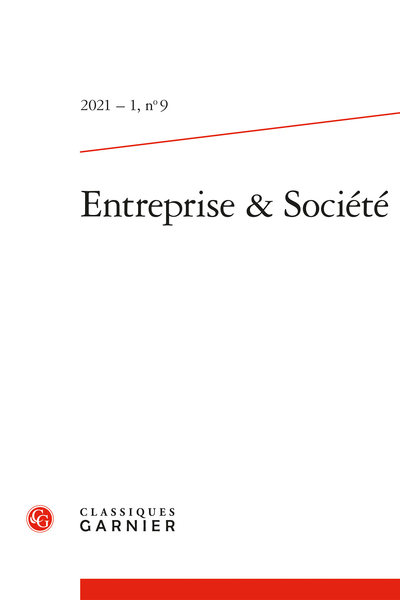
Un nouveau regard sur la finance et la finance responsable
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Entreprise & Société
2021 – 1, n° 9. varia - Auteur : Billaudot (Bernard)
- Résumé : L’objet de cet article est de comprendre l’avènement au tournant du 21e siècle de la « finance responsable ». En considérant qu’on ne peut étudier la finance sans prendre en compte la société globale dont elle n’est qu’une composante, cette compréhension est faite à partir d’un nouveau regard porté sur une Nation moderne. Cet avènement est l’une des manifestations de l’entrée en crise de ce modèle de vivre-ensemble avec la montée en puissance de la question écologique au Nord et celle de la question sociale au Sud. C’est aussi l’une des pierres constitutives d’un projet de transformation sociale dont l’actualisation en serait une issue « par le haut ». Une place essentielle est accordée dans l’élaboration de cette thèse à l’incertitude radicale et aux conventions qui permettent de la réduire à du risque.
- Pages : 49 à 88
- Revue : Entreprise & Société
- Thème CLIL : 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN : 9782406122036
- ISBN : 978-2-406-12203-6
- ISSN : 2554-9626
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12203-6.p.0049
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/08/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : finance, incertitude, institution financière, marché financier, responsabilité
Un nouveau regard sur la finance
et la finance responsable
Bernard Billaudot
CREG – Université Grenoble Alpes
Introduction
L’avènement de la finance responsable au tournant du 21e siècle est une nouveauté. Certes certaines pratiques de financement du passé ont quelque chose à voir avec telle ou telle de ses caractéristiques observables parce que la relation financière entre le prêteur et l’emprunteur y était vécue par les deux comme relevant de la réciprocité, mais il s’agissait de relations établies dans un espace privé, alors que ce nouvel OVNI apparait dans l’espace public. En prenant comme un acquis ces caractéristiques, l’objet de cet article est de comprendre cette nouveauté.
Pour ce faire, on ne peut pas en rester à la percée réalisée par Myrdal et Keynes en dénonçant l’idée que la monnaie serait un voile qu’il faut lever pour voir l’économie réelle (cela n’a pas de sens de distinguer une sphère réelle et une sphère financière) et, par conséquent, celle qu’il y aurait la formation d’un équilibre spontané entre l’offre et la demande sur le marché des fonds prêtables comme le prétend Wicksell1. On ne peut pas non plus s’en tenir à la proposition essentielle de Keynes selon laquelle les pratiques des acteurs de la finance sont gouvernées par des conventions en raison de l’incertitude radicale dans laquelle ils se 50trouvent, la première de ces conventions étant celle qui est désormais qualifiée de convention de continuité2, en ajoutant que ces conventions sont précaires. Plus précisément, l’idée qui doit être abandonnée est que l’incertitude radicale se limiterait au fait que, d’un côté, le prêteur ne sait pas si l’emploi de la somme d’argent qu’il obtient sous forme de prêt sera de nature à générer des revenus monétaires qui lui permettront d’honorer ses engagements financiers et, de l’autre, le prêteur ne sait pas si les rétributions associées à son prêt d’une somme d’argent donnée seront à la hauteur de ses attentes initiales. Enfin, on ne peut se contenter de la façon dont André Orléan reformule le problème spécifique que l’incertitude radicale pose en finance en prenant en compte l’ambivalence de la monnaie et en en déduisant le besoin de liquidité du prêteur (Orléan, A., 2011). Non seulement il faut aller jusqu’au terme de cette prise en compte, mais encore ce n’est pas suffisant.
En effet, la thèse qui va être défendue dans cet article se décline en un certain nombre de propositions dont les deux premières sont à la base de celles qui rendent compte de l’avènement de la finance responsable. La première tire les conséquences de la nécessité pour le prêteur de pouvoir liquider sa créance et la seconde donne la raison de cette insuffisance. En l’occurrence, ces deux premières propositions sont les suivantes :
1. une transaction financière impersonnelle entre deux agents-acteurs non financiers ne peut s’établir que si une solution a été trouvée pour satisfaire ce besoin de liquidité au cas où il advient, dès lors que cette éventualité relève de l’incertitude radicale ;
2. les problèmes que l’incertitude radicale pose aux acteurs-agents de la finance vont au-delà de ce premier problème qui est spécifique à la relation financière ; ils sont fondamentalement communs aux trois sortes de transactions économiques (la transaction commerciale, la transaction salariale et la transaction financière) ; ces problèmes sont surmontés en ayant recours à des conventions financières (elles réduisent l’incertitude radicale à du risque) ; ces conventions sont 51plurielles parce qu’elles sont justifiées en ayant recours à un mode de justification sociétal qui comprend plusieurs grammaires de justification.
Quant aux propositions qui sont ensuite établies sur cette base et qui répondent à la compréhension recherchée, ce sont les deux suivantes :
3. les conventions financières marchandes qui se sont imposé dans le cours de la mondialisation (en se substituant aux conventions industrielles qui avaient porté les trente glorieuses) sont contestées en raison de la montée en puissance de la question écologique au Nord et de la question sociale au Sud (ainsi que son retour au Nord) ; comme elles ne sont plus communes, elles sont en crise ;
4. l’avènement de la finance responsable est à la fois un produit de cette crise et l’une des pierres constitutives d’un projet de transformation sociale dont l’actualisation en serait une issue « par le haut », un point d’appui important d’engagement de la transition à même d’y mener.
Le plan retenu pour cet article en découle : il comprend quatre sections dont chacune a pour objet de défendre une proposition en respectant cet ordre. Toutefois, comme la problématique théorique qui préside à l’établissement de ces propositions est que rien de sérieux ne peut être dit sur l’économique sans prendre en compte la société globale dont il n’est qu’une composante, il y a lieu de présenter, succinctement, dans une section préliminaire (section 0), la vision originale d’une Nation moderne qui est mobilisée, vision qui postule que la matrice de cette sorte de société humaine est le couplage d’un mode de justification pratiqué dans l’espace public qui est particulier (la justification en raison moderne en priorité du juste sur le bien) et d’une cosmologie tout aussi particulière (la cosmologie dualiste qui consiste à penser que les humains sont extérieurs à la Nature).
52Le soubassement théorique
Une analyse institutionnaliste à la fois historique
et pragmatiste d’une Nation moderne
Les quatre propositions qui vont être défendues font partie de l’analyse essentiellement théorique qui est développée dans un volumineux ouvrage « Société, économie et civilisation », dont lesous-titre « Vers une seconde modernité écologique et solidaire ? » évoque la dernière. Le statut de cette analyse est d’être institutionnaliste et, dans ce cadre, de relever d’un institutionnalisme à la fois historique et pragmatiste. À s’en tenir aux travaux institutionnalistes développés en économie, cela signifie qu’elle procède d’une appropriation critique de ceux de l’École de la régulation (institutionnalisme historique) (TR dans la suite) et de ceux de l’Économie des conventions (institutionnalisme pragmatiste3) (EC dans la suite). L’enjeu de cette double appropriation critique était de dépasser les limites respectives de chacune en surmontant les points sur lesquels elles s’opposent. Cela s’avérait a priori possible en raison de leurs nombreux points d’accord.
Les points d’accord entre la TR et l’EC
Les principaux points d’accord entre la TR et l’EC sont les suivants : (i) entendues comme des systèmes de règles (ou de normes si on préfère), les institutions sont indispensables à prendre en compte pour expliquer les phénomènes économiques, (ii) il convient de le faire à l’écart de la problématique du choix rationnel pour laquelle les individus suivent des règles parce qu’ils sont rationnels, (iii) cela implique, en suivant Keynes, de partir d’une hypothèse d’incertitude radicale et de considérer que la rationalité est toujours située (elle dépend de la situation dans 53laquelle se trouve les agents-acteurs économiques), (iiii) la monnaie, le Droit et l’État sont des institutions fondamentales de la société qui est le cadre des phénomènes économiques que ces deux écoles se proposent d’expliquer (ou de comprendre, si on préfère), sans qu’il y ait un accord sur la façon de caractériser cette société – elle l’est par le fait que le capitalisme y domine (TR) ou par le fait qu’elle est démocratique (EC).
De quelques limites de la TR
Les principales limites de la TR sont les suivantes : (i) il n’y a pas de place faite à la justification des règles, leur institution relevant uniquement de rapports de forces entre classes sociales, (ii) les règles qui sont privilégiées sont celles qui sont constitutives des formes d’institution des rapports sociaux à l’échelle sociétale, c’est-à-dire les règles de Droit qui sont la codification des compromis auxquels un certain état des rapports de forces a conduit, (iii) celles qui procèdent d’une action collective non concertée (les conventions dont se préoccupe l’EC) ne sont pas ignorées, mais elles ne joueraient pas un rôle essentiel, (iiii) il n’y a de place que pour des acteurs collectifs, les individus étant des agents dont les luttes de classement sont hors du champ de l’analyse.
De quelques limites de l’EC
Les limites de l’EC sont, dans une large mesure, inverses de celles de la TR. Les principales sont suivantes : (i) malgré des tentatives louables en ce sens, l’EC ne réussit pas à capter les institutions que sont la monnaie et le Droit, (ii) le champ pris en compte est celui de la coordination d’individus par des conventions, d’où une difficulté à ressaisir les conflits sociaux autrement que comme des conflits naissant de références éthiques différentes, (iii) la distinction entre les conventions qui répondent à la question « comment faire ? », celles qui peuvent être qualifiées de procédurales, ne sont pas nettement distinguées de celles qui répondent à la question « qui a le droit de faire ? », (iv) en conséquence, pour la composante de l’EC qui accorde une place centrale à la justification des conventions et aux principes qui président à une telle justification, la distinction entre la justification des premières, qui est une justification en termes de justesse (le juste opposé au faux) et celle des secondes, qui est une justification en termes de justice (le juste 54opposé à l’injuste) n’est pas faite, (v) la justification d’une activité, qui est une justification en termes moraux formulée par celui qui s’active (exemple : établir une relation financière), n’est pas nettement distinguée de la justification d’une convention relative à « qui a le droit de faire ? » qui est une justification en termes de justice, (vi) les divers principes de bien commun qui sont mobilisés ne sont pas historicisés.
Le socle de science sociale au point d’aboutissement
de cette double appropriation critique (complétée par d’autres)
Mus par un effort de persévérance dans l’être au même titre que les autres existants (le Conatus de Spinoza), les humains sont confrontés à l’incertitude radicale. Ils n’acquièrent une sécurité ontologique qu’en s’en remettant à des conventions qui sont le produit de la « Puissance de la multitude » (Spinoza)4. En toute généralité (avant tout processus particulier d’institution de normes), un vivre-ensemble des humains (un groupement humain global) ne peut exister que si ses membres ont quelque chose en commun. Il s’agit du couple formé par un mode de justification pratique et une cosmologie. Le premier est pratiqué pour justifier les normes relatives à « qui a le droit de faire ? » dans le groupement ; ces normes sont instituées à l’échelle de ce dernier ; elles sont spécifiquement qualifiées de normes-règles ou plus simplement de règles. Une cosmologie est une façon philosophique de penser les différences entre les humains et les autres existants du cosmos : sont-elles des différences de nature ou des différences de degré au sein d’une même nature ? D’une sorte de groupement humain global à l’autre, la matrice en question n’est pas la même. Ce couplage est qualifié de monde. Toujours est-t-il que, quel que soit le mode de justification, la justification d’une règle est à la fois déontologique (respect de principes de justice) et conséquencialiste (un résultat pour tous les membres est attendu du suivi de la règle). Dès lors, si le résultat attendu n’est pas au rendez-vous, au moins pour certains, la règle est contestée et si cette contestation s’étend à de nombreuses règles elle atteint le couple en question : telle est l’origine du changement institutionnel. D’un mode de justification à l’autre, les principes et le résultat attendu ne sont pas les mêmes.
55Une fresque historique comprenant la Nation moderne
La fresque historique qui est construite sur la base de ce socle est la suivante (voir tableau 1).
Tab. 1 – Une fresque historique des mondes et des sortes de groupement humain global fondées sur ces mondes. Source : Billaudot 2021.
|
Cosmologie |
Cosmologie moniste |
Cosmologie céleste |
? |
Cosmologie dualiste |
Cosmologie écologique* |
|
Mode de justification |
Sacralisation |
Sacralisation raisonnée |
Justification en raison à l’ancienne |
Justification en raison moderne en « priorité du juste » |
Justification en raison moderne faisant une place à la « priorité du bien »* |
|
Monde (ou méta-monde) |
Monde magique (générique) |
Monde traditionnel (générique) |
Semi-Monde antique (simple) |
Monde de première modernité (Nation moderne) |
Méta-monde de seconde modernité* |
|
Forme de groupement humain global |
Genre Communauté |
Genre Société |
|||
|
Espèce Société traditionnelle |
Cité antique |
Espèce Société moderne |
|||
|
Nation moderne |
Société de seconde modernité* |
||||
* Entité virtuelle
Il ressort de cette fresque que le groupement humain global « Nation moderne » est un modèle particulier de l’espèce « société moderne », espèce qui relève du genre « société ». Il s’agit du seul modèle qui ait été actualisé jusqu’au tournant du xxie siècle. C’est la raison pour laquelle le qualifier de « première modernité » convient. Ce n’est pas a priori le seul. Nous verrons, dans la dernière section que la finance responsable doit être considérée comme un point d’appui de l’engagement d’une transition vers une seconde modernité.
56De la justification dans une Nation moderne
(première modernité)
Comme dans tout groupement humain, trois sortes de justification doivent être distinguées :
–la justification en termes de justice d’une norme-règle (exemple : l’autorisation du prêt contre intérêt) ;
–la justification en termes de justesse d’une norme-procédure (exemple : la procédure de recours au marché financier) ;
–la justification en termes moraux d’une activité (justification associée à la signification).
Il y a lieu de commencer par la première et de voir ensuite comment les autres lui sont liées.
La justification des normes-règles publiques : le mode de justification
en « priorité du juste » pratiqué dans la Nation moderne
Dans le débat actuel concernant la justice d’un ordre social, les apports les plus importants sont ceux de John Rawls (1971) qui parle, pour une société de citoyens libres et égaux entre eux, de justice en « priorité du juste sur le bien5 » et d’Alasdar MacIntyre (1988) qui distingue la justice en termes de coordination efficace et la justice en termes d’excellence. En partant de la proposition de Commons (1934) selon laquelle la transaction est l’unité de base, la question qui se pose est celle de savoir comment les normes qui président à l’établissement des transactions publiques dans une Nation moderne sont justifiées, étant entendu que les parties prenantes sont égales en Droit à l’entrée dans la transaction et qu’il y a trois modalités de règlement du couple « conflit/dépendance » en jeu dans toute transaction (la planification, le marchandage et la direction)6. Cette question est celle qui a présidé à 57l’appropriation critique de ces deux apports afin de les rendre compatibles, avec pour résultat les propositions suivantes :
1. Un mode de justification est une façon pratique de justifier. Ce n’est pas une théorie normative de la justice.
2. Le mode pratiqué dans une « Nation moderne » est la justification en raison moderne en priorité du juste sur le bien. Sa particularité, au regard des modes du passé, est de ne pas reposer sur une conception commune du bien (opposé au mal). C’est un mode en termes de coordination sociale efficace7.
3. Ce mode consiste à se référer à une valeur sociale (une valeur relative aux rapports des humains entre eux) pour justifier. Les trois valeurs primaires en la matière sont la liberté-compétition (celle qui s’arrête où commence celle de l’autre), l’efficacitétechnique (dans l’usage des objets) qui est instrumentale et collective en tant que valeur sociale et le collectif-Nation (le « nous » des citoyens). Ce mode se décline donc en trois grammaires de justification distinctes8. Le recours à la planification est justifié par référence au collectif, le marchandage par référence à la liberté et la direction par référence à l’efficacité technique.
La justification en termes de justesse des normes-procédures
Une norme-procédure est une norme technique relative à l’usage d’un objet9. Elle procède d’une norme-définition de cet objet. Quant à cette 58dernière, elle dépend de la norme-référence (une norme sociale) retenue pour réaliser cette définition. Dans une « Nation moderne », les normes-références sont les trois valeurs sociales qui viennent d’être définies. Les pratiques humaines qui consistent à adopter une norme-procédure particulière en se conformant aux normes-règles sociales en vigueur sont donc normalement celles qui sont justifiées en se référant à la même valeur que celle qui a présidé à la justification des normes-règles en question.
La justification en termes moraux d ’ une activité
Dans une « Nation moderne », chaque personne est libre du choix de sa propre morale. Elle n’est pas obligée d’avoir adopté comme morale l’une ou l’autre des trois morales sociales qui vont de pair avec la « priorité du juste sur le bien » – viser la richesse, viser la puissance (la capacité de faire via la santé, l’instruction et la sécurité), viser la reconnaissance (celle des autres membres du « nous ») – ou toute combinaison des trois en des proportions qui peuvent dépendre de la situation (voir tableau 2, qui n’est pas propre à la Nation moderne, la spécificité de cette dernière étant que les biens supérieurs y sont visés).
Tab 2 – Les valeurs de référence de la justification en raison moderne
(espace public) et les biens supérieurs associés.
Source : Billaudot, 2021.
|
Valeur de référence |
Bien supérieur associé |
La nature de ce bien supérieur (celle qui est commune aux biens ordinaires qu’il regroupe) |
|
Le collectif |
La reconnaissance |
Le bien qui est apporté par les autres (ce sont les autres membres du « nous » qui reconnaissent un individu comme étant l’un des leurs à tel ou tel titre) |
|
L’efficacité technique |
La puissance |
Les biens dont on ne peut disposer que si les autres en disposent. Ce sont la santé, l’instruction et la sécurité |
|
La liberté |
La richesse |
Les biens dont un membre de la collectivité peut disposer sans qu’il soit nécessaire que d’autres en disposent aussi (on les obtient en raison d’un choix personnel). Ils sont nombreux |
Par contre, une personne ne peut à la fois justifier en termes moraux de se livrer à une activité particulière et ne pas justifier en termes de justice les normes-règles qui habilitent cette activité. C’est l’acteur qui justifie. Il justifie ce qu’il fait devant les autres lorsque ces derniers le lui demandent. Cette justification complète la signification qu’il donne à telle occupation et met en jeu sa motivation. L’agent est celui que le chercheur en science sociale analyse en attribuant à cette occupation, une orientation (liée à la signification) et une finalité (liée à la motivation). L’hypothèse faite est que, dans une Nation moderne, les occupations sont principalement à signification rationnelle et pour partie à orientation téléologique, la finalité qui en découle est extérieure à l’occupation lorsque la morale personnelle de l’acteur-agent est l’une de celles qui va de pair avec le mode « en priorité du juste10 » .
La cosmologie dualiste
Tel qu’il est couramment compris à la suite des Lumières, l’avènement de la « société moderne » sous la première forme qu’est la « Nation moderne » (en tant que modèle) a sonné le glas de l’histoire des cosmologies en assignant à ce terme un nouveau sens – la cosmologie comme branche de la physique. L’idée que le recours à la seule raison conduit à considérer que l’être humain est d’une autre nature que les autres existants du cosmos, à commencer par les animaux, s’est imposée en considérant que ce n’est pas un point de vue philosophique particulier, mais une proposition de nature scientifique. Il n’en reste pas moins que ce point de vue conventionnel a été contesté. Arendt est celle dont l’argumentation est la plus incisive : ce point de vue découle de « l’aliénation par rapport à la terre » que produit la « science moderne », avec comme conséquence que « nous avons trouvé moyen d’agir sur la 60Terre et dans la nature terrestre comme si nous en disposions de l’extérieur, du point d’Archimède » (Arendt, 1983, p 332). Plus récemment, ce sont Descola (2005) pour qui ce point de vue n’est qu’une ontologie parmi d’autres en la qualifiant de naturalisme et Latour (1991, 1995, 2006) pour qui c’est une illusion. La typologie des cosmologies dans laquelle prend place la cosmologie dualiste qui est au fondement de la « Nation moderne » (voir tableau 1) a été obtenue par appropriation critique de ces trois apports. Nous allons voir que la prise en compte de cette cosmologie dualiste, qui forme système avec la « priorité du juste », est à la base de notre troisième proposition et que la perspective d’un basculement au profit de la cosmologie écologique l’est pour la quatrième.
1. Le problème spécifique que pose l’incertitude radicale en matière financière :
intermédiation et marché
Dans l’introduction de son article, longtemps ignoré et désormais célèbre, sur La nature de la firme, Coase fait le constat suivant : « La théorie économique a souffert de n’avoir pas toujours su, dans le passé, poser clairement ses hypothèses. En construisant une théorie, les économistes ont souvent omis d’examiner les fondements qui la soutenaient. Un tel examen est pourtant essentiel, non seulement pour prévenir les incompréhensions et les controverses inutiles susceptibles d’être provoquées par une connaissance insuffisante des hypothèses de base d’une théorie, mais aussi de l’extrême importance que revêt, pour l’économie, le choix qui est opéré entre des hypothèses rivales » (Coase, 2005, p. 51). Tel est tout particulièrement le cas s’agissant de la théorie financière. L’hypothèse qui n’est pas explicitée dans les analyses mainstream est que les agents qui établissent des relations financières ne seraient confrontés qu’au risque (incertain probabilisable)11. L’incertitude radicale est ignorée. Si 61on la postule, on parvient à la conclusion qu’une transaction financière « publique » entre deux agents non-financiers ne peut s’établir. Des solutions institutionnelles ont été inventées pour résoudre ce problème. Elles sont nécessairement couplées en raison de la nature de l’instrument monétaire.
1.1. De la relation financière à la transaction financière
En toute généralité, une relation financière consiste en la mise à disposition d’argent d’une entité à une autre, chacune d’elle étant une unité institutionnelle d’une société humaine particulière12. Le doit d’usage de cette somme d’argent est un droit acquis par l’emprunteur dans le futur. Une transaction financière est une relation financière qui est propre à la « Nation moderne ». Elle est codifiée en Droit. Les caractéristiques d’une telle codification sont que les unités institutionnelles en question sont des personnes physiques ou morales et que ces dernières sont des entités « sans qualités particulières ». Elles ne sont différentiées les unes des autres que par leur nom. La transaction financière est donc une relation qui relève de ce que Caillé (1986) appelle la socialisation secondaire abstraite (ce n’est pas une relation personnelle relevant de la socialité primaire), Giddens (1987), l’intégration systémique (elle ne relève pas de l’intégration sociale sans distanciation spatio-temporelle) et Thévenot (2006) l’espace public (distinct de l’espace du plan et de l’espace du proche). Comme le retient Commons (1934), cette transaction consiste comme toutes les transactions à transférer un droit de disposition sur quelque chose. C’est une transaction économique parce que la contrepartie de cette cession est une dette d’une certaine somme comptée et réglée en monnaie et elle est financière parce que ce quelque chose est de l’argent. Qualifiée de prêt, cette transaction est un apport lorsque la mise à disposition est sans limitation de durée et sans rémunération convenue à l’avance et un prêt ordinaire dans le cas contraire.
1.2. L’incertitude radicale interdit la transaction financière
L’emprunteur ne peut assurer au prêteur la garantie que, s’il est dans le besoin, il pourra lui rendre la somme prêtée, puisqu’il ne connait pas personnellement ce dernier. Or le prêteur est devant une incertitude : 62il ne sait pas si, dans l’avenir, il se trouvera dans une situation telle qu’ayant à régler une dette quelconque en monnaie, il ne dispose pas de l’argent nécessaire et ne peut trouver un créancier. Si cette incertitude relevait du risque, il pourrait s’engager dans la transaction. Mais elle relève de l’incertitude radicale. Il s’avère donc nécessaire qu’une solution ait été instituée pour lui permettre de liquider la créance qu’il détient13.
1.3. Les deux solutions trouvées
La première solution est la transaction financière en finance de marché. Elle consiste, pour l’emprunteur à faire de sa créance un titre négociable sur un marché des titres déjà émis, alors qualifié de marché financier. Ce dernier est une institution publique régie par des règles de Droit et des conventions communes aux opérateurs sur ce marché. La seconde solution est la transaction financière en finance d’intermédiation ou plutôt la décomposition de la transaction impossible entre deux agents non-financiers en deux transactions financières relevant de la finance d’intermédiation. Cette dénomination s’impose parce que les deux sont établies par un intermédiaire financier : d’un côté, il emprunte en assurant la liquidité au prêteur (dépôt à vue non rémunéré assorti de services, dépôt à vue rémunéré ou dépôt à terme rémunéré) et, de l’autre, il prête sans garantie de liquidité.
1.4. Un bref historique de la naissance
de ces deux solutions et de leur couplage
Dans une « Nation moderne », ces deux solutions conventionnelles sont couplées. Elles s’ajoutent à la solution étatique qui consiste pour l’État à être le prêteur sans avoir besoin d’un marché pour liquider sa créance dès lors qu’il peut obliger les unités citoyennes à payer des impôts pour financer toutes ses dépenses14. Elles sont dites conventionnelles parce 63qu’elles ne sont pas nées d’une décision politique. Cela signifie qu’elles ont été inventées séparément l’une de l’autre, mais la codification en Droit de chacune d’elle n’a pu se faire qu’en raison de leur couplage, dès lors que l’instrument monétaire est la monnaie bancaire.
1.4.1. L ’ invention de la transaction financière en finance de marché
Chacun sait que cette invention a eu lieu avec la création sous la forme d’une société par actions de la Compagnie néerlandaise des indes orientales (la VOC en néerlandais) à Amsterdam en 1602. En effet, cette création s’est accompagnée de la mise en place d’un marché des actions émises et souscrites, ce qu’on appelle une Bourse comme il en existe déjà pour certaines matières premières (exemple : les oignons de tulipe). L’emprunt initial de la VOC pour la constitution de son capital social a été de 6,5 millions de florins divisé en actions de 3000 florins chacune. À l’époque, l’instrument monétaire, le florin, n’est pas encore de la monnaie bancaire mais de la monnaie métallique.
1.4.2. L ’ invention de la transaction financière
en finance d ’ intermédiation
La seconde solution conventionnelle a été inventée en Italie par un banquier qui a été immédiatement imité par les autres à un moment où le dépôt à vue transférable existe déjà. En effet, un marchand dépose de l’argent (monnaie métallique) chez un banquier qui lui remet une lettre de change avec laquelle il règlera ses achats lointains par le biais du banquier qui est le correspondant dans le pays où il achète de son banquier. Plus généralement d’ailleurs, le banquier se charge, pour un marchand ou un entrepreneur qui a effectué un dépôt, de réaliser pour lui ses opérations de règlement et d’encaissement qui ont lieu avec une entité disposant d’un dépôt en banque. De plus, le billet de banque voit le jour : le banquier remet à l’entité qui a un dépôt chez lui un billet, qui est une créance à vue sur le banquier, en débitant ce dépôt et en créditant le sien propre15. Le déposant s’en sert pour régler 64ce qu’il doit, sans faire usage de monnaie métallique. Quant à celui qui dispose maintenant du billet, il peut s’adresser au banquier et lui demander d’honorer sa dette en monnaie métallique en lui remettant le billet ou conserver ce dernier pour son usage propre (il est accepté dans un cercle privé beaucoup plus large qu’une traite commerciale en sa possession). À ce moment de l’histoire, le banquier n’accorde pas un crédit lorsqu’il crée des billets et les remet au déposant. L’invention de la transaction financière relevant de la finance d’intermédiation a lieu lorsqu’un banquier, après avoir constaté que le montant global des dépôts au passif de son bilan oscille dans le temps en passant par des minimas qui restent importants, prend le risque de remettre un billet à un déposant dont le dépôt s’est annulé ou est insuffisant. Il lui accorde alors un crédit. D’ailleurs ce crédit peut se faire sans émission de billet : le banquier crédite d’autant le dépôt du bénéficiaire du crédit, écriture qui a pour contrepartie l’inscription d’un crédit accordé à l’actif de son bilan. Ainsi, le banquier ne prête pas l’argent qui est déposé chez lui, il crée des signes de crédit qui servent couramment à assurer les fonctions de l’instrument monétaire légal émis par l’État sans avoir leur pouvoir libératoire en dehors de cercles privés. Le dédoublement (dépôt/crédit) est alors acquis. L’expression qui s’est imposé est que le banquier transforme des dépôts à vue en crédits à terme. Toutes ces transactions relèvent d’espaces privés.
1.5. La jonction
La jonction des deux solutions conventionnelles intervient lorsque le grand compromis historique entre la monnaie d’État et la monnaie privée (le billet de banque) a lieu avec l’institution comme instrument monétaire légal des billets du banquier de l’État à la place de la monnaie métallique et du papier monnaie d’État et l’interdiction faite désormais aux autres banquiers d’émettre des billets (ils n’ont le droit que de gérer des dépôts à vue transférables n’ayant pas le statut de monnaie et d’accorder des crédits par accroissement de ces dépôts). Ce compromis est à la base de la « Nation moderne » parce qu’il dissocie le rapport monétaire de l’État16 et autonomise ainsi un ordre économique de 65l’ordre politique, soit un ordre comprenant l’ensemble des activités et des opérations auxquelles un acteur-agent ne peut donner une signification sans faire appel à la monnaie. Celle-ci est souveraine à côté de la souveraineté politique du peuple tout entier composé de citoyens soumis au même Droit17. On est en présence d’un adossement réciproque de l’une (la monnaie-rapport dont l’instrument est la monnaie-instrument) sur l’autre (la citoyenneté dont l’instrument est le Droit). La jonction est acquise parce que l’instrument monétaire dont il est fait usage dans le marché financier est la monnaie bancaire. Comme l’avènement de la « Nation moderne » donne lieu à une distinction entre « ce qui est public » et « ce qui est politique », le marché financier est une institution publique d’ordre économique. Le couplage est ainsi institué en Droit de telle sorte que l’une (la finance d’intermédiation, notée FI) est indissociable de l’autre (la finance de marché, notée FM dans la suite).
Dans son principe, ce couplage n’est en rien modifié par l’institution des DAVT des banques ordinaires comme signes monétaires de plein droit à côté des billets de la banque de l’État à la suite de la crise de 1929 aux USA avec le Banking Act et à la sortie de la seconde guerre mondiale dans les autres nations dites développées – cette institution crée un système bancaire national ; il a à sa tête une banque centrale (le banquier de l’État) qui conserve le monopole de l’émission des billets et il comprend des banques monétaires de second rang dont il est convenu (sans que cela soit écrit) que la banque centrale assurera leur refinancement si elles ne peuvent faire face aux retraits de leurs déposants (la demande à leur banquier de convertir leur dépôt en billets de la banque centrale).
Ce couplage permet l’existence d’institutions financières procédant à des émissions d’actions et d’obligations. Il permet aussi à l’État de se financer par des émissions de titres (obligations, bons du trésor) sur le marché financier national (ainsi que sur les marchés d’autres pays, si cela est autorisé) ou l’obtention de crédits accordés par la banque centrale (si cela est autorisé) ou les banques de second rang (on parle alors de bons du trésor en compte courant à la banque centrale, bons qui ne sont pas négociables sur le marché financier).
661.6. De la justification des trois procédures
Ces deux solutions conventionnelles nécessairement couplées sont des procédures. Le recours à l’une ou à l’autre est nécessairement justifié en termes de justesse, même si cela reste implicite. Il en va de même pour la solution étatique. Il est aisé de parvenir à la proposition selon laquelle la finance étatique est justifiée par référence à la valeur « collectif-nation », la finance d’intermédiation par référence à la valeur « efficacité technique instrumentale et collective » et la finance de marché par référence à la valeur « liberté-compétition ».
Si on laisse de côté le cas où l’on est en présence d’une forme d’institution du système de financement d’une Nation qui ne fait de place qu’à la finance étatique et qui est donc une solution totalitaire, le couplage des solutions conventionnelles est de toutes ses formes d’institution. La finance étatique, pour laquelle les entreprises sont des entreprises publiques-étatiques en situation de monopole dans sa forme pure, est présente, mais sa place est le plus souvent secondaire18. En passant à notre seconde proposition, nous voyons maintenant que ce système, lorsqu’il est institué de façon cohérente, l’est soit comme un système à dominante de finance d’intermédiation (FI), soit comme un système à dominante de finance de marché (FM).
2. De la nécessité de conventions techniques
et sociales de qualification des créances (titre, crédit, dépôt) : trois modalités de qualification
Au point où nous en sommes, trois sortes de transaction financière ont été dégagées : 1/ la transaction financière relevant de la FM qui s’établit entre l’émetteur d’un titre et son détenteur (qu’il l’ait acquis à l’occasion d’une émission ou par achat en Bourse)19 ; 2/ la transaction 67entre un agent non financier qui obtient un crédit d’un intermédiaire financier et ce dernier ; 3/ la transaction entre un agent non-financier qui effectue un dépôt auprès d’une banque (IF) et cette dernière. Dans la suite, nous laissons la troisième dans l’ombre.
Comme pour une transaction commerciale et une transaction salariale, l’établissement d’une transaction financière entre un prêteur et un emprunteur ne peut s’établir que si deux problèmes ont été réglés. Le premier tient à l’incertitude radicale dans laquelle le prêteur et l’emprunteur se trouvent. Le premier ne sait pas si la créance qu’il va détenir en accordant un prêt répond aux exigences qu’il se donne – ces dernières déterminent les caractéristiques techniques de la créance requise. Quant à l’emprunteur, il ne sait pas si ce à quoi il destine l’argent qu’il emprunte et sa propre capacité future à payer les intérêts et rembourser le crédit à l’échéance répond aux exigences du prêteur – ces données propres à l’emprunteur sont les caractéristiques techniques de la créance acquise. Ce problème est réglé par la qualification des créances. C’est un problème technique dont la solution est assurée, soit par l’État (solution étatique), soit par une convention de procédure (solution conventionnelle). Une telle qualification technique passe par une conversion entre les caractéristiques de la créance acquise et celles de la créance requise20. Le second problème est social : il faut que les parties prenantes partagent un point de vue concernant ce qu’est la juste rémunération d’un prêt donnant lieu à la naissance d’une créance compte tenu de la qualité technique de cette dernière. En tout état de cause, si la qualification technique a été conventionnelle, le règlement de ce problème social consiste à hiérarchiser les différences de qualité technique en convenant qu’une créance de moins bonne qualité qu’une autre doit être mieux rémunérée. Cette solution au problème social passe par l’institution d’une convention qui est une règle conventionnelle. Pour que la transaction s’établisse sans trop de problèmes (pour que l’une des parties n’ait pas l’impression qu’elle a dû accepter les conditions de l’autre parce qu’elle n’avait pas le choix), il 68ne faut pas seulement que le problème social et le problème technique aient été résolus, il faut aussi que les façons de justifier retenues en justesse et en justice soient cohérentes entre elles, c’est-à-dire que ce soit à la même valeur que l’on se soit référé d’un côté comme de l’autre. Cela doit être qualifié de cohérenceinstitutionnelle. Le déroulement de l’activité économique dans le domaine financier s’effectue « en régime » lorsque cette cohérence est très majoritairement acquise et « en crise » lorsque ce n’est pas le cas. Un couplage cohérent est une convention de qualité. Puisqu’il y a trois valeurs de référence dans une Nation moderne, il y a trois conventions de qualité. Reprenons tout cela en détail.
2.1. De la qualification technique des créances (crédits/titres) : deux conventions procédurales de qualité technique
Pour Knight, il y a deux procédures à la disposition d’un acteur pour réduire l’incertitude radicale concernant ce que va faire l’entité (objet ou être humain) en interaction avec lui : la consolidation et la spécialisation21. La consolidation : toutes les entités sont semblables ; la spécialisation : chacune est différente des autres. Cela s’applique à la fois à l’emprunteur et au prêteur : pour l’emprunteur, consolider les prêteurs ou les spécialiser et pour le prêteur, consolider les emprunteurs ou les spécialiser. Il y a donc a priori quatre solutions de conversion entre la « créance acquise » et la « créance requise ». Mais seulement deux d’entre elles sont justifiées en termes de justesse dans une « Nation moderne22 » . Ce sont celles qui reposent sur la consolidation des emprunteurs par les prêteurs23. Ces deux solutions sont la qualification technique extérieure (double consolidation) et la qualification par les prêteurs (par chacun d’eux) (consolidation des emprunteurs par les prêteurs et spécialisation des prêteurs par les emprunteurs). Il y a lieu de préciser à quelle qualification technique conduit chacune de ces solutions de conversion 69pour une créance de type « crédit » (FI) et pour une créance de type « titre » (FM)24.
2.1.1. La qualification technique des crédits
Considérons d’abord la transaction financière entre un agent non financier (entreprise, ménage, État) et un intermédiaire financier (une banque monétaire ou autre IF). Dans ce cas, le prêt est un prêt ordinaire du type crédit à terme et la transaction s’inscrit dans le marché du crédit. La première solution de conversion est dite extérieure parce qu’elle est extérieure à ce marché et préalable à son fonctionnement. Elle l’organise. Elle consiste à prendre en compte des critères objectifs pour différencier les crédits : à un premier niveau, il s’agit de la durée du crédit qui conduit à une décomposition du marché du crédit en trois compartiments (le CT, le MT et le LT) et à un second niveau, le recours à une note attribuée à l’emprunteur en combinant des critères qui ne lui sont pas spécifiques et dont la solvabilité est le principal. On est alors en présence d’une qualification technique industrielle des crédits ou encore d’une convention procédurale industrielle de qualité technique. Cette convention est justifiée par référence à la valeur « efficacité technique instrumentale et collective ». Elle est cohérente avec le choix de la FI25.
La solution de conversion par chaque intermédiaire financier est faite de la créance requise à la créance acquise (chaque IF a sa propre façon de définir la « créance requise »). Une nomenclature des crédits ne peut alors qu’émaner du marché du crédit, en tant que phénomène émergent issu de la « puissance de la multitude ». Rien ne nous garantit que la nomenclature en question comprenne une différenciation selon la durée26. Au second niveau, il n’est plus question pour l’IF d’attribuer 70une note à un emprunteur sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs et d’une connaissance dans la durée de l’emprunteur. Au moins pour ses clients qui émettent des titres (les entreprises managériales et les États), l’IF n’a pas confiance en son propre jugement. Elle s’en remet à ce que la communauté des intervenants sur le marché financier révèle à propos de l’emprunteur via la façon dont se forme le cours des titres émis par ce dernier. Cette seconde procédure de conversion est justifiée par référence à la valeur « liberté-compétition ». Elle est cohérente avec le choix en faveur de la FM. Lorsque cette dernière est dominante, la cohérence impose que ce soit cette convention commune procédurale qui émane de la « puissance de la multitude ». On doit parler d’une convention procédurale de qualification technique marchande ou encore d’une convention technique de qualité marchande.
2.1.2. La qualification technique des titres
Considérons maintenant la créance de type « titre ». Elle est acquise par le prêteur par achat sur le marché financier en prenant la place d’un ancien prêteur qui a liquidé le titre qu’il détenait ou à l’émission dans des conditions qui dépendent de ce qu’il en est sur ce marché des conditions d’échange des titres émis antérieurement pas l’emprunteur. Ce marché financier est le seul marché des titres27. Les opérateurs sur ce marché constituent une « communauté » (ils se situent au même moment ou dans le temps des deux côtés de ce marché) (Aglietta et Valla, 2017). Comme pour les crédits, la qualification technique des titres procède d’une conversion à trois modalités : la conversion étatique, la conversion conventionnelle extérieure au marché financier et la conversion conventionnelle par ladite « communauté » vue comme un ensemble de prêteurs, c’est-à-dire par chaque opérateur.
La qualification technique qui est fondée sur la conversion extérieure au marché financier consiste d’abord à distinguer, sans prendre en compte la diversité des émetteurs, diverses catégories de titres (les actions, les obligations à échéance longue de remboursement, etc.) et ensuite à attribuer une note à chaque emprunteur, opération réalisée par des 71agences de notation ou des experts sur la base d’une batterie de critères. Comme pour les crédits, cette procédure est justifiée par référence à la valeur « efficacité technique instrumentale et collective ». Il s’agit d’une qualification technique industrielle des titres. Quant à la solution de conversion par chaque prêteur, elle peut conduire à dégager des classes de titres et cela peut conduire à l’institution de divers compartiments du marché financier (exemple : le compartiment des titres émis par des entreprises relevant des NTIC). On est alors en présence d’une qualification technique marchande des titres qui est cohérente avec la FM parce qu’elle est justifiée par référence à la valeur « liberté-compétition ».
2.2. La qualification sociale des créances :
la hiérarchisation des différences de qualité technique
selon un critère de juste rémunération
Passons à la nécessité que les protagonistes de la transaction s’entendent sur ce qu’est la juste rémunération d’un prêt (apport ou prêt ordinaire). Pour simplifier, je m’en tiens au juste taux d’intérêt pour un prêt ordinaire, qui est explicite pour un crédit et implicite pour un titre (via le juste niveau du cours du titre sur le marché financier). Le préalable est un accord sur le mode de justification. Il est acquis, de façon totalement implicite, si le mode convenu à l’échelle de la Nation n’est pas publiquement contesté (il s’agit de la « priorité du juste »). Dès lors, la levée de cet obstacle est assurée par un accord sur la grammaire de justification à retenir puisque ce dernier en comprend plusieurs. Il y a donc trois solutions à ce problème social pour lesquelles les principes de justice sont ceux d’une justice distributive (voir section A, supra). D’abord la solution étatique justifiée par le recours à la valeur « collectif-nation » : c’est l’État qui, s’il y a lieu, hiérarchise les différences de qualité technique dont il a été l’acteur. Ensuite, deux solutions conventionnelles, celle qui procède du recours à la grammaire de justification associée à la valeur « efficacité technique instrumentale et collective » et qui est donc « industrielle » et celle qui procède du recours à la grammaire de justification associée à la valeur « liberté-compétition » et qui est donc « marchande ». Avec la première, ce sont les différences de qualité technique définies de façon industrielle qui sont hiérarchisées et, avec la seconde, les différences de qualité technique définies de façon marchande. La cohérence est alors assurée. En règle générale, les protagonistes d‘une transaction financière 72ne sont pas conscients de l’existence du problème en question. Ils butent dessus lorsqu’ils n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente sur la rémunération due par l’emprunteur au prêteur.
2.2.1. La hiérarchisation industrielle des créances
La convention industrielle hiérarchise la qualification technique issue de la conversion extérieure. Il y a lieu de distinguer ce qu’il en est pour les crédits et pour les titres. S’agissant des crédits, la première étape de hiérarchisation est relative au critère « durée du crédit ». En justice distributive les emprunteurs sont consolidés : la convention est de mieux rémunérer l’IF qui prend le plus de risque, c’est-à-dire celle qui s’engage sur une durée plus longue. D’où une droite des taux qui est ascendante (a contrario, si on n’observe plus une telle droite, cela signifie que la hiérarchisation marchande a remplacé la hiérarchisation industrielle). Comme le rapport financier n’est pas extérieur au rapport monétaire mettant en jeu le système des banques monétaires ayant à sa tête la banque centrale, le niveau de cette droite est déterminé par le taux auquel cette dernière refinance les banques de second rang28. Ce dernier est à juste titre qualifié de taux directeur. La seconde étape consiste à réduire à une note l’appréciation objective de l’emprunteur ; cela donne une hiérarchisation ; l’emprunteur qui a une meilleure note bénéficie d’un taux d’intérêt plus bas. On comprend ainsi le « taux de base ». Cette modalité est cohérente avec la FI.
Pour les titres, le juste cours dont découle le juste taux d’intérêt du moment est fonction de la qualité du titre, qui est appréciée à l’amont du marché financier par la note synthétique attribuée à l’emprunteur (exemple : si la note attribuée à un État est abaissée, les cours de ses titres doivent normalement baisser si les opérateurs sur le marché financier se conforment à la convention en question). Cette modalité n’est pas cohérente avec la FM.
2.2.2. La hiérarchisation marchande des créances
Avec la convention de qualité marchande, la hiérarchisation est révélée par le marché, le marché du crédit pour les crédits et le marché financier 73pour les titres. S’agissant des crédits, il n’y a plus de droite des taux à pente positive. Certes, le taux d’intérêt auquel un crédit particulier est accordé est toujours lié à la qualité sociale du crédit, mais cette dernière n’est plus déterminée à l’amont du marché du crédit. Au regard de la convention industrielle, le sens du lien est inversé : c’est parce que l’IF propose un taux plus bas que le crédit est considéré comme étant de meilleure qualité. Mais, comme cela a été vu à propos de la qualification technique marchande des crédits accordés à des agents non financiers qui se financent aussi par émission de titres, l’IF qui accorde un crédit à un tel agent s’en remet à ce que le marché financier révèle concernant la qualité sociale des créances de cet agent (comme cela est vu au paragraphe suivant, ce n’est pas le cas où une note lui est attribuée). Le marché du crédit est donc en quelque sorte un clone du marché financier. Cela s’applique en particulier à la politique de refinancement de la Banque centrale lorsqu’elle a le droit d’acheter et de vendre des titres de l’État sur le marché financier. En particulier, elle va acheter des titres de ce dernier pour éviter que les cours de ces titres baissent et que, de ce fait, son financement par de nouvelles émissions soit plus couteux pour lui.
S’agissant des titres, c’est le marché financier qui révèle la qualité sociale des titres. Si des notes sont encore attribuées par les agences de notation ou les experts, elles ne commandent plus les mouvements des cours. Le « concours de beauté » de Keynes est à l’œuvre.
2.3. Synthèse : la domination d’une forme de finance
dans l’institution du système de financement
d’une « Nation moderne »
En raison de la jonction des deux solutions, le système de financement d’une « Nation moderne » comprend à la fois un marché des crédits, un marché des dépôts et un marché financier sur lequel se forme, via les cours des titres déjà émis, les taux implicites d’intérêts effectifs des titres ordinaires (le coupon annuel en intérêts du titre rapporté à son cours)29 – ces taux implicites sont les taux que les émetteurs doivent proposer pour leurs nouvelles émissions afin qu’elles puissent être souscrites sans problème. 74Cela s’impose si on retient que toute personne qui souscrit lors d’une émission de titres négociables ne se livre qu’aux activités auxquelles il peut donner une signification, que cette signification est rationnelle et que sa finalité est externe (obtenir une rémunération).
Si cette sorte de signification est celle de toute activité relationnelle d’un intervenant dans le système de financement d’une Nation, il y a nécessairement un lien entre les taux d’intérêt des crédits et les taux d’intérêts d’émission des titres. Ce lien implique que l’une des finances (la FM ou la FI) soit dominante et le sens de ce lien dépend alors de celle qui domine. Nous avons vu que la FM et la FI ne sont pas justifiées en se référant à la même valeur. De plus, nous savons que l’établissement des transactions financières pose des problèmes lorsque la cohérence de la forme d’institution du système en question n’est pas acquise. Cette exigence de cohérence impose que, si la place tenue par la finance étatique est secondaire, cette forme d’institution soit à dominante de FI ou à dominante de FM. Si ce n’est pas le cas, on se trouve en situation de crise. Encore faut-il bien s’entendre sur le sens de cette domination. En effet, une domination de la FI ne signifie pas que le financement des agents non financiers se ferait avant tout par l’octroi de crédits des IF à ces agents et une domination de la FM, que leur financement se ferait avant tout par l’émission de titres. Cette dominante signifie que les conventions de qualité sont du même type pour la FI et la FM. Il est donc préférable de parler de finance à dominante industrielle ou de finance à dominante marchande. La première se caractérise par le fait que les conventions de qualité des crédits et des titres sont toutes deux industrielles, avec un marché financier qui est sous la coupe du marché du crédit en ce qui concerne le sens du lien entre les taux d’intérêts d’émission des titres et les taux d’intérêts sur le marché du crédit. À l’inverse, pour la seconde, les conventions de qualité des crédits et des titres sont toutes deux marchandes, avec un marché du crédit qui est sous la coupe du marché financier, les taux d’intérêts qui se forment sur le marché du crédit étant commandés par ceux qui se forment (de façon implicite via les cours) sur le marché financier.
2.4. Une lecture des changements dans l’histoire
À la fin du xixe siècle, la finance est à dominante marchande, mais cette domination commence à être remise en cause par le poids grandissant de la masse du financement accordé sous la forme de crédits des IF au 75regard de celle qui provient de l’émission de titres, un poids qui grandit avec la place prise par l’usage de la monnaie scripturale (les DAVT) dans les règlements monétaires (surtout aux USA). La « crise de 1929 » est pour partie une conséquence de cette remise en cause sans basculement au profit d’une finance à dominante industrielle. La « grande transformation » qui a lieu à la suite de cette crise se caractérise, en matière financière par un tel basculement. Il est acquis après la seconde guerre mondiale. Le régime de croissance qui se met en place après la seconde guerre mondiale dans les Nations développées à économie de marché (celui que l’École de la régulation qualifie de fordien ou fordiste) repose sur une finance à dominante industrielle. Cette domination est remise en cause à partir de la « crise de 1974 ». Nous voyons maintenant que l’une des dimensions les plus importantes du processus de mondialisation qui débute dans les années 80 et qui s’opère tout particulièrement en matière financière est qu’il va de pair avec un basculement au profit d’une finance à dominante marchande.
3. Mondialisation et crise écologique :
la contestation des conventions
financières marchandes
La première étape dans l’élaboration de notre troisième proposition a pour objet d’expliquer le basculement au profit de conventions financières marchandes par le processus de mondialisation qui débute dans les années 80. Il s’agit ensuite d’expliquer pourquoi la montée en puissance de la question écologique au Nord et de la question sociale au Sud (ainsi que son retour au Nord) ont pour effet conjoint de provoquer une contestation de ces conventions financières marchandes mondialisées.
3.1. Mondialisation et basculement
au profit de conventions financières marChandes
Le lien qui est postulé est un lien systémique de type roll over. D’une part, la mondialisation est à l’origine du basculement et, d’autre part, la place prise par les conventions financières marchandes dans la régulation 76des flux financiers à la suite de ce basculement renforce le processus de mondialisation. La mondialisation en question dans ce lien est entendue en un sens qui prend ses distances vis-à-vis de son appréhension largement dominante par le gonflement des échanges internationaux de marchandises, de services et de capitaux.
3.1.1. La mondialisation économique n ’ est pas
l ’ internationalisation économique
Lorsque le volume des transactions d’ordre économique (commerciales, salariales et financières) à l’échelle internationale augmente on est en présence d’un processus d’internationalisation. Un tel processus a eu lieu au cours de la période de régime de l’après seconde guerre mondiale, dans le cadre d’un strict contrôle des mouvements de capitaux à cette échelle. Il s’accélère ensuite avec la levée généralisée de ces restrictions (dans un contexte où les États sont en déficit et ont des difficultés à se financer sur une base intérieure en FI) et la création de l’OMC. On s’interdit de comprendre la mondialisation réellement existante (MRE) à l’œuvre au début du xxie siècle lorsqu’on l’identifie à ce processus d’internationalisation. Il y a lieu de réserver l’emploi du terme « mondialisation » pour désigner un processus proprement institutionnel qui est distinct de celui qui soutient l’internationalisation – l’adoption généralisée par les États de politiques de libre-échange. Il s’observe lorsque les mêmes formes d’instituions de l’ordre économique tendent à se mettre en place dans toutes les Nations du monde. Pour la MRE, un tel processus repose sur la formation de nouvelles conventions communes aux agents économiques (grandes entreprises et grandes banques généralistes) dont l’activité passe de nationale ou multinationale à mondiale (ou globale, si on préfère). Ces nouvelles conventions sont mondiales. Ce processus disqualifie les règles de Droit propres à chaque Nation qui ne s’y accordent pas, ainsi que les conventions communes nationales dont la formation par le jeu de la « puissance de la multitude » s’était faite en conformité avec l’exigence de cohérence avec ces dernières. La nécessité de les réformer s’impose pour tous ceux qui sont favorables à cette mondialisation de l’ordre économique sans mondialisation, dans le même temps, de l’ordre politique30. Ainsi, « les 77ordres juridiques nationaux sont placés dans une situation de concurrence les uns à l’égard des autres. Il se crée ainsi, non pas un droit mondial mais un”marché mondial des droits nationaux” » (Frydman et Goldberg, 2007, p. 7). Cela vaut tout particulièrement dans le domaine financier, celui dans lequel la mondialisation ainsi comprise est la plus avancée. Telle est la nature exacte de la compétition internationale en matière économique qui préside aux destinées du monde depuis la « crise de 1974 ». Pour comprendre les phénomènes économiques qui y ont cours, il faut prendre en compte le couplage de la MRE avec le basculement au profit de la FM.
3.1.2. La MRE actionne le basculement au profit de la FM
L’organisation du système de crédit selon le modèle de la finance industrielle (FI) est nécessairement nationale. En effet, les processus de qualification technique des créances, qui sont extérieurs au marché du crédit et au marché financier, sont le fait d’instances nationales qui conduisent à une institution nationale de ces marchés et, par conséquent, à en faire des marchés proprement nationaux. Il n’en va plus de même en finance marchande (FM) puisque les conversions sont faites par les institutions financières (crédits) et par la communauté des opérateurs sur le marché financier (titres), avec une qualité sociale révélée par le marché financier qui se reporte sur le marché du crédit.
La MRE actionne le basculement d’une finance industrielle à une finance marchande parce que la première est un obstacle à cette mondialisation dès lors qu’elle est nationale tandis que la FM est celle qui s’y accorde en raison de la cohérence, sous l’égide d’une justification reposant sur la référence à la valeur « liberté-compétition », entre les nouvelles conventions mondialisées portées par les firmes qui se globalisent et celles qui le sont dans le domaine proprement financier par les banques qui se globalisent.
3.1.3. L ’ institution généralisée de la finance en FM renforce la MRE
À l’action qui vient d’être analysée se couple d’une rétroaction de la FM sur la MRE. En effet, l’institution généralisée de la finance selon 78le modèle de la finance marchande est un point d’appui essentiel de la mondialisation des activités des firmes et des banques. Quant aux États qui doivent accroitre l’encours de leur endettement parce qu’ils sont en permanence en déficit, la FM mondialisée leur assure de satisfaire ce besoin par des émissions de titres souscrits par des acteurs-agents de tous les pays, mais cela les rend dépendant des marchés financiers mondialisés et les contraint à adapter leurs interventions intérieures en matière de règles de Droit et de dépenses à ce qui leur est imposé par le régime international marchand qui se caractérise par ce marché mondial des Droits nationaux dont il a été question il y a peu.
Mais ce couplage, qui se fait sous l’égide du mode de justification propre à la « Nation moderne », est en même temps la négation de ce modèle puisqu’il disqualifie la Nation comme entité pleinement souveraine en matière d’institutions en Droit de ses trois ordres, l’ordre économique étant alors celui qui est concerné au titre de la finance31. Toutefois, ce n’est pas l’aspect principal de cette entrée en crise.
3.2. La contestation des conventions de la FM
Par définition, les conventions qui sont constitutives d’une forme d’institution de la finance sont communes. Si elles sont contestées par une minorité d’acteurs qui n’est pas négligeable et que ces derniers se conforment à d’autres conventions, on se trouve dans une situation « de crise ». Nous savons (voir section A) que la contestation de règles instituées (conventions communes et règles de Droit cohérentes entre elles) intervient lorsque le résultat attendu de ces règles n’est plus au rendez-vous. Dans une Nation moderne, ce résultat attendu est une croissance d’ordre économique aux fruits justement répartis (sans préjuger du contenu de cette croissance et des biens supérieurs pris en compte pour apprécier cette juste répartition).
Deux « faits » conduisent un nombre appréciable de citoyens au sein de chaque Nation à considérer que ce résultat n’est pas au rendez-vous en considérant que les conventions financières marchandes portées 79par la MRE en sont les principales responsables Ce sont la montée en puissance de la question écologique au Nord et celle de la question sociale au Sud (ainsi que son retour au Nord).
3.2.1. Ce que la question écologique conduit à remettre en cause
La question proprement écologique est suivante : l’humanité a-t-elle un avenir si se poursuit la dégradation de son milieu de vie qui a pour origine son existence ? Cette dégradation est maintenant bien documentée32. La montée en puissance de la conscience que cette question se pose a eu lieu principalement dans les Nations du Nord en l’attribuant au développement que celles-ci ont connu, mais elle s’observe maintenant à l’échelle mondiale, même si elle n’y prend pas le dessous sur la montée en puissance de la question sociale dans les Nations du Sud dites « en développement » (voir infra). La grille d’analyse présentée dans la section 0 conduit à l’imputer à la cosmologie dualiste qui nous donne la clé des raisons pour lesquelles les humains se sont données tous les droits d’exploiter la Nature sans limites et de la considérer comme une poubelle sans fond. C’est cette cosmologie qui est remise en cause, sans pour autant que soit clairement identifiée celle qui pourrait prendre sa place puisque certains écologistes (les fondamentalistes) prônent un retour à la cosmologie moniste et que beaucoup d’autres n’ont pas pris leurs distances vis-à-vis du concept de Nature (cette cosmologie a la vie dure !). Il s’agit du premier pilier de la Nation moderne, celui qui explique pourquoi le « nous » d’un groupement humain global au sein duquel la question de la justice de son organisation se pose est une partition au sein des seuls humains et non pas au sein de l’ensemble des existants.
3.2.2. Ce que la question sociale (celle du début du xxi e siècle)
conduit à remettre en cause
La question sociale, qui s’est posée à la fin du xixe siècle dans les Nations modernes de l’époque et à laquelle la grande transformation qui a conduit au passage de la société bourgeoise à la société salariale a 80été la réponse inventée, était la suivante : la société bourgeoise a-t-elle un avenir dès lors que se constitue et se renforce un prolétariat qui vit aux marges de cette société ? Elle se pose dans des termes analogues au début du xxie siècle dans beaucoup de pays du Sud, quand on y observe l’entassement croissant de la population dans les marges des grandes métropoles. Ce qui diffère est que ces pays ne sont pas des sociétés bourgeoises mais des sociétés « en développement », c’est-à-dire « en modernisation selon le modèle de la Nation moderne », dans un contexte marqué par la présence dominante des Nations déjà « développées » (en ce sens précis). La composante de gauche du néolibéralisme considère d’ailleurs que la MRE, dès lors que les mesures qu’ils préconisent sont mises en œuvre, est porteur de ce « développement ». Or le modèle en question est en crise et l’on ne voit pas comment le « marché mondial des droits nationaux » pourrait conduire à une résolution de la question sociale au Sud.
D’ailleurs, on assiste aussi dans les Nations du Nord à un retour de la question sociale s’agissant de ceux que l’on qualifie de « quart monde » et plus largement de « nouveaux pauvres ». Ce ne sont pas avant tout des pauvres en richesse d’ordre économique, mais des petits en reconnaissance33.
3.2.3. La cible principale de la contestation publique :
les conventions de la FM
On ne peut dire que ce sont à la fois le mode de justification et la cosmologie qui sont propres à la Nation moderne qui sont contestées dans l’espace public. Ce n’est que le résultat d’une analyse menée avec une grille inconnue de tous ceux qui s’y expriment. Par contre, une bonne partie des conventions financières marchandes mondialisées le sont explicitement, à commencer par celle selon laquelle l’objectif que doit poursuivre une firme managériale est de « créer de la valeur pour les actionnaires » et que le financement doit aller à celles qui se donnent cet objectif et y parviennent mieux que les autres. Le domaine dans lequel cela se manifeste tout particulièrement est celui de l’industrialisation des PED dans le contexte de la MRE, qu’il procède d’Investissements directs étrangers ou d’entreprises locales qui sont des sous-traitants de 81firmes du Nord. On est en présence d’une sous-industrialisation dépendante qui contribue peu au développement humain visé34.
4. L’avènement de la finance responsable :
une pierre sur le chemin de la transition
vers un nouveau monde
Nous en arrivons à notre quatrième et dernière proposition qui répond à l’objectif visé par cet article : comprendre l’avènement de la finance responsable.
4.1. Une manifestation de l’entrée en crise du monde
qui est au fondement de la Nation moderne
Il n’est pas discutable que cet avènement se conjugue à celui de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) en lien avec celui de la problématique d’un développement durable. La compréhension proposée vaut pour les trois. La première composante de cette compréhension relève d’un regard porté sur le passé : ce sont des manifestations de l’entrée en crise du modèle de la « Nation moderne », telle qu’elle a été diagnostiquée dans la section précédente (troisième proposition).
À partir du moment où personne ne peut nier que ceux qui s’activent pour mettre en œuvre des formes de finance responsable ont des motivations morales qui ne se limitent pas à ce que des principes de justice soient respectés mais intègrent la préoccupation de laisser aux générations futures un monde vivable, il y a lieu de privilégier l’un des principaux arguments en faveur de notre troisième proposition selon laquelle ce modèle n’a pas d’avenir. Son attendu est que la préoccupation de laisser un monde vivable aux générations humaines futures est une préoccupation morale (cela n’a pas de sens de parler de justice intergénérationnelle). Or les morales sociales associées aux trois grammaires de justification en termes de justice de la « priorité du juste » ne comprennent pas une telle préoccupation. Cela n’était pas le cas pour beaucoup des morales sociales 82antérieures. Ces dernières sont de moins en moins présentes dans les sociétés modernes réellement existantes à mesure que joue la pression à un alignement des morales personnelles sur ces morales sociales modernes. Dès lors ce recul a entrainé une purification de ces sociétés en mettant à nu leur fondement et, par voie de conséquence, sa contestation avec les manifestations de la crise écologique, une contestation qui a pris de plus en plus d’ampleur à mesure que cette dernière s’approfondissait.
4.2. La composante d’un nouveau monde
C’est d’un regard vers l’avenir dont relève la seconde composante de la compréhension proposée : la finance responsable est une pierre du chemin conduisant à un autre monde, c’est-à-dire une voie qui assurerait de sortir « par le haut » de la crise du monde de première modernité. Il n’y a aucune chance que cette voie s’actualise dans l’histoire humaine si un tel projet ne motive pas des actions individuelles et collectives en ce sens en conjuguant du bottom up et du top down. Étant entendu qu’un monde est le couplage cohérent d’une cosmologie et d’un mode de justification pratiqué dans l’espace public, quel peut être ce nouveau monde ? En prenant en compte les cases vides des typologies qui ont servi à construite la fresque historique présentée dans la section 0, une réponse à cette question s’impose : il s’agirait d’un monde de seconde modernité fondé sur une cosmologie écologique et un mode de justification faisant une place à la « priorité du bien ». La finance propre à ce projet assure le financement d’entreprises relevant d’un monde de production partenarial ou d’un monde inventif, sans prééminence de l’un sur l’autre.
4.2.1. La cosmologie écologique
Comme la cosmologie dualiste, la cosmologie écologique est moderne : les humains sont vus comme étant d’une autre nature que les autres existants en communication. Ce qui change est propre à la dimension ontologique : ils sont alors vus comme étant de même nature. Cette cosmologie virtuelle conduit notamment à introduire des composantes écologiques à la qualification technique des produits35, à accorder de 83l’importance à cette qualité écologique et, par conséquent, à instituer des règles économiques qui interdisent la production de produits dont la qualité écologique est nettement insuffisante.
4.2.2. Son couplage à un mode de justification
faisant sa place à la « priorité du bien »
Cette cosmologie virtuelle ne fait pas bon ménage avec la « priorité du juste » : aucun vivre-ensemble relativement pacifique des humains ne peut être porté par ce couplage incohérent. Elle ne peut être couplé qu’à un mode de justification qui, étant encore « en priorité » parce qu’il est moderne, fait une place à la « priorité du bien ». Cette entrée en scène est porteuse de morales qui comprennent la préoccupation de ce que les présents laissent aux générations futures. Quant aux valeurs qui président aux justifications, ce sont encore la liberté, l’efficacité technique et le collectif, mais elles sont appréhendées comme étant des valeurs éthiques (des valeurs relatives à soi-même). La liberté est la « liberté-épanouissement personnel », l’efficacité technique devient « non instrumentale et personnelle » et le collectif-nation se transforme en « collectif-humanité ». Les justifications en termes moraux mettent en avant comme finalité générale des occupations humaines la réalisation de soi et, non plus, la disposition de plus de biens supérieurs – la richesse la santé, l’instruction, la sécurité et la reconnaissance ne sont plus que des moyens au service de la réalisation de soi.
Cette entrée en scène est à même de se faire sans exclure la « priorité du juste » (les règles qui ne sont justifiables qu’en « priorité du juste » sont disqualifiées) ou en alternative de la « priorité du juste ». La seconde modernité se décline donc en deux mondes distincts. Le premier est à la base d’un projet réformiste de transformation et le second, d’un projet révolutionnaire, mais dans les deux la « société » est mondiale. Dans le projet réformiste cette société est à monnaie commune et Droit commun ; c’est une communauté de nations. Dans le projet révolutionnaire, la nation a disparu ; la société mondiale est à monnaie unique et Droit unique.
Il y a lieu d’ajouter deux caractéristiques qui sont communes aux deux mondes virtuels qui viennent d’être dessinés à grands traits et qui vont de pair : 1/ la codétermination, en tant que mode d’organisation du 84pouvoir « sur » l’entreprise, est instituée via celle des règles de Droit relatives à la transaction salariale (le Droit du travail) et à la transaction financière (le Droit des sociétés)36 ; 2/ les agents/acteurs ne sont plus des personnes sans qualité. Elles sont dotées d’une qualité intrinsèque. Pour les entreprises, cette qualité est la responsabilité dont elles font preuve en matière sociale (via la codétermination) et écologique (le respect des normes de qualité écologique des produits).
4.2.3. Deux nouvelles conventions de qualité
L’entrée en scène de la « priorité du bien » n’est pas autre chose que celle de la justice commutative. Dès lors, deux nouvelles solutions de conversion assurant la qualification des produits, des emplois et des créances sont justifiables. Elles procèdent de la spécialisation des producteurs par les acheteurs, des employeurs par les candidats à un emploi salarié et des emprunteurs par les prêteurs. Les deux conventions de qualité (couplage du technique et du social) qui en résultent sont la conventions de qualité partenariale (conversion conjointe relevant de la double spécialisation) et la convention de qualité inventive (conversion par le producteur, par l’employeur ou par l’emprunteur, relevant de la spécialisation des trois et de la consolidation des acheteurs, des salariés et des prêteurs). La première est justifiée par référence à la « liberté-épanouissement personnel » et la seconde, par référence à l’« efficacité technique non-instrumentale et personnelle » (la réalisation de soi en une telle efficacité). En matière de produits, la conversion conjointe qui est à la base de la convention partenariale permet d’atteindre une bonne qualité écologique de ceux-ci, tandis que l’inventivité en question dans la convention inventive est en premier lieu la capacité de concevoir des produits dont la nouveauté tienne à leur qualité écologique.
Ce sont ainsi deux nouveaux mondes de production qui entrent en scène sans faire disparaitre les mondes industriel et marchand puisque 85le mode de justification pratiqué est un mode complexe, mais ces deux mondes ne sont plus les mêmes dès lors que certaines des règles antérieures à la transformation réalisée avec l’actualisation du projet de seconde modernité réformiste ne sont plus justifiables ; à savoir, celles qui ne sont justifiables qu’en priorité du juste, à commencer par celle qui n’attribue au salarié aucun pouvoir « sur » l’entreprise qui l’emploie.
4.2.4. La finance du modèle réformiste
Si on considère que l’histoire avance en conjuguant rupture et continuité, le projet d’actualiser une seconde modernité qu’il y a lieu de sélectionner est le projet « réformiste » dont le mode de justification est complexe (les règles justes sont celles qui peuvent être justifiées à la fois en « priorité du juste » et en « priorité du bien »).
La distinction entre la finance d’intermédiation et la finance de marché est encore présente dans ce modèle virtuel réformiste de seconde modernité, parce que les deux possibilités offertes à un agent non financier de liquider un prêt sont encore d’actualité. Mais l’exigence de cohérence ne conduit plus à délimiter seulement deux formes d’institution cohérentes du système de financement mondial qui se décline en systèmes de financement nationaux distincts (une forme dite industrielle et une forme dite marchande), mais quatre si on s’en tient aux formes conventionnelles (hors forme étatique nationale) puisqu’il y a quatre conventions de qualité des créances, que ces dernières soient des crédits ou des titres.
4.3. La finance responsable comme forme primitive
de la finance virtuelle de seconde modernité
Il est aisé de constater que les acteurs actuels de la finance responsable, ceux qui tentent de la mettre en œuvre et ceux qui se préoccupent de la comprendre, tiennent des propos qui ont quelque chose à voir avec la finance virtuelle dont il vient d’être question, sans pour autant que la distinction entre finance partenariale et finance inventive soit évoquée d’une façon ou d’une autre. D’ailleurs, la domination actuelle de la référence à la liberté conduit à ce que la finance responsable soit souvent enfermée dans une forme primitive de finance participative.
86Bibliographie
Aglietta M. et Orléan A. (1982), La violence de la monnaie, Paris, PUF.
Aglietta M. et Brender A. (1984), Les métamorphoses de la société salariale, Paris, Calmann-Levy.
Aglietta M. et Valla N. (2017), Macroéconomie financière, Collection Manuels, Grands repères, Paris, La Découverte.
Arendt H. (1983), Condition de l’homme moderne, Paris, « Agora » Press Pocket, Calmann-Lévy (trad. fr. de The Human Condition, 1958).
Attioui A., Billaudot B. et Chafiq A. (2020), Les implications du mode d’insertion du Maroc dans l’économie mondiale sur sa croissance et son développement : passé et avenir, Casablanca, Policycenter for the new south.
Billaudot B. (2001), Régulation et croissance. Une macroéconomie historique et institutionnelle, Paris, L’Harmattan.
Billaudot B. (2011), « La norme ISO 26000 : une norme-définition qui a le statut d’un compromis », in Capron M., Quairel-Lanoizelée F. et Turcotte M.-F. (dir.), ISO 26000 : une Norme « hors norme » ?, Paris, Economica.
Billaudot B. (2021), Société, économie et civilisation. Vers une seconde modernité écologique et solidaire ?, https://books.openedition.org/emsha/422 (dernière consultation le 21/04/2021) Paris, EMSHA.
Caillé A. (1986), Splendeurs et misères des sciences sociales, Genève, Droz.
Coase R. H. (2005), « La nature de la firme » in L’entreprise, le marché et le droit, Paris, Éditions d’Organisation (trad. fr. de The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, 1988).
Commons J. R. (1934), Institutional Economics. Its Place in Political Economy, New York, Macmillan (rééd. Madison, Wisconsin University Press, 1959 ; New Brunswick, Transaction Publishers, 2 vol., 1989, 3e éd. 2005).
Descola P. (2005), Par-delà nature et culture, Bibliothèque des sciences humaines, Paris, Gallimard.
Dosse F. (1995), L’empire du sens. L’humanisation des sciences humaines, Paris, La Découverte.
El Aoufi N. et Billaudot B. (2019), Made in Maroc. Made in Monde, trois vol., Rabat, Économie critique.
Frydman R. et Goldberg H. D. (2007), Imperfect Knowledge Economics : Exange Rates and Risk, Princeton, Princeton University Press.
Giddens A. (1984), The Constitution of Society, Cambridge, Polity Press(trad. fr. : La constitution de la société, Paris, PUF, 1984).
Keynes J. M. (1930), A Treatise on Money, 2 vol., London, Macmillan.
87Keynes J. M. (1966), Théorie Générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la Monnaie, Paris, Payot (1re éd. 1936).
Knight F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Boston-New-York, Houghton Mifflin Company.
Latour B. (1991), Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte.
Latour B. (1995), « Moderniser ou écologiser ? À la recherche de la “septième” cité », Écologie politique, no 13, p. 5-27.
Latour B. (2006), Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte.
MacIntyre A. (1988), Whose Justice ? Which rationality ?, University of Notre Dame Press, Indiana (trad. fr. : Quelle justice ? Quelle rationalité ?, Paris, Léviathan PUF1993).
Myrdal G., 1931, « Om penningteoretisk jämvikt. En studie över den “normala räntan” i Wicksells penninglära », Ekonomisk Tidskrift, vol. 33, no 5-6, p. 191-302.
Orléan A. (1991), « Logique walrasienne et incertitude qualitative : des travaux d’Akerloff et Stiglitz aux conventions de qualité », Économies et Sociétés, série OEconomia, PE no 14, p. 137-160.
Orléan A., 2004, « L’économie des conventions : définitions et résultats », préface à Analyse économique des conventions, collection « Quadrige Manuels », Paris, PUF.
Orléan A., 2011, L’empire de la valeur, collection La couleur des idées, Paris, Seuil.
Polanyi K. (1944), The Great Transformation, Boston, Bacon Press (trad. fr. : La Grande transformation, Paris, Gallimard, 1983).
Polanyi K. (1977), The Livelihood of Man, New York, Académic Press (trad ; fr. : La subsistance de l’homme. La place de l’économie dans l’histoire et dans la société, Paris, Flammarion, 2011).
Rawls J. (1971), A Theory of Justice, The Belknap of Harvard University (trad. fr. : Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987).
Rawls J. (1993), Justice et démocratie, Paris, Le Seuil.
Rawls J. (2001), Justice as Fairness. A Restatement, The Belknap Press of Harvard University Press(trad. fr. : La justice comme équité. Une reformulation de théorie de la justice, Paris, La Découverte 2003).
Salais R. (1989), « L’analyse économique des conventions du travail », Revue économique, Vol. 40, no 2, Mars, p. 199-240.
Salais R. (1998), « À la recherche du fondement conventionnel des institutions », in Salais R., Chatel E. et Rivaud-Danset D. (dir), Institutions et conventions, Paris, Éditions de l’EHESS.
Salais R. et Storper M. (1993), Les mondes de production, Paris, Éditions de l’EHESS.
88Simmel G. (1900), Philosophie des Geldes, Dunker & Humblot, Berlin, (ed. 1987) (trad. fr. : Philosophie de l’argent, Paris, PUF, 1987).
Spinoza B. (1990), Éthique, traduction Misrahi R. in Philosophie d’aujourd’hui, Paris, PUF.
Thévenot L. (2006), L’action au pluriel : sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte.
Weber M. (1995), Économie et société, Tome 1 et 2, Paris, Agora pocket, Plon (Première édition allemande, 1921).
1 Myrdal, 1931. Keynes, 1930, 1936. Pour sa part, Keynes considère que « cette théorie s’écroule dès qu’on a compris qu’il est impossible de déduire le taux de l’intérêt de ces deux seuls facteurs » (1966, p. 180).
2 « Dans la pratique, nous sommes tacitement convenus, en règle générale, d’avoir recours à une méthode qui repose à vrai dire sur une pure convention. Cette convention réside essentiellement – encore que, bien entendu, elle ne joue pas toujours sous une forme aussi simple – dans l’hypothèse que l’état actuel des affaires continuera indéfiniment à moins qu’on ait de raisons définies d’attendre un changement » (Keynes, 1966, p. 167). Concernant cette convention, voir notamment (Orléan, 1991).
3 Adopter ce qualificatif revient à s’entendre avec l’historien des idées, François Dosse, qui constate l’affirmation, dans toutes les sciences sociales et en philosophie à la fin du xxe siècle, d’un tournantpragmatique. Pour lui, ce tournant est celui qui, afin d’éviter les impasses du déterminisme des comportements par la structure, « accorde une position centrale à l’action dotée de sens, réhabilite l’intentionnalité et les justifications des acteurs dans une détermination réciproque du faire et du dire » (Dosse, 1995, p. 12, souligné par moi).
4 Concernant les similitudes et les différences entre cette « puissance de la multitude » de Spinoza et la « mimésis » de Girard, qui est à la base de l’ouvrage d’Aglietta et Orléan (1982), voir (Billaudot, 2021).
5 Il la qualifie aussi de conception politique de la justice ou encore de conception en termes d’équité. Ceci est bien explicité dans (Rawls, 1993) et réexaminé dans (Rawls, 2003).
6 La planification : une instance extérieure aux parties prenantes à la transaction décide ; le marchandage : toutes participent à égalité au règlement ; la direction : l’une d’entre elles décide. Ces trois modalités sont à même d’opérer pour chacune des composantes de la transaction qu’il y a à régler et ce n’est pas nécessairement la même qui opère pour toutes les composantes.
7 Cette coordination sociale est assurée par les normes-règles instituées. Le résultat attendu de la coordination issue des nouvelles normes-règles qui sont justifiées est la disposition de plus de biens supérieurs (richesse, santé, éducation, sécurité, reconnaissance – voir infra) par la croissance économique. Elle est efficace si les fruits de cette croissance sont justement répartis (les inégalités dans la disposition des biens supérieurs sont injustes si, en les réduisant, on peut améliorer la situation de ceux qui en ont le moins).
8 Chacune d’elle n’est pas un mode de justification parce que les trois valeurs sont indissociables de leur fondement commun ; à savoir, la liberté-individualité, dont il est question lorsqu’on dit que les citoyens d’une nation moderne sont libres et égaux entre eux ou encore celle qui figure dans la devise « Liberté-égalité-fraternité » de la République française. Contrairement à la confusion savamment entretenue par les libéraux entre celle-ci et la liberté-compétition, il est essentiel de bien les distinguer. Ainsi, retenir la grammaire de justification procédant de la référence à la liberté-compétition, c’est-à-dire considérer cette dernière comme la valeur « suprême », n’élimine pas le fond commun, sauf dans sa version totalitaire.
9 Voir Billaudot, 2011.
10 La distinction entre « orientation téléologique » et « orientation causale » est reprise de Simmel (1900-1987). Comme chez Weber (1995), la rationalité qui fait système avec la première n’est donc pas pensée comme étant un attribut de la personne qui s’active (comme cela est le cas pour celle de la « problématique du choix rationnel »). C’est une caractéristique de la signification que cette personne donne de son activité. On est en présence d’une finalité interne à l’activité lorsque ce qui compte pour la personne est de se livrer à l’activité (appropriation critique de la signification rationnelle en valeur de Weber). Nous verrons que cette rationalité est celle d’un acteur de la finance responsable : ce qui importe pour celui qui prête est de prêter à une entité qu’il considère comme responsable socialement et écologiquement et non pas (ou seulement secondairement) la rémunération qu’il tirera de son placement.
11 Jusqu’à ce que Blaise Pascal invente le calcul des probabilités, les humains ne connaissent que la différence entre le certain et l’incertain. Avec lui, l’incertain est décomposé en « incertain probabilisable », alors qualifié de risque, et celui qui ne l’est pas, l’« incertain radical ».
12 Les relations financières entre agents de sociétés différentes sont ignorées pour simplifier.
13 Ce problème est propre à la transaction financière. Par contre, l’existence d’un obstacle ne l’est pas. Pour la transaction commerciale, l’obstacle pour l’acheteur – ne pas pouvoir se séparer de l’objet acheté s’il n’en a plus l’usage – est déjà levé puisqu’il lui suffit de le revendre d’occasion dès lors que la transaction commerciale qui lui a permis de l’acquérir est habilitée. Pour la transaction salariale, l’obstacle pour l’employeur – ne pas pouvoir se séparer du salarié s’il n’en a plus l’usage – est levé si le droit de licenciement fait partie du Droit du travail – la convention de chômage de Salais (1989).
14 Ou à faire « rouler » sa dette auprès de la Banque centrale (emprunter pour rembourser) si cette dernière a le droit de lui prêter.
15 La comptabilité en partie double a été inventée à cette occasion : cela évite au banquier d’avoir à disposer d’un coffre pour chaque déposant en plus du sien et de déplacer d’un coffre à l’autre la monnaie métallique.
16 Le terme anglais « desembodedness » utilisé par Polanyi (1944) est celui qui convient pour qualifier cette dissociation.
17 Elle assure l’ordination du multiple à l’un pour les dettes d’une certaine somme.
18 À noter que la pandémie Covid 19 a conduit les États, à commencer par l’État français, à redonner une place à la finance étatique en garantissant des prêts accordés par les banques aux entreprises dont l’activité est arrêtée ou limitée par les mesures prises pour lutter contre cette pandémie.
19 Pour simplifier, les OPCVM sont laissées dans l’ombre.
20 Pour une transaction commerciale, le vendeur ne sait pas si son produit (un produit-article) répond à une demande et l’acheteur ne sait pas si les produits qu’il peut acheter sont à même de correspondre à la ressource qu’il recherche. Une conversion entre les caractéristiques techniques de production du produit et les caractéristiques techniques d’usage de la ressource s’avère la façon de parvenir à une qualification du produit (qui est à la fois un produit et une ressource). Il n’y a pas une seule façon de procéder à une telle conversion.
21 Knight, 1921. Je suis redevable à Salais de la connaissance de l’apport de ce chercheur qu’il mobilise pour construire ses mondes de production (Salais et Storper, 1993).
22 Si on laisse de côté la conversion étatique qui est à la base de la finance étatique et qui, d’ailleurs, n’est pas conventionnelle.
23 Dans une « Nation moderne », la consolidation des emprunteurs par les prêteurs est la modalité qui est justifiée parce que ces derniers ne se préoccupent pas que la relation avec tel emprunteur soit juste (justice commutative), mais que l’organisation du système de financement conduise à une distribution juste entre eux (justice distributive). Nous verrons dans la section 4 que ce n’est plus le cas si la justification « en priorité du bien » entre en jeu, avec la finance responsable.
24 Il est question à la fin de cette section de la pertinence des propositions théoriques observables qui sont établies.
25 Si la FI existait isolément c’est-à-dire sans être nécessairement couplée à la FM, la seule solution de qualification technique des crédits serait la première (la solution CC), puisque la FI se justifie par référence à l’efficacité technique. Mais comme il y a toujours un couplage des deux et que ce couplage peut être à dominante de FM, la convention de qualification des crédits par les IF est envisageable ; il s’agit en l’occurrence de celle qui s’impose dans ce cas (voir infra).
26 De plus, si l’emprunteur est une entreprise, le critère de la nature de son activité productive ou des technologies qu’il utilise ou développe peut émerger comme base de cette différenciation.
27 Cela n’a donc aucun sens de parler d’un marché « primaire » qui serait celui des titres émis et de marché « secondaire » pour celui qui assure la liquidité des titres, comme le retiennent ceux qui s’en remettent à la proposition théorique qu’il y aurait un marché des fonds prêtables.
28 Concernant la logique de cette intervention, voir (Billaudot, 2001).
29 En notant t l’année courante, C(et-j, t) le cours d’un titre émis j années auparavant, VN(et-j) la valeur nominale de ce titre, TIe (et-j) le taux d’intérêt à l’émission et TIi(et-j, t) le taux implicite en question, ce dernier vaut : TIi(et-j, t) = [TIe(et-j) x VN(et-j)] / C(et-j, t)) – Pour un émetteur donné de titres, ce taux est le même quel que soit j, en raison des opérations d’arbitrage.
30 Dans (Billaudot, 2021), le néolibéralisme est défini comme étant la nouvelle philosophie politique libérale qui prône cette mondialisation en mettant en avant qu’elle permet à toutes les Nations du monde d’accéder à la croissance.
31 Dans ce cadre, il est possible d’expliquer la formation de taux d’intérêt quasi-nuls pour les émissions de titre des États et des firmes qui se financent à l’échelle mondiale. Cette démonstration n’est pas faite dans cet article. Ce « fait » est l’une des principales manifestations de cette contradiction et, par conséquent, de la crise du modèle de la Nation moderne.
32 Elle comprend principalement celle du climat avec en premier lieu la hausse des températures, mais aussi la pollution, la disparition de nombreuses espèces, etc. Il est courant d’ajouter l’épuisement de nombreuses ressources naturelles non reproductibles pointé dès 1968 par le Club de Rome.
33 Voir le mouvement des gilets jaunes en France en 2018-2019.
34 Pour le cas du Maroc, voir notamment (El Aoufi et Billaudot, 2019) et (Attioui, Billaudot et Chafiq, 2020).
35 Cette qualité met en jeu à la fois leur production (contenu en eau, contenu en matières premières non reproductibles, contenu en émissions de CO2, autres pollutions) et leur usage (idem).
36 Le terme « codétermination » s’est imposé à juste titre en remplacement de celui de « cogestion » parce que la gestion est assurée par le patron (entreprise personnelle) ou le manager (entreprise managériale) et qu’en conséquence le pouvoir « sur » l’entreprise se pose en termes de codéterminantion, par les apporteurs de capitaux et les salariés, en ce qui concerne le contrôle de la gestion, la nomination du manager (pour les entreprises managériales) et la répartition du profit d’entreprise. Le débat porte sur la forme que peut prendre cette codétermination.