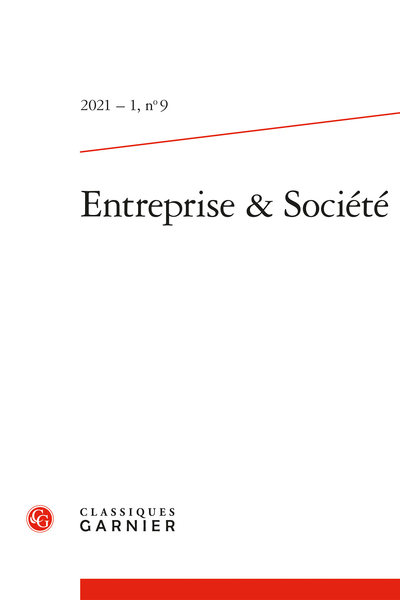
« Grand Angle » avec Jacques Richard Professeur émérite à l’université Paris-Dauphine – PSL
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Entreprise & Société
2021 – 1, n° 9. varia - Auteurs : Méric (Jérôme), Pérez (Roland), Rambaud (Alexandre)
- Pages : 25 à 35
- Revue : Entreprise & Société
- Thème CLIL : 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN : 9782406122036
- ISBN : 978-2-406-12203-6
- ISSN : 2554-9626
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12203-6.p.0025
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/08/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
« Grand Angle » avec JACQUES RICHARD
Professeur émérite à l’université Paris-Dauphine – PSL
Jérôme Méric
Université de Poitiers
Roland Pérez
Université de Montpellier
Alexandre Rambaud
Agro-ParisTech
RAPPEL SUR LA RUBRIQUE
« GRAND ANGLE »
Dans sa politique éditoriale, Entreprise & Société (ENSO) a décidé de consacrer, dans chacun de ses numéros, une rubrique spécifique, dite « Grand Angle », mettant en valeur une personne, un groupe, ou un événement particulier. Il ne s’agira pas d’un article académique, d’une recension ou d’une information factuelle, comme d’autres rubriques de la revue peuvent les offrir, mais d’une réflexion menée sur la relation entre entreprise et société, vue à travers l’itinéraire et la vision d’une personne « mise à la question », du groupe étudié, de l’événement analysé. L’objectif recherché est d’aider les lecteurs de la revue dans leur démarche de compréhension – parfois le déchiffrage) de cette relation entre entreprise et société, en ajoutant, aux rubriques usuelles ci-dessus mentionnées, cette rubrique « Grand Angle » qui se veut comme un instant de pause et de réflexion partagée.
26ENTRETIEN avec JACQUES RICHARD (JR)
Professeur émérite à l’Université Paris-Dauphine
Propos recueillis par Jérôme Méric (JM), Roland Pérez (RP)
et Alexandre Rambaud (AR)
Professeur émérite de gestion à l’université Paris-Dauphine, Jacques Richard a co-dirigé le Master Développement Durable et Responsabilité des Organisations. Diplômé de l’ESSEC, Docteur d’état en Sciences de gestion, titulaire d’un DES de droit privé, et d’un DES de Sciences économiques, Licencié es Lettres, il est devenu l’un des spécialistes – si ce n’est le spécialiste – des langues étrangères en comptabilité notamment des langues allemande, anglaise, hollandaise, russe, serbo-croate, polonaise, bulgare, tchèque, roumaine. Ses études ont notamment porté sur les systèmes comptables de l’autre côté du Rideau de Fer. Auteur de plus de cent articles de recherche, il a publié dans de prestigieuses revues comptables nationales et internationales, ainsi que dans des supports en langue allemande, espagnole ou portugaise. Invité par les universités de Kyoto, Münster, Saint Pétersbourg et Vienne, il a partagé sa conception de ce que doit être une comptabilité socio-environnementale au-delà des territoires français et francophones. Il a rédigé de nombreux articles pour le Monde, le Monde diplomatique, et dans la revue Analyses et Documents économiques de la CGT (Confédération Générale des Travailleurs).
Expert-Comptable et Commissaire aux comptes associé au Groupe Alpha spécialisé dans l’aide aux comités d’entreprise, il a siégé au Conseil National de la Comptabilité et au Comité de la Réglementation Comptable.
Auteur de nombreux ouvrages pédagogiques et de recherche, il accompagne aujourd’hui des cabinets comptables dans la mise en œuvre de la comptabilité socio-environnementale qu’il a conçue : la méthode CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement). Une comptabilité destinée à ne pas chiffrer l’impact, les dommages, mais le coût du renouvellement du capital environnemental à la charge de l’organisation.
Jérôme Méric : Comment en êtes-vous venu à la comptabilité ?
27Jacques Richard : J’y suis arrivé un peu par hasard : c’était en 1966, je sortais de l’ESSEC, école qui commençait à se doter d’un corps enseignant permanent. Disposant de deux DES (actuels Masters) l’un en droit et l’autre en économie, j’ai commencé à préparer une thèse de doctorat en économie, sur la comparaison des systèmes comptables dans le monde. J’étais en effet attiré par les langues et les thèmes à dimension internationale ; j’ai pris comme pays de référence les USA, les deux Allemagnes, l’URSS ; ce qui m’a amené à apprendre et pratiquer l’anglais, l’allemand et le russe. J’ai pu être recruté à l’université de Paris Dauphine qui venait d’être créée et dont le doyen était André Cibert qui y avait créé un centre de recherches dévolu à la comptabilité, ce qui était nouveau à l’époque.
J’ai soutenu ma thèse au début des années 1970 à l’université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne – soutenance thèse qui a été difficile, ma thèse ayant choqué une partie du jury.
JM : Pourquoi votre thèse a-t-elle choqué ?
JR : La réflexion comptable était centrée sur les aspects nationaux français et certains membres du jury ne voyaient pas l’intérêt d’une comparaison internationale, surtout avec des pays relevant de régimes économiques différents. Au-delà de mon cas, il faut comprendre la faible considération que le monde académique avait à l’époque pour la comptabilité, considérée comme une simple technique dont l’enseignement était confié à des praticiens sans préoccupations particulières pour la recherche. Qui plus est, mes intérêts se portaient sur des systèmes comptables auxquels le monde occidental tournait le dos : celui de la RDA, celui de l’URSS, et celui de la Yougoslavie, fondé sur l’autogestion.
JM : Dans quelle mesure vos travaux ont-ils apporté un élément disruptif à la recherche comptable ?
JR : à mon sens, pour deux raisons distinctes qui se sont succédé dans le temps :
–Tout d’abord pour l’intérêt, mentionné ci-dessus, pour la recherche comparée en comptabilité. Commencé avec ma thèse, il a continué après. C’est ainsi que j’ai été amené à étudier les comptabilités de l’ex-Yougoslavie, très différentes à la fois des comptabilités 28–occidentales et de celles de l’Union soviétique. Si ce penchant pour la recherche comparée était peu prisé en France, il a été, en revanche, apprécié dans des enceintes plus ouvertes ainsi par l’Association européenne de comptabilité (European Accounting Association, EAA) où j’ai pu présenter mes travaux tirés de ma thèse (3e conférence de l’EAA, Amsterdam, 1980). Anthony Hopwood (créateur d’Accounting, Organisations and Society) a réservé à cette occasion le meilleur accueil à mes travaux et m’a encouragé à publier dans sa revue ;
–Ensuite, pour mon intérêt porté aux questions environnementales, avant que ces problématiques ne deviennent à la mode. Cela est dû à une demande émanant des responsables (Sylvaine Trinh) d’un nouveau master de Dauphine orienté sur le développement durable, lesquels souhaitaient créer un module de « comptabilité verte ». Cela m’a amené à élargir ma vision du champ de la comptabilité et à innover. En cela, c’est bien à la sociologue Sylvaine Trinh que je dois l’aspect disruptif de ma démarche, au-delà de mon caractère qui me porte à cela.
Ces deux dimensions de ma démarche de recherche ne sont pas totalement étrangères l’une à l’autre. Ainsi l’idée de compartimenter les domaines comptables par centres d’intérêt, amenant à la non-substituabilité des capitaux concernés – principe qui est à la base du modèle CARE – était déjà présente, mais avec une autre typologie, dans les systèmes comptables de l’ex-Union soviétique. Le bilan soviétique était structuré en trois « couches ». La première sur les opérations à long terme, la deuxième sur les opérations à court terme, et la troisième sur le « Social », c’est-à-dire tout ce qui était destiné aux conditions de travail et de vie des ouvriers. Ces trois lignes étaient étanches, de manière à obliger à des disciplines budgétaires. Jusqu’ici, je n’ai pas vraiment parlé de cette genèse de ma réflexion, sans quoi elle eût paru douteuse aux yeux de certains. In fine, la première partie de ma carrière a été utile pour la seconde…les expériences du passé peuvent être source d’innovation pour le présent.
Roland Pérez : Quand on parle de « finance verte » il n’y a-t-il pas un double problème : celui de définir les différentes catégories d’items concernés et celui de leurs unités de mesure en conséquence. Doit-on tout ramener à des variables financières ?
29JR : Effectivement, il existe maintes unités de mesure possibles. Par exemple, on pourrait raisonner en termes d’énergie émise ou consommée. Tout un courant écologique raisonne en unités d’énergie solaire, d’autres tiennent compte en unités de surface terrestre, comme l’unité de Wackernagel. Cependant, il est nécessaire d’utiliser un langage commun pour construire une comptabilité intégrée au service de la société.
JM : Justement, peut-on concevoir une comptabilité qui soit un instrument de transformation de la société, et pas seulement un vulgaire outil comme d’aucuns voudraient nous le laisser croire ?
JR : Au-delà de l’automate débit-crédit, la comptabilité soulève de très sérieuses questions. Parmi elles, la question fondamentale est : « qu’est-ce que l’on veut conserver ? » C’est une question fondamentale, d’ordre philosophique. Elle dépasse en importance, à mon sens, celle de savoir si le dasein est au dessus du sein. S’il n’y a pas d’être humain en voie d’être conservé, le dasein et le sein n’ont plus lieu d’être. Alors, que conserver ? Le capital financier, une dette vis-à-vis du capitaliste, la résultante d’une séparation « égoïste » entre propriétaire et propriété qui remonte au Haut Moyen-Âge1, et qui fonde la comptabilité actuelle ? Le capital humain ? Le capital naturel ? Voire les trois, comme le propose la méthode CARE ?
JM : Le capital est-il un apport, du patrimoine, une ressource, une dette, un résidu ?
JR : Fondamentalement, pour les comptables classiques, le capital est une dette que les actionnaires souhaitent préserver en la mettant au passif. J’adhère à cette conception classique. Les juristes du 19e siècle considèrent comme indiscutable le fait que le capital constitue une dette, même si c’est une dette à très long terme. Ceux qui s’y opposent ont été préalablement influencés par les économistes. Ces derniers ont une autre conception, celle d’une ressource à laquelle il faut donner une valeur. Alexandre Rambaud2 a très bien montré comment Luca Pacioli 30anticipe cela en présentant le capital comme la résultante de flux futurs, entre actif et passif, même s’il demeure dans une époque où le capital est très majoritairement considéré comme une dette.
On ne peut pas changer la gestion sans réfléchir à ce concept. Marx n’en a pas perçu l’importance, alors qu’Engels, dans une lettre à Marx que j’ai retrouvée et citée dans notre ouvrage à paraître, explique que le capital relève d’un « dédoublement de personnalité ». Une dette vis-à-vis de soi, en somme.
Les économistes méprisent les comptables, les considérant comme incapables de valoriser des actifs autrement qu’à leur coût, alors qu’eux passent leur temps à essayer de donner une valeur aux choses.
JM : Dans un ouvrage sur la Juste Valeur, vous dessinez un moment dans l’histoire (la fin du 17e siècle) où les conceptions bifurquent entre l’école colbertiste, attachée aux représentations classiques et entrepreneuriales, et l’école juridique allemande, qui vient à représenter le capital comme un résidu de la valeur de l’actif une fois les dettes remboursées. Le basculement du coût historique à la juste valeur s’opérait parce que la solvabilité devenait une priorité.
JR : J’ai approfondi mes recherches depuis. Cette évolution est allée encore plus loin, à partir des années soixante, avec les IFRS qui expriment la montée en puissance des évaluations des actifs en termes de « valeurs de marché » à partir d’une approche actuarielle. À cette époque, le changement est radical. Ce que j’avais décrit dans le chapitre sur la Juste Valeur s’inscrivait encore dans le système classique. Il demeurait l’idée qu’au passif, il y avait une dette à rembourser au capitaliste.
In fine, on peut concevoir trois modes d’évaluation des actifs d’une entité. Le coût d’acquisition avec amortissement a été le format dominant jusque dans les années 1950. En parallèle, les juristes, qui se posent comme protecteurs des créanciers, privilégient la valeur liquidative et au 19e siècle, vont jusqu’à recommander aux comptables, par prudence, d’enregistrer des pertes, ce qui prévient la distribution hasardeuse de dividendes. Cela n’a finalement rien à voir avec la valeur de marché, un calcul économique fondé sur l’actualisation des flux futurs. Ce sont bien là trois philosophies différentes. La Juste Valeur traduit la mainmise des économistes sur les comptables.
31Au passage, faut-il rappeler que le concept d’amortissement est une invention des comptables ? Il se distingue du seul concept d’entretien qui était retenu par les économistes (cf. Quesnay). Rares sont les économistes, qui comme René Passet, ont compris l’intérêt de la notion d’investissement. La partie double permet de représenter une charge comme une diminution d’actif.
JM : Venons-en à la méthode CARE. Elle fait débat sur deux aspects. D’aucuns lui opposent la décision politique, seule propre à changer l’ordre des choses dans le sens d’une préservation de l’environnement. D’autres (parfois les mêmes) se refusent à mettre une valeur de marché sur l’environnement. Que répondez-vous à ces critiques ?
JR : Une méthode comptable nouvelle ne se substitue pas à une décision politique mais permet aux politiques de disposer d’informations plus larges pour prendre leurs décisions. Nous avons la faiblesse de croire que ce que nous apportons à leur réflexion peut être utile. Sous Louis XIV, des politiques comme Colbert se sont saisis de réflexions comptables. Réduire la comptabilité à une technique est un phénomène paradoxalement récent.
Sur le deuxième ordre de critiques, le mot monnaie renvoie les non-comptables au phénomène de marchandisation. C’est une tendance qu’il faut comprendre et chercher à infléchir. Nous essayons de montrer que la monnaie peut servir à exprimer la conservation des choses. Ne doit-on pas dépenser des sommes d’argent pour préserver l’environnement ? Je comprends moins lorsque cette critique émane de comptables. Les comptables classiques savent bien que l’objectif du marchand médiéval est de conserver son entreprise. L’innovateur comptable fabrique en quelque sorte des modèles alternatifs au modèle dominant : le modèle classique repose sur la conservation du capital financier ; le modèle CARE est plus large et envisage les trois catégories de capitaux : financier, humain et naturel.
RP : Pour certains critiques, cela peut entrainer le risque (évoqué supra) lié à un langage commun ?
JR : Non, car cela serait confondre monétisation et marchandisation. Évaluer le coût de restauration de la cathédrale de Paris ne donne pas 32une évaluation de la valeur (supposée marchande) de ce monument ! Le modèle CARE, bien au contraire, lutte contre la marchandisation.
JM : Il existe plusieurs modèles prenant en compte les aspects extra-financiers. Pourraient-ils converger par consensus ou par décision du normalisateur ?
JR : Des modèles concurrents et parfois divergents de l’extra-financier co-existent. Nombre d’indicateurs extra-financiers ne sont que des moyens d’éviter de remettre en cause le système comptable actuel, en préservant le modèle comptable classique. On peut même voir les IFRS tenter de s’adapter en intégrant les atteintes à l’environnement aux valeurs de marché via les baisses de profits futurs liées aux contraintes édictées une réglementation plus stricte…. Les défenseurs de l’extra-financier préservent l’idée d’une dette au seul capitaliste, et les chantres des IFRS ramènent tout à l’impact sur la valeur financière de l’entreprise. La méthode CARE est l’une des rares à prendre en compte l’humain.
L’approche CARE sous-tend une co-gestion écologique du pouvoir dans les entités concernées. Cette remise en cause du pouvoir dans les entreprises a quelque chose de révolutionnaire, et peut-être de protecteur. Une gestion paritaire préserverait peut-être les grandes firmes d’une perte d’indépendance à l’égard de grandes puissances qui ont déjà manifesté leurs appétits à cet égard.
JM : Est-ce à dire que l’approche CARE s’accorde avec un régime de gouvernance ?
JR : En effet, le régime de gouvernance le mieux adapté serait celui à trois catégories de partenaires représentant respectivement le capital financier, le capital humain et le capital naturel. C’est un peu plus englobant que la coopérative ouvrière, mais c’est bien une manière d’organiser un partage des pouvoirs entre ceux qui travaillent dans l’entreprise – ou leurs représentants.
Au-delà de l’aspect ontologique concernant la nature de ces capitaux, la question se pose de leur représentation dans le régime de gouvernance de l’entité concernée :
33–Pour le capital financier, il s’agit des apporteurs de capitaux ? C’est ce qui se fait actuellement en droit des sociétés, même si l’on peut espérer que les nouvelles formes d’entreprises pourront attirer de nouveaux types d’actionnaires (de type dit « socialement responsable ») ;
–Pour le capital humain, il s’agit du personnel salarié, via leurs représentants, comme cela est fréquent dans maints pays, notamment en Allemagne avec sa Mitbestimmung ;
–Pour le capital naturel, c’est un peu plus compliqué, mais il est possible d’en représenter des défenseurs (riverains, voisins, ONG, …).
Par ailleurs, le résultat final étant commun à l’ensemble des parties concernées, les conflits devraient être moins violents (du moins on peut l’espérer…), et le public plus enclin à investir dans ces structures. C’est une vision proudhonienne écologique, bien plus que marxiste (il ne s’agit pas de nationaliser).
Actuellement, la chaire « Comptabilité écologique », qu’anime Alexandre, mène plusieurs travaux exploratoires en ce sens, notamment en relation avec le collège des Bernardins dont l’un des groupes (sous la direction d’Olivier Favereau) a travaillé sur la co-détermination ; régime de gouvernance multipartenaires auquel le modèle CARE peut apporter l’infrastructure comptable nécessaire.
RP : Pour se projeter sur l’actualité, comment l’approche CARE se situe-elle par rapport à la crise actuelle ?
JR : Les financements actuels des entreprises ne font pas assez de distinction au niveau des entreprises et de leurs investissements, du point de vue de leurs impacts sociaux et écologiques. La méthode CARE peut être utile pour distinguer les entreprises qui font des efforts dans ces domaines. Pour parvenir à ancrer très rapidement la méthode CARE dans la pratique, une solution raisonnable serait de coupler le modèle CARE à la comptabilité analytique des entreprises, ce qui permettrait d’avoir, à côté du résultat financier donné par la comptabilité classique, le résultat ajusté issu de CARE. Pour l’État et les apporteurs de financement, une telle information pourrait s’avérer particulièrement utile dans la prise de décision.
34JM : Effectivement, cela irait dans le sens du Rapport Jenkins qui dès 1994 prônait une transparence la plus grande de l’information de gestion3
JR : Si les rapports de la sorte sont sincères, alors la méthode CARE peut constituer un apport fondamental.
JM : Pour terminer, pourrais-tu donner ta position sur la recherche engagée par rapport à l’injonction dite de « neutralité axiologique » initialement posée par Max Weber4), donnant lieu à un débat souvent passionné en SHS (Habermas, Caillé, … ?)
JR : Je ne suis pas spécialiste des débats épistémologiques, mais il me semble qu’on ne peut pas faire de recherche en SHS sans avoir une représentation du monde dont nous faisons partie, et par là d’avoir un engagement a minima sur les priorités à étudier. Ainsi, en comptabilité, la question prioritaire qui se pose est : qu’est-ce que l’on veut conserver ?
RP : En effet, en SHS, la spécificité de ces disciplines est que « l’observateur fait partie du champ d’observation5 » ; en conséquence, comme le notait F. Perroux, maintes recherches, se proclamant axiologiquement neutres, reposent en fait sur des hypothèses « implicitement normatives6 »
JR : Tout-à-fait, en SHS le chercheur ne peut totalement être étranger à sa problématique de recherche. En revanche, il doit être le plus rigoureux possible dans les protocoles mis en œuvre, afin de pouvoir en tirer les enseignements les plus pertinents, même si certains d’entre eux ne le réjouissent pas…
(Question post-entretien, en guise d’hommage)
35RP : Sur les décennies que je te connais (depuis cette fameuse soutenance de thèse) tu as toujours eu « un coup d’avance » dans tes travaux par rapport à ceux, majoritaires, de l’époque : tout d’abord – comme on l’a rappelé – en t’intéressant à l’international quand les comptables français étaient cantonnés à l’Hexagone ; ensuite en analysant les comptes de l’entreprise pour leurs salariés et leurs syndicats alors que seuls auparavant les actionnaires en bénéficiaient ; enfin – comme on vient d’en parler – en t’intéressant aux enjeux écologiques bien avant qu’ils soient devenus évidents et en tentant de les prendre « en compte » dans un modèle intégré. La question que nous souhaiterions te poser est : quelle nouvelle question de recherche te préoccupe actuellement ? Car il y a de bonnes chances qu’elle soit au centre des débats de demain…
1 Renvoi à Yves Renouard (1949), Les hommes d’Affaires italiens du Moyen Âge, Pari, Armand-Colin.
2 A. Rambaud (2018), « Aux origines du capital – le capital chez Luca Pacioli – entre comptabilité et économie – entre mondes ancien et moderne », Journée Transition numérique et information comptable, Nantes, mai, 57 p.
3 AICPA (1994). Improving business reporting – a customer focus : Meeting the information needs of investors and creditors ; comprehensive report of the special committee on financial reporting, New York, NY, American Institute of Certified Public Accountants.
4 M. Weber (1917 [trad. fr. 1965]), « Essai sur le sens de la “neutralité axiologique” dans les sciences sociologiques et économiques », dans M. Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, p. 475-526.
5 C. Lévy-Strauss (1950), « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », in Mauss M., Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, p IX-XII.
6 F. Perroux (1970), « Les conceptualisations implicitement normatives et les limites de la modélisation en économie », Économies et sociétés, IV, no 12, décembre, p 1255-2307.