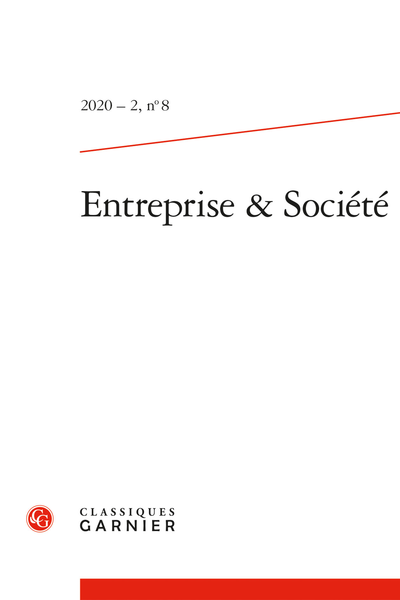
Les Communs, des entreprises comme les autres ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Entreprise & Société
2020 – 2, n° 8. varia - Auteur : Méric (Jérôme)
- Pages : 45 à 48
- Revue : Entreprise & Société
- Thème CLIL : 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN : 9782406114161
- ISBN : 978-2-406-11416-1
- ISSN : 2554-9626
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11416-1.p.0045
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/02/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
les communs, des entreprises
comme les autres ?
Jérôme Méric
CEREGE – IAE de Poitiers
Ce second volet du dossier « Entreprise et Communs » dirigé par Cécile Renouard et Swann Bommier (voir le no 6, de cette même revue) aborde les communs dans leur forme organisationnelle. Il s’agit donc ici de dépasser la matérialité des communs pour en examiner la praxis, c’est-à-dire l’agir et la conscience de cet agir en commun (Castoriadis, 1975). La focalisation sur les biens communs fait oublier qu’Ostrom (2010) assimile les communs à des dispositifs de gouvernance et de gestion. Partant de ce qui peut être considéré comme une définition, la proximité entre l’entreprise et le commun peut sembler évidente. Une fausse évidence peut-être, car le commun se veut mu par une action collective collectivement délibérée, des règles communément définies et acceptées, une gestion propre à préserver le bien commun que constitue la ressource en jeu. Il n’empêche que dans le contexte socio-économique contemporain, les contraintes de financement et les règles de droit laissent une voie étroite aux collectifs qui visent à entreprendre sans entreprise. C’est à cette problématique que répondent les deux articles constitutifs de ce second dossier, de manières diamétralement opposées. Le premier étudie les modes d’organisation des communs dans le secteur de l’économie Sociale et Solidaire (ESS), selon une perspective analytique et descriptive, alors que le second propose, dans une contribution à visée normative, des modalités de financement alternatives pour les communs. Les conclusions des deux articles convergent toutefois vers la difficulté que peuvent éprouver de telles organisations à échapper aux schémas conventionnels de l’économie néo-libérale.
46Menée auprès de 15 Initiatives en Commun (IeCs) dans la région Hauts-de-France, l’étude d’Amélie Lefebvre-Chombart, Pierre Robert, Laurent Gardin, Florence Jany-Catrice et Christian Mahieu suggère que le champ de l’ESS se prête particulièrement bien à l’émergence de « communs sociaux », dont la marque de fabrique semble être a minima un processus de décision démocratique. En réaction au modèle néo-libéral qui soumet l’ESS à la concurrence – au moins pour l’accès aux ressources – les initiatives en commun se développent, qui portent des projets coopératifs d’écotourisme, de centrales d’achat pour les PME-PMI, etc. La recherche fait ressortir les caractéristiques communes de ces structures : une gouvernance horizontale (et les dérives de rapports de force qu’elle peut induire), un travail mutualisé – coopératif – inclusif, un modèle économique fondé sur la réciprocité, un engagement local in fine politisé. Il faudra probablement inscrire cette analyse dans la durée car c’est ainsi que s’apprécie la praxis instituante et que, comme le suggère l’article suivant, l’organisation suit la trajectoire des projets qu’elle porte.
Bernard Paranque rejoint la première contribution sur l’idée que l’on ne peut confondre un commun et les ressources qu’il gère. Il apporte toutefois un éclairage complémentaire à la notion : si l’on ne peut réduire le mode d’action collective à la matérialité, cette dernière demeure l’enjeu des « actions congruentes » via le produit, c’est-à-dire son marché, et la technologie en jeu. Confrontés à des problématiques analogues aux entreprises, les communs doivent se financer sans pour autant passer par les fourches caudines de la finance institutionnelle et actionnariale. C’est un passage étroit que celui qui doit à la fois préserver l’impact sociétal du financement et pérenniser l’investissement privé « désintéressé ». Les Social Impact Bonds (SIB) financent les projets sociaux et assurent une rémunération à partir d’un consensus formé a priori par les parties prenantes sur le résultat à atteindre. La problématique devient alors celle des objectifs à déterminer a priori et de l’évaluation à réaliser a posteriori en tenant compte de la trajectoire finalement prise par le projet. La déclinaison des « mondes de production » (Salais et Storper, 1993) permet d’esquisser la cohérence à donner à l’action collective selon le degré de spécialisation des « produits » et la prévisibilité des marchés. Dans ce cadre, les communs constituent des formes d’organisations qui privilégient l’interpersonnalité, le marchand (au sens de l’échange) 47et l’innovation. L’autre caractéristique des communs réside dans leur appréhension du risque. Ils inscrivent de fait leur action dans le long terme et ne peuvent se limiter à l’évaluation d’une perte probable à brève échéance. En situant les pratiques selon l’espace de l’échange (public ou privé) et selon l’importance que revêt la socialisation pour l’organisation, Bernard Paranque suggère que les communs peuvent porter une conception de la « finance en tant que lien », que ce soit dans le modèle associatif (dominance du don), ou dans celui du peer-to-peer ou de l’open source (dominance de la finance alternative fédérant les parties prenantes autour de valeurs communes). Dans ce contexte, la levée de fonds peut s’opérer via des SIB, par des systèmes mutualistes ou par des communs financiers. Cela suppose la formalisation collégiale d’un projet, des règles de gouvernance, des conditions de contribution et de rétributions explicites (au même titre que les critères de performance), incluant enfin des dispositifs de garantie.
Performance, long terme, court terme, financement… en fin de compte, les communs se trouveraient confrontés à des enjeux de gestion analogues à ceux de l’entreprise. L’approche praxéologique semble plus apte à dresser une frontière nette entre l’entreprise capitaliste et le commun, car la question des régimes de propriété demeure, chez Ostrom, passablement complexe. L’ancrage des communs dans la théorie des droits de propriété ne la conduit-elle pas à redéfinir les droits d’extraction et d’exploitation des ressources communes comme relevant de choix collectifs eux même régis par une constitution, et ainsi à dresser une analogie entre la corporation et le commons (Weinstein, 2013) ? La différenciation s’opèrerait, in fine, sur l’usage des ressources et la relégation du critère d’efficience à celui d’accessoire, alors que la pérennité deviendrait centrale. Bernard Paranque suggère que les communs s’inscrivent dans la cité par projet de Boltanski et Chiapello (2011), une récupération somme toute de la critique artiste adressée au capitalisme. Nous pouvons aussi y voir une tentative de joindre une valeur anciennement portée par le capitalisme, la sécurité, et celle de son nouveau visage, la liberté.
48BIBLIOGRAPHIE
Boltanski L., Chiapello E. (2011), Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris.
Castoriadis C. (1975), L’Institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil.
Ostrom E. (2010), Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Bruxelles, Éditions DeBoeck Supérieur.
Salais R. et Storper M. (1993), Les Mondes de Production – Enquête sur l’identité économique de la France, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
Weinstein O. (2013), « Comment comprendre les “communs” : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie institutionnelle », Revue de la régulation, no 14, 2e semestre.