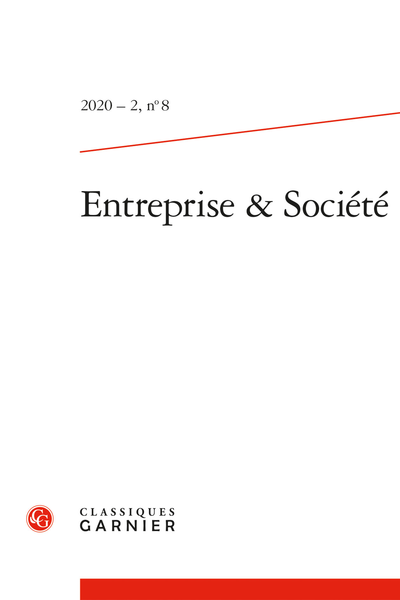
Présentation du numéro
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Entreprise & Société
2020 – 2, n° 8. varia - Auteurs : Méric (Jérôme), Jardat (Rémi)
- Pages : 15 à 18
- Revue : Entreprise & Société
- Thème CLIL : 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN : 9782406114161
- ISBN : 978-2-406-11416-1
- ISSN : 2554-9626
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11416-1.p.0015
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/02/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
PRéSENTATION DU NUMéRO
Jérôme Méric
CEREGE-IAE de Poitiers
Rémi Jardat
LITEM –
Université d’Évry-Paris-Saclay
Le docet omnia du Collège de France vaut autant pour la diversité des savoirs qu’il dispense que pour l’esprit érudit de ses professeurs, dans la droite ligne des humanistes que regroupaient les premiers Lecteurs Royaux. À la lecture d’Alain Supiot, à son écoute, le parcours du juriste n’est pas immédiatement perceptible. Sa conception du droit s’inscrit dans une compréhension du social, dans ce que ce terme peut avoir à la fois d’éclairant et de totalisant. Lorsqu’il propose de dépasser le droit comme technique apparemment neutre pour en faire le miroir réflexif d’une société, on ne peut s’empêcher de penser aux travaux de Durkheim sur le droit pénal. À considérer la question écologique, on réalise en sa compagnie que le droit postrévolutionnaire fondé entre autres sur la propriété a institué la capacité à user et abuser des ressources, puisque quelqu’un, in fine, doit les détenir. Le droit, en particulier le droit du travail, est un savoir empirique et c’est ce qui fait son intérêt pour Alain Supiot. C’est un prolongement de la langue, qui suppose à la fois la médiation et l’interprétation par un tiers propre à faire sens commun – le juge, en l’occurrence. Cette fonction est essentielle dans une société où la dualité de l’Homme est de moins en moins assumée. L’entreprise, pour sa part, n’est pas un artefact externe au social, comme on se plairait à nous le faire croire. Elle incarne la société contemporaine, en 16cela qu’elle est le lieu de la gouvernance par les nombres, cette invention qui remonte probablement à la Renaissance, et que consacrera l’imaginaire cybernétique. Avec l’entreprise comme acteur majeur de la société, c’est le règne de l’efficacité qui se substitue à celui de justice, l’autopoïèse libérale (pardonnez le pléonasme) à l’hétéronomie régulatrice. Ce manque d’hétéronomie n’expliquerait-il pas, entre autres, les replis fondamentalistes ? Alain Supiot l’affirme clairement : le recours aux nombres n’est pas un problème en soi, c’est son usage a-contextuel et autoritaire qui l’est. Pouvoir expliquer comment on « fabrique les chiffres », participer à leur genèse et à la constitution de leur sens, là seulement réside la liberté, une liberté qui demeurerait donc réservée à une élite ? L’exercice de cette liberté appellerait, en tout état de cause, celui de responsabilités. Pourtant, dans le monde globalisé qui est celui que nous avons construit, les chaînes de valeurs aux maillons lâches et dispersés contribuent à la dilution de la responsabilité. Sans la force des états pour préserver la vie sur le long terme, les entreprises sont tentées de conserver les coudées franches tout en se cachant derrière le vocable cybernétique de RSE. C’est à un combat quotidien contre la réification que ce Grand Angle d’Alain Supiot, élaboré grâce à Yannick Lemarchand et Samuel Jubé, semble nous appeler.
S’organiser en « communs » peut-il et doit-il justement constituer un rempart contre la réification ? À la suite du numéro 6 de la revue, le présent volume reprend la suite du dossier « entreprise et communs » coordonné par Cécile Renouard et Swann Bommier. Les deux contributions font la part belle aux aspects organisationnels et financiers des communs. Amélie Lefebvre-Chombart, Pierre Robert, Laurent Gardin, Florence Jany-Catrice et Christian Mahieu examinent pour leur part la manière dont se structurent les « communs sociaux » et quelles sont, dans la diversité de leur nature, leurs caractéristiques communes. Les règles de gouvernance qui les rejoignent semblent constituer, pour Bernard Paranque, une condition nécessaire à l’acceptabilité du financement des projets en « communs », ne serait-ce que parce que les financeurs privés attendent la formalisation collégiale des projets et l’accord préalable sur les conditions de contribution-rétribution.
Dans le Cahier Finance, Thomas Lagoarde-Segot et Christophe Revelli se font l’écho de la manière dont émerge une théorie financière écologique en réponse aux représentations néoclassiques : une théorie 17de l’encastrement dans les arrangements sociaux et dans les contraintes environnementales, une théorie projective et plus prescriptive, une théorie ouverte à d’autres disciplines. Force est constater, avec les auteurs, que la finance verte, vue sous l’angle des outils, n’est pas satisfaisante. Elle représente une part négligeable des transactions, notamment parce que les instruments sont assimilés à n’importe quel autre produit financier, un label de plus dans une liste déroutante pour l’investisseur, alors que les causalités résultats-performance financière se heurtent à la question des obligations de résultat et des temporalités hétérogènes. Le présupposé néoclassique d’une économie autonome des autres disciplines conduit à cette impasse, tout autant que la soumission du système « environnement » au sous-système « finance ». L’alternative du TSE, instrument souverain visant à financer une création de richesse à l’échelle macro-économique est examinée. L’intérêt est bien de financer des actions à grande échelle propres à soutenir la résilience climatique.
Comme en écho au dossier thématique sur les entreprises familiales (no 7 de cette revue), la contribution de Taïb Berrada, Badr Habba et Oumaima Quiddi apporte l’éclairage d’un contexte culturel où le fonctionnement clanique est prégnant, et où, plus qu’ailleurs encore, la dette est perçue comme une prise de contrôle de tiers sur les affaires. Avec la taille des structures, l’aversion à l’endettement qui caractérise entre autres les entreprises familiales a tendance à s’estomper, mais est-ce le cas dans les pays du MENA ? Après avoir recensé les facteurs susceptibles d’influencer le recours à l’endettement dans les entreprises familiales, les chercheurs comparent leur influence sur la population-cible avec celle exercée sur une population-témoin (entreprises non-familiales). Il ressort de l’étude que les grandes entreprises familiales du MENA ne s’alignent pas sur le comportement des entreprises non-familiales. Entre autres résultats, il apparaît que le caractère familial de l’entreprise ne constitue pas un signal favorable en termes de risque, et que les financeurs accordent plutôt de l’importance à la nature des actifs financés. L’endettement à court terme y est perçu comme un signal négatif, ce qui souligne en creux la réticence des grandes entreprises familiales à s’endetter. Au-delà des résultats de recherche de cet article, on perçoit comment les dirigeants et les financeurs de telles structures engendrent par leur méfiance réciproque des freins au développement du family business.
18À l’occasion de ce numéro, nous inaugurons une nouvelle section de la revue, intitulée « éclairage ». L’objet est de fournir une note ou une étude de cas propre à nourrir la réflexion et la praxéologie. Jean-Claude Thoenig y expose comment BSN, l’ancêtre de Danone, a mis au point un dispositif de réduction du temps de travail dès la fin des années 1970 sous l’impulsion de son dirigeant, qui était alors Antoine Riboud. Ce dernier s’était fait, contre l’avis de la plupart de ses pairs, le porte-parole d’une philosophie qui n’oppose pas croissance de la richesse et justice sociale. Une manière d’anticiper les exigences croissantes des salariés, éviter les mouvements de grèves massifs, et négocier des gains de productivité. La conjonction d’une initiative centrale et d’une mise en œuvre décentralisée dans les usines a assuré le succès de la démarche.
Trois recensions concluent ce numéro, consacrées respectivement à « pragmatisme et étude des organisations », de Philippe Lorino, « How Business Organizes Collectively » de Sandra Renou et Hervé Dumez, et « Le capitalisme sans rival » de Branko Milanovic.
Dans l’esprit de la revue Entreprise & Société, le dossier thématique du numéro 10 envisagera de dévisager les écrits de Frank Knight afin de comprendre pourquoi, aujourd’hui, un tel monument a été occulté par l’économie « mainstream » qu’il a contribué à fonder. Peut-être parce qu’en fin de compte, Frank Knight devrait inspirer la pensée critique…