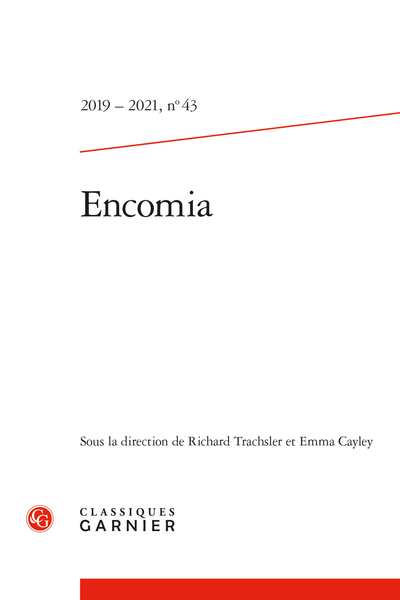
Images of Courtly Life in Fabliaux Disturbing Elements and Class Solidarity
- Publication type: Journal article
- Journal: Encomia
2019 – 2021, n° 43. varia - Author: Corbellari (Alain)
- Abstract: In the few fabliaux that are set in a curial environment, the latter is represented as a closed world that is tightly bound to its unity, since the very nature of the fabliau is to feature characters who are potentially destructive of social stability. Faced with disruptors such as Trubert, dissension ceases and the aristocratic world appears as a much more united community than it generally is. The troublemaker thus proves to be the ideal scapegoat for a society in need of reference points.
- Pages: 75 to 85
- Journal: Encomia
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406130949
- ISBN: 978-2-406-13094-9
- ISSN: 2430-8226
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13094-9.p.0075
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-24-2022
- Periodicity: Annual
- Language: French
- Keyword: fabliaux, social identity, court, scapegoat, Trubert
Images de la vie de cour
dans les fabliaux
Éléments perturbateurs et solidarité de classe
Que le milieu de prédilection où se déroulent les fabliaux ne soit pas la société de cour est un fait d’évidence, dont on ne doit cependant pas tirer des conclusions hâtives pour ranimer la vieille querelle sur l’esprit ‘bourgeois’ ou ‘courtois’ des contes à rire du Moyen Âge.1 S’il n’est pas majoritaire, le milieu curial y est en effet suffisamment présent pour que l’on puisse délimiter une sous-catégorie de fabliaux mettant en scène nobles et chevaliers, catégorie d’ailleurs explicitement privilégiée par Jean-Luc Leclanche dans les deux anthologies de fabliaux qu’il a publiées, respectivement intitulées Chevalerie et grivoiserie et Le Chevalier paillard.2 Parmi ces contes, on peut délimiter au moins trois groupes : ceux, d’abord, qui ne font intervenir que des personnes de haut rang et où l’humour est souvent plus raffiné que dans les fabliaux ordinaires : le ton du Chevalier qui recouvra l’amour de sa dame (NRCF 78), par exemple, n’est pas si différent qu’on pourrait le croire de celui de nouvelles courtoises comme Le Lai de l’ombre, et Le Chevalier qui fit parler les cons (NRCF 15) fait intervenir – fait exceptionnel dans le corpus fabliesque3 – des éléments de merveilleux, certes parodiques ; ceux, ensuite, qui se situent dans le milieu de la petite chevalerie, comme la version II des Tresses, où l’origine sociale des personnages est secondaire par rapport à l’intrigue, ou comme Bérengier au long cul, où le personnage du mari n’est chevalier que, si l’on ose dire, par effraction ; ceux, enfin, qui confrontent 76nobles et roturiers, et qui nous intéresseront essentiellement ici. Dans ces textes, la société de cour apparaît en effet comme un monde clos et crispé sur son unité, conscient de la menace que représente l’irruption d’éléments extérieurs incontrôlés dans leur univers protégé. Ils peuvent par là tout aussi bien servir la thèse du ‘burlesque courtois’, défendue par Nykrog, voulant que la noblesse constitue le principal public des fabliaux,4 que la thèse inverse faisant de l’irruption du trickster5 dans le monde policé de la cour le signe d’une origine essentiellement plébéienne de ces contes à rire.6 Plus intéressant me semble donc de dialectiser le rapport de force : les textes que j’aimerais aborder ici ne plaident pas davantage pour l’anarchie que pour le respect de l’ordre, ils décrivent un monde instable où chacun tire à hue et à dia pour sauvegarder ses prérogatives et dont la morale se révèle fondamentalement ambiguë.
On rappellera au surplus que, comme le disait Mario Roques à Jean Rychner, ‘il n’y a pas les fabliaux, il y des fabliaux’,7 ce qui fait naître le soupçon que la tripartition que je viens de proposer est sans doute elle-même trop rigide. Et de fait, dans deux fabliaux au moins, aux intrigues très proches (Guillaume au faucon, NRCF 93, et Celle qui fut foutue et defoutue pour une grue, NRCF 30a), la perturbation émane de personnages que les narrateurs prennent bien soin de rattacher au monde de la noblesse, dont l’unité se voit donc non plus contestée de l’extérieur, mais de l’intérieur. Le caractère apotropaïque de cette caractéristique est évident ; il s’agit de minimiser l’impact social des ruses des deux personnages de séducteurs intempestifs : Guillaume qui parvient à ses fins grâce aux équivoques que permet l’évocation de son faucon, et le chevalier à la grue qui jouit deux fois d’une jeune fille parce que celle-ci 77ignore le sens du mot ‘croistre’ (que J.-L. Leclanche traduit joliment par ‘tringlette’)8 sont deux jeunes gens de bonne famille rompus à l’art de tromper la vigilance des duègnes et sûrs que leur statut social leur vaudra l’indulgence de leurs pairs et, sans doute plus encore, des lecteurs. À la vérité, nous restons ici dans le cadre d’un libertinage très ‘ancien régime’ qui – soit dit en passant – nous fait comprendre l’engouement que le xviiie siècle développa pour ce type de fabliaux.9
Il en va tout autrement dans Trubert (NRCF 124) où le premier bon tour que joue le protagoniste est cependant extrêmement proche de celui du héros de Celle qui fut foutue et defoutue pour une grue, puisque c’est en échange d’une chèvre multicolore que Trubert obtient, lui aussi, un ‘croistre’ avec la duchesse. Mais les différences n’en sont pas moins frappantes : la duchesse n’est pas une pucelle naïve et elle ne se méprend guère sur les intentions de Trubert. (S’insinue ainsi l’idée que la ‘grue’, en l’occurrence, ce serait plutôt elle…) Surtout, Trubert est un vrai personnage du dehors, et tout l’épisode se déroule dans une atmosphère de cynisme aux limites de l’absurde fort éloignée du marivaudage ‘éducatif’ de Guillaume au faucon et même de Celle qui fut foutue et defoutue. Aussi dans ces deux derniers fabliaux n’insiste-t-on que sur la réaction de la vieille qui jure qu’elle fera meilleure garde la prochaine fois ; les autres membres de la cour restent indifférents à l’aventure qui vient de se dérouler, préférant fermer les yeux plutôt que de voir compromise l’unité de façade de leur univers.
Dans Trubert, au contraire, le protagoniste s’ingénie sciemment à défaire les liens curiaux. Ainsi déjà – quoique sur un mode encore très bénin – de l’épisode où il accuse la demoiselle assise à côté de lui du pet qu’il vient de lâcher, ou – épisode plus lourd de conséquences – du désordre qu’il cause dans le gynécée lorsqu’il est déguisé en femme. Malgré tout, ces actions ne perturbent pas longtemps le monde curial, et Trubert le sait fort bien, qui s’éclipse toujours très opportunément une fois ses méfaits accomplis. La réaction qui suit sa disparition est en effet 78immédiate : sitôt qu’il n’est plus là, les solidarités se recomposent aussi vite qu’elles avaient été ébranlées ; toute la cour se précipite autour du duc malmené dans la forêt, ou lui manifeste son soutien lors de la mort de son neveu, qui avait inconsidérément revêtu les habits de Trubert et, pris pour ce dernier, avait été pendu. Retrouver Trubert devient alors la préoccupation no 1 du duc. Et il faut un péril plus grand encore pour le faire renoncer à sa vengeance. De fait, le défi du roi Golias le détourne un moment de la pensée obsédante de Trubert. Le trickster lui-même en profite puisque aussitôt connu l’ordre de mobilisation générale décrété par le duc contre le roi Golias, Trubert se précipite à la cour sous un nouveau déguisement pour offrir ses services. Notons l’étonnant caméléonisme qui permet à Trubert de passer tour à tour pour un guerrier fort et accompli et, dans l’épisode suivant, pour une frêle jeune fille, censément sa propre sœur. Il y a là plus qu’un art consommé du déguisement, un véritable génie de la persuasion : il suffit que Trubert affirme une identité (charpentier, médecin, guerrier, pucelle) pour que ses interlocuteurs le croient, comme s’ils étaient hypnotisés par son aplomb. Mais en fait, cette propension en dit peut-être davantage sur les trompés que sur le trompeur : Trubert révèle à ses victimes leur propre désir d’être mystifiés. La première rencontre du héros avec le duc et la duchesse de Bourgogne dit en effet exemplairement à quel point son irruption était inconsciemment attendue : la chèvre multicolore que la duchesse puis le duc se précipitent tour à tour pour acheter comme s’ils en étaient amoureux (en mots d’aujourd’hui, on dirait qu’ils ont ‘flashé’ sur l’animal) nous fait comprendre, par contraste, à quel point la vie de cour est ennuyeuse et dépourvue de piquant. La deuxième rencontre du duc et de Trubert est basée sur le même mécanisme : Trubert se vante à la cantonade d’être le meilleur charpentier du monde, et aussitôt le duc décide de s’attacher ses services, prétendant avoir justement envie de se faire construire une maisonnette. Désir un peu curieux, si l’on y regarde de plus près : en quoi le locataire du plus beau château de la région aurait-il besoin d’une cabane de jardin ? Ici encore, Trubert a suscité un désir que sa victime n’aurait jamais eu s’il ne l’avait pas rencontré.10 La vie de cour, qui devrait se suffire à elle-même, révèle ici une incomplétude dont elle n’avait nulle conscience : l’irruption de l’élément étranger provoque automatiquement un désir d’assimilation 79qui a tout de la rivalité mimétique.11 Le duc, qui possède tout, ne peut supporter l’idée qu’un autre que lui jouisse de quelque chose dont il vient de découvrir l’existence, et dont la possession lui apparaît aussitôt impérieuse. Une fois la tromperie découverte, les choses ne peuvent cependant plus redevenir ce qu’elles étaient auparavant ; le caractère illusoire du gain espéré ne renvoie pas simplement au néant le désir suscité : celui-ci demeure, à titre de manque, et la vengeance, à travers la reformation de l’unité curiale, s’avère le seul palliatif à la frustration, car c’est en fin de compte moins le dommage subi que la perte de l’illusion qui provoque la colère du duc.
Regardons de plus près le moment où l’expédition punitive est enfin organisée : le narrateur a pris grand de soin de la placer à un moment où convergent plusieurs fils narratifs. On se souvient en effet que le défi de Golias était intervenu juste après l’exécution du neveu du duc, pris pour Trubert. La guerre contre Golias avait interrompu la reconnaissance du quiproquo et ce n’est, de fait, qu’une fois l’épisode guerrier clos et la fille du duc promise à Golias, que l’écuyer du neveu parvient enfin à la cour ducale pour annoncer que les hommes du duc de Bourgogne n’ont pas pendu la bonne personne. Le chagrin du seigneur est à la hauteur des chocs successifs qu’il a subis :
Mout est li sires adolez,
jamés si grant duel ne verrez
com li dus fet por son cosin.
Il jure que jamés de vin
ne bevra jusque tant qu’il ait
le glouton qui ce li a fet.12
Le mouvement de la douleur est significatif : le duc passe sans transition de la plus grande tristesse au désir de vengeance envers le coupable.13 Chevauchant plusieurs jours par monts et par vaux, il parvient avec ses hommes (dont il peut ici encore tester à la fois la patience et la fidélité) à la cahute de la mère de Trubert, mais c’est un dernier leurre que le duc en rapportera : Trubert lui-même, mais sous l’apparence de 80sa sœur. Notons en passant les quelques mots par lesquels le duc caractérise la prétendue jeune fille en la présentant à sa femme, à son retour :
ele ne set ne bien ne mal ;
onques mes ne fu entre gent. (vv. 2380–81)
Cette idée que seule la vie en société peut procurer la connaissance du bien et du mal confirme l’opposition diamétrale de Trubert et du milieu curial, mais dédouane aussi Trubert lui-même, qui, ‘homme sauvage’ par excellence, doit par conséquent également être exonéré du reproche d’avoir voulu ‘faire le mal’, soulevant par là le paradoxe avec lequel joue Douin de Lavesne tout au long de son récit : Trubert est-il un simplet inconscient de ses nuisances ou un véritable génie du mal ? C’est, au fond, on le sait, toujours là la double et inextricable nature du trickster.14
L’ironie de la capture de la ‘sœur’ est que, alors même qu’il croit n’avoir pris qu’un succédané de sa proie, c’est bien celle-ci que le duc détient, mais de telle manière qu’elle lui échappera encore, au moment précis où il croira avoir fait une bonne affaire en substituant sa captive à sa propre fille. Il y a là double jeu de dupes où le duc, lui-même trompé, croit de bonne foi avoir évité le pire à sa fille en jouant un bon tour à Golias. Mais le fait est qu’en réalité, et tout à l’inverse de son vœu, le duc a exposé sa fille à une disgrâce plus grave encore que s’il en avait fait l’épouse de Golias, puisqu’elle sera engrossée par Trubert ! La probable incomplétude du manuscrit nous laisse d’ailleurs dans l’ignorance de sa réaction finale, mais il est aussi possible que celle-ci ait été laissée délibérément en suspens. On ne peut certes pas exclure que la fin du manuscrit soit accidentelle et que le récit ait pu revenir finalement sur un duc comprenant la dernière mystification dont il a été victime, mais, telle quelle, la fin curieusement abrupte de Trubert s’avère plus excitante pour l’esprit du lecteur moderne : ayant réussi à mettre à sa place dans le lit de Golias la suivante qui l’accompagnait, et donc à rétablir un équilibre dans le milieu curial, puisque sa tromperie 81compensera jusqu’à un certain point celle fomentée par le duc, le héros semble alors disparaître dans le néant. Et l’on est fortement tenté de se dire que cette façon de terminer son récit en queue de poisson était peut-être, pour Douin de Lavesne, la seule façon de clore une histoire qui, à travers l’escalade des mauvais tours, n’avait aucune raison de s’arrêter. On le sait : seule l’auto-immolation du bouc-émissaire (donc, pour Girard, la crucifixion du Christ)15 permet de mettre fin au cycle de la violence mimétique. J’en reviens ainsi, par une voie détournée, à la caractérisation ‘antéchristique’ de Trubert que j’avais proposée dans une précédente publication.16
Trubert n’est pas le seul fabliau ou le monde curial est investi par un imposteur, mais il est celui dans lequel l’antagonisme des deux mondes est le plus éclatant. À un degré moindre, Le Vilain mire (NRCF 13) illustre aussi cette dialectique, en la neutralisant partiellement, d’entrée de jeu, par le fait que, comme dans Bérengier au long cul, le héros a épousé la fille d’un chevalier. Il se montre cependant tout aussi peu digne de cet honneur, car il bat sa femme, et l’on peut dire que sa promotion comme ‘médecin malgré lui’ lui donnera l’occasion de réussir une entrée dans le milieu curial que son comportement avec son épouse semblait avoir irrémédiablement compromise. Contrairement à Trubert, d’ailleurs, le héros du Vilain mire ne vient pas à la cour de son plein gré, mais il comprend vite que ce n’est qu’en acceptant le rôle de médecin qu’on lui impose qu’il trouvera son salut,17 l’ironie voulant précisément que le stratagème de sa femme pour se débarrasser de lui aboutisse exactement à l’inverse de ce qu’elle souhaitait : voulant le punir et l’embarrasser en le prétendant médecin, elle permet tout au contraire son élévation sociale. De fait, plus notre héros montre d’aplomb dans l’exercice de son art prétendu, plus ses victimes s’empressent de lui donner leur aval. On retrouve ici la logique perverse de Trubert : le roi lui déclare même, avec un double jeu de mots, qu’il en fera son ‘mestre [en médecine] et 82saigneur [pour lui administrer des saignées]’.18 De peur de voir dévoilée la précarité de sa propre cohésion, la cour se soumet donc aveuglément aux ordonnances du faux médecin. Mais celui-ci, bon prince, si l’on ose dire (et au contraire de Trubert), ne profitera pas de la situation pour nuire à ses protecteurs ; tout au plus parviendra-t-il à se soustraire à ses obligations par un stratagème qui renforcera encore sa réputation dans la mesure même où il n’en usera pas : prétendant sacrifier le plus malade de ses patients pour guérir les autres, il verra simplement se disperser la cohorte des éclopés, personne ne voulant risquer sa peau en se vantant d’être le plus malade.19
Le roi le récompense richement, tout comme le duc avait couvert Trubert de présents :
Assez avrez dras et derniers
et palefroiz et biax somiers (vv. 363–64)
Mais le mire réclame seulement le droit de retourner chez lui. Il y retrouve son épouse avec qui il vivra désormais en excellente intelligence, bien conscient de ce qu’il lui doit, comme le disent les derniers vers du fabliau :
par sa feme et par sa voidie
fu il bons mire sans clergie. (vv. 377–78)
Le récit se termine donc sans drame ni déchirement : à l’inverse du mari de Bérengier au long cul (NRCF 34), le faux médecin a réussi à dompter son épouse et, contrairement à Trubert, son naturel pacifique (et, il faut bien le dire, parfaitement opportuniste) le préserve de la fuite en avant à laquelle le héros de Douin de Lavesne se voyait poussé par son démon intérieur.
Je prendrai pour conclure l’exemple d’un fabliau qui ne se déroule pas exactement dans un milieu curial, mais qui en dessine la parodie. 83Je veux parler de Boivin de Provins (NRCF 7), dont le héros éponyme parie avec lui-même qu’il parviendra à profiter de l’hospitalité d’un bordel sans bourse délier.20 Appâtant la maquerelle Mabille à travers un monologue destiné à lui faire croire qu’il est riche, il se fait choyer par la tenancière qui lui prodigue un bon repas et lui réserve les faveurs de sa meilleure employée, Ysane. Après avoir joui du repas comme de la fille, Boivin crie qu’on lui a subtilisé une bourse qu’il n’a en réalité jamais eue et, profitant du remue-ménage occasionné (puisque la maquerelle est persuadée qu’Ysane a voulu lui soustraire ses gains), s’éclipse pour aller raconter son bon tour au prévôt de la ville.21 Ce fabliau est, avec Richeut, l’un des rares à nous faire voir la vie interne d’une maison close, dont on comprend vite, sans grande surprise, qu’elle fonctionne à la manière d’une cour miniature, dont tous les membres sont tenus par des liens de hiérarchie et de solidarité. Or, ce que nous montre parfaitement le récit de Boivin de Provins, c’est que, unie pour plumer le pigeon, cette micro-société voit se désagréger le vernis de sa cohésion dès que l’un des membres est soupçonné de vouloir faire cavalier seul pour s’approprier indûment un profit qui devrait alimenter la caisse commune. La bataille qui conclut le fabliau, digne des scènes les plus débridées du cinéma burlesque, illustre, comme dans d’autres fabliaux qui se déroulent à la cour, la vérité anarchique d’un monde impuissant à cacher longtemps le manque de solidarité qui le mine de l’intérieur. Tant que Mabille, ses sbires et ses employées pouvaient croire avoir circonvenu Boivin, l’entente était parfaite, mais notre héros une fois disparu sans avoir payé, c’est à qui criera ou tapera le plus fort pour faire valoir son droit bafoué. On pourrait s’étonner, au demeurant, que le bordel de Mabille ne se mette pas, pour retrouver son unité, en quête du fripon, comme dans Trubert, où le projet de retrouver le mauvais plaisant garantit justement, au moins pour un temps, la solidarité du monde curial. Mais la ville n’est pas la cour : hors de son château, mais à l’intérieur de son fief, le duc de Bourgogne reste le maître. En milieu urbain, par contre, le pouvoir de la mère maquerelle s’arrête sur le seuil de sa maison close : au-delà, 84c’est l’anonymat d’un espace qui appartient à tous et à personne,22 le dédale des rues offrant à Boivin la meilleure protection contre ceux qu’il a grugés, au point que la personne à qui il choisit de raconter son histoire, pour le prix, une fois encore, d’un bon repas (mais ici le marché est honnête), n’est autre que le chef de la police urbaine.
La thèse que j’ai tenté d’illustrer ici à travers divers cas de figures ne devrait pas surprendre. Magistralement déployée par René Girard, mais assez rarement appliquée au fabliau,23 la logique du bouc émissaire s’avère ainsi une clé de compréhension aussi commode qu’efficace des liens qui unissent le trickster et les groupes sociaux plus ou moins fortement structurés auxquels il s’oppose. Au-delà des logiques de tromperie souvent pratiquées d’individu à individu (songeons aux prêtres inhospitaliers du Boucher d’Abbeville [NRCF 18] ou du Prêtre et le Chevalier [NRCF 103], ou encore aux innombrables cocus des fabliaux), il arrive que le fripon s’attaque à des groupe plus complexes : or, qu’il s’agisse de la micro-société des Trois aveugles de Compiègne (NRCF 9) qui, dans le fabliau éponyme, se battent comme des chiffonniers pour une pièce de monnaie inexistante ou des cours raffinées mises en scène dans Trubert ou Le Chevalier qui fit parler les cons, en passant par la ‘cour’ parodique de la maquerelle Mabille, la morale est presque toujours la même : il n’est pas de groupe humain, aussi soudé soit-il, qui ne puisse longtemps résister à l’action diffractrice d’un trickster venu du dehors, sauf à voir celui-ci se neutraliser lui-même comme dans le demi contre-exemple du Vilain mire. Plus cyniques que Goscinny qui, dans une fameuse aventure d’Astérix, montrait les stratagèmes du semeur de zizanie se retournant contre lui,24 les auteurs de fabliaux n’abandonnent jamais leurs héros aux griffes de ceux qu’ils roulent dans la farine. Modèle par excellence de 85société médiévale organisée, la cour ne sort donc jamais grandie de ces récits qui, dans la logique de leur poétique anti-idéaliste,25 se délectent à dévoiler les mesquineries et les jalousies d’un milieu sur lequel la littérature satirique ne s’acharnera que plus tard. C’est en effet surtout aux xive et xve siècles que la satire anti-curiale fleurira.26 Mais à cette époque le fabliau aura déjà disparu.
Alain Corbellari
Universités de Lausanne
et de Neuchâtel
Alain.Corbellari@unil.ch
1 Débat bien résumé par Philippe Ménard, Les Fabliaux, contes à rire du Moyen Âge (Paris: PUF, 1983), p. 102. Comme à son habitude, l’auteur y adopte une position moyenne de conciliation.
2 Chevalerie et grivoiserie, Fabliaux de Chevalerie, ed. by Jean-Luc Leclanche (Paris: Champion, 2003), et Le Chevalier paillard. Quinze fabliaux libertins de chevalerie, ed. by Jean-Luc Leclanche (Arles: Actes Sud, 2008).
3 Il y a certes aussi Le Souhait desvez (NRCF 70) où le merveilleux n’est, identiquement, qu’un prétexte à obscénité.
4 Voir Per Nykrog, Les Fabliaux (Copenhague et Genève: Droz, 1957; repr. Genève: Droz, 1973), p. 104.
5 Sur la notion de trickster, voir P. Radin, Carl Gustav Jung, Charles Kerenyi, Le Fripon divin (Genève: Georg, 1993), Mehdi Belhaij Kacem, Théorie du trickster (Paris: Sens et Tonka, 2002), et sur son application à Trubert, Massimo Bonafin, ‘La Parodia e il briccone divino. Modelli letterari e modelli antropologici del Trubert di Douin de Lavesne’, L’Immagine riflessa. Rivista di sociologia dei testi, 5 (1982), 237–72 et Carlo Dona, Trubert, o la carriera di un furfante: genesi e forme di un antiromanzo medievale (Parma: Pratiche, 1994).
6 Thèse dont Bédier est loin d’être l’inventeur, puisqu’elle se situe dans le prolongement de l’exaltation romantique du génie populaire, exaltation que Bédier combat comme on le sait, mais qu’en l’occurrence il n’infléchit qu’à peine en postulant au genre une origine ‘bourgeoise’ (J. Bédier, Les Fabliaux, Paris: Champion, 1895), p. 371.
7 Jean Rychner, La Narration des sentiments, des pensées et des discours dans quelques œuvres des xiie et xiiie siècles (Genève: Droz, 1990), p. 8.
8 Le Chevalier paillard, ed. by Jean-Luc Leclanche, p. 293.
9 Je dis ce type de fabliaux, plutôt que les fabliaux en général car les éditions du xviiie siècle montrent bien que les plus appréciés de ces contes étaient ceux dont le vernis de courtoisie était le plus grand. On allait alors jusqu’à compter des textes comme Le Vair palefroi parmi les fabliaux. Voir à ce sujet la thèse de Fanny Maillet, sous la direction de Joëlle Ducos et Richard Trachsler, Extraire la littérature médiévale: du fonds de l’Arsenal à la Bibliothèque universelle des romans, Paris 4, 2016.
10 Voir René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque (Paris: Grasset, 1961).
11 Voir René Girard, La Violence et le sacré (Paris: Grasset, 1972).
12 Douin de Lavesne, Trubert, ed. by Guy Raynaud de Lage, pres. and trans. Alain Corbellari (Genève: Droz, 2018), vv. 2197–202.
13 On reconnaît au demeurant bien là la société dans laquelle les mots ire et courroux désignent simultanément le chagrin et la colère.
14 Sur Trubert homme sauvage, voir Pierre-Yves Badel, Le Sauvage et le sot. Le fabliau de Trubert et la tradition orale (Paris: Champion, 1979). Rappelons que le Moyen Âge ne connaît pas de ‘bon sauvage’, et pas davantage de ‘mauvais’; pour lui, l’homme sauvage est d’abord l’indifférencié. Perceval, dont Trubert est le double monstrueux, n’est tout simplement rien avant sa rencontre avec les chevaliers.
15 Voir René Girard, Le Bouc émissaire (Paris: Grasset, 1982).
16 Voir mon article, ‘Trubert antéchrist’, in Figures de l’Oubli, ed. by Patrizia Romagnoli and Barbara Wahlen, Études de Lettres, 1–2 (2007), 161–77, repris dans Des fabliaux et des hommes. Narration brève et matérialisme au Moyen Âge (Genève: Droz, 2015), pp. 121–35.
17 Je me permets de renvoyer à la distinction que je fais, dans mon introduction à Deux contes à rire médiévaux. ‘Le Boucher d’Abbeville’, suivi de ‘Trubert’, ed. by Jean Rychner and Guy Raynaud de Lage, pres. and trans. by Alain Corbellari (Genève: Droz, 2018), p. xv, entre le trickster ‘ontologique’ et le fripon ‘d’occasion’.
18 ‘Le Mire de Brai’, in Fabliaux français du Moyen Âge, vol. 1, ed. by Philippe Ménard (Genève: Droz, 1979), v. 280.
19 On retrouve cet épisode dans Amis le Prêtre du Stricker (mais pas chez Molière !), où il est replacé dans une série d’escroqueries où la propension du trickster à la nuisance reprend ses droits: voir Le Stricker, Amis le Prêtre (Der Pfaffe Amis). Roman du xiiie siècle, pres. and trans. by Marianne Derron Corbellari et Alain Corbellari (Amiens: Presses du Centre d’études médiévales, Université de Picardie – Jules Verne, 2005), pp. 70–71.
20 Voir mon article ‘Boivin de Provins ou le triomphe du monologue’, Vox Romanica, 49–50 (1990/1991), 284–96, repris dans Des fabliaux et des hommes, pp. 105–20, où je propose de lire l’expression ‘faire le fabliau’ dans le double sens de ‘jouer un bon tour’ et ‘écrire une histoire comique’, puisque Boivin apparaît à la fin du récit comme le narrateur même de sa propre aventure.
21 Voir l’article de Michel Zink, ‘Boivin auteur et personnage’, Littératures, 6 (1982), 7–13.
22 Voir le poème anonyme intitulé ‘Les Rues de Paris, en vers’, inspiré du dit du même nom par Guillot de Paris, in Paris sous Philippe-le-Bel, d’après des documents originaux, et notamment d’après un manuscrit contenant le rôle de la taille imposée sur les habitants de Paris en 1292, publié pour la première fois par H. Géraud (Paris: Crapelet, Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Première série: Histoire politique, 1837), pp. 567–79, dont le héros cherche vainement sa femme dans la ville, en énumérant toutes les rues où il ne la trouve pas.
23 On lira tout de même Denis Billotte, ‘L’Unité de Trubert: le sens d’une série’, Reinardus, 1 (1988), 22–29.
24 Voir René Goscinny et Albert Uderzo, La Zizanie (Paris: Dargaud, 1970). Bien que stipendié par César, Tullius Detritus laisse librement s’exprimer un plaisir de nuire tout personnel qui est la marque du vrai trickster.
25 Voir mon ouvrage Des fabliaux et des hommes, pp. 17–18.
26 Voir J. Blanchard et J.-Cl. Mühlethaler, Écriture et pouvoir à l’aube des temps modernes (Paris: PUF, 2002), en part. pp. 59–83.