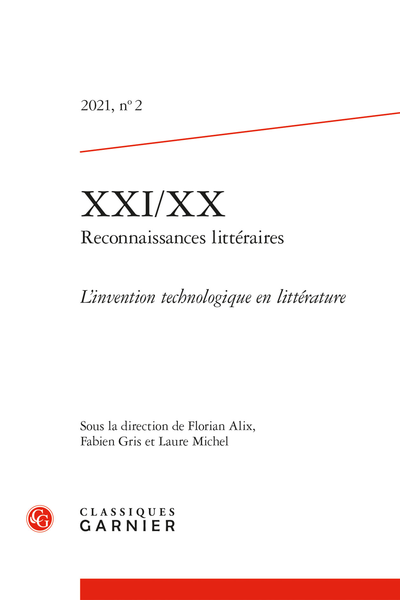
L’invention technologique en littérature, d’aujourd’hui à hier
- Type de publication : Article de revue
- Revue : XXI/XX – Reconnaissances littéraires
2021, n° 2. L’invention technologique en littérature - Pages : 11 à 14
- Revue : XXI/XX – Reconnaissances littéraires
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406123637
- ISBN : 978-2-406-12363-7
- ISSN : 2740-7713
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12363-7.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/10/2021
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
L’invention technologique
en littérature, d’aujourd’hui à hier
« Siècle de la vitesse », ironisait Bardamu au début de Voyage au bout de la nuit. L’élan s’est poursuivi, les moyens de transports et de communication ne cessant de se développer au long du xxe siècle, pour culminer avec la révolution numérique, qui configure très fortement nos vies et nos imaginaires au xxie siècle. Ces bouleversements ont-ils été immédiatement perçus, représentés, pensés par les écrivains ? En quoi ont-ils affecté les conditions d’écriture, ou même la poétique, de la littérature depuis plus d’un siècle ? Ce numéro de XXI/XX – Reconnaissances littéraires se propose d’interroger les différents rapports à l’imaginaire technologique, tel qu’on peut le percevoir à partir des études littéraires1. Cet imaginaire se constitue dans une relation souvent complexe, de curiosité, voire de fascination, ou à l’inverse de distance critique, mais témoigne dans tous les cas de l’intérêt porté par la littérature aux espoirs et aux craintes que les technologies représentent pour les sociétés de leur temps2. Les machines permettent de réduire les distances, augmentent 12les capacités physiques et intellectuelles des hommes et des femmes qui les utilisent. En même temps, ce développement n’est pas sans susciter des réticences : ce qui aide peut aussi asservir, menacer la vie autant que la rendre plus simple. In fine, c’est toute une manière de penser le monde qui est à refonder. Cet imaginaire n’est toutefois pas seulement le reflet des préoccupations d’une époque. Il résulte aussi directement de l’impact des évolutions technologiques sur la littérature elle-même, autrement dit, des interactions concrètes entre outils technologiques, modalités de diffusion des œuvres, et pratiques d’écriture. Outre l’effet du numérique, dont les potentialités continuent de se déployer, songeons aux rapports d’interfécondité de la littérature et des autres médias : relations de la littérature à la photographie et au cinéma dès le début du xxe siècle, à la radio, puis à l’audiovisuel à partir de l’après-guerre et dans les années 1960, avènement du support vidéo puis informatique à la fin du siècle, déploiement de l’Internet et de l’intelligence artificielle aujourd’hui. La littérature s’est appropriée les nouveautés technologiques et les a mises au service de sa création, autant qu’elle les a détournées en leur inventant de nouveaux usages. Ce numéro propose un aperçu de cette interaction, telle qu’elle s’est constituée depuis plus d’un siècle.
Tout d’abord, la machine devient un instrument qui sert à saisir un état de la société, des tensions qui la traversent, l’imaginaire qui la travaille. Corinne Grenouillet parcourt ainsi les xxe et xxie siècles en s’interrogeant sur la relative rareté des machines dans les récits portant sur le travail en usine, dans des œuvres où la technologie est plus souvent perçue comme déshumanisante. Plus que des interrogations sur les technologies usinières, ce sont les perceptions et sensations des travailleurs qui sont mises en avant, à quelques exceptions près (François Bon). Joël Loehr observe que la bicyclette apparaît sous la plume de différents romanciers (Zola, Queneau, Proust, Pieyre de Mandiargues, Echenoz) comme un ambivalent instrument d’émancipation féminine, dont la puissance repose sur des formes de transgression. Simon Bréan, à travers une étude de la dynamique des personnages, met au jour la manière dont les romans conjecturaux français permettent la mise en tension entre « fantasme de puissance » et « fantasme de souffrance », reflet dans la fiction des désirs et des peurs de l’humain face à une 13création qui, pour le meilleur et/ou pour le pire, le dépasse. Laurence Dahan Gaida s’intéresse à Galatea 2.2 de Richard Powers en montrant que le texte va au-delà de la logique de la représentation de l’intelligence artificielle pour interroger la nature même de l’acte de penser.
Les contributions suivantes considèrent les technologies de communication. Alors que le texte littéraire repose lui-même sur des techniques spécifiques et même une industrie, l’imprimerie, il s’interroge et il met en question, au moins depuis les Illusions perdues de Balzac, ses conditions de production matérielle. La prodigieuse diversification des moyens de communication moderne n’a fait qu’amplifier l’attitude de questionnement, voire de suspicion de celles et ceux qui écrivent, envers ce qui permet de diffuser leurs écrits. Maxime Morin revient ainsi sur le regard de Bernanos et Baudoin de Bodinat sur la radio, en tant que média contribuant à l’avènement de la culture de masse, qui pourtant a aussi des répercussions sur la forme même de leur écriture. Thomas Carrier-Lafleur montre comment le travail sur les médias nourrit le projet de Houellebecq de dire le social, en interrogeant le processus de médiatisation voire de médiation en lui-même. Ninon Chavoz observe la manière dont l’écran, de cinéma chez Blick Bassy et de smartphone chez Mohamed Mbougar Sarr, devient un enjeu important de la progression romanesque. En permettant l’évolution des personnages dans les intrigues, le motif des écrans sert la visée critique des écrivains sur les médias contemporains, dans des récits qui cependant demeurent assez peu perméables à l’influence de ces autres moyens de communication. Clément Sigalas montre, à l’inverse, comment Aurélien Bellanger et Pierre Ducrozet travaillent la trame de leur roman pour y intégrer la notion de réseau comme un élément de construction narrative et non pas uniquement comme une thématique des œuvres.
Enfin, il s’agit de réfléchir à la manière dont la technologie vient modifier la manière même d’écrire et la conception que l’on peut avoir de la littérature. Céline Pardo propose ainsi d’intégrer le travail de Franck Venaille sur France Culture à sa production littéraire, en réfléchissant à la manière dont l’écriture radiophonique lui ouvre un véritable espace d’expérimentation et renouvelle sa relation à son lecteur. Gaëlle Théval montre que les usages de technologies de communication dans les poésies expérimentales reposent parfois sur une non-maîtrise de l’outil qui, loin d’être maladresse, constitue la poéticité même du geste créateur et une 14critique des dominations médiatiques sur le corps et le vivant. Gaëlle Debeaux propose un bilan sur la pratique de l’hypertexte de fiction, qui semble s’épuiser dans les années 2000 après avoir été perçue comme la voie d’un renouvellement des formes. Sa théorisation demeure toutefois à construire, afin de mettre en perspective les théories de la fiction. Enfin, Servanne Monjour et Nicolas Sauret abordent des productions littéraires produites selon le protocole GIT en réfléchissant à la manière dont leur caractère intermédial, associant des procédés linguistiques et du code informatique, modifie en profondeur la notion d’auctorialité et, au-delà, la valeur et le rôle du texte littéraire.
En conclusion, un entretien avec Emmanuelle Pireyre mené par Estelle Mouton-Rovira et présenté par Danielle Perrot-Corpet permet de voir comment plusieurs questions abordées dans les articles du volume animent le processus d’écriture de l’autrice, nourrissent les questionnements qu’elle adresse au réel et au social, tout en lui fournissant des outils pour la construction fictionnelle.
1 Avec l’adjectif « technologique » nous renvoyons non pas à la technologie comme science des techniques mais à l’autre usage courant du terme : la technologie comme ensemble de techniques. Nous donnons à ces dernières le sens usuel d’applications de la science dans des réalisations pratiques, impliquant le plus souvent l’usage de machines.
2 Isabelle Krzywkowski, dans un livre pionnier, Machines à écrire. Littérature et technologies du xixe au xxie siècle (Grenoble, ELLUG, 2010) a bien montré que, contrairement aux idées reçues, la littérature s’est toujours intéressée de près aux technologies. Parmi les ouvrages qui témoignent de l’intérêt croissant des études littéraires pour cette question, voir Jean Bessière et Hans-George Ruprecht (dir.), Littérature et technologie, Paris, Les Belles Lettres, 1993 ; Nadja Cohen, Les Poètes modernes et le cinéma, 1910-1930, Paris, Classiques Garnier, 2014 ; Elaine Despres et Hélène Machinal (dir.), PostHumains. Frontières, évolutions, hybridité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014 ; Céline Pardo, La Poésie hors du livre, 1945-1965 : le poème à l’ère de la radio et du disque, Paris, PUPS, 2015 ; Roxanna Nydia Curto, Inter-techs. Colonialism and the question of technology in Francophone literature, Charlottesville, University of Virginia Press, 2016 ; Anne Reverseau, Le Sens de la vue. Le regard photographique dans la poésie moderne, Paris, Sorbonne Université Presses, 2018 ; Fabian Kröger et Marina Maestrutti (dir.), Les Imaginaires et les techniques, Paris, Mines Paris-Tech PSL, 2018 ; Magali Nachtergael, Poet against the machine. Une histoire technopolitique de la littérature, Marseille, Le mot et le reste, 2020.