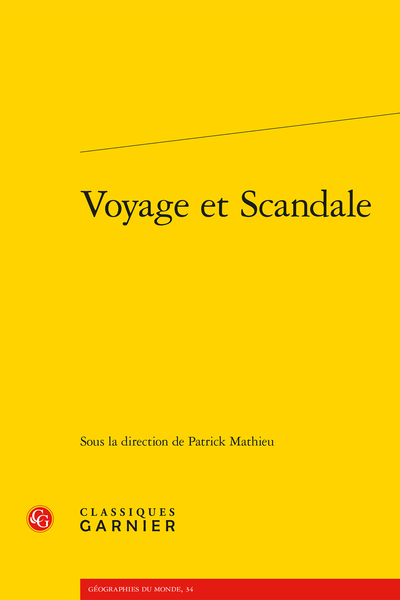
Avant-propos Études viatiques aujourd’hui
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Voyage et Scandale
- Author: Mathieu (Patrick)
- Pages: 7 to 17
- Collection: World Geographies, n° 34
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406126850
- ISBN: 978-2-406-12685-0
- ISSN: 1775-3503
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12685-0.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-20-2022
- Language: French
Avant-propos
Études viatiques aujourd’hui
À l’heure où les études viatiques s’emportent par monts et par vaux, il n’est guère plus question de la dignité du genre, qui a gagné depuis belle lurette ses quartiers de noblesse. Considéré comme de basse extraction par certains jusqu’aux années 1990, le récit de voyage s’est hissé sur l’un des sommets de la littérature, tantôt chevauchant sa Rossinante, tantôt cheminant avec son bâton de pèlerin et sa besace, jusqu’à devenir un incontournable de la littérature, même académique ; c’est parmi tant d’autres, l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, de Chateaubriand ou encore L’Usage du monde de Bouvier qui sont mis à l’Agrégation de Lettres. Les exemples sont légion de la nouvelle dignité du genre : les œuvres s’étudient aussi bien séparément que comme un adjuvant obligatoire à l’approche critique biographique : s’il n’est pas nécessaire de lire Par les champs et par les grèves de Du Camp et Flaubert pour comprendre Madame Bovary, il est en revanche indispensable de le lire pour comprendre comment Flaubert conçoit l’écriture, comment il perçoit le monde qui l’entoure.
Le champ d’étude de la littérature viatique s’est considérablement élargi depuis ses débuts, englobant désormais les récits de fiction, les voyages immobiles, les déplacements scientifiques ou poétiques, englobant aussi des approches novatrices, comme celles des carnets de voyages avec croquis, des récits photographiques, de blogs en période de confinement, au risque de frôler l’éclatement : y aura-t-il un moment où le récit de voyage ne pourra plus être conceptualisé et théorisé de façon univoque ? Mais c’est là un autre débat… Pour l’heure, nous constatons que le genre critique se porte gaillardement, et de façon inversement proportionnelle au resserrement du monde, à son étroitesse toujours plus symbolique. D’ailleurs, ne voit-on pas fleurir au milieu des parterres d’humanités numériques, de l’écopoétique ? L’accent est désormais mis sur la géographisation, la spatialisation du monde littéraire qui franchit 8de nouvelles frontières. La littérature française devenant de plus en plus francophone, les textes viatiques, ouverts par définition sur l’autre et l’ailleurs, ont des choses à nous dire, là aussi de façon proportionnellement inverse au déclin de l’ethnologique ou du sociologique, voire du civilisationnel. Contextualisés par un monde toujours plus changeant, ils sont évidemment forcés de se réinventer, de se récrire : la question de la poétique du voyage, de la fabrique de l’écriture, de celle de l’écrivain est donc toujours autant d’actualité qu’à ses débuts1.
Pourquoi le scandale ?
On a trop longtemps associé le voyage, réel ou fictionnel, au progrès, par les découvertes scientifiques, culturelles religieuses… Ainsi, il permettrait le décentrement, la découverte de l’Autre, la mise en perspective des cultures et religions : Homère, Apulée, Montaigne, Voltaire ou l’abbé Barthélémy ont fait école.
C’est ainsi que tout un pan de la littérature critique viatique a considéré que le voyage, en quelque sorte, et si j’ose dire, allait de soi, et qu’il ne pouvait être que bénéfique2. S’il est vrai que certains voyagent pour se soigner (Montaigne), pour retrouver le calme, voire l’inspiration, d’autres pour remonter aux sources culturelles (mais est-ce encore le cas en ce xxie siècle ?), n’envisager les déplacements, militaires, commerciaux, touristiques que sous l’angle des bienfaits revient à omettre une réalité subjective du voyage, le voyage négatif, impossible, inracontable, scandaleux. C’est aussi passer outre une partie historique du voyage, par le simple et premier fait, déjà, que le scandale a toujours existé et se revisite constamment… Par exemple, avant ou derrière le Grand 9Tour (en lui-même moralement scandaleux3, n’y a-t-il pas déjà parfois l’ombre d’un scandale familial, ou au contraire le désir du scandale ? Ainsi, Flaubert et Maxime Du Camp, qui n’en sont pas à leurs premières frasques, embarquant pour l’Orient, entendent bien se livrer à des facéties exotiques tout bonnement scandaleuses…
Le livre qui suit est donc l’occasion de changer notre façon de voir, et d’envisager le voyage sous l’angle du choc (cette surprise indignée devant une personne ou une œuvre non conformiste), choc individuel ou collectif. Le choc est aussi littéraire à savoir qu’il passe par la médiation, la saisie et la transformation dans un double mouvement : du scandale à l’écriture du scandale, et de l’écriture au scandale. Entre ces deux points, toute la tentative et toute la dérivation artistique.
Il nous faut donc, pour une fois, emprunter les chemins scabreux difficilement accessibles, jalonnés de difficultés qui incitent à trébucher, sur le chemin de la foi, de la morale et de la raison, des convenances et de l’éducation. Voyons comment le voyage met l’individu hors de lui, révèle une part innommable : il se sent libéré de ses chaînes et est tenté par le plongeon dans l’Inconnu, le grand mal.
Mais qui sont ces scandaleux ?
Qui sont donc ces écrivains-voyageurs qui créent autour d’eux une aura sulfureuse, que la renommée précède en faisant frissonner le public d’incompréhension, d’inquiétude ou de réprobation ? Quels sont ceux qui, grâce au scandale de leurs écrits ou de leurs actes ont permis la transformation d’un monde figé, ou au contraire, sont restés scandaleusement incompris ? Que rapportent ceux qui se font les échotiers des chroniques de cours étrangères scandaleuses ?
Les libertins, Don Juan et Casanova en tête, voyagent et séduisent, dans l’accumulation des conquêtes et des souffrances, les leurs ou celles des conquises, comme preuves insatiables de l’existence, au grand dam 10de la Morale, mais aussi des bonheurs individuels. Sade fait deux voyages en Italie (et deux récits) avant de produire cette œuvre scandaleuse qu’est Juliette : le scandale est-il dans une civilisation italienne décadente ou dans l’expansion incontrôlée des instincts naturels ? L’Italie est bien « le territoire du désir anglo-saxon » (Yves Clavaron). Mais en France, des intellectuels du début du siècle (Gide, Montherlant…) profitent de l’« exotisme » du Maghreb pour assouvir leurs penchants sexuels réprimés en Europe sans que personne ne se récrie : la chaleur, la couleur exotiques recouvrent pudiquement les scandales viatiques. Un peu avant, Freud voyageait en Italie pour tenter de définir cet indicible scandaleux qu’est l’inconscient… Gauguin fatigué raconte dans Noa Noa comment il découvre Tahiti, y prend femme de treize ans et revit. Jean-Jacques Bouchard visite l’Italie en hérétique et homosexuel et laisse dans ses Confessions un « amas de raffinements d’obscénités ». James Joyce dans Ulysses fait, lui, scandale en 1922 avec une journée de l’errance sexuelle d’un homme chaste attendant sa Pénélope. Les figures mythiques et les parodies mythologiques sont convoquées pour dire le scandale de la guerre chez Claude Simon, par la puissance écrasante de la matière, son autonomie, sa putréfaction (La Route des Flandres, L’Acacia). Mais avec Céline, la farce, l’humour s’invitent dans le Voyage pour dénoncer la folie humaine (voyages sur L’Amiral Bragueton, L’Infanta Combitta et le San Tapeta – tout un programme sexuel), ou le scandale de l’injustice permanente dans Mort à crédit (exemple des torgnoles et du tricar, ou du vomissement collectif lors du voyage en Angleterre), scènes qui écœurent et font rire tout à la fois. Sur un mode plus poétique, Jules Romains (Les Copains) raconte, au cours d’un voyage à bicyclette, la scandaleuse atteinte aux bonnes mœurs organisée par une bande d’amis dans deux malheureuses sous-préfectures du Puy-de-Dôme. Plus récemment, Michel Houellebecq alimente la chronique des scandales médiatiques d’œuvres désenchantées, comme Lanzarote et Plateforme, par le traitement de sujets scandaleux (la pédophilie, le tourisme sexuel) ainsi que par la confusion de sa posture d’écrivain qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Céline… Ainsi, nombreux et variés sont les scandaleux, comme nombreuses sont les formes que peut revêtir le scandale.
11Le scandale, une heuristique
Vers de nouveaux codes, de nouveaux espaces
Intégrer le scandale au voyage permet donc d’en régénérer l’approche viatique en donnant la parole aux textes de la frontière, frontières du genre, frontière de la littérature, frontières morales. Y aurait-il, comme dans l’Ouest américain, des textes pionniers qui franchissent la frontier, qui défrichent de nouveaux horizons ?
La littérature viatique critique est habituée des stéréotypes obligatoires : l’écrivain-voyageur, humain trop humain, emporte avec lui sa provision d’idées préconçues dont il ne parvient pas facilement à toujours se défaire. La thématique du scandale qui parcourt ce recueil balaie d’office les stéréotypes ; y a-t-il un stéréotype du scandale ? Le scandale, toujours contextualisé et lié à une problématique de la réception, est par définition, inattendu, hors norme. Réchauffé, il prend un autre goût, celui de l’indécence, au pire de la bêtise. Peut-on d’ailleurs concevoir a priori un autre et un ailleurs scandaleux, outre celui de la fiction ? Peut-on se concevoir soi-même scandaleux dans un ailleurs parfaitement normé ? Indubitablement, le scandale est nouveau, soudain, et semelfactif.
Hauts cris, horreur et dégoût, rejet social, quelles que soient ses formes et ses émanations, le parfum de scandale, s’il ne sent pas forcément bon aux narines délicates, parfume autrement la littérature, contamine l’éthos du narrateur, donne une saveur particulière à la vie telle qu’elle est soudain racontée ; de ce fait, la vision scandaleuse permet de nettoyer tout un pan de la littérature, les comportements attendus, les tableaux relevés.
La morale du scandale
Est-il scandaleux d’étudier la littérature scandaleuse ? Celle-ci a depuis longtemps droit de cité dans les Belles Lettres, puisqu’on sait avec Gide qu’on ne fait pas de la (bonne) littérature avec de bons sentiments. Il est vrai que les bons sentiments ont pu s’étaler sur des pages de littérature de voyage, encore davantage quand son écriture était un passage obligé pour s’insérer dans la république des Lettres : les voyages 12étaient forcément instructifs, didactiques, charmants… Or, même si la critique s’est vite méfiée de la prétendue vérité des textes de nature autofictionnelle, il n’en demeure pas moins que le genre reste trop associé à des conventions sociales qu’il fallait faire voler en éclat. Bouvier s’y était essayé, justement, avec le Poisson-Scorpion, qui montrait un hors-temps semi-référentiel, poétisé et décadent, dans lequel le narrateur perdait progressivement pied, bien loin du confort douillet de la Suisse dont il avait de lointains échos par de rares lettres parentales.
Scandale et médiation
Le scandale littéraire a ceci de particulier que, désobéissant aux codes, il est rare sinon impossible d’en trouver une trace antérieure dans la bibliothèque, médiation habituelle du voyageur. Impossible en effet d’imaginer qu’un voyageur s’en aille imiter un scandale précédent4 (serait-ce encore un scandale, qui n’aurait plus le goût de la nouveauté ?). Aussi, la médiation de la bibliothèque, sans disparaître tout à fait, se trouve régénérée, laissant l’homme, en proie à sa folie, ou à son désir de folie, se colleter au monde. De fait, si le scandale est aussi poétique, il est avant tout humain.
On se gardera bien d’associer l’écriture scandaleuse à celle qui raconte le scandale. L’écriture scandaleuse est par exemple celle d’un Casanova, d’un Sade, d’un Céline ou d’un Bataille. L’écriture qui raconte le scandale n’est pas à proprement parler scandaleuse, mais est toute aussi intéressante par la distance qu’elle met entre elle et l’objet de son discours, auquel elle est bien forcée d’adhérer : dire, c’est déjà s’approprier une part de la parole autre, aussi scandaleuse soit-elle.
Car dans le scandale, l’autre est au premier plan, comme valeur différentielle. Il y a scandale parce que le voyage choque, le voyage dérange, le voyage ne correspond pas aux codes de valeur des sociétés visitées, parce que le déplacement fait éclater les présupposés initiaux. Il nous appartient dès lors de nous déprendre de la morale qui supposerait une orientation axiologique, en faveur ou en défaveur de l’homme ou de son récit ; il conviendrait davantage de réaliser que le scandale est le choc 13culturel à son apogée (pensons au syndrome de l’Inde par exemple), nouvel exotisme ségalénien, créant le nouvel Exote, dont certes n’aurait pas voulu Segalen, mais qui semble situer la position maximale sur le curseur symbolique de l’étrangeté du voyageur.
Scandale et contextualisation
Voyage et scandale peuvent coexister séparément, mais il faut reconnaitre qu’ils vont merveilleusement bien ensemble : ils forment une union parfaite, si l’on en excepte la durée, car les deux sont faits pour se rencontrer, mais non pour vivre ensemble.
Le scandale est toujours moderne et relatif. Il n’y a de scandale que contextualisé, dans un choc culturel, social immédiat, dans le hic et nunc du voyage : marqueur parfait de l’histoire, le scandale arrête un instant le temps dans son déroulement normatif et normé, dans sa régularité. Il est parfaitement accolé au voyage, à ce hors-temps et hors-champ qu’est le voyage, qui fait que le voyageur, parti pour rencontrer l’autre, rencontre vraiment l’autre, parti pour vivre ailleurs, vit vraiment l’ailleurs, au-delà des politesses et des conventions d’usage. Le scandale prend alors des formes agonistiques, il est une opposition brutale, une guerre tacite d’êtres et de savoir-être, il fait remonter et s’opposer, lorsqu’il s’agit des usages, des historicités codées différentes, ou lorsqu’il s’agit des personnes, des personnalités autrement inimaginables, des individualités impensables.
Dans l’écriture, tout se passe de façon inverse : elle est la condition même de l’émergence du scandale, d’un dire fait pour choquer, qu’il soit politique ou érotique. L’écriture se fait voyage, elle est le nouveau tapis volant qui, sur une formule magique, permet de survoler les usages, de retourner les morales, de changer les mœurs ; pas toujours pour le meilleur, peut-être, mais qui pourra donc juger, sinon celui qui est scandalisé ?
À la surface du quotidien de l’écrivain-voyageur émerge une bulle, qui vient crever la planéité sans ride du jour pour tracer ses remous sur la page : cette bulle monte des profondeurs, exprime les profondeurs, l’impossible acceptation de l’humanité ou l’irréfragable différence des êtres. À ce titre, le scandale est profondément heuristique.
14Économie de l’ouvrage
Nœud gordien, le voyage scandaleux est difficilement théorisable : où, précisément, réside le scandale, comment séparer celui de l’écriture de celui du vécu dans la mesure où, bien souvent, nous n’avons trace du vécu que par celle de l’écriture ? Il nous a cependant bien fallu trancher, et cet ouvrage se décompose en trois parties dont les thématiques secondaires, telles d’infinies ramifications jouant sur les débordements, l’implicite, la liberté d’action ou de parole, le dégoût, etc., peuvent se croiser.
La première partie renvoie aux scandales historiques et biographiques. Quels sont ces écrivains-voyageurs qui sont sujets de scandale ou qui révèlent un scandale, mais aussi qui font ou publient des récits des scandales liés à leur voyage (chroniques de cour…) ? C’est ainsi que nous visiterons quelques grandes figures scandaleuses, Mme de Genlis, « gouverneur » des Orléans qui cache maladroitement ses liaisons sous de faux prétextes dont personne n’est dupe (J. M. Ibeas-Altamira), la célèbre voyageuse Isabelle Eberhardt (E. Galifi) qui s’habillait en homme autant pour complaire à sa nature rebelle et garçonne que pour mieux se fondre dans cet ailleurs masculin, Mme Giovanni qui aurait abusé Alexandre Dumas sur ses origines scandaleuses pour bâtir ce portrait d’elle en femme à la fois mondaine et voyageuse (L. Demougin)… Louise Colet et Flaubert révèlent une autre face des écrivains-voyageurs, celle de la provocation et de l’arrogance dans un jeu constant de théâtralisation (Th. Poyet). Avec G. Gelleri, nous revenons sur le passé civilisateur peu glorieux d’une mission française féminine dans les colonies, censée fonder pourtant la grandeur de la France, et resterons dans les colonies avec la dénonciation de l’esclavage et plus largement du système colonial par le célèbre journaliste Albert Londres (J. Cappi). Cette partie historique se clôt comme il se doit sur les « belles infidèles » dans un Orient à la violence sexuelle fantasmée (B. Zegdhani).
« Je hais le mouvement qui déplace les lignes5 », disait le poète, pourtant scandaleux, en faisant parler la beauté idéale, rêve marmoréen des artistes de l’Art pour l’Art. Ironie, l’histoire a paradoxalement 15montré que cette quête immobile de la Beauté, transgressant les codes en vigueur, avait été jugée scandaleuse… La deuxième partie de cet ouvrage se tourne vers la notion de modernité que peut apporter le scandale, en déplaçant les lignes de front non plus de la poésie, mais de la littérature de voyage : le scandale, comme moteur, changement, évolution ou régression. Comment le voyage permet-il la libération scandaleuse, comme celle de l’eros peregrinus ? D. Rouiller nous rappelle avec l’exemple de La Mothe Le Vayer que le cosmopolitisme est d’une certaine façon scandaleux, car il éradique les frontières, entendons, les frontières des sociétés de cour, et affranchit le philosophe, devenu un Cynique, des usages et des lois. Se confronter à d’autres us, voilà qui relève d’une nouvelle expérience de la liberté qui n’est pas simple à accepter, comme le révèle l’article sur le cannibalisme dans le premier voyage de Cook, pratique difficilement audible à l’époque (N. Cambon).
Avec Titaÿna (O. Gannier), sœur d’Alfred Sauvy, nous pénétrons un autre monde, celui de l’aventurière qui entend faire parler d’elle coûte que coûte : téméraire, révélant de véritables qualités d’investigation au mépris des lois du genre (féminin), elle ne peut pourtant s’empêcher d’aller trop loin dans ses propos parfois sans discernement, illustrant des siècles plus tard ce que prophétisait La Bruyère « Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages6 ».
L’œuvre de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres montre, selon R. Sayre, qu’il ne suffit pas de dénoncer le scandale pour que celui-ci disparaisse ; au contraire, il se trouve aussitôt déplacé vers l’origine même du discours qui le désigne. Tel est bien le cas à l’autre bout du monde africain, avec le voyage d’Antonioni en Chine (Q. Meng), dont le film que le réalisateur italien en a tiré a été jugé scandaleux, avant d’être réhabilité : le scandale semble toujours contextualisé… Enfin, le dernier article de cette seconde partie est dû à M. Mesierz qui revient sur les conditions de la réception d’Autour des sept collines, de Julien Gracq, livre de l’échec assumé du projet viatique, et par cela même, réussi.
La troisième partie de ce projet nous convie à considérer les effets de style (au sens large) que peut avoir le scandale sur le voyage, réel ou 16fictif, et son écriture. Quel traitement subit la scène scandaleuse dans la littérature viatique, et de quelle manière l’écrivain modifie-t-il (ou non) ses propres codes de bienséance pour raconter ? L’écriture viatique impose-t-elle une mise en scène à la crudité première du scandaleux et fabrique-t-elle le scandale ? Il convient désormais de voir comment le scandale mêle les genres. Ainsi le traitement des Amazones (société de femmes aux mœurs subversives) dans le théâtre du xviiie siècle est-il source d’une transgression comique qui actualise la réflexion sur le rôle de la femme (S. Delage). La fiction s’étend au roman par la parole érotisée et érotomane de Georges Bataille dans deux de ses œuvres, Histoire de l’œil et Bleu du ciel (A. Garric). Même désir de se perdre dans le labyrinthe de la brutalité scandaleuse du réel, mais cette fois avec les photographies d’Antoine d’Agata et son « esthétique du saisissement » (N. Bigot). C’est inversement le paratexte critique qui recréera a posteriori le scandale dans le Diable amoureux de Cazotte, montrant ainsi les multiples potentialités historiques et culturelles d’une œuvre qui laisse des blancs à l’interprétation (M. Bastide de Sousa).
Avec Tchekhov, la démarche est autre : il s’agit de rendre compte de cette île de Sibérie – dite de Sakhaline, où résident les condamnés soviétiques : dans l’enfer de la criminalité et de la prostitution, l’auteur inscrit le rire au cœur de son témoignage (N. Washington). Pour Sade en Italie, selon M. Menin, c’est l’art qui permet le renversement des valeurs scandaleuses, en laissant transparaître la démesure érotique pulsionnelle au fil des découvertes artistiques. Enfin, dans un xxe siècle sans plus de gloire, d’art, ni d’érotisme, le vomi de Céline emporte tout, avec la tempête, lors de la traversée vers Brighton, dans une grande oblation sacrificielle qui, toute fantasmée, n’est pas pour autant innocente (P. Mathieu).
Patrick Mathieu
Université de Mayotte
Aix-Marseille Univ – CIELAM
17Voyage et scandale est né d’une proposition de madame la professeure Sylvie Requemora (CRLV).
J’ai eu l’immense chance de pouvoir réunir un comité scientifique international de grande valeur, et je tiens à remercier chaleureusement les collègues qui m’ont accompagné dans ce beau voyage scandaleux, Mesdames Canonne, Rasoamanana, Requemora, Sadiqi, et Messieurs Abramovici, Brulotte, Laborie et Tinguely.
1 On le voit parfaitement avec Flaubert voyageur sous la direction d’Éric Le Calvez : l’ouvrage revient incidemment sur la fabrique de l’écrivain en commentant l’apport du voyage et la genèse du style.
2 Dans cette catégorie de critiques négatives du voyage, on pense par exemple à l’article de Sylvie Requemora, « Ondes amères : le discours anti-viatique des moralistes classiques », dans Jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique. Études de littérature française du xviie siècle offertes à Patrick Dandrey, D. Amstutz, B. Donné, G. Peureux et B. Teyssandier (dir.), Paris Hermann, 2018, p. 329-342.
3 Cf. Gilles Bertrand, Le Grand Tour revisité. Le Voyage des Français en Italie, xviiie-xixe siècle, Collection de l’école française de Rome, 2013.
4 Il ne faudrait pas confondre le fait d’imiter un scandale et celui de rentrer dans une habitude de dépravation. Le Carnaval de Venise ne donne pas lieu à des scandales, mais à des scènes de dépravation.
5 Baudelaire, « La Beauté », Les Fleurs du mal, 1857.
6 La Bruyère, Les Caractères, « Des esprits forts », § 4 : « Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait. Ils voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies […] », Garnier Flammarion, Paris, 1965.