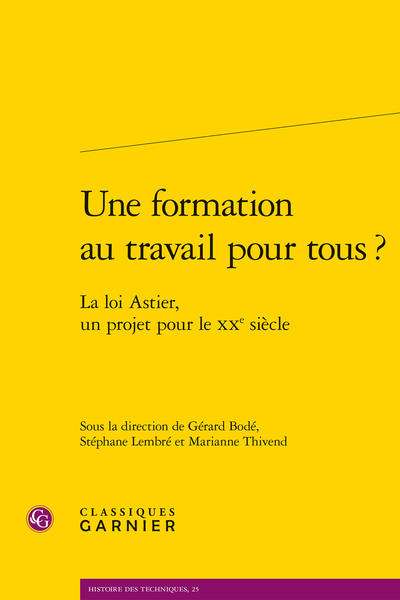
Préface
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Une formation au travail pour tous ?. La loi Astier, un projet pour le xxe siècle
- Auteur : Hatzfeld (Nicolas)
- Pages : 7 à 15
- Collection : Histoire des techniques, n° 25
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406130383
- ISBN : 978-2-406-13038-3
- ISSN : 2264-458X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13038-3.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/06/2022
- Langue : Français
Préface
« La “crise de l’apprentissage”, c’est la crise de l’enfance laborieuse ». Tel est le titre d’un article consacré aux enfants qui travaillent, publié dans L’Humanité le 31 octobre 1911, à la veille de la Grande Guerre. Il est écrit à l’occasion d’une initiative prise par Maurice Couyba, ministre du Commerce et de l’Industrie, qui évoque cette crise et se propose d’y remédier en créant par un décret, dans chaque département, des « conseils de l’enseignement technique », et en faisant délivrer aux apprentis qui le méritent un « certificat de capacité professionnelle ». L’initiative s’inscrit dans la dynamique sociale et politique qui conduit à la loi Astier du 25 juillet 19191.
Les auteurs de l’article, Léon et Maurice Bonneff, ne sont pas des responsables socialistes ni des dirigeants syndicaux, comme on en trouve dans la rédaction du journal de Jaurès2. Simples journalistes affectés aux questions sociales et particulièrement au monde du travail, ils ne s’attardent guère sur le décret Couyba, et proposent une analyse exprimant les vues du socialisme et du syndicalisme. Pour promouvoir réellement l’apprentissage, écrivent-ils, il faut « commencer par protéger l’apprenti ; il faudra ensuite veiller à ce que cet apprenti apprenne et ne serve pas de domestique affecté aux besognes ménagères ou de manœuvre attaché à la machine ».
S’il existe bien une crise, aux yeux des deux journalistes, celle-ci tient à leurs yeux à trois causes profondes.
Selon eux, une des causes de déclin de l’apprentissage est l’essor du machinisme, qui remplace le travail exécuté par les ouvriers maîtrisant leur métier et disposant du temps nécessaire à sa réalisation. Exécutant 8mécaniquement les opérations pour lesquelles elles ont été réglées, ces machines écartent la nécessité de former des apprentis : dans beaucoup d’activités, des travailleurs sans métier suffisent à les actionner ou à les servir. Toutefois, il ne faut sans doute pas voir dans cette analyse une mise en accusation de l’évolution technique. Dans d’autres articles, ces auteurs penchent pour une acceptation du machinisme. Ainsi dans le secteur du bâtiment, ils voient comment les appareils de levage transforment les manutentions, accroissent la productivité et réduisent la peine ainsi que les risques. Ailleurs, à propos de l’extension du machinisme dans la métallurgie, qui met à mal nombre d’emplois de métier, ils relaient la recommandation du dirigeant syndical Merrheim, qui préconise de s’adapter à cette dynamique qu’il estime irrépressible. Les métiers ne doivent donc pas être figés dans une définition menacée d’obsolescence : « Pour en déterminer la renaissance, il faut adapter l’apprentissage à la machine3 ». Par contre, le journal dénonce la menace que la production en série fait peser sur différents métiers. Ainsi, dans le cas des « articles de Paris » jouissant d’une réputation mondiale, des ateliers cherchent à décomposer cette activité fondée sur le métier et le goût des ouvrières en une succession d’opérations rudimentaires et répétitives, propres à ruiner la valeur de la profession.
Mais le principal de la crise de l’apprentissage est ailleurs, et met en jeu, d’une part, les relations qui s’établissent entre les entreprises, les jeunes apprentis et leurs familles, et d’autre part, le rapport entre le travail et la formation, autrement dit entre le présent immédiat des familles et l’avenir des enfants. Autant de questions de société majeures, alors que la grande majorité des enfants entre dans le monde du travail au sortir de l’école primaire.
Une des causes profondes de la crise de l’apprentissage est située par les frères Bonneff dans la précarité où se trouvent les familles ouvrières soumises à la cherté croissante de la vie et aux risques de chômage. Nombre d’entre elles ne peuvent plus « laisser le garçonnet ou la fillette étudier un état durant trois ou quatre années sans recevoir aucun salaire : il faut que les enfants, au sortir de l’école, occupent des emplois “où l’on gagne de suite” et dans ces emplois-là, généralement, on ne reçoit pas, ou l’on reçoit peu d’instruction professionnelle4. »
9Dans ce domaine, leurs reportages abondent, pour décrire la condition de petits pâtissiers qui « font plus de courses que de sauces », ou de garçons bouchers passant l’essentiel de leur longue journée à effectuer une première tournée au domicile des maîtresses de maison pour prendre les commandes, puis une seconde pour livrer. Parmi les petites crémières ou les employées d’épicerie-fruiterie, beaucoup sont largement occupées à des tâches de domestique. Le petit commerce n’est pas seul en cause. L’administration des postes ne forme guère plus les petits télégraphistes, rétribués « à la remise » des plis chez les destinataires, avec la perspective de concourir à seize ans pour devenir téléphonistes et d’espérer devenir facteurs au retour du service militaire. Plantés à la porte des hôtels et cafés élégants, les « petits chasseurs », affectés à répondre aux souhaits des clients, apprennent eux aussi à devenir des « sans métier ». Toutefois, le tableau n’est pas systématiquement négatif. Ainsi, si les commis de restaurant travaillent dur, ils n’en acquièrent pas moins une formation qui leur permet de faire carrière. Dans l’industrie, dans l’artisanat, dans le bâtiment, des articles évoquent d’autres métiers dont la transmission continue de s’effectuer par le biais de l’apprentissage. Cela se produit au sein d’activités artisanales comme celles des sabotiers, des modistes ou des graveurs sur métal5, ou peut être assuré sous la houlette de compagnons dans le cadre d’entreprises plus concentrées telles que des meuleries, des menuiseries et des fonderies, ainsi que dans des métiers du bâtiment et des travaux publics6. Certains articles évoquent l’intervention des syndicats sur ce sujet, par exemple dans le bâtiment et les travaux publics ou la verrerie7.
La troisième cause de décadence est imputée aux industriels. Certains d’entre eux rechignent à accepter des apprentis dont la formation détourne de la production les ouvriers qui les forment. Surtout, beaucoup voient dans l’emploi d’enfants une excellente opportunité d’abaisser les coûts salariaux. Attirés par la promesse d’un apprentissage et la perspective d’une petite rémunération, des parents confient leurs enfants à des 10entrepreneurs. Ceux-ci les substituent à une main-d’œuvre masculine ou féminine et s’en trouvent largement gagnants, même pour un travail moindre, comme l’illustrent quelques cas évoqués plus haut. Ils font exécuter à ces enfants des travaux relativement simples de manutention ou de préparation, souvent répétitifs, parfois même trop ingrats pour être acceptés par des adultes. Menant campagne contre le travail de nuit des enfants, et notamment contre les dérogations à la loi de 1892 qui l’interdit, au bénéfice des industriels de la métallurgie et de la verrerie, des articles soulignent la surexploitation dont font l’objet de jeunes enfants : aux horaires de nuit s’ajoute un ensemble de conditions insoutenables de travail : durée, chaleur, trajets et meurtrissures8.
Toutefois, on l’a vu, les forces syndicales dont L’Humanité se fait l’écho ne sont pas fatalistes en ce qui concerne la crise de l’apprentissage. Elles savent pouvoir discuter avec nombre de branches patronales pour esquisser des voies de rénovation. Cette discussion fait ressortir des différences de conception. L’une d’elles porte sur l’ampleur des jeunes à former ainsi au sein d’un métier. Dans le bâtiment, tandis que le patronat cherche à former des travailleurs en nombre limité pour en faire des chefs et des contremaîtres aptes à diriger la tâche d’ouvriers d’exécution, les syndicats souhaitent au contraire « l’élévation de toute la corporation », autrement dit un ensemble d’ouvriers habiles, aptes à comprendre l’ensemble du travail et relativement autonomes. La seconde grande différence porte sur les contenus. Les syndicats ferraillent contre le dirigeant de la Fédération patronale du Bâtiment et des Travaux publics, qui affirme qu’« un ouvrier maçon n’a pas besoin de connaître la géographie ». Par-delà la géographie prise ici comme exemple, la controverse, inscrite dans la longue durée, porte sur l’amplitude des savoirs à dispenser. Elle offre une alternative entre deux finalités distinctes, celle de professionnels efficaces dans leur spécialité ou celle de gens de métier aptes à donner son sens à leur activité. Dans cette seconde perspective, les syndicats prônent l’allongement jusqu’à quatorze ans de la scolarité obligatoire et la fixation à cet âge de l’entrée en apprentissage, en invoquant l’exemple de l’Allemagne9.
11Allant plus loin, certains d’entre eux voient dans cet allongement l’opportunité de recomposer l’instruction des enfants. Au cours de l’école primaire, les heures de travail manuel donneraient l’occasion de reconnaître les goûts des élèves, de les signaler aux parents et de dessiner les futures carrières des enfants. L’allongement de douze à quatorze ans permettrait d’organiser des cours de préapprentissage, offrant « une instruction théorique et pratique » préparant les élèves à leur futur métier, grâce à une « collaboration entre la classe ouvrière et les maîtres chargés d’en instruire les enfants ». Après viendrait l’apprentissage proprement dit, comportant un enseignement sur le tas et une partie théorique enseignée durant la journée de travail10.
Que peut apporter ce survol rapide et partiel du journal soucieux d’exprimer la conscience ouvrière ? Quels éclairages offre-t-il, et quelles questions soulève-t-il à propos de l’apprentissage ?
Il montre tout d’abord l’attention portée à la formation professionnelle des enfants par le mouvement ouvrier, ainsi que la volonté du syndicalisme de participer à sa redéfinition suscitée par les changements techniques, par l’évolution de la condition ouvrière ou encore par l’affirmation de l’instruction publique. En outre, à côté des organisations professionnelles, ouvrières et patronales, ainsi que des institutions publiques, on entrevoit le rôle des familles. Leur action, encore discrète et largement informelle, s’exerce essentiellement par le jeu de l’adhésion ou de la défection, parfois aussi devant les instances de justice en cas de contestation. Pour elles, l’arbitrage entre les besoins de ressources au présent et la dotation d’une formation pour l’avenir des enfants varie au gré des circonstances. Quoi qu’il en soit, la diversité des attentions à l’apprentissage porte à considérer cette question de divers points de vue, à la situer à l’intersection de plusieurs champs historiens.
Un second éclairage tient à l’idée d’une crise de l’apprentissage. Le thème, ancien et renouvelé de façon récurrente au cours du xixe siècle, prend une portée et une teneur nouvelles à la Belle Époque. Avec le mouvement ouvrier, le patronat, le monde politique et l’administration d’État parlent de crise, et prônent une réforme. Les diagnostics et les propositions 12divergent, notamment entre forces patronales et ouvrières, avec des arguments qu’il est intéressant de voir se confronter de manière répétée. C’est le cas en particulier à propos de l’extension de l’apprentissage au sein de la jeunesse populaire, que les uns veulent réserver à une élite ouvrière destinée à l’encadrement tandis que les autres entendent l’ouvrir à tous. C’est aussi le cas de son articulation avec la scolarité, ou encore celui de la finalité de la formation : faut-il préférer une stricte spécialisation opérationnelle au travail ou plutôt l’acquisition d’une autonomie de jugement dans l’exercice du métier ? Nombre de développements concernant les enjeux, les terrains, les destinataires et les modalités de l’apprentissage sont encore informulés ou peu considérés, à l’aube du xxe siècle.
Troisième apport de ce rapide examen : la mise en question du rôle de l’État dans la réforme de l’apprentissage. Les articles signalés ici se montrent expéditifs à propos de la mise en place du certificat de capacité professionnelle créé par le ministre, et mettent plus de soin dans leurs controverses à l’encontre des points de vue patronaux. On aurait tort d’en déduire une représentation des rapports de force. En ce qui concerne l’apprentissage, les organisations professionnelles ont perdu l’autonomie qu’elles avaient pu avoir dans la transmission des métiers. Dans la majorité des branches d’activité, les syndicats ne sont au mieux que des partenaires de la formation, même si celle-ci s’effectue pour l’essentiel « sur le tas », pour reprendre l’expression des journalistes, dans les ateliers et sur les chantiers. La situation des entreprises est certes différente. Parmi les plus importantes, nombre d’entre elles organisent un apprentissage en leur sein. Mais les réalisations sont très inégales. Certaines constituent un élément attractif par leur prestige dans le bassin d’emploi des établissements qui les portent. D’autres ne sont que des façades destinées à masquer l’exploitation d’une enfance nécessiteuse, dont la triste réputation porte atteinte à la légitimité des entreprises à organiser l’apprentissage de la jeunesse ouvrière. Des institutions de bienfaisance et des réseaux de placement, qui se faisaient les intermédiaires entre les familles et les demandeurs d’apprentis, voient aussi leur crédit s’éroder. Les préventions croissent parmi les parents qui veulent et peuvent offrir à leurs enfants un avenir digne. Des divers pans de la société, l’État est attendu dans son rôle de régulation.
La loi Astier est la première réponse de poids à ces attentes, comme le montre l’examen de sa genèse, de sa mise en œuvre et des façons 13dont elle affecte l’apprentissage, examen qui fait l’objet de cet ouvrage. Les contributions que le livre réunit mettent en lumière l’intervention des forces économiques et politiques, les développements législatifs, les modalités et les territoires de mise en œuvre de la loi. L’ouvrage souligne aussi les limites de ses effets, les frontières du social qu’elle ne franchit que tardivement ou partiellement : c’est le cas, par exemple des territoires ruraux à faible culture industrielle et technique, des secteurs de l’artisanat, ou encore des populations indigènes dans les colonies11. La mise en lumière des frontières et inégalités de genre, étudiée ici explicitement pour la formation des futurs agriculteurs, est à relier à d’autres travaux plus amples sur ce sujet12. Néanmoins, de diverses manières, cette loi transforme le paysage dans lequel s’inscrivent désormais les politiques et les pratiques de l’apprentissage, comme le montre efficacement l’introduction collective du livre.
L’inscription des questions soulevées dans une plus longue durée conforte cette appréciation. Un premier échange entre historiennes et historiens de différentes périodes montre l’existence récurrente, depuis des sociétés antiques, de relations entre des détenteurs d’un métier et de jeunes personnes désireuses de les acquérir, et travaillant pour le maître en contrepartie13. Le sujet touche à la fois à la transmission des normes de savoir-faire qui permettent d’assurer une continuité dans la qualité des productions effectuées, et de fonder sur la maîtrise d’un métier l’entrée dans le monde du travail pour les enfants issus des couches supérieures des milieux populaires. De manière générale, pour l’ensemble des périodes évoquées, l’apprentissage se situe dans le cadre de relations de travail, que les contrats soient formalisés par écrit ou, comme c’est souvent le cas, simplement par oral. Les parents, tuteurs ou responsables de l’enfant à divers titres louent ainsi les services de celui-ci au maître, la notion de service étant plus souvent marquée lorsqu’il 14s’agit de jeunes filles. Mais la formule diffère selon qu’elle s’inscrit dans un cadre artisanal où le maître est à la fois employeur et formateur ou plutôt dans un établissement manufacturier ou industriel dans lequel l’emploi, le commandement et la formation peuvent être représentés par des personnes distinctes.
C’est donc dans le cadre d’un contrat de travail que l’employeur s’engage à montrer un métier, et à permettre à l’apprenti de l’acquérir. Sur cet aspect, il est généralement convenu que la transmission des savoirs s’effectue en grande partie pour l’apprenti par la fréquentation du maître au travail : obéissance, accoutumance, observation et imitation sont les principales déclinaisons de cette assimilation progressive, suivant des modalités plus ou moins explicites, et plus ou moins respectées. La progression professionnelle est bien souvent traduite dans l’évolution de la rémunération : il est fréquent qu’elle soit particulièrement faible au début du contrat – parfois même l’apprenti paie pour connaître un métier – et qu’elle s’élève au fil des ans, jusqu’à approcher la rémunération des compagnons en fin de parcours. À côté de cette formation par la pratique, l’enseignement de connaissances abstraites est parfois réalisé hors des ateliers ou des chantiers, comme les mathématiques ou le dessin, enseignés depuis le temps du compagnonnage en soirée par des ouvriers chevronnés.
La présence de plusieurs de ces caractéristiques depuis des époques anciennes, suivant des modalités très diverses, conduit à relativiser une image strictement séquencée des évolutions pour les temps antérieurs au xxe siècle ; à ne pas se contenter d’un schéma faisant se succéder un long temps structuré par l’emprise des corporations, puis un xixe siècle marqué par la dérégulation, la révolution industrielle et la crise de l’apprentissage. L’Ancien Régime voyait, à certaines époques et pour certains métiers, la logique d’apprentissage mise à mal par la fermeture des corps de métier au profit des enfants de maître, ainsi que l’extension variable des contrats établis hors du domaine régi par les corporations14. A contrario, durant une grande partie du xixe siècle, la continuité des 15arbitrages effectués dans les tribunaux de prud’hommes témoigne de l’existence d’une relative régulation dans la transmission des métiers. L’évolution de ces conseils, qui se fondent de plus en plus clairement à partir de 1848 sur une représentation paritaire des employeurs et des salariés, adapte cette instance à l’évolution des relations d’emploi et à l’affirmation du salariat.
Ce premier échange entre spécialistes de différentes périodes de l’histoire confrontant leurs connaissances et leurs interrogations montre comment s’inscrivent dans la longue durée certains constituants de l’apprentissage. Il fait écho à l’ouvrage qui suit, confirmant en quelque sorte que s’il y a un moment de crise dans l’apprentissage à la Belle Époque et autour de la Première Guerre mondiale, celle-ci tient en grande partie à quelques grands changements sociaux : l’extension à l’ensemble de la société du domaine de la scolarité, et son allongement ; l’affirmation de la relation salariale, qui formalise la relation à la fois de subordination et de protection qu’elle induit entre l’employeur et le salarié ; la dissémination d’innovations techniques affectant l’exercice de la plupart des métiers et du travail en général ; la mise en œuvre législative et administrative de projets des pouvoirs publics dans le domaine de la réforme sociale, autrement dit l’adjonction d’un volet social à la république démocratique. Ainsi, ce changement de l’échelle temporelle aide à relativiser les limites et les lenteurs des transformations entraînées par la loi Astier.
En inscrivant cette loi dans un examen pluriel de l’histoire de l’apprentissage, l’ouvrage qui suit montre comment celui-ci s’inscrit à la rencontre de plusieurs champs historiques : notamment ceux des milieux populaires, du travail, des savoirs et des techniques, des entreprises, de l’éducation, des institutions et de l’action publique. Le recentrage qu’il propose ainsi établit ce champ en témoin précieux de l’histoire sociale, et conforte le bien-fondé d’un axe de recherche centré sur l’apprentissage.
Nicolas Hatzfeld
Université d’Évry Paris-Saclay – IDHE.S
1 Sur la genèse réglementaire et parlementaire de la loi, on se rapportera notamment dans cet ouvrage au chapitre de Stéphane Lembré : « La loi Astier : acteurs, débats et enjeux, 1905-1919 ».
2 Nicolas Hatzfeld (éd.), Les frères Bonneff, reporters du travail. Articles publiés dans L’Humanité, 1908-1914, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 19-28.
3 Léon et Maurice Bonneff, « La rénovation de l’apprentissage. Ouvriers et patrons la souhaitent. Comment la conçoit la Fédération du Bâtiment », L’Humanité, 17/02/1913.
4 Id., « Pour les enfants qui travaillent », L’Humanité, 31 10 1911.
5 Id., articles publiés dans L’Humanité : « Les sabotiers agissent », 16/09/1909 ; « Créatrices de l’avant-mode », 11/03/1913 ; « Prix de Rome socialiste », 20/07/1914.
6 Id. : « L’hécatombe des meuliers », 30/07/1909 ; « Dans les fabriques d’estropiés », 27/09/1910 ; « Les fournaises de Paris », 27/06/1911 ; « Les intellectuels du Bâtiment », 21/04/1911.
7 Id. : « Avant le congrès du Bâtiment, les questions à l’ordre du jour », 05/04/1912 ; « Les enfants des verreries », 11/06/1909.
8 Id., « Laignelet, pénitentier des enfants », L’Humanité, 30/11/1912 ; id., « Enfants battus », L’Humanité, 19/12/1912 ; id., « L’inspection désarmée », L’Humanité, 04/01/1913.
9 Id., « Le travail de nuit des enfants », L’Humanité, 01/07/1911 ; id., « Vers la rénovation de l’apprentissage », L’Humanité, 02/03/1913.
10 Id., « Vers la rénovation de l’apprentissage. Un maçon n’a pas besoin de connaître la géographie. Tel est l’avis de monsieur Villemin. Les syndiqués du bâtiment sont d’un avis contraire. La géographie n’est pas seulement la géographie. Un programme de rénovation de l’apprentissage », L’Humanité, 02/03/1913.
11 Cf. notamment les chapitres de Guy Brucy, de Cédric Perrin, de Stéphane Lembré ou de Fabien Knittel.
12 Cf. Fabien Knittel et Pascal Raggi (éd.), Genre et Techniques, xixe-xxie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013. Et, plus largement, les travaux de Marianne Thivend, Gérard Bodé, Jean Castets.
13 Anna Bellavitis, Christel Freu, Stéphane Lembré, Claire Lemercier, François Rivière, « La longue histoire de l’apprentissage », Table ronde aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 9 octobre 2021. https://rdv-histoire.com/programme/edition-2021-le-travail/la-longue-histoire-de-l-apprentissage (consulté le 10/11/2021).
14 Clare Haru Crowston, « L’apprentissage hors des corporations. Les formations alternatives à Paris sous l’Ancien Régime », Annales HSS, t. 60, no 2, 2005, p. 409-441 ; Steven S. Kaplan, « L’apprentissage au xviiie siècle : le cas de Paris », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 40, no 3, 1993, p. 436-479 ; Ruben Schalk, Patrick Wallis, Clare Crowston, Claire Lemercier, « Failure or Flexibility ? Apprenticeship Training in Premodern Europe », Journal of Interdisciplinary History, vol. XVIII, no 2, 2017, p. 131-158.