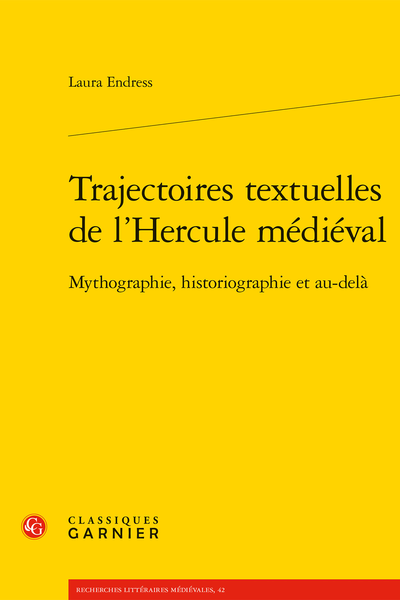
Les travaux de l’Hercule vainqueur Rapports intra- et intertextuels
- Publication type: Book chapter
- Book: Trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Mythographie, historiographie et au-delà
- Pages: 311 to 330
- Collection: Medieval Literary Research, n° 42
- Series: Ovidiana, n° 3
- CLIL theme: 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN: 9782406154648
- ISBN: 978-2-406-15464-8
- ISSN: 2261-0367
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15464-8.p.0311
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 01-24-2024
- Language: French
Les travaux
de l’Hercule vainqueur
Rapports intra- et intertextuels
Parmi les passages des Métamorphoses qui ont été augmentés dans l’OM, l’énumération finale des exploits d’Hercule mérite une attention particulière. Il s’agit là d’un passage ovidien qui nous a déjà occupé dans la première partie de ce livre1. La transposition des hexamètres latins en octosyllabes français fait apparaître, outre une augmentation du nombre de vers, des modifications et ajouts divers au catalogue des exploits. Les deux passages sont cités en regard ci-dessous. Afin de visualiser les exploits individuels à l’intérieur des extraits ainsi que les parallèles et divergences entre les deux textes, nous avons mis en gras et numéroté les éléments suivant primairement l’ordre de leur mention dans le passage des Métamorphoses2. Les numéros des éléments qui ne sont pas présents dans l’un ou l’autre texte sont marqués par un astérisque.
|
Mét. IX, 182-198 |
OM IX, 717-748 |
|
Ergo ego foedantem peregrino templa cruore Busirin [ 1 ] domui saeuoque alimenta parentis Antaeo [ 2 ] eripui nec me pastoris Hiberi [ 3 ] Forma triplex, nec forma triplex tua, Cerbere, [ 4 ] mouit ? Vosne, manus, ualidi pressistis cornua tauri [ 5 ] ? |
Ja poi je Busyrin [1] conquerre Qui des pelerins d’autrui terre Fesoit ou temple sacrefice Comme il feïst d’une genice ; Et le jaiant [2 ?] et Gerion [3] Ai je mis a perdicion ; Et si trais Cerberon [4] d’enfer |
| 312
Vestrum opus Elis [ 6 ] habet, uestrum Stymphalides undae [ 7* ] Partheniumque nemus [ 8 ] ; uestra uirtute relatus Thermodontiaco caelatus balteus auro [ 9 ] Pomaque ab insomni concustodita dracone [ 10 ] ; Nec mihi centauri [ 11 ] potuere resistere, nec mi Arcadiae uastator aper [ 12 ] ; nec profuit hydrae [ 13 ] Crescere per damnum geminasque resumere uires. Quid, cum Thracis equos [ 14 ] humano sanguine pingues Plenaque corporibus laceris praesepia uidi Visaque deieci dominumque ipsosque peremi ? His elisa iacet moles Nemeaea [ 15 ] lacertis ; Hac caelum ceruice tuli [ 16 ] ; [ … ] « Est-ce bien moi qui ai vaincu ce Busiris qui souillait les temples du sang des étrangers, moi qui ai ravi au terrible Antée les forces qu’entretenait sa mère, moi que n’ont pu effrayer ni le triple corps du pasteur d’Hibérie, ni ta triple gueule, ô Cerbère ? Est-ce bien vous, mes mains, qui avez fait toucher la terre aux cornes du taureau redoutable ? vous dont l’œuvre a pour garants l’Élide, les eaux du Stymphale et les bois du Parthénius ? Est-ce bien grâce à votre vaillance que furent rapportés le baudrier, ciselé en or, du Thermodon et les fruits confiés à la garde d’un dragon qui ne connaissait point le sommeil ? Est-il vrai que j’ai vaincu la résistance des Centaures et du sanglier qui dévastait l’Arcadie ? Que l’hydre n’a rien gagné à croître par ses pertes et à reprendre ses forces en les doublant ? Rappellerai-je encore que, ayant vu les chevaux du roi de Thrace engraissés de sang humain et leurs crèches remplies de corps en lambeaux, j’ai détruit les crèches, immolé le maître et ses coursiers ? Voici les bras qui ont étranglé et abattu le monstrueux lion de Némée ; voici le cou qui a porté le ciel […] » |
En grosses chaënes de fer ; La corne Acheloüs [5 ?] le fort Ai je route par mon effort, Troie [ 17* ] par terre trebuschié, La cité d’Elin [6] conquis gié Et le torel de Maratone [5 ?] Et le porc sengler de Cremone [18*] Et le moustre de Parthemee [8] Et le lyon de bois Nemee. [15] Dyomedem, le roi de Trace, [ 14 ] Et Nessus [19*] et celz de s’estrace [11] Ai tous a martire livrez. Tous les maulz pas ai delivrez Tant com j’en ai trouvez au monde Tant comme il dure a la reonde. Le regne conquis d’Oechalie [20*] Et le baudré de Femenie. [9] Si reconquist, ce dist la fable, Le fruit d’or au serpent veillable. [10] L’ydre [13]et le porc d’Arcade [12] ai mort Antheon [ 2 ] ai je mis a_mort, Qui, quant je l’avoie abatu, Doubloit sa force et sa vertu ; Si gaaignoit en son meschief. Je portai le ciel sor mo n chief. [ 16 ] |
Il est évident que le texte français se base dans un premier temps sur le modèle d’Ovide : on reconnaît sans difficulté Busyrin,qui ouvre la liste, ainsi que des composantes comme l’ydre et le porc d’Arcade, de même que le ciel que le héros porta et qui sert de clôture à l’énumération3. Pour d’autres exploits, cependant, plutôt que d’opter pour une simple traduction des termes d’Ovide en vers français, le translateur a modifié à des degrés divers la manière dont les exploits sont décrits. Il a « interprété » certains épisodes et a complété le catalogue ovidien d’exploits en y ajoutant d’autres accomplissements d’Hercule. Jung avait noté que l’ajout d’Achéloüs, Troie, Nessus et Œchalie, absents chez Ovide, sont des compléments « naturels » dans le contexte de l’OM, dans le sens où la lutte entre Hercule et Achéloüs pour gagner la main de Déjanire, l’intervention du héros à Troie, sa victoire sur Nessus et sa conquête d’Œchalie, d’où il a ramené Iole, sont relatées ailleurs dans le texte4. Mais il est possible de dire plus sur la nature des éléments modifiés et ajoutés par rapport à Ovide. Dans ce but, nous considérerons d’abord les commentaires d’Ovide, en élargissant ensuite la perspective à d’autres textes et contextes.
Suivant sa tendance à « gloser » les tournures allusives d’Ovide, l’auteur du texte français a remplacé un certain nombre de désignations périphrastiques de son modèle primaire par des noms propres, en ajoutant d’autres précisions qu’il a pu trouver facilement dans la tradition des commentaires médiévaux sur les Métamorphoses. En identifiant les cornua tauri (Mét. IX, 725) comme La corne Acheloüs le fort (OM IX, 725), le pastor(is) Hiberi d’Ovide (Mét. IX, 184) en tant que Gerion (OM IX, 721), et en remplaçant les monstrueux Thracis equos humano sanguine pingues (Mét. IX, 194) par l’évocation de leur maître Dyomedem, le roi de Trace (OM IX, 733), il fournit des informations supplémentaires qu’il a pu repérer dans divers paratextes, dont le Commentaire Vulgate et celui du manuscrit Vat. lat. 1479, entre autres. Ainsi, on trouve dans le Commentaire Vulgate, au-dessus du mot pastoris la glose interlinéaire Gerionis ; au-dessus de tauri, on lit Acheloi ; et une note marginale sur les chevaux de Thrace précise que Diomedes, rex Tracie, habuit equos velociores vento qui humanis carnibus vescebantur […]5. En décrivant les poma314soustraits au dragon toujours veillant en tant que fruit d’or, le translateur a également pu s’appuyer soit sur le paratexte Vulgate, soit sur un commentaire composite tel que celui du manuscrit Vat. lat. 1479. Ce dernier précise, par exemple, que quem[= draconem]interfecit Hercules et poma aurea rapuit6. On peut s’imaginer que le translateur a, pour ces passages, intégré dans sa propre composition des données repérées dans la glose du témoin des Métamorphoses à partir duquel il travaillait.
Dans certains cas, la glose latine, en plus de fournir des précisions sur les vers d’Ovide, est peut-être à l’origine de dédoublements dans la translation. Considérons les cornua tauri : l’OM évoque, outre la corne Acheloüs (OM IX, 725), un torel de Maratone (OM IX, 729). La présence de ces deux antagonistes d’Hercule dans le texte français résulte éventuellement de l’interprétation double du tauri anonyme d’Ovide, qu’on rencontre déjà parmi les plus anciens commentaires à propos des Métamorphoses d’Ovide, puis chez Arnoul d’Orléans et les commentateurs s’inspirant de lui7. Le commentaire composite du manuscrit parisien lat. 8010, transmettant entre autres des éléments d’Arnoul, précise ainsi, en glose à propos de tauri8 :
Hoc potest legi dupliciter : de Acheloo, quia Achelous pugnavit contra Herculem in specie tauri et eum Hercules devicit, vel potest legi de tauro quem Minos petiit a Neptuno causa immolandi, et ipsum furibundum Hercules interfecit. Alii dicunt quod in Maratone quondam taurum interfecit , et sic tripliciter legitur istud.
Le fait que la corne Acheloüs figure à côté du torel de Maratone s’explique donc éventuellement par la présence de telles gloses dans un grand 315nombre de manuscrits, menant à une multiplication des interprétations possibles. Un autre type de dédoublement qui pourrait s’appuyer à son tour sur les commentaires concerne Antée. Chez Ovide, ce dernier est nommé en deuxième position dans l’énumération des exploits (Antaeo, Mét. IX, 184). À l’endroit correspondant de la translation, placé entre Busiris et Géryon, on retrouve le jaiant (OM IX, 721), caractérisation qui pourrait en principe s’appliquer à divers adversaires d’Hercule. Antée est cependant nommé explicitement, vers la fin de la liste d’exploits de l’OM, avec des précisions supplémentaires, absentes chez Ovide : Antheon […] / Qui, quant je l’avoie abatu, / Doubloit sa force et sa vertu (OM IX, 744-746). Les éléments ajoutés par le translateur français aux deux endroits se retrouvent, dans ce cas aussi, dans les commentaires latins : dans celui du manuscrit Vat. lat. 1479, on lit illi giganti en glose interlinéaire à Anteo, et le Commentaire Vulgate offre une précision sur les pouvoirs régénérateurs du personnage en jeu – Istum enim devicit Hercules cui quotiens cadebat ad terram vis sua duplicabatur9 – qui résonnent dans la description d’Antheon d’après l’OM.
Mais revenons encore sur le sujet du torel de Maratone, qui mérite quelques observations supplémentaires. La présence de ce taureau dans le passage de l’OM peut être considérée sous un autre angle encore : celui des reprises intra-textuelles dans l’OM, vraisemblablement motivées à leur tour par les commentaires d’Ovide. Comme divers chercheurs l’ont déjà noté, le catalogue de travaux herculéens au livre IX de l’OM fait écho à l’énumération des exploits de Thésée au livre VII du même texte10. Nous citons ci-dessous des extraits des deux passages, en mettant en gras les exploits parallèles11.
|
Exploits de Thésée ( OM ) |
Exploits d ’ Hercule ( OM ) |
|
Le tor cretensie conquist En la cité de Maratone Et le porc sengler de Cremone Qui la terre avoit afamee (VII, 1692-95) |
La cité d’Elin conquis gié Et le torelde Maratone Et le porc sengler de Cremone (IX, 728-730) |
| 316
Et le lyon de bois Nemee Qui le païs avoit desert. (VII, 1696-97) |
Et le lyon de bois Nemee. (IX, 732) |
|
De Dyomedes le sauvage, Qui des homes qu’il decoloit Ses felons chevaulz saouloit, Fist merveilleuse ocision (VII, 1700-03) |
Dyomedem, le roi de Trace, Et Nessus et celz de s’estrace Ai tous a martire livrez. (IX, 733-735) |
|
Et Procrusten et Guerion Qui se muoit en trois figures Ocist. […] (VII, 1704-05) |
Et le jaiant et Gerion Ai je mis a perdicion ; (IX, 721-722) |
|
Si se repot il bien vanter D’ocirre Cacun le jaiant (VII, 1716-17) |
[Cacus n’est pas présent explicitement au livre IX, mais il pourrait éventuellement se cacher dans le jaiant évoqué au vers 721, cité supra12] |
En nous limitant tout d’abord au premier exemple, les vers évoquant Et le torel de Maratone / Et le porc sengler de Cremone (OM IX, 729-730) sont un calque évident de ceux qui parlent de la victoire de Thésée sur Le tor cretensie[…] En la cité de Maratone / Et le porc sengler de Cremone (OM VII, 1692-94). Le passage source de la matière de ces différents vers est l’énumération des exploits de Thésée au livre VII des Métamorphoses13 :
Te, maxime Theseu, /
mirata est Marathon Cretaei sanguine tauri ;
quodque suis securus arat Cromyona colonus,
munus opusque tuum est [ … ]
« C’est toi, grand Thésée, que Marathon a vu avec admiration répandre le sang du taureau de la Crète ; si le paysan laboure les champs de Cromyon sans se soucier du sanglier, c’est ton bienfait et ton ouvrage […] »
Or dans le texte latin d’Ovide, les adversaires en question (le taureau « de Marathon » et le sanglier « de Cromyon ») ne sont nommés en tant que tels que dans ce passage au livre VII. Ils ne sont pas repris explicitement dans le catalogue de travaux herculéens au livre IX comme c’est le cas dans la translation.
Fait intéressant, l’exemple d’auto-citation du Livre VII dans le Livre IX de l’OM, a, lui aussi, pu être motivé par des données 317contenues dans les commentaires des Métamorphoses. La présence du taureau de Maratone dans les deux passages de l’OM (alors qu’Ovide n’en parle explicitement qu’au livre VII, au vers 434, Marathon Cretaei sanguine tauri) a pu être conditionnée par des gloses dans plusieurs commentaires latins qui associent les deux héros à cet animal, présentes soit dans l’un ou l’autre passage, soit dans les deux14. Déjà dans les Glosulae d’Arnoul d’Orléans, les deux passages sont commentés de manière à établir une sorte de référence croisée entre les exploits des deux héros. Arnoul précise, à propos du Cretaeitauri au livre VII, Quem taurum ligatum, Hercules, rogatu populi, in Maratoni montem transtulit. Quem postea iaculo Teseus peremit15, et, au livre IX, au sujet d’un tauri sans toponyme déterminant, Hercules taurum domuit et domitum in Maratonem montem transportavit. Et postea fuit a Teseo interfectus16. Certains commentateurs offrent des remarques explicites sur l’attribution de cet exploit aux deux héros. Paule Demats en a déjà relevé un exemple dans le manuscrit Vat. lat. 1479, auquel on peut ajouter un autre exemple, tiré du commentaire composite parisien lat. 801017 :
|
Vatican, BAV, Vat. lat. 1479 |
Paris, BnF, lat. 8010 |
|
Nota quod omnes iste operaciones dicuntur principaliter de Hercule, secundario de Theseo. Vel possunt esse similes operationes utriusque. Fabula talis est : Nepturnus Minoy regi misit taurum ut illum sibi sacrificaret Minos autem accensus cupidine retinuit et nolit sacrificare. Qua de causa iratus Nepturnus fecit illum furibundum et omnes destruebat nec erat qui resistere sibi posset Theseus huc venit et occidit et hoc totum legitur de Hercule . |
Ipsum [ = taurum ] interfecit Hercules, sed quicquid fecit Hercules attribuitur Theseo, quicquid fecit Theseus attribuitur Herculi. |
Suivant son habitude de recourir aux gloses d’Ovide, l’auteur de l’OM se serait, une fois de plus, inspiré des données présentes dans l’espace paratextuel de son modèle afin de mélanger les deux passages.
Les commentaires expliquent en effet non seulement la présence d’exploits théséens provenant du livre VII dans le passage sur Hercule au livre IX, mais également le phénomène inverse. En effet, dans le livre VII de l’OM, Thésée est censé avoir vaincu lui aussi le lyon de bois Nemee (OM VII, 1696), Dyomedes le sauvage (VII, 1700), Guerion (VII, 1704), de même que Cacun le jaiant (VII, 1717). Ces confusions ont probablement été renforcées, à leur tour, par des variantes textuelles et des gloses présentes dans certains manuscrits médiévaux au livre VII des Métamorphoses. Regardons de plus près les exemples de Géryon et de Cacus associés à Thésée, en comparant le texte « reçu » d’Ovide (dans la colonne de gauche), les données présentes dans les deux manuscrits médiévaux des Métamorphoses, Vat. lat. 1479 et Vat. lat. 1598 (dans la colonne centrale), et les passages correspondants de l’OM (dans la colonne de droite), en mettant en gras les données qui nous intéressent.
|
Texte d ’ Ovide |
Texte d ’ Ovide |
Texte de l ’ OM |
|
Mét. VII, 439 : Cercyonis letum vidit Cerealis Eleusin. Éleusis, chère à Cérès, a vu la mort de Cercyon. |
Mét. VII, 439 : Gerionis letum vidit Cerealis Elempsis (Vat. lat. 1479, f. 107v) Gerionis letum vidit Cerealis Eleusis (Vat. lat. 1598, f. 70v) |
OM VII, 1704-06 : […] et Guerion, Qui se muoit en trois figures, Ocist. […] Varia lectio : 1704 Guerion] girion A2YZ2gyrion Z1 gerion BG13guerron E2 ; mq. Z4 |
|
Texte d ’ Ovide |
Commentaire |
Texte de l ’ OM |
|
[ … ] tellus Epidauria per te / Clavigeram vidit Vulcani occumbere prolem […]. |
Glose à propos de VII 436 : Epidaria est quedam regio, et ibi erat Chacus , qui noctu omnes interficiebat. huc veniens Theseus interfecit [ … ] . (Vat. lat. 1479, f. 107v) |
Si se repot il bien venter D’ocirre Cacun le jaiant. (OM VII, 1716-17) |
| 319
[…] grâce à toi, la terre d’Épidaure a vu succomber le fils de Vulcain, qu’armait une massue […] (Mét. VII, 436-437) |
prolem scilicet Cacun (Vat. lat. 1598, f. 70v) |
Varia lectio : 1717 Cacun] taccumA2 tateumY1 tactumY3 cocun BD124E12G2cocum D4F cocon D5 chocum G1coccu Z123 phocon G3 tactid Y2 ; mq. Z4 |
Pour résumer, au livre VII de certains manuscrits médiévaux des Métamorphoses, Cercyon, un brigand qui aurait en effet été vaincu par Thésée, devient Gerion dans le catalogue d’exploits théséens, ce qui explique la présence a priori inattendue de Guerion dans le passage correspondant au livre VII de l’OM. En d’autres mots, un exploit déjà revendiqué par Hercule au livre IX, qui n’est pas habituellement associé à Thésée, est attribué à ce dernier au livre VII, tout comme c’est le cas dans l’OM. Quant au Vulcani prolem (« fils de Vulcain ») qui apparaît dans le même passage du livre VII des Métamorphoses, il reçoit dans plusieurs témoins médiévaux du texte latin une glose précisant qu’il devrait s’agir de Cacus (dont le nom est souvent noté à l’accusatif, conformément à prolem), anticipant à son tour la présence de Cacun au livre VII de l’OM. Les variantes textuelles et gloses paratextuelles en question renforcent davantage les parallèles ressentis entre le passage à propos d’Hercule et celui à propos de Thésée18.
Au sujet du rapprochement entre les hauts faits des deux héros, il est intéressant d’évoquer aussi la présence, dans certains manuscrits glosés d’Ovide, de listes d’exploits, transmis dans les marges à côté de l’un ou des deux passages en question, témoignant de confusions et de dédoublements semblables. Ainsi, le manuscrit Burney 224 de la British Library, qui transmet le texte d’Ovide avec les Glosulae ainsi que les Allegoriae d’Arnoul d’Orléans, cite, dans la marge inférieure au-dessous du passage qui parle des exploits de Thésée, neuf probitates, dont mors Gerionis, mors Cachi, ainsi que uictoria de centauris (autre exploit qui pourrait être attribué à Hercule). De façon analogue, le commentaire inclut 320au-dessous du passage sur Hercule au livre IX une liste de quatorze exploits, parmi lesquels on trouve, entre autres, les mentions Gerionem interfecit et Cacum interfecit19.
|
Londres, BL, Burney 224, f. 76v Travaux de Thésée |
Londres, BL, Burney 224, f. 99r Travaux d ’ Hercule |
|
Neptunus generat Egeum, qui Teseum, cuius sunt hee probitates : [1]uictoria de centauris ; [2]mors Gerionis ; [3]destructio Tebarum ; [4]descensus ad inferos ; [5]mors Cachi ; [6]mors Scenis (avec ajout suscrit Certionis) ; [7]mors Procrustis ; [8]mors Minotauri ; [9]mors Chironis |
Probitates Herculis : [1]Angues in cunis strangulauit, unde « cunarum labor est angues superare mearum » ; [2]Busirim interfecit, unde « Busirim domui » ; [3]Idram domuit, unde « nec profuit Idre crescere per dampnum » ; [4]Celum sustinuit, unde « hac celum ceruice tuli » ; [5]Antheum deuicit unde « seuoque alimenta paren[t]is Antheo eripui » ; [6]Gerionem interfecit, unde « nec me pastoris Hiberi forma triplex » ; [7]Tres leones occidit qui pro uno acipiuntur, unde « Parthemiumque nemus » ; [8]Archadiem aprum interfecit, unde « Archadie uastator aper » ; [9]poma hesperidum rapuit, unde « pomaque ab insompni noncustodita dracone » ; [10]Cerberum ab inferno traxit, unde « nec forma triplex tua cerbere mouit » ; [11]Taurum in Mauritane [sic] interfecit, unde « meque alta sternuit arena » (IX, 84) ; [12]Baltheum Amasonibus restituit, unde « Termodontiaco celatus balteus auro » ; [13]Arpias interfecit ; [14]Cacum interfecit |
Les confusions concernant l’attribution de certains exploits à Thésée et à Hercule se rencontrent ailleurs encore. Rappelons à ce sujet notre petite enquête sur les sources possibles des contenus mythologiques dans la première rédaction de l’Histoire ancienne jusqu’à César, et en particulier l’anecdote à propos de l’attribution incertaine de la victoire sur Cacus, 321qui survient dans ce contexte20. En effet, les listes d’exploits notées dans les marges du manuscrit Burney 224 cité supra s’avèrent étroitement apparentées à certains exemples de listes de probitates Herculis et probitates Thesei que nous avons cités en parlant de l’Histoire ancienne. Rappelons que les textes en question sont des sortes de manuels de savoir mythographique (et encyclopédique) qui comportent souvent des généalogies de dieux antiques21. Nous nous permettons de citer ici in extenso, à côté des données du manuscrit Burney 224 de la British Library, celles de deux listes présentes dans des manuels mythographiques que nous avons déjà évoqués en rapport avec l’HAC, contenus dans les manuscrits Angers, BM, 312 (xiiie siècle) et Vatican, BAV, Pal. lat. 1741 (xve siècle). Nous reproduisons ci-dessous les données contenues dans les listes non selon leur ordre original, qui varie, mais afin de faire ressortir les contenus parallèles, en mettant en gras, et en bas des listes, les entrées impliquant un rapprochement entre Hercule et Thésée.
|
Londres, BL, Burney 224, f. 76v et 99r |
Angers, BM, 312, |
Vatican, BAV, |
|
Probitates Thesei : Destructio Tebarum Mors Minotauri Mors Scenis Mors Chironis Mors Procrustis Mors Gerionis Victoria de Centauris Descensus ad inferos Mors Cachi |
Hee sunt probitates Thesei : Destructio Thebarum Mors Minautauri [ sic ] Mors Cenis Mors Chironis et Procrustis Mors Certhicanis [ ? ] Victoria de Centauris Descensus aput inferos cum Piriteo Mors Caci que attribuitur Herculi |
Probitates Thesei : Destructio Thebarum Mors Minotauri Mors Scenis Mors Chironis Mors Protrustis Mors Cercionis Victoria de Centauris Descensus ad inferos pro Peritoo Mors Caci que attribuitur Herculi |
|
Probitates Herculis : Angues in cunis strangulauit Busirim interfecit Idram domuit Celum sustinuit Antheum deuicit |
Hee sunt probitates Herculis : Busirin interfecit Idram decertavit Celum sustinuit Anteum devicit |
Probitates Herculis : Angues in cunis strangulavit Busirim interfecit Ydram interfecit Celum sustinuit Anteum devicit |
| 322
Gerionem interfecit Tres leones occidit qui pro uno acipiuntur Archadiem aprum interfecit Poma Hesperidum rapuit Baltheum Amasonibus restituit Arpias interfecit Cerberum ab inferno traxit Taurum in Mauritane [ sic ] interfecit |
Gerionem Tres leones interfecit : Nemeum, et Oleneum et Parthoenium Archadium aprum interfecit Pomum Hesperidum rapuit Balteum Amazonibus restituit Arpias interfecit Cerberum ab inferis extraxit Taurum in Maratone domuit |
Tres leones interfecit qui pro uno accipiuntur Archadicum aprum interfecit Poma Esperidum rapuit Balteum Amazonibus restituit Cerberum extraxit ab inferis Taurum in Maratonem (glose montem) transtulit |
|
Cacum interfecit |
En les comparant, on constate que les trois listes, sans être identiques, partagent une quantité notable de données, dont plusieurs exploits qui, suivant nos observations précédentes, pourraient avoir occasionné un rapprochement voire une confusion entre les deux héros. Il y a donc lieu de s’interroger plus avant sur la relation entre Thésée et Hercule et leurs exploits respectifs, ce que nous ferons plus loin. Mais signalons d’abord quelques innovations supplémentaires dans la liste des exploits herculéens, au livre IX de l’OM.
À côté des éléments de glose – destinés à éclairer les périphrases allusives d’Ovide – et des emprunts au catalogue d’exploits de Thésée, l’énumération comporte certains autres ajouts, concernant notamment Nessus (OM IX, 734) ainsi que les conquêtes de Troie (OM IX, 727) et d’Œchalie (OM IX, 739). Il convient de se demander si ces éléments sont de simples ajouts de circonstance dans le contexte de l’OM, dans la mesure où les épisodes en question sont traités ailleurs dans la même œuvre, ou s’ils s’inspirent, accessoirement, d’autres listes d’exploits. Virgile lui-même, dans l’Énéide, n’a-t-il pas relié Troiamque Oechaliamque aux travaux herculéens22 ? Pour chercher des parallèles qui soient éloquents, nous laisserons cependant les sources de ce type, trop éloignées de notre sujet, au profit de textes plus étroitement apparentés à la mythographie ovidienne.
323Certaines listes d’exploits comparables à celles que nous venons d’évoquer ci-dessus, transmises également dans des manuscrits des Métamorphoses, offrent une piste intéressante à cet égard. Dans plusieurs manuscrits d’Ovide, dont certains témoins du Commentaire Vulgate23 et certains qui transmettent les Glosulae et/ou des Allegoriae d’Arnoul d’Orléans24, entre autres25, nous avons trouvé une autre liste de travaux en marge à proximité du passage sur les travaux herculéens au livre IX. Nous la citons ici d’après deux témoins du xiiie siècle : le manuscrit Milan, Biblioteca Ambrosiana P 43 sup., qui transmet le texte d’Ovide avec le Commentaire Vulgate, et le manuscrit Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 13.10 Aug. 4o, comportant les vers d’Ovide et les gloses d’Arnoul dans un état remanié avec divers ajouts. Nous indiquons la varia lectio des autres témoins repérés.
|
Ms. Milan, Biblioteca |
Ms. Wolfenbüttel, HAB, |
|
Versus de probitatibus Herculis : Antheus, leo, sus, celum, draco, Cerberus, ydra, Cerva, Cacus, stadium, Nessus, Gerion, Achelous Herculis acta nota ; sunt cetera facta minora. |
Hee sunt probitates Herculis : Antheus, leo, sus, celum, draco, Cerberus, Idra, Cerva, Cacus, stadium, Nessus, Gerion, Achelous et Diomedis equi. Sunt cetera facta minora. |
Varia lectio (sur la base du ms. de Milan)
Achelous ] aqua pluto Ms. Leiden, Bibl. der Rijksuniversiteit, BPL 96 – Herculis acta nota] et Diomedis equi Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 5.4 ; Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 159 Gud. lat. ; Berlin, Staatsbibliothek, Diez. B. Sant. 11 ; Leiden, BPL 97 ; Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, Barth. 110 heraclis acta nota sunt Ms. Berlin, Staatsbibliothek, Diez. B Sant. 5– sunt […] minora]sunt Herculis optima facta Ms. Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, Barth. 110 – remplacement de la dernière ligne par Com totidem superesse dies de mense videbis / Quot sunt Herculei facta videbis[pour laboris]ait (Fastes V, 695-696). Leiden, BPL 96.
324Comme les vers dans l’OM, la liste comporte les noms d’Achéloüs et de Nessus, absents chez Ovide. Elle omet, en outre, les oiseaux stymphaliens, qui manquent également dans la translation française. Mais elle ajoute aussi, avec Cachus et stadium, deux exploits qui ne sont pas présents (explicitement) dans le catalogue d’exploits herculéens de l’OM. Il ne s’agit donc pas d’un répertoire analogue à celui de l’OM (ni à celui d’Ovide), mais d’une sélection d’exploits, d’inspiration ovidienne, relatés sous forme de liste compacte. Notons par ailleurs l’appellation Versus de probitatibus Herculis désignant la liste en question dans le manuscrit du Commentaire Vulgate26. Il s’agit en effet de trois vers hexamétriques. Comme l’indique le dernier vers, les éléments rapportés sont censés donner l’essentiel des exploits du héros. Ce sont des vers mnémotechniques qui permettent de se souvenir des travaux d’Hercule qui ont vraisemblablement circulé dans des écoles au xiiie siècle, transmis également indépendamment du modèle d’Ovide27. On pourrait donc s’imaginer que l’auteur du texte français a eu recours en supplément à une telle liste, à côté de son modèle commenté d’Ovide, pour composer sa liste de travaux d’Hercule.
On ne serait pas surpris de trouver d’autres versus ou listes composites d’exploits, transmis dans les manuscrits de Métamorphoses, qui évoquent également les conquêtes de Troie et d’Œchalie. D’autant plus qu’on trouve aussi, dans d’autres œuvres médiévales à peu près contemporaines de l’OM, des catalogues des exploits d’Hercule comparables, amplifiés d’une manière semblable qui, sans être des ancêtres ou descendants directs de l’OM,partagent comme un « air de famille » avec ce dernier et nous permettent ainsi d’apprécier les augmentations et modifications des travaux d’Ovide sous un angle plus large. Les exemples les plus frappants que nous avons identifiés se trouvent dans des œuvres historiographiques provenant de différentes parties de l’Europe médiévale qui puisent dans la mythographie 325ovidienne. L’un d’entre eux se trouve dans la General Estoria espagnole d’Alphonse le Sage, composée à partir de 1270. Cette histoire comporte, vers le début de la série de chapitres qui traitent de la vie d’Hercule, un chapitre De la cuenta de los grandes fechos de Ercoles, qui résume les actes du héros, mentionnant, parmi bien d’autres exploits, vençoi el Ateloo, mato a Neso, el sagitario, quebranto a Troya, et vençio al rey Eurico de Oetalia28. Un deuxième exemple apparaît dans au moins trois témoins de la Satyrica historia, compilée par le franciscain Paolin de Venise dans les premières décennies du xive siècle. Ces témoins transmettent, outre cette chronique, diverses annexes, dont un traité intitulé De diis gentium qui comporte des éléments intéressants sur Hercule29. Ce traité reprend et abrège le texte du Mythographe III du Vatican, son chapitre sur Hercule ayant été retravaillé au point de ressembler à un résumé des exploits du héros. Le segment en question évoque, entre autres, Ylium subvertit (correspondant à la conquête de Troie), Acheloo, et rappelle certains autres exploits d’une façon qui ressemble davantage au texte de l’OM qu’aux vers d’Ovide, dont taurum Maratonium interfecit, et et Cerberum ab inferis extraxit, qui est proche du texte français (Et si trais Cerberon d’enfer, OM IX, 723), et plutôt différent du vers d’Ovide dans le même passage (nec forma triplex tua, Cerbere, movit, Mét. IX, 185).
Il est douteux qu’aucun de ces deux textes historiographiques qui puisent dans la mythographie n’ait été la source immédiate de l’OM. Il n’est pas impossible cependant qu’ils aient des sources en commun. Plutôt que d’avoir compilé leurs catalogues de travaux herculéens en consultant chaque auctoritas séparément, les compilateurs de chroniques autant que l’auteur de l’OM ont pu se baser sur des listes déjà augmentées, semblables à celles transmises dans les marges des manuscrits d’Ovide ou encadrées dans des œuvres historiographiques. Les manuels de mythographie évoqués plus haut pourraient représenter un lien manquant dans ce cadre. On se rappelle que les mêmes formules taurum Maratonium interfecit et Cerberum ab inferis extraxit présents chez Paolin de Venise figurent également, entre autres éléments, tels quels dans la liste retenue dans les deux manuels mythographiques (Pal. lat. 1741 et 326Angers 312) ainsi que dans le manuscrit de Burney 224 des Métamorphoses, cités plus haut pour les listes de travaux d’Hercule et de Thésée. On a l’impression que ces témoignages sont tous apparentés, puisant dans un fond de savoir mythographique commun, qui reste cependant encore à identifier clairement avant d’être défriché.
Le catalogue augmenté des travaux d’Hercule dans l’OM illustre de façon exemplaire les différentes strates de matériaux qui entrent en jeu dans une telle translation médiévale. Les Métamorphoses et leurs paratextes tels qu’ils sont transmis dans les manuscrits médiévauxsont un point de départ propice pour aboutir à une meilleure compréhension de la composition de l’œuvre. À l’aide d’indices qui se retrouvent dans les marges et dans l’interligne des témoins d’Ovide, on arrive à déceler comment ont pu se produire des phénomènes de mélange intertextuel et de récriture intratextuelle, et les métamorphoses que subit en conséquence l’héritage ovidien. Les éléments qui se dégagent de l’étude de ces strates de matériaux-sources aident à leur tour à comprendre des tendances plus générales qui puisent dans un discours littéraire plus ample et le rejoignent.
À cet égard, ajoutons quelques réflexions sur une tendance déjà observée dans cette étude de cas à propos des rapports entre Hercule et Thésée. En les regardant de plus près, on arrive aussi à mieux comprendre un autre passage du livre IX de l’OM qui parle, sous un angle plus large, des exploits d’Hercule, tout en innovant par rapport à Ovide. Le segment sur la mort d’Hercule dans les Métamorphoses, dans lequel se situe aussi le catalogue de travaux considéré auparavant, s’ouvre par un constat succinct : Longa fuit medii mora temporis, actaque magni / Herculis inplerant terras[…]30. Mention d’un « long intervalle de temps », pendant lequel les exploits d’Hercule « remplissent la terre de sa gloire ». L’auteur du texte français a décidé, pour sa part, de préciser bien davantage les exploits d’Hercule qui ont rempli cette période31 :
Pour son vasselage exaucier
Aloit par tout le mont querant
Aventures et conquerant
Ces terres et ces regions.
327Nulz malz senglers, nulz malz lyons,
Ne nul moustre qui mal feïst
Ne lessoit que tous n’oceïst.
Maint en ocist par sa proesce ;
Si fist maint biau fet de noblesce.
Sages estoit et biaux et fors.
Ses proesces et ses esfors
Fist aparoir par tout le mont.
Quant il ot tant fet ça amont
Qu’il n’i ot plus riens a conquerre,
En enfer ala mouvoir guerre.
Enfer brisa ; si traist d’enfer
Le portier en liens de fer.
Ce passage sert à la fois à dresser un portrait d’Hercule et à donner une première synthèse de ses exploits, qui seront repris plus en détail dans le discours final prononcé par Hercule que nous venons d’étudier de près. Le passage n’est pas sans rappeler, de par son style et ses contenus, les présentations succinctes d’Hercule dans les Romans de Troie32. Les caractérisations d’Hercule font en même temps écho à des éléments d’acculturation repérés plus haut dans l’OM (dans les récits d’Achéloüs) et commentés supra. Hercule est présenté comme un vainqueur, un conquérant – bref, un auteur de hauts faits. Mais l’Hercule moralisé, au-delà d’être fors, est également sages, et il se distingue non seulement par ses exploits guerriers, mais aussi parce qu’il est l’auteur de maint biau fet de noblesce. Ce que disait Marc-René Jung à propos de l’Hercule médiéval se vérifie donc aussi pour l’OM : « [e]n effet, Hercule n’apparaît pas uniquement comme une sorte de Fierabras aux muscles redoutables, mais peut aussi être un philosophe, un exemple de la fortitudo morale […]33 ». Il dispose donc de qualités morales qui ouvrent vers d’autres niveaux d’interprétation figurée34. Ces qualités, en plus de la proesce du 328héros et ses efforts de partir querant aventures afin de son vasselage exaucier, introduisent Hercule dans le contexte socio-culturel du Moyen Âge, en lui conférant les traits prototypiques du chevalier vaillant35.
Fait intéressant, ce portrait d’Hercule-chevalier se trouve à son tour en dialogue avec le portait de son homologue Thésée. En plaçant les vers qui servent à introduire Thésée au livre VII de l’OM à côté de ceux qui présentent Hercule au livre IX, on voit apparaître de nouveaux échos intratextuels, qui semblent adhérer à un même modèle formulaire (intertextuel). Nous marquons par des gras les reprises littérales, et par des italiques les contenus parallèles :
|
Hercule ( OM ) |
Thésée ( OM ) |
|
Pour son vasselage exaucier Aloit par tout le mont querant Aventures et conquerant […] Maint en ocist par sa proesce ; Si fistmaint biau fet denoblesce. (IX, 490-498) |
C’iert Theseüs au fier corage. Qui pourquerre honor et barnage Aloit aventures querant O Herculés le conquerant, […] Cil Theseüs par sa proesce Fist mainte œuvre de grant noblesce, (VII, 1683-90) |
Plus qu’il ne relève d’un même stéréotype littéraire, le portrait d’Hercule paraît un véritable écho intratextuel de celui de Thésée, construit sur les mêmes rimes, caractérisé par des éléments lexicaux identiques ou synonymiques36. Le portrait d’Hercule fait allusion par ailleurs à un autre ajout du livre VII de l’OM qui n’est pas chez Ovide. En rappelant au 329lecteur qu’Hercule Enfer brisa et qu’il traist d’enfer / Le portier en liens de fer (OM IX, 505-506), l’auteur de l’OM renvoie à l’épisode de la libération de Thésée aux enfers. Cet épisode est absent des Métamorphoses, mais fait l’objet d’un développement de plusieurs centaines de vers dans l’adaptation française37. Comme l’a suggéré Paule Demats, l’ajout dans le livre VII paraît être motivé à son tour, entre autres, par des notes paratextuelles dans des manuscrits des Métamorphoses38. On a l’impression d’avoir affaire à un dense réseau de renvois intra- et intertextuels formé autour d’Ovide et de ses paratextes, sur lequel s’appuie et auquel participe l’auteur de l’OM en composant sa propre œuvre de mythographie ovidienne.
À ce réseau de références relevant du paratexte ovidien s’ajoutent des points de renvoi « externes ». Nous nous limitons à les commenter rapidement ici. La mythographie ovidienne n’est pas le seul endroit où se croisent les chemins d’Hercule et de Thésée, comme nous l’avons déjà observé à plusieurs reprises au long de ce travail, et notamment dans nos pages dédiées à l’historiographie médiévale. Les deux héros sont présentés en tant que compagnons qui partent en expédition contre les Amazones dans les Historiae adversum paganos d’Orose, d’où ils sont passés dans les histoires vernaculaires, à commencer par l’Histoire ancienne jusqu’à César39. D’autres œuvres historiographiques, dans la lignée du Chronicon d’Eusèbe-Jérôme, ont accueilli l’anecdote à propos d’Hercule qui aurait libéré Thésée des enfers, ce qui a pu accessoirement influencer l’élaboration de cet épisode dans l’OM40. Compte tenu de ces autres occurrences, il ne paraît guère surprenant de retrouver les deux héros, que les lecteurs médiévaux ont déjà vu combattre côte à côte comme les .ij. chevaliers les meillors dou monde dans l’Histoire ancienne jusqu’à César au xiiie siècle, présentés comme « égaux » dans ce texte du xive siècle41.
En fin de compte, le rapprochement Hercule-Thésée est aussi à considérer en rapport avec un autre phénomène qui caractérise l’OM, à savoir une tendance à la perte de l’identité individuelle des personnages au profit d’une identité symbolique généralisée. Comme l’a observé 330Karl Galinsky à propos des représentations médiévales d’Hercule, « Herakles was regarded merely as a virtuous man, and the emphasis was on the virtuous and not, as in the ancient secularizations of the theme, on the man42. » Cette nouvelle image de l’homme vertueux se laisse facilement rattacher, à son tour, à d’autres figures mythologiques. L’ancienne signification spécifique des mythes (y compris, entre autres, l’identité des créatures vaincues par Hercule) s’érode progressivement sur leur chemin à travers le Moyen Âge, de sorte que certains éléments finissent par se brouiller ou à s’échanger sans porter atteinte au nouveau sens, exemplaire et généralisé, désormais prévu pour les mythes et leurs protagonistes. C’est ainsi qu’Hercule et Thésée deviennent des personnages schématiques, interchangeables, définis par les mêmes qualités idéales qu’on peut résumer sous l’expression de « vertus chevaleresques ».
1 Mét. IX, 182-198, qui nous a déjà servi de point de départ pour étudier les trajectoires d’une série d’exploits évoqués par Ovide et glosés par les commentateurs médiévaux (cf. supra, p. 111 sqq.).
2 En d’autres termes, la numérotation dans le tableau ne suit pas l’ordre canonique des douze athloi. Rappelons tout de même ce dernier ici, car on peut en effet reconnaître les douze athloi dans le passage ovidien, évoqués de manière explicite ou périphrastique : le lion de Némée [15] ; l’hydre de Lerne [13] ; le sanglier d’Érymanthe [12] ; la biche / le cerf de Cérynie [8] ; les oiseaux du lac Stymphale [7] ; le taureau de Crète [5] ; les chevaux de Diomède de Thrace [14] ; la ceinture d’Hippolyte [9] ; les troupeaux de Géryon [3] ; les pommes des Hespérides [10] ; les écuries d’Augias à Élis [6] ; Cerbère [4].
3 Comparer avec Busirin (Mét. IX 183), dont l’auteur français reproduit l’accusatif, hydrae et Arcadiae vastator aper (IX, 192), et caelum cervice tuli (IX, 198).
4 M.-R. Jung, « Hercule dans les textes du Moyen Âge », art. cité, p. 52.
5 Ms. Vatican, BAV, Vat. lat. 1598, f. 91v sur Géryon et Achéloüs, et f. 92r sur les chevaux de Diomède. Quant aux gloses équivalentes qui se trouvent dans le manuscrit Vat. lat. 1479, voir, à propos de pastoris (Mét. IX 184), Gerion pastor fuit et multitudinem ovium et multitudinem illam [sic] conservabat, et dicitur habere triplicem formam Gerion et tria capita, et à propos de Tracis (Mét. IX 194), id est Diomedis, regis Tracie, qui hospites suos interficiebat, et equis feris ad comedendum aponebat ; hunc Hercules interfecit et eum equis suis ad comedendum apposuit, quod possibile est (gloses citées d’après Un commentaire médiéval […], éd. Ciccone, op. cit.). Différentes solutions (auxquelles nous reviendrons infra) sont proposées à propos du tauri (Mét. IX 186) entre autres, potest intelligi de Acheloo, de quo prius sermo processit (cité également d’après Un commentaire médiéval […], éd. Ciccone, op. cit.). Des gloses équivalentes sont, par ailleurs, déjà présentes parmi les Glosulae d’Arnoul d’Orléans. Ainsi, dans le ms. Londres, BL, Burney 224, on lit : pastoris hiberi id est Gerionis […] (f. 99r, en marge), acheloi in taurum mutati (même feuillet, en interligne sur tauri) et Tracis Diomedis. Nota est fabula quia Diomedes, rex Tracie, qui equos suos humana carne pascebat, quem interfecit Hercules. […] (même feuillet, en marge).
6 Ms. Vatican, BAV, Vat. lat. 1479, glose à Mét. IX 190 (d’après Un commentaire médiéval […], éd. Ciccone, op. cit.). Le Commentaire Vulgate donne, en glose au même vers : Aureum pomerium filiarum Athlantis spoliavit Hercules (ms. Vatican, BAV, Vat. lat. 1598, f. 91v).
7 Parmi les commentaires les plus précis, voir p. ex. Munich, BSB, clm 14482, 7r, à propos de tauri : id est Acheloi vel tauri quem alligatum in Maritonum [sic] montem transmisit.
8 Ms. Paris, BnF, latin 8010, f. 114r, marge de gauche.
9 Ms. Vatican, BAV, Vat. lat. 1598, f. 91v, marge de gauche.
10 Demats, Fabula, op. cit., p. 66 ; Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé, op. cit., p. 590. Voir aussi les remarques dans notre article « À la recherche du modèle latin de l’Ovide Moralisé », art. cité, p. 105 sqq.
11 Les extraits du livre VII sont cités d’après Ovide moralisé, éd. de Boer, op. cit.
12 Voir également, à ce propos, nos observations sur les allégories infra, p. 350 sqq.
13 Mét. VII, 433-436.
14 Nous avons présenté cette argumentation dans notre étude, « À la recherche du modèle latin de l’Ovide Moralisé », art. cité, p. 106-108.
15 Cité d’après Londres, BL, Burney 224, f. 76v, manuscrit de provenance française du début du xive siècle, qui transmet les Métamorphoses accompagnées des gloses d’Arnoul avec des ajouts. La glose en question est présente dans l’essentiel des témoins d’Arnoul.
16 Ibid., f. 99r.
17 Ms. Vatican, BAV, Vat. lat. 1479, f. 107v, cité d’après Demats, Fabula, op. cit., p. 66. La glose se rapporte au passage sur Thésée (cf. Mét. VII, 430-447) ; ms. Paris, BnF, lat. 8010, f. 89r.
18 Pour un traitement plus approfondi de ces cas de figure et des variantes de noms propres, voir Endress, « À la recherche du modèle latin de l’Ovide Moralisé », art. cité, passim. Un autre cas de figure que nous traitons dans l’article en question concerne le toponyme Cromyona (cf. l’extrait cité plus haut à propos du taureau de Marathon), qui devient dans bon nombre de manuscrits médiévaux Cremona (entre autres, dans les mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 1598 et Vat. Lat. 1479), anticipant ainsi le porc sengler de Cremone de l’OM (VII, 1694).
19 Contrairement à l’énumération des exploits de Thésée, la liste des travaux d’Hercule comporte en outre des citations de vers ovidiens qui parlent des éléments énumérés.
20 Supra, p. 169 sqq. L’attribution incertaine de Cacus dans l’HAC a également été retenue par Demats, Fabula, op. cit. p. 66.
21 Cf. p. 167, n. 42 supra. Nous avons abordé certains représentants de ces manuels mythographiques à la lumière de leurs rapports avec l’OM dans Endress, « Un répertoire “de montibus et fluminibus” dans l’Ovide moralisé ? », art. cité.
22 Virgile, Énéide, livre VIII, 291 (liste aux vers 288-305), d’après l’éd. Durand, op. cit. Nous avons résumé les éléments présents dans le passage concerné de l’Énéide dans notre tableau de catalogues éclectiques de travaux herculéens chez les auctoritates latines supra, p. 75-77. L’épopée virgilienne considérée par rapport au commentaire de Servius permettrait, par ailleurs, d’expliquer également la présence de Nessus et d’Achéloüs dans l’OM.
23 En font partie les manuscrits Berlin, Staatsbibliothek – Preussischer Kulturbesitz, Diez. B Sant. 5, f. 79r ; Milan, Biblioteca Ambrosiana, P 43 sup, f. 85r ; Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 159 Gud. lat. 2o, f. 82r.
24 À savoir les manuscrits Leiden, Bibl. der Rijksuniversiteit, BPL 96 ; Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 5.4., f. 103r ; Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 13.10 Aug. 4o, f. 77v.
25 Berlin, Staatsbibliothek – Preussischer Kulturbesitz, Diez. B Sant. 11, f. 72r ; Leiden, Bibl. der Rijksuniversiteit, BPL 97, f. 86v ; Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, Barth. 110.
26 Voir aussi, dans celui de Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 13.10 Aug. 4, Hee sunt probitates Herculis, et dans Berlin, Staatsbibliothek, Diez. B Sant. 11, In illis versibus probitates Herculis, ajouté à la fin de la liste.
27 En effet, le manuel mythographique du manuscrit Angers, BM, 312 comporte, sur un même feuillet, juste au-dessous de la première liste d’exploits que nous avons citée supra aux p. 321-322, également les versus hexamétriques en question : Antheus, leo, sus, celum draco, Cerberus, ydra / cerva, Cacus, stadium, Nessus, Gerion, Achelous / et Diomedis equi. Sunt cetera facta mitiora (f. 22r). Par ailleurs, des vers mnémotechniques très semblables sont transmis dans le Fabularius ainsi que le Novus Graecismus du maître zurichois Konrad von Mure (xiiie siècle). Citons le Fabularius : Et hic probitates Herculis hiis uersibus notantur : / Cerberus, Antheus, Achelous, Nessus et Ydra, / Angues, Cacus, equi, leo, sus, Gerionque polusque, / Busyris, stadium, Centhaurus, cerua dracoque, (d’après Conradi de Mure Fabularius, éd. van de Loo, op. cit., entrée Alceus, v. 744-747). Ces listes d’exploits mériteraient une étude plus approfondie.
28 Alfonso el Sabio, General Estoria. Segunda parte. vol. 2, éd. Solalinde, op. cit., chap. 297.
29 Les trois manuscrits (avec indication des feuillets où se trouve le chapitre sur Hercule) sont Bamberg, Staatsbibliothek, Hist. 4/2, 18ra, Vatican, BAV, Vat. lat. 1960, f. 26vb-27ra (les deux du xive siècle) ainsi que Dresden, Sächsische Landesbibliothek, L.7, f. 441rb-va (xve siècle). Voir, pour la description des manuscrits et des autres témoins de l’œuvre de Paolino, I. Heullant-Donat, « Entrer dans l’Histoire. Paolino da Venezia et les prologues dans ses chroniques universelles », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 105:1, 1993, Annexe I, 426-435. Le traité De diis gentium est inédit, comme l’essentiel de la Satyrica historia.
30 Mét. IX, 134-135.
31 OM IX, 490-501. Le fait que l’auteur français élabore ici par rapport à Ovide est peut-être mis en évidence dans les mss. Paris, BnF, fr. 373 (G1) et Copenhague, KB, Thott 399 (G3), par une glose marginale au vers 494 du texte français, Cy recite l’aucteur les fais Herculés. On remarquera que les gloses vernaculaires dans ces deux témoins ainsi que dans le manuscrit Florence, BML, Acq. e doni 442 (F) désignent souvent, dans le segment étudié, les éléments qui ne proviennent pas des Métamorphoses.
32 À commencer par Benoît de Sainte-Maure, Le roman de Troie par Benoit de Sainte-Maure, publié d’après tous les manuscrits connus par L. Constans, Paris, Firmin Didot, 6 t., 1904-1912, t. 1, v. 805-812 : (Jason i fu e) Herculès, / Cil qui sostint maint pesant fais / E mainte grant merveille fist / E maint felon jaiant ocist / E les bones iluec ficha, / Ou Alixandre les trova : / Ses granz merveilles e si fait / Seront a toz jorz mais retrait. À propos de ce passage, voir aussi les remarques de M.-R. Jung, « Hercule dans les textes du Moyen Âge », art. cité, p. 32.
33 Ibid., p. 10.
34 On rappelle que les acceptations courantes du terme vertu ont changé au cours des siècles, de même que les qualités désignées par leur étymon latin, virtus. Nous n’aborderons pas ici la distinction entre fortitudo et virtus, en notant simplement que ces changements ont joué un rôle pour l’évolution de l’identité littéraire d’Hercule. Notre raisonnement s’appuie sur les observations faites à ce sujet par F. Gaeta, « L’avventura di Ercole »,art. cité, p. 234, ainsi que M.-R. Jung, Hercule dans la littérature française du Moyen Âge, op. cit., p. 15-16.
35 Cf. notamment K. Galinsky, The Herakles Theme, op. cit., p. 186 ; 191-194, et M.-R. Jung, « Hercule dans les textes du Moyen Âge »,art. cité, p. 58-59, sur la figure d’« Hercule chevalier » qui se perpétuera à travers le xive et le xve siècle. Dans l’OM, l’« équilibre parfait » des qualités chevaleresques d’Hercule revient dans des caractérisations comme cil ou tant avoit poissance, / Bonté, valour et sapiance (OM IX, 543-544), avec les variantes Force, valeur, bonté, vaillance (dans les manuscrits G13) et Prouesse, valleur et puissance (dans les manuscrits Z) au v. 544.
36 En outre, Thésée est censé être parti en quête d’aventures avec Hercule, idée qui n’est pas présente dans les Métamorphoses. La précision s’explique à l’égard de l’épisode que l’auteur de l’OM inclut au livre VII, où Hercule libère Thésée des enfers lorsqu’il descend chercher Cerbère. Il est possible de retracer cette thématique à travers différentes sources, dont les Mythographes I (cf. chap. 48 et 57) et II du Vatican (chap. 156), en remontant jusqu’au commentaire tardo-antique de Servius, qui évoque l’opinion selon laquelle Thésée fertur ab Hercule esse liberatus (commentaire à Én. VI, 617). Voir déjà Demats, Fabula, op. cit., p. 33 et 65 sur l’insertion de cet épisode dans l’OM.
37 OM VII, 1730-1951 (Ovide moralisé, éd. de Boer, op. cit.).
38 Demats, Fabula, op. cit., p. 63-65. Demats évoque en particulier une note marginale dans le manuscrit Paris, BnF, lat. 8011 (Commentaire Vulgate), qui détaille le mythe sous-jacent à propos de la rencontre entre Thésée et Hercule aux enfers.
39 Cf. supra, p. 162 sqq.
40 Cf. supra, p. 147 (à propos du Chronicon d’Eusèbe-Jérôme), 228-230 (à propos du Manuel d’Histoire de Philippe VI de Valois,qui intègre l’anecdote en question, vraisemblablement à partir de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur, en l’adaptant en français).
41 La désignation provient de la rubrique du chap. 140 de l’HAC dans le ms. Paris, BnF, fr. 20125 (f. 121a).
42 K. Galinsky, The Herakles Theme, op. cit., p. 296.