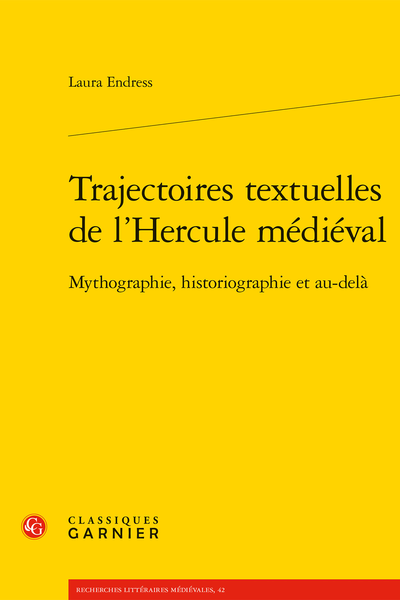
Les éléments herculéens dans les histoires qui dérivent de l’HAC1 Quelques lumières sur une tradition touffue
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Mythographie, historiographie et au-delà
- Pages : 181 à 243
- Collection : Recherches littéraires médiévales, n° 42
- Série : Ovidiana, n° 3
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406154648
- ISBN : 978-2-406-15464-8
- ISSN : 2261-0367
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15464-8.p.0181
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/01/2024
- Langue : Français
Les éléments herculéens
dans les histoires qui dérivent
de l’HAC1
Quelques lumières sur une tradition touffue
Les éléments que nous avons regardés jusqu’ici appartiennent à l’HAC1 – c’est-à-dire la « première rédaction » de l’Histoire ancienne jusqu’à César – et plus précisément à l’état le plus ancien de ce texte tel qu’il est représenté par le manuscrit Paris, BnF, fr. 20125 (P) en particulier. Or l’HAC a connu une riche tradition textuelle et a servi de modèle à une série d’histoires postérieures qui en ont repris un certain nombre d’éléments de la biographie d’Hercule, en les retravaillant à leur tour. Certains de ces textes sont habituellement désignés comme des « rédactions » ultérieures de l’HAC, alors que d’autres portent des titres conventionnels propres – tels la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (CBA), qui a à son tour été retravaillée et qui a exporté certains éléments herculéens vers des textes postérieurs. Les interrelations entre ces textes sont telles que l’on ne devrait pas être surpris du fait qu’une chronique particulière du xve siècle ait déjà été désignée comme « troisième rédaction » de l’HAC par certains chercheurs et, par d’autres, comme une version de la CBA1. Dans la suite de ce travail, nous proposerons d’examiner quelques compilations qui s’inscrivent dans cette tradition touffue à travers leurs composantes herculéennes. Nous commencerons par regarder les portraits d’Hercule dans la « deuxième rédaction » de l’HAC (HAC2), en nous interrogeant d’abord sur la position de cette compilation par rapport à la tradition textuelle de l’HAC1, puis sur les autres modèles et sources mis à contribution. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux épisodes herculéens contenus dans un certain nombre de témoins de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (CBA) ou de textes associés ou dérivant de cette dernière.
182Trois portraits herculéens
dans la « deuxième rédaction » de l’HAC (HAC2)
et leurs rapports avec la tradition précédente
Si la biographie d’Hercule dans le plus ancien état de l’HAC1 s’avère un conglomérat de matériaux qui confèrent au héros une image hétérogène, dans la compilation que l’on connaît sous le titre de deuxième rédaction de l’HAC (HAC2), de provenance napolitaine et datant de la première moitié du xive siècle, la multiplicité de ses portraits atteint un autre niveau. Dans les témoins de cette dernière composition, Hercule est « présenté » à plusieurs reprises. Considérons les extraits suivants du manuscrit de la British Library de Londres portant la cote Royal 20 D I (que nous abrégerons en Ro), le plus ancien témoin connu de l’HAC2, qui est également considéré comme l’archétype de tous les autres manuscrits survivants de cette œuvre2 :
Cils Herculés fu fil a le royne Armene qui fu file le roy Laudati, qui vint de Crete. Et saciés que plus fort homme ne plus hardi ne fu puis le deluge que estoit Herculés. Et pour ce dient li plusour qu’il fu samblant a Sanson de forche et de proesche.
Et dit on que ce fu cestui Herculés qui ficha les coullonnes que Alixandre trouva et qui fist moult d’autres grans merveilles selonc ce que li aucteur racontent.
Herculés fu fils Jupiter, et out non sa mere Hermena qui fu fame au roy Amphitrion. Quant Herculés fu grans et parcreus, si ala par diversses parties du monde et fist de grans merveilles qui sont escrites el livre de sa vie. Il vainqui Ancheüs et planta les coullones outre la grant mer. Et si vainqui Euchonius li fils Vulcanus qui premiers trouva la charrete. Et en cel temps meïsmes crut si le flume de Ducalion qui par deluge noia la cité qui fu desous le chastel de Voltrento. Et l’aouroient la gent du païs comme dieu, car l’en ne trouva onques homme ne beste ne giant qui le peüst rendre vaincu. […]
183Le premier extrait nous est déjà familier : c’est une adaptation quelque peu abrégée du portrait initial d’Hercule qui survient dans le segment sur les Amazones, déjà présent dans l’HAC1. Les deux extraits suivants sont nouveaux, tout comme la section entière dans laquelle ils s’insèrent : comme on le sait bien, dans l’HAC2, on retrouve à la place de la section troyenne de l’HAC1 d’après Darès, une adaptation bien plus longue de l’épisode, qui s’inscrit dans la lignée des mises en prose du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure et qui est appelée conventionnellement Prose 53. Dans ce nouveau récit troyen, le deuxième extrait cité supra correspond au moment où l’on apprend qu’Hercule rejoint Jason et les Argonautes lors de la quête de la toison d’or ; le troisième est donné avant le récit de la mort du héros. Nous voulons dans la suite du développement offrir quelques réflexions sur les différents morceaux et sur le cadre textuel dans lequel ils s’insèrent, à la lumière de la tradition textuelle et des sources de l’HAC.
Auparavant, il convient cependant d’ajouter quelques mots sur la tradition textuelle de l’HAC1 et de l’HAC2. Ce sera aussi l’occasion de fournir une rapide vue d’ensemble des différents témoins que nous prendrons en compte dans les pages suivantes. L’état textuel dont témoigne le manuscrit P que nous avons regardé supra n’est présent en effet que dans un petit ensemble de manuscrits de l’HAC1 qui semblent représenter la plus ancienne rédaction de l’œuvre, s’opposant à une version abrégée du texte qui est présente dans une quantité bien plus grande de témoins. Marc-René Jung avait décrit ces deux versions comme des « familles » textuelles à part dans la tradition de l’HAC14 :
Quant au texte, on peut distinguer deux familles, la première, α, semble se limiter aux manuscrits du groupe iconographique D. Je suis évidemment loin d’avoir collationné tous les autres manuscrits, mais je crois pouvoir affirmer qu’ils forment, dans leur ensemble, une deuxième grande famille, β, attestée dès le xiiie siècle. Elle récrit des phrases entières et « modernise » en partie le vocabulaire ; elle omet le deuxième ordre du seigneur et d’autres passages, notamment la plupart des moralisations en vers.
Dans l’inventaire des manuscrits de l’œuvre que Jung a dressé dans sa monographie sur la Légende de Troie en France au Moyen Âge, les représentants du « groupe iconographique D » (désignation renvoyant à la classification proposée par Doris Oltrogge) qui constitueraient la « famille 184α », dont fait partie le manuscrit P, sont au nombre de sept5, s’opposant à quelque soixante autres témoins qui formeraient la « famille β ». Puisque Jung ne fournit pas de données pour appuyer son hypothèse sur le plan de la généalogie des manuscrits, nous parlerons – suivant Craig Baker, qui a remis en question l’hypothèse de Jung dans un article récent6 – d’une « version longue » et d’une « version courte » du texte, que nous abrégerons dans la suite en HAC1a et HAC1b.
Les manuscrits associés à l’HAC2, à leur tour, ne témoignent pas d’une « œuvre » unique aux délimitations nettes. Comme l’avait déjà observé Paul Meyer, ils se définissent par la présence de certains segments de l’HAC1, alors que l’ancienne section troyenne est remplacée par Prose 5 et que la section I sur la Genèse est absente7. Autrement dit, l’HAC2 n’est plus une histoire universelle, mais une « histoire ancienne » au sens propre. On en connaît aujourd’hui dix témoins, que Jung a divisés en deux groupes sur la base de leurs contenus8 :
–le groupe A, représenté par trois témoins qui comportent tous les sections suivantes : III-IV-Prose 5-VI-VIII-VII-X9. C’est l’état textuel représenté par le manuscrit Ro, caractérisé par l’absence non seulement de la section I, mais aussi des sections II (Orient I) et IX (Alexandre). La compilation regroupe, par ailleurs, à la fin du texte les deux sections VII et X, consacrées à l’histoire de Rome, ce qui mène accessoirement à l’inversion de l’ordre entre VII et VIII.
–le groupe B, représenté par sept témoins, dont quatre transmettent les sections II-III-IV-Prose 5 ; deux témoignent, en outre, de la section VI, et un comporte II-III-IV-Prose 5-VIII-VII-IX-X. Les manuscrits se définissent tous par la présence d’une rubrique spécifiant que l’œuvre a été offerte au roi Charles V de France (r. 1364-1380).
Les études de Luca Barbieri sur la tradition textuelle de Prose 5 soutiennent que l’ensemble des témoins (et donc les représentants des deux 185groupes décrits par Jung) semblent remonter à Ro,quiserait commel’« archétype vivant » de la tradition de l’HAC2.
Dans la mesure où le premier des trois portraits herculéens dans Ro (cités supra) semble s’appuyer sur l’HAC1, il nous paraissait intéressant de l’aborder d’une manière permettant en même temps de nous interroger sur le modèle, parmi les témoins de l’HAC1, dont dérivent les chapitres herculéens de la section IV dans l’HAC2. Nous nous inspirons en cela d’une piste qui a été ouverte par Richard Trachsler dans une étude exploratoire sur les différentes « rédactions » de l’HAC, à partir d’une comparaison d’extraits provenant à leur tour de la section IV, sur les Grecs et les Amazones10. Après avoir comparé le manuscrit P de l’HAC1a, un représentant de l’HAC2 (Paris, BnF, fr. 30111) et un représentant d’origine italienne de l’HAC1 présentant un texte composite (Vienne, ÖNB, 257612), Trachsler observe que l’HAC2 se rapproche davantage du témoin de Vienne, car ce dernier, comme le manuscrit de l’HAC2, omet les moralisations qui s’insèrent, dans P, entre l’expédition des Grecs contre les Amazones et la lutte entre Hercule et Antée ; en même temps le manuscrit de Vienne ne peut pas être le modèle de l’HAC2, car il témoigne d’une réécriture et d’une réorganisation importante de certains passages du texte qui se trouvent, en revanche, dans l’ordre attendu dans le manuscrit parisien de l’HAC213. Conclusion : « Il manque donc, pour l’instant, l’intermédiaire qui permettrait de comprendre le passage de la première à la seconde rédaction. Mais ce chaînon manquant pourrait tout à fait émerger des témoins manuscrits14. » C’est sur ce plan que nous espérons apporter quelques éclaircissements, à travers des échantillons de collation prenant en compte un nombre plus grand de manuscrits.
En supposant que l’HAC2 a vu le jour dans la première moitié du xive siècle en Italie, nous nous sommes concentrée tout d’abord sur 186des témoins de l’HAC1 datant du xiiie et du xive siècle, représentant différents « groupes iconographiques » identifiés par Doris Oltrogge, en veillant à inclure une grande partie des témoins d’origine italienne, mais également un certain nombre de témoins de provenance française et de date plus tardive, afin d’avoir un échantillon plus large et une vision plus complète de la tradition. Nous avons considéré, en particulier, la majorité des représentants du « cycle iconographique E » qui comportent la section IV (Ca, P13, P16, V et Vat dans notre table infra), du fait que ce groupe a déjà été évoqué par Fabio Zinelli comme étant potentiellement apparenté à l’état textuel de l’HAC215. Quant à l’HAC1a, nous avons regardé sept manuscrits, dont deux témoins tardifs (Ph et Re dans notre liste infra16). Précisons que notre relevé des passages concernant Hercule dans les différents témoins nous a permis dans un premier temps de vérifier la présence de variations potentielles sur le plan des épisodes. Pour ce qui concerne les témoins de l’HAC2, nous en avons retenu six, situés sur les différentes branches du stemma établi par Barbieri dans le cadre de ses études sur Prose 517. En outre, nous avons inclus deux témoins d’un état textuel mixte, qui combine le début de Prose 5 (y compris tous les éléments herculéens dans cette partie) avec la suite de l’ancien segment troyen de l’HAC118. Sont listés dans la table ci-dessous les témoins pris en compte pour nos relevés, dont nous indiquons respectivement sigle, cote, datation et lieu d’origine, contenu, feuillets où se trouvent les segments herculéens dans les sections IV et V et groupe iconographique auxquels ils appartiennent d’après Oltrogge19.
187|
Sigle |
Cote |
Date et lieu |
Contenus |
Passages sur Hercule (ff.) |
Groupe |
|
|
HAC1a |
D |
Dijon, BM, 562 |
1250-75, Acre |
I-XI |
87va-90va |
D |
|
L |
Londres, BL, Add. 15268 |
1275-1300, Acre |
I-X |
102va-106vb |
D |
|
|
P |
Paris, BnF, fr. 20125 |
1250-75, France |
I-XI |
120va-124vb |
D |
|
|
P 3 |
Paris, BnF, fr. 168 |
1375-85, Bologne |
I-VI + début VII |
107vb-110va |
D |
|
|
P 15 |
Paris, BnF, fr. 9682 |
1325-50, France |
I-XI + Exode |
106rb-110ra |
D |
|
|
Ph |
Philadelphia, Univ. of Pennsylvania, Rare Book and Manuscript Library, Schoenberg Coll. 17 |
ca 1470 |
I-XI |
118va-122vb |
||
|
Re |
Rennes, Bibliothèque Rennes Métropole, 2331 |
1474, Bretagne |
I-XI |
120va-124vb |
D |
|
|
HAC1b |
C |
Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, 1260 |
fin xiiie / début xive s., Italie |
I-VIII + début IX |
69ra-71rb |
E |
|
L 5 |
Londres, BL, Add. 19669 |
1250-75, France du nord |
I-X |
76ra-78ra |
C |
|
|
Ma |
Mâcon, Archives de Saône-et-Loire, H 362 |
xiv e s., France |
I-X + Fet Rom. |
58ra-59va |
||
|
P 5 |
Paris, BnF, fr. 246 |
1364, Paris (Mathias Rivalli) |
I-X + Fet Rom. |
48ra-49rb |
A |
|
|
P 7 |
Paris, BnF, fr. 251 |
1325-50, Paris |
II-X + Fet Rom. |
64vc-66va |
F |
|
|
P 13 |
Paris, BnF, fr. 1386 |
début xive s., Italie du sud |
III-X |
22va-25rb |
E |
|
| 188 |
P 16 |
Paris, BnF, fr. 9685 |
fin xiiie / début xive s., Gênes |
I-VIII |
87ra-89vb |
E |
|
P 18 |
Paris, BnF, fr. 1717720 |
1275-1300, France du nord |
I-VI-Brut-VII-XI |
66ra-66va |
C |
|
|
P 20 |
Paris, BnF, fr. 20126 |
xiii e s., France |
I-X |
65r-66v |
||
|
V |
Vienne, ÖNB, 257621 |
vers 1350, Venise |
I-X |
155ra-vb |
E |
|
|
Vat |
Vatican, BAV, Vat. lat. 5895 |
fin xiiie s., Gênes |
I-VII + début IX |
83vb-86ra |
E |
|
|
HAC mixte |
La |
Londres, BL, Add. 25884 |
1380-1400, Paris |
I-X |
106rb-116ra |
|
|
Px |
Paris, BnF, fr. 250 |
fin xive s., Paris |
I-X + début XI + Fet Rom. |
76ra-83va |
B |
|
|
HAC2 |
Ro |
Londres, BL Royal 20 D I |
ca 1335-40, Naples |
III-IV-Prose 5-VI-VIII-VII-X |
24va-38va |
|
|
Pr |
Paris, BnF, fr. 301 |
ca 1400, Paris |
III-IV-Prose 5-VI-VIII-VII-X |
23rb-24vb, 35rb |
||
| 189 |
St |
Londres, BL, Stowe 54 |
ca 1400, Paris |
III-IV-Prose 5-VI-VIII-VII-X |
28va-45rb |
|
|
Ch 2 |
Chantilly, Musée Condé, 727 |
xiv e-xve siècle |
II-III-IV-Prose 5-VI-VIII-VII-IX-X |
24ra-35rb |
||
|
Ox |
Oxford, Bodl. Library, Douce 353 |
ca 1470, France |
II-III-IV-Prose 5 |
29r-43r |
||
|
Os |
Osaka, Otemae University Library, 122 |
milieu xve s., France |
II-III-IV-Prose 5 (inachevé) |
22rb-31rb |
||
|
Ps |
Paris, BnF, fr. 254 |
31 juillet 1467, Paris ? |
II-III-IV-Prose 5-VI |
32vb-42va |
Sur la base de ces observations, examinons les réalisations concrètes de quelques passages herculéens dans les manuscrits en question.
Le premier portrait du héros, bien qu’il nous soit déjà connu dans son essence par l’HAC1, est un point de départ commode pour dégager les rapports entre les différents états textuels. Nous citons ci-dessous le début du passage en question d’après la version longue HAC1a (transcrit d’après P), la version abrégée HAC1b (d’après le manuscrit de Londres, British Library, Add. 19669, l’un des plus anciens témoins de cet état textuel, siglé L5) et l’HAC2 (d’après Ro)23. Nous avons mis en italique les éléments qui ne sont présents, d’après nos relevés, que dans les témoins de l’HAC1a. Les gras et les chiffres romains en exposant servent à désigner les éléments dont nous regarderons dans un deuxième temps des variantes dans notre sélection d’autres témoins. Pour chaque rédaction, une varia lectio sélective est placée en dessous de la transcription24.
|
HAC1a ( P ) |
HAC1b ( L 5 ) |
HAC2 ( Ro ) |
|
Segnor, adonques estoit Herculés en la flor de sa jovente. Cil Herculés fu fiz de la roïneI AlmeneII qui fu filleIII le* roi Laudaci, qui vint de Crete. |
Adonc estoit Herculés en la flor de sa jovente. Cil Herculés fu fil la dameI ArmeneII qui fu filzIII le roi Laudaci, qui vint de Crete. |
Adont estoit Herculés en la force de sa jouvent. Cils Herculés fu fil a le royneI ArmeneII qui fu fileIII le roy Laudati, qui vint de Crete. |
|
E bien sachés que plus fors hom ne plus hardis ne fu guaires puis le doloive que fu cil Herculés, si com on trueve en escriture. |
Et saichiez que plus forz hom ne plus hardiz ne fu puis le deluge que estoit Herculés. |
Et saciés que plus fort homme ne plus hardi ne fu puis le deluge que estoit Herculés. |
|
Et por ce dient li pluisor et tesmoignent qu’il fu samblans a Sanson de proece et de force. Herculés fist mainte merveille en sa vie, qui bien funt a reprendre et ausi fist Sansos IV. |
Et por ce dient li plusor qu’il fu samblanz a Sanson de proesce et de force, entendre autresi fist SansesIV. [ fin de la comparaison ] |
Et pour ce dient li plusour qu’il fu samblant a Sanson de forche et de proesche4. [ fin de la comparaison ] |
| 191
Mes de Sanson ne vos parlerai plus ore jusques a tant que par droiture viendra a lui li contes de l ’ estoire. Ce sera quant parlera des Hebrius, quar il fu de lor lignee. E bien sachés neportant qu ’ entre Sanson et Herculés n ’ ot mie grant tens, quar andui furent ou tans que Troie fu premerement destruite. Mes a Troie ne fu mie Sansos, quar ausi ne furent cil de sa lignee. |
||
|
Leçons rejetées |
||
|
Varia lectio I. roïne PDLP3P15PhRe |
Varia lectio ( HAC1b+mixte ) I. dame L5P5P12P13P18P20V (+Px) roine CMaP7P16Vat |
Varia lectio I. royne RoStPrPs |
|
II. Almene PDLP3P15PhRe |
II. Armene CL5P7P16P20VVat armeyne P5 armenne Ma (armenes PxLa)hermene P13 armenee P18 ane P12 |
II. Armene RoPrSt hermene OxPs |
|
III. qui fu fille PLDP3P15PhRe |
III. qui fu filz L5P12 (+ LaPx) et filz MaP7 qui fu fille CP5P13P16P20VVat ; mq. (segment réécrit) P18 |
III. qui fu file RoOxPrPsSt |
|
IV. phrase complète Herculés fist mainte merveille en sa vie, qui bien funt a reprendre et ausi fist Sansos P […] q. b. font a entendre […]LRP3[…] q. b. font entendre […] D […] qui font encores a entendre […]P15 |
IV. phrase réduite a entendre autresi fist Sanses L5CP20V (+LaPx) a. e. ausi f. s. P16 a e. autres fu s. P12 atendre ø P7 ; phrase omise MaP5P13 (segment réécrit) P18 |
IV. phrase omise RoPsOxSt ; phrase réduite Pr |
Pour commencer par un constat général, les extraits mis en regard suggèrent dès le premier abord que l’HAC2 se rapproche plus de la version abrégée HAC1b que de la version longue HAC1a. Comme il a déjà été observé, HAC1b a la caractéristique générale d’abréger et d’omettre, en particulier, les éléments moralisateurs de la version 192longue du texte25. Dans le cas du passage cité ici, il n’est pas question d’une « moralisation » au sens strict, mais d’un rapprochement entre histoire païenne et histoire biblique : l’HAC1b réduit considérablement la comparaison entre Hercule et Samson, omettant les détails à propos de la contemporanéité des deux héros et de leur appartenance à différents lignages, ainsi que l’indice selon lequel on trouve ce rapprochement en escriture. Le texte du manuscrit Ro reflète un état textuel ayant subi les mêmes abrègements, voire réduisant davantage la comparaison, ne gardant qu’une anecdote brève qui mentionne le nom du héros biblique.
Or il est possible d’affiner nos réflexions sur la position textuelle du portrait herculéen dans l’HAC2 à la lumière de la tradition manuscrite, en considérant tout d’abord un échantillon de variantes dans ce même extrait. On constate, par exemple, que tous les témoins de la version abrégée HAC1b partagent une forme moins « correcte » du nom d’Alcmène, mère d’Hercule : au lieu d’Almene (variante commune à tous les témoins de l’HAC1a pris en compte), ils ont une forme en r du type Armene, qui subsiste également dans les témoins de l’HAC2. Un tel cas de variation à lui seul ne dit que peu sur les rapports entre les textes, mais quand on le considère à l’intérieur d’une série de variantes communes, il ne fait que renforcer l’impression que l’HAC2 se rapproche davantage de l’HAC1b que de l’HAC1a. Il est possible, en outre, de cibler à l’intérieur des témoins de l’HAC1b des manuscrits qui paraissent textuellement plus proches de l’HAC2 que d’autres. L’absence de connaissances de la part des copistes et « rédacteurs » (et, en général, des écrivains) médiévaux à propos des personnages mythologiques en jeu et de leurs rapports généalogiques a provoqué dans certains témoins de l’HAC1b, dont le manuscrit L5 à partir duquel nous avons transcrit le segment, une variante faisant d’Alcmène le « fils de Laudaci », ce qui correspond à un état de corruption plus avancé dans la chaîne de transmission des données. Les témoins de l’HAC2 ne comportent pas cette erreur supplémentaire. Ils ne comportent pas non plus la variante, présente dans certains témoins de l’HAC1b, faisant de la roine Armene une dame Armene. On ne devrait évidemment pas attacher de grande signification à des erreurs faciles à commettre et à des variantes adiaphores, surtout lorsqu’elles sont isolées. Si l’on considère cependant, dans ce cas particulier, les témoins de l’HAC1 qui partagent avec l’HAC2193chacune des trois variantes textuelles que nous venons d’évoquer dans ce paragraphe26, on arrive à un constat intéressant : on a affaire à trois témoins – Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, 1260 (C), Paris, BnF, fr. 9685 (P16) et Vatican, BAV, Vat. lat. 5958 (Vat) – tous d’origine italienne, datant de la fin du xiiie ou du début du xive siècle, tous des représentants du « groupe iconographique E27 ». Or, comme l’a déjà suggéré Fabio Zinelli, un témoin de ce groupe iconographique pourrait avoir été le chaînon transitionnel entre l’HAC1 et l’HAC228.
Ce constat nous invite à approfondir encore un peu la question. En effet, d’autres passages dans la suite de la section IV, parlant toujours d’Hercule et de Thésée, fournissent des données intéressantes. Le passage cité ci-dessous se situe à la fin de la section IV, commençant par une observation générale à propos des autres créatures féroces dont aucune ne pouvait faire peur à Hercule, en se poursuivant ensuite sur des exploits de son compagnon Thésée et les descendants de ce dernier29.
|
HAC1a ( P ) |
HAC1b ( L 5 ) |
HAC2 ( Ro ) |
|
E bien sachés qu’il fist mout de proeces autres, quar il ne doutoit rien ne lion ne serpent ne nulle autre beste, tant fust crueuse ne orrible. Segnor, et bien sachés que Theseüs, ses compains, fu ausi mout preus, quar ce fu cil dus qui destruist |
Et saichiez que il i fist maintes autres proesces, car il ne doutoit riens, ne serpant ne autre beste, tant fust crueuse. Et sachiez que Theseüs, ses compainz, fu ausi moult preuz, car ce fu cil dus qui destruit ThebesI, |
Et sachiés qu’il fist moult d’autres proesces, car il ne doutoit riens, ne serpens ne autres bestes, tant fuissent crueuses. Et saciés que Theseüs, ses compains estoit ausi moult preus, car il occist celui duc qui destruist ThebesI, et si comme vos |
| 194
Thebes I, si com je vos a conté ariere. Et si ocist un jaiant ausi, Quacus ot a non. Mes teus i a qui dient que Herculés l’ocist, qui bien le peut faire. |
ensi com vos avez oï. Et si occist ausi un jaiant qui ot non Tatus. |
avés oï dire ci arieres. Et si occist aussi un jaiant qui ot nom Cacus. |
|
Si ot Theseüs un fill de sa feme YppoliteII qu’il amena d’Amazone. Cil ot a non Yppolitus, encontre sa mere. |
Et ot Theseüs .i. fil de sa fame YpoliteII, qu’il amena de Mazone, qui ot non Ypolitus. |
Theseüs ot un fil qui fu de sa femme YpoleII la quele il amena d’Amasoinne, qui ot nom Ypositus. |
|
Varia lectio I. quar ce fu cil dus qui destruist Thebes PLP3 car c. f. cellui duc q. destruisit Thebes Re |
Varia lectio ( HAC1b+mixte ) I. car ce fu cil dus qui destruit Thebes L5MaP20P7P18P12PxLa car cil furent ses .ij. qe destruistrent thebes P13 car il occist cil dus que destruit Thebes CP16VVat hercules fu cilz dux qui destruit thebes P5 |
Varia lectio I. car il occist celui duc qui destruist Thebes RoStCh2PsOx car ce fut ce duc qui destruist Thebes Pr |
|
II. Yppolite P hippolite Re ypolite LP3 |
II. Ypolite L5P20P13VP12Px ypolipe P5 ypolippe MaP7 ypole CP16Vat ypolites La ; mq. (segment réécrit) P18 |
II. Ypole RoStCh2Os ypolite PrPsOx |
Les extraits comportent non seulement une nouvelle série d’omissions et de variantes communes à l’HAC1b et l’HAC2, mais également deux erreurs conjonctives reliant certains témoins de ces deux états textuels, y compris Ro, l’archétype supposé de l’HAC2. Nous proposons dans la suite quelques remarques à propos des lieux relevés30 :
195–L’exemple 1 implique une erreur à propos de Thésée. Dans l’HAC1a et dans la plupart des manuscrits de l’HAC1b, on attribue à ce dernier la destruction de Thèbes. La grande majorité des manuscrits de l’HAC2, cependant, partage avec C, P16, Vat ainsi qu’avec V une variante erronée qui fait de Thésée non « le duc qui détruisit Thèbes » mais « celui qui tue le duc qui détruisit Thèbes », ce qui suggère fortement qu’ils sont apparentés, car on voit mal surgir une telle erreur par polygenèse. Il est intéressant de noter dans ce contexte que Pr (Paris, BnF, fr. 301) fait exception, présentant une leçon « correcte » qui s’appuie à cet endroit, selon toute vraisemblance, sur un autre manuscrit de la tradition31. Cela suggère que si Ro est bien l’archétype vivant de l’HAC2, il n’est pas nécessairement le modèle unique de tous ses descendants, comme cela a déjà été noté par Barbieri32.
–L’exemple 2 se situe aussi dans le passage relatif à Thésée, au moment où l’on apprend que ce dernier a eu un fils de l’Amazone Hippolyte. Les trois manuscrits C, P16 et Vat de l’HAC1b appellent l’Amazone par erreur Ypole à cet endroit. La même forme fautive est présente dans quatre manuscrits de l’HAC2, dont Ro. Que d’autres témoins de l’HAC2 aient corrigé l’erreur s’explique dans ce cas facilement par la présence répétée du nom de l’Amazone en question dans les passages précédents. En l’occurrence, la persistance même de l’erreur en question, facile à remarquer et à corriger, renforce davantage la probabilité que le modèle de l’HAC2 soit à rattacher aux témoins nommés de l’HAC1b.
Avant de tirer les conséquences de ces témoignages, on se permettra d’évoquer un dernier cas de figure situé également dans la section IV, qu’avait déjà mentionné Richard Trachsler dans son étude citée supra à propos des rédactions de l’HAC33. Après la victoire d’Hercule sur les Amazones, on apprend que Penthésilée fut la prochaine à accéder au trône, alors que Synope revenait de ses conquêtes : A cesti revint Synope, 196[l]a fille la roïne Marpesia, dont je vos ai parlé ariere34. Comme Trachsler l’avait constaté en regardant Ro, la proposition A cesti revint Synope a fait l’objet d’une mauvaise lecture dont on retrouve l’écho dans ce témoin particulier de l’HAC2 – a ceste reine Synope – ce qui donne lieu à une phrase agrammaticale, où manque le verbe. En ajoutant la varia lectio des autres témoins pris en compte jusqu’ici, nous observons des solidarités tout à fait semblables à celles des exemples évoqués plus haut :
A cesti revint Synope]PL5P20 a ceste r. synope [cynape P12]LPhP13P5P12apres ceste r. synope P3 a ceste r. synope VPxLa a ceste reuint scisiope Ma a ceste royne syciope P7a ceste roine sinope[synepe Vat synope Pr synoppe Ps synape RoSt]CP16Vat, RoPrStCh2Ps ; réécrit Et ceste royne Synope (fut fille…) Ox
L’erreur présente dans Ro se retrouve dans ce cas dans tous les autres témoins de l’HAC2 pris en considération, ainsi que dans les trois témoins italiens C, P16 et Vat, ce qui renforce encore l’hypothèse que la « deuxième rédaction » se rattache à un manuscrit de cet ensemble ou à un témoin apparenté.
Notre échantillon d’exemples, certes réduit, suggère que l’HAC2 se rattache, dans les passages étudiés, à l’HAC1b, plus spécifiquement aux manuscrits du groupe iconographique E, comme cela a déjà été suggéré par Fabio Zinelli35, et peut-être surtout aux deux témoins génois P16 et C ainsi qu’à Vat. L’une des erreurs mentionnées précédemment – Thésée qui tua le duc qui détruisit Thèbes – se trouve dans le manuscrit V, autre représentant du cycle iconographique E, qui témoigne cependant d’un état textuel hybride36. De manière générale, les données soulignent la présence de témoins ayant pu recourir à plusieurs modèles. On pense à Pr en particulier37, qui n’est visiblement pas un simple descriptus de Ro, mais qui a mis à contribution d’autres modèles, comme cela a déjà été constaté par Barbieri pour d’autres parties du texte38. Dans nos passages, nous constatons spécifiquement que dans tous les exemples où Pr197diverge du modèle de Ro, il s’aligne avec des témoins de la version mixte de l’HAC. Finalement, les passages pris en considération permettent de souligner que si certains éléments disparaissent dans le passage de l’HAC1a à l’HAC1b, et qui manquent ensuite dans l’HAC2, la plupart des composantes herculéennes – comme a pu aussi le montrer l’étude de Trachsler pour d’autres passages de la même section – ne changent pas dans leur essence dans cette partie du texte entre l’HAC1b et l’HAC2. En effet, ces derniers sont si étroitement apparentés que l’on peut considérer qu’ils donnent le « même texte » dans les passages concernés. Le premier portrait d’Hercule dans l’HAC2 – et, en général, les épisodes herculéens dans la section IV de l’HAC2 – reprend celui de l’HAC1b.
Cela change toutefois lorsqu’on passe à la section troyenne, dans laquelle on retrouve le deuxième et le troisième « portrait » d’Hercule dont nous avons cité des extraits supra39. Nous n’allons pas entrer dans les détails pour évaluer cette section dans son ensemble, mais nous nous concentrerons exclusivement sur la présence d’Hercule, notamment ses « portraits » et leur entourage textuel immédiat. Alors que dans l’HAC1 (a et b) Hercule fait sa première apparition dans la section V au moment où il rejoint les Argonautes quand ces derniers partent de Grèce (E la fu Herculés ave[c] Jason en compaignie40), l’auteur de Prose 5 le présente plus tôt, au moment où Peleüs convoque Jason à sa cour afin de le persuader de partir à la quête de la toison d’or. Le passage en question s’appuie, comme cette adaptation du récit troyen en général, non pas sur Darès, mais davantage sur la première mise en prose connue du Roman de Troie (ou Prose 141) :
|
Prose 1 |
HAC2 ( Ro ) |
|
Jason meïsmes i fu et Herculès, qui son compaignon estoit. Et dit l’en que cesti Herculès fu celui qui ficha les bones, ce sunt les columpnes de pierres, la ou rei Alixandre les trova, et autres granz merveilles fist il assés. |
Jason meismes i fu et Herculés ses compains. Et dit on que ce fu cestui Herculés qui ficha les coullonnes que Alixandre trouva et qui fist moult d’autres grans merveilles selonc ce que li aucteur racontent. |
L’auteur de Prose 5 reformule certains éléments, en optant pour des constructions plus concises, et en ajoutant qu’il relate les informations selonc ce que li aucteur racontent. Le passage ne nous permet pas de savoir si le compilateur de l’HAC2 s’est rendu compte de la duplication de portraits qu’il faisait en ajoutant ce segment. A-t-il vu dans cet Hercule compagnon de Jason un autre que l’Hercule compagnon de Thésée dont il vient de parler – d’autant plus qu’il précise : et dit on que ce fu cestui Herculès, impliquant qu’il a pu y en avoir plusieurs. Quoi qu’il en soit, on a l’impression qu’il reproduit ici une sorte de noyau d’information qui s’est « sédimenté » à travers la tradition antérieure du Roman de Troie qui se croise dans cette section avec celle de l’HAC. Le fait qu’Hercule aurait établi les « colonnes » qui n’ont été dépassées que par Alexandre le Grand subsiste comme élément de savoir accepté, voire conventionnel, qui se passe de toute précision ultérieure42.
Conformément au récit de Prose 1, suivant le modèle de Benoît de Sainte-Maure, Hercule acquiert un rôle plus notable et plus impliqué dans cette version du récit que dans l’HAC1a/b, s’insérant dans le cadre d’une narration plus développée et plus « romanesque ». Cette présence se manifeste à divers endroits de la narration que l’on connaît déjà du Roman de Troie. Le moment où les Grecs sont chassés par Laomédon après être arrivés près de Troie est élaboré en une rencontre faisant intervenir un messager qui informe les Argonautes du mécontentement du roi troyen et auquel Hercule adresse des paroles menaçantes, préfigurant le retour des Grecs et le destin funeste de la cité d’Asie Mineure : Va, dist il, et di a ton seigneur que ains que lonc temps passe, nous enterrons sus sa terre en telle maniere que il ne le pourra amender43. Qu’Hercule lui-même soit une force – et un acteur – avec lequel il faut compter se reflète également dans la suite du texte, entre autres quand il se met à haranguer les Grecs pour se mobiliser contre les Troyens (Et meesmement Herculés en fist grans paroles et moustra a tous ses amis le grant outrage des Troiens44), quand il expose minutieusement sa tactique pour duper l’armée de 199Laomédon et pour conquérir la ville de Troie45, et surtout lorsqu’il est décrit chevauchant vers le roi ennemi Laomédon46 :
Si estoit [= Herculés] montés sus .i. merveilleus cheval, le branc d’acier en sa main, dont il fesoit merveilles, car maintes fois coupoit le cheval outre et faisoit d’un chevalier .ii. parties, et ne trouvoit nus qui son coup osast atendre. Si est tant avant alé en la presse que il encontra le roi Laomedon et li va tel coup donner que il li fist la teste voler en terre devant toute sa gent.
Ce n’est pas une image qui se trouve en décalage avec celle de l’épisode troyen selon l’HAC1, mais qui est bien plus explicite. Doté d’un esprit vengeur, Hercule se présente ici (comme déjà dans Prose 1 dont proviennent les éléments évoqués jusqu’ici47) comme un stratège militaire et un guerrier redoutable, qui avance implacablement vers son adversaire et dont la présence même semble jeter une ombre terrifiante sur l’armée ennemie.
La notoriété qu’acquiert Hercule dans le contexte de cette dernière narration va de pair avec l’amplification du segment qui relate la fin de sa vie, situé peu après le retour des Grecs en leurs terres. En effet, à la place de l’anecdote brusque évoquant sa mort par le feu selon l’HAC1, le rédacteur de Prose 5 lui fait l’honneur d’un dernier portrait. Celui-ci se situe dans un chapitre à part qui est censé traiter De la mort Herculés, ou, comme on lit en rubrique dans deux témoins du texte, Des merveilles de Herculés, et comme il mourut48. On se permet de citer ici une nouvelle fois les premières lignes de ce chapitre49.
200Herculés fu fils Jupiter, et out non sa mere Hermena qui fu fame au roy Amphitrion. Quant Herculés fu grans et parcreus, si ala par diversses parties du monde et fist de grans merveilles qui sont escrites el livre de sa vie. Il vainqui Ancheüs et planta les coullones outre la grant mer. Et si vainqui Euchonius, li fils Vulcanus, qui premiers trouva la charrete. Et en cel temps meïsmes crut si le flume de Ducalion qui par deluge noia la cité qui fu desous le chastel de Voltrento. Et l’aouroient la gent du païs comme dieu, car l’en ne trouva onques homme ne beste ne giant qui le peüst rendre vaincu.
Curieusement, le segment qui est censé raconter la fin d’Hercule commence par un rappel de sa vie et de ses faits, qui n’est pas sans répéter des informations fournies déjà plus haut. À l’observation qu’Herculés fu fil a le royne Armene qui fu file le roy Laudati50, faite dans la section IV sur les Grecs et les Amazones, la phrase introductive de ce chapitre de Prose 5 offre une sorte d’écho approximatif, plus complet, disant qu’Herculés fu fils Jupiter, que sa mère s’appelait Hermena et qu’elle fut femme du roi Amphitrion. On entend ensuite parler à nouveau – comme on l’a déjà appris au début de la section troyenne dans la partie reprise à Prose 1 – des colonnes d’Hercule et des grans merveilles qu’il a accomplies. Certaines de ces merveilles sont nommées : on retrouve la mort d’Antée (qui était narrée in extenso dans la section IV), à côté de la mention d’Euchonius, li fils Vulcanus. Ce dernier sert à son tour de lien vers une contextualisation historique, fortement brouillée, car non seulement Hercule n’est pas censé avoir vaincu un tel Euchonius, mais il n’existe pas a priori de « fleuve de Ducalion » ni de « château de Voltrento51 ». La phrase conclusive de l’extrait cité introduit l’idée – nouvelle dans le texte concerné – qu’Hercule fut considéré comme divinité par la gent du païs, du fait qu’aucun homme ni bête ni géant ne pouvait le vaincre.
On ne sait pas à quelle source renvoie le livre de sa vie dans lequel on est censé trouver les éléments biographiques évoqués dans le segment. Luca Barbieri, qui a proposé quelques observations à propos du passage, indique comme source une « Estoria di Ercole » non spécifiée, en suggérant que l’Ovide moralisé pourrait être le texte cible, du fait que les événements relatés dans la suite du chapitre, sur la mort du héros, résonnent dans l’adaptation française des Métamorphoses52. Cela n’est 201pourtant pas le cas des phrases initiales du segment que nous chercherons à éclairer davantage ici. Il est en effet possible, en décortiquant le passage, d’identifier plusieurs sources (au moins indirectes), et de mieux comprendre quelques éléments a priori énigmatiques.
Certains éléments dans l’extrait, on l’a mentionné, font écho à la présentation du héros remontant à Prose 1, lorsqu’Hercule est introduit comme compagnon de Jason au début du récit troyen. Or les résonances avec ce dernier passage ne sont, selon toute vraisemblance, pas fortuites. Notre portrait final semble en effet mettre à contribution le passage correspondant d’une autre adaptation dérivant de la même source lointaine, l’Historia destructionis Troiae de l’écrivain de Messine Guido delle Colonne, qui a vu le jour vers la fin du xiiie siècle et qui constitue une mise en prose latine du récit de Benoît. Il est éclairant de mettre en parallèle les phrases de Guido pour introduire Hercule et le début du dernier portrait d’Hercule dans Prose 5, en mettant en gras les parallèles, et en italiques les éléments comparables mais qui ne correspondent pas entièrement53.
|
Guido delle Colonne, |
HAC2 / Prose 5 |
|
Inter quos fuit ille uir uere fortissimus et fortis Hercules nuncupatus, natus, ut scripsere poete, ex Ioue et Alcmena, Amphitrionis vxore. Hic est ille Hercules de cuius incredibilibus actibus per multas mundi partessermodirigitur. Qui sua potentia infinitos gigantes suis temporibus interemit et in ulnis propriis eleuatum, intollerabili strictura factum exanimem, fortissimum confregit Antheum. […] Sed quia suorum actuum longa narratio poetarum longa expectatione animos auditorum astraheret, ista de eo sufficiant tetigisse, cum et rei ueritas in tantum de sua uictoria acta per mundum miraculose diuulget quod usque in hodiernum diem usquequo uictor apparuit columpne Herculis testentur ad Gades. […]Vltra quas non est locus adhibilis, cum sit mare magnum, occeani uidelicet, […] |
Herculés fu fils Jupiter, et out non sa mere Hermena qui fu fame au roy Amphitrion. Quant Herculés fu grans et parcreus, si ala par diversses parties du monde et fist de grans merveilles qui sont escrites el livre de sa vie. Il vainqui Ancheüs et planta les coullones outrela grant mer. |
Prose 5 abrège et ne comporte pas tous les éléments présents chez Guido, mais, inversement, tous les noyaux d’information évoqués dans le texte français sont présents dans le texte latin : la généalogie plus complète du héros, ses faits merveilleux, sa victoire sur Antée, ses colonnes. La version française adapte certains détails (volontairement ou par mauvaise interprétation) : plutôt que les merveilles d’Hercule qui sont connues partout (cuius incredibilibus actibus per multas mundi partes sermo dirigitur), c’est le héros lui-même qui a traversé le monde, et il a dressé ses colonnes outre la « grande mer » plutôt qu’à l’extrémité des terres au-delà desquelles commence l’océan. Compte tenu de ces détails adaptés de manière très libre, il paraît même légitime de se demander si le « livre de sa vie » mentionné dans le texte français est censé renvoyer à un vrai texte unique et spécifique, ou si c’est simplement une manière d’adapter l’idée de la longa narratio poetarum dédiée à ses exploits.
Notons que certaines informations présentées en amont dans l’HAC2, d’après une autre version du récit troyen, se trouvent reprises à cet endroit dans Prose 5, ce qui donne lieu à un dédoublement des informations. Mais avant de tenter d’expliquer ce phénomène, il convient de faire quelques observations préliminaires sur la suite du passage dans Prose 5 : cette suite (voir les passages cités ci-dessous) propose en effet de contextualiser certains exploits du héros avec des événements de l’histoire ancienne, et cela d’une manière qui rappelle non seulement le format des chroniques, mais qui présente des parallèles de contenu avec certaines œuvres spécifiques. Considérons la suite du texte dans Prose 5 à côté d’un passage de l’Historia scholastica, l’œuvre dans laquelle nous avons identifié les plus nettes ressemblances, ce qui nous permet de relever d’autres éléments qui n’ont éventuellement pas été bien compris par l’écrivain français. Nous utilisons des gras et des italiques dans les deux passages afin de relever les correspondances54.
|
Historia scholastica |
HAC2 / Prose 5 |
|
Dicitur etiam diluvium in Thessalia factum sub Deucalione, et incendium sub Phaetonte circa tempora Moysi, et sub eo Hercules Antheum vicit. Erictonius filius Vulcani currum, et Troilus primus quadrigam junxisse feruntur. |
Et si vainqui Euchonius, li fils Vulcanus, qui premiers trouva la charrete. Et en cel temps meïsmes crut si le flume de Ducalion qui par deluge noia (la cité qui fu desous le chastel de Voltrento). |
Comme Luca Barbieri l’a déjà souligné, le fils de Vulcain auquel est attribuée l’invention du quadrige (la charrete) est Érichthonius, nommé Euchonius dans Prose 555. S’il n’est pas censé avoir été vaincu par Hercule, le fait qu’Hercule ait assommé un autre fils de Vulcain, Cacus, a cependant pu jouer un rôle dans la genèse de cette anecdote confuse, comme le suggère également Barbieri56. En considérant le passage de l’Historia scholastica,on arrive mieux àexpliquer la confusion. Comme dans la traduction française, Erictonius est mentionné par Pierre le Mangeur directement après la victoire d’Hercule sur Antée (voir la phrase précédente de Prose 5, citée plus haut, qui s’inspire peut-être de Guido delle Colonne). On peut bien s’imaginer comment un traducteur voyant filius Vulcani dans l’entourage immédiat d’une phrase du type Hercules […] vicit a pu lier les deux informations. La confusion paraît d’autant plus plausible si l’on tient compte de la phrase suivante du passage français, qui implique une autre erreur manifeste : le flume de Ducalion, dont la cruenoie la cité comme sous un deluge, évoque le souvenir lointain et déformé du diluvium[…]sub Deucalione mythologique invoqué au même endroit dans l’Historia scholastica pour ancrer le héros dans une réalité « historique ». En enchaînant, en associant et mélangeant les différents éléments, le passage réécrit pour ainsi dire une histoire factice autour d’Hercule.
C’est probablement cette même logique d’associations fictives et de déformations de noms qui a produit le seul élément du passage de Prose 5 pour lequel on ne trouve pas d’explication en consultant d’autres sources : l’énigmatique cité qui fut desous le chastel de Voltrento, dont le nom sonne – comme l’a observé Barbieri57 – curieusement italien. Il n’est en effet pas sans rappeler le nom de Castel Volturno, qui n’est situé qu’à une trentaine de kilomètres de Naples, où fut probablement 204rédigée l’HAC2 et où s’élevait dès le Haut Moyen Âge un château fortifié surplombant la localité située sur le fleuve Volturno (d’où le toponyme). L’idée d’associer, à travers ce portrait, le déluge mythique à une inondation (fictive ?) de cette cité de Campanie répondra elle aussi à un projet de rattacher l’histoire mythologique à l’histoire locale, peut-être avec un clin d’œil voulu ; car on ne sait en effet pas si la déformation des données évoquées est accidentelle ou intentionnelle.
Suivant cette lecture, on arrive aussi à mieux contextualiser la dernière phrase du passage cité, selon laquelle la gent du païs vénéraient Hercule comme divinité. Cette idée peut en effet être un écho du pan « italique » du mythe d’Hercule, dont la traversée de l’Italie et notamment le séjour auprès du roi Évandre furent marqués par l’institution consécutive de son culte au Latium. Ajoutons, afin d’étayer cette hypothèse, que d’autres textes historiographiques (latins) antérieurs à la rédaction de l’HAC2 renvoient explicitement à cet épisode et au culte d’Hercule dans la région en question dans des segments où ils traitent de la mort du héros. Tel est le cas notamment du Speculum historiale de Vincent de Beauvais, qui fait suivre un chapitre De Jepte et Hercule, où la mort d’Hercule est mise en contexte avec l’histoire biblique, par un segment emprunté à Albericus (le Mythographe III du Vatican) qui traite spécifiquement de l’épisode d’Hercule auprès d’Évandre. Citons le début du chapitre en question58 :
Hercules devicto Ierione [ = Gerione ] veniens Ytaliam, ab Evandro tunc rege susceptus est. Et cum se Iovis filium dixisset, et morte Cati [ = Caci ] virtutem suam probasset, pro numine habitus est et aram meruit que maxima dicta est et ei data est.
« Ayant vaincu Géryon, Hercule, à son arrivée en Italie, fut accueilli par Évandre, qui régnait alors. Et comme il se disait fils de Jupiter et prouva sa force par la mort de Cacus, il fut admis en tant que dieu et mérita un autel, qui fut appelé (ara) maxima, et celui-ci lui fut dédié. »
Cet épisode n’est évidemment pas évoqué explicitement dans l’HAC2, mais il n’est pas invraisemblable que l’auteur du texte ait connu et ait peut-être eu en tête le passage concerné ou un passage semblable quand il a construit son chapitre sur la mort d’Hercule.
Dans son ensemble, le dernier portrait d’Hercule ressemble à un collage de voix auctoriales. Les diverses « histoires » que nous avons évoquées dans les pages précédentes – l’Historia destructionis Troiae, l’Historia 205scholastica et le Speculum historiale – étaient tous les trois des textes très diffusés, d’autorité et d’actualité quand l’HAC2 et Prose 5 ont été rédigés. Il est envisageable que l’auteur se soit inspiré de ces diverses sources afin de compiler son chapitre, en tissant un fil d’associations et en créant sa propre translatio autour d’Hercule, passant symboliquement de Troie en Italie. Évidemment, il est loin d’être certain qu’un tel projet fût bien dans l’intention de l’auteur. Le constat nous invite cependant à jeter un regard également sur la suite du chapitre. Après tout, les lignes que nous venons d’examiner servent d’introduction au récit sur la fin d’Hercule. Ce récit sur la mort du héros est nouveau par rapport non seulement à la tradition de l’HAC1, mais aussi par rapport aux différentes histoires latines évoquées précédemment. Plutôt que de mentionner en anecdote succincte qu’Hercule se jette au feu afin de se délivrer des souffrances d’une « maladie », l’auteur de Prose 5 ajoute sa propre adaptation des péripéties autour de Déjanire, Nessus et de la chemise empoisonnée. Le segment dans son ensemble peut se lire chez Luca Barbieri, ainsi que dans l’édition récente de Prose 5 par Anne Rochebouet59. Nous aborderons ici le passage en en citant des extraits à la base du manuscrit Ro60.
À l’instar des lignes qui le précèdent, le récit en question fait apparaître de nouveaux noms et informations légèrement déformés. Nessus est devenu Nexustaurus (et parfois Nexumtaurum et, encore ailleurs, simplement Nexus), Déjanire est Degermir(r)a, et Iole est Hyloes. Le centaure semble, par ailleurs, faire l’objet d’une confusion avec le Minotaure, car on lit qu’il estoit moitié buef et moitié home61. On apprend aussi que Degermirra amoit moult Nexumtaurum, ce qui ne correspond pas à la version « reçue » du mythe, où il n’est pas question d’une complicité entre elle et Nessus. Pour résumer les éléments centraux de la trame : Hercule prend pour femme Degermirra (une dame moult bele). Un jour, il rencontre un énorme serpent (si grant et si merveilleus que il mengioit .i. buef) qu’il abat de l’une de ses flèches62. Il 206arrive ensuite auprès d’une grant riviereforte et roide que sa femme ne peut traverser. Voyant Nexumtaurum, Hercule prie ce dernier de la passer – ce que l’être hybride fait volontiers, essayant ensuite de s’accoupler avec elle alors qu’Hercule est de l’autre côté de l’eau63. Hercule enrage, prend la flèche avec laquelle il a tué le serpent et frappe Nexumtaurum à la cuisse. Se sentant blessé à mort, ce dernier pense à se venger, s’adressant à Déjanire et lui disant qu’il veut lui donner .i. precieus don64 :
Pren, dist [il], ta chemise et la baigne en mon sanc et la guarde. Et quant Herculés, ton mari, sera courrouciez avec toi, si li fai ceste chemise vestir, et tantost que il l’ara vestue, il sera reconciliés o toi et t’ara plus chiere que il n’out onques. Ceste vertu a mon sanc.
Déjanire suit le conseil de Nexus et garde la chemise en cachette, jusqu’au jour où Hercule s’éprend d’une autre dame, Hyloes. Degermirra se souvient alors du vêtement et le donne à son mari. Dès qu’il revêt l’habit, Hercule est frappé d’une grant chaleur qu’il ne peut pas supporter. Afin de s’en libérer, il entre dans une fournaise ardant, mettant ainsi fin à sa vie.
Ce développement à propos des derniers événements de la vie d’Hercule rappelle, comme l’a déjà observé Barbieri, l’Ovide moralisé, et plus précisément le livre IX de l’adaptation ovidienne, où l’on retrouve le même épisode narré en détail65. On peut ajouter un indice parlant à cet égard, sur le plan de l’iconographie. Le manuscrit Ro comprend dans la marge inférieure du feuillet 38r, où commence le chapitre sur la mort d’Hercule, des illustrations de deux moments spécifiques du récit : à gauche, on voit Hercule venant de frapper de sa flèche une créature ressemblant à un dragon (sans doute le serpent du récit) ; à droite est représenté Nexustaurus, pareillement blessé, alors qu’il essaie d’enlever la femme d’Hercule. Le fait que le séducteur de Degermirra représenté en image soit bien un centaure et non un hybride homme-taureau, comme le spécifie le texte, s’explique par le fait que l’enlumineur du manuscrit a repris un motif déjà en circulation. Le même motif apparaît en effet, entre autres, dans le 207témoin le plus ancien de l’Ovide moralisé, Rouen, Bibliothèque municipale, O.4, où il accompagne le récit correspondant du livre IX de l’adaptation ovidienne66. De plus, la créature représentée dans la scène à gauche dans Ro rappelle une autre miniature du manuscrit rouennais de l’Ovide moralisé, censée illustrer le combat d’Hercule contre Achéloüs sous forme de serpent, marquant en même temps le début du livre IX. Les illustrations (reproduites ci-dessous) suggèrent que l’enlumineur de Ro a pu connaître et s’appuyer sur l’iconographie présente dans un témoin de l’Ovide moralisé.

Fig. 2 – Ms. Londres, BL, Royal 20 D I, f. 38r : Hercule tue un serpent (à gauche) ; enlèvement de Degermirra par Nexustaurus (à droite). Original Source British Library, Royal 20 D I, f. 38r.


Fig. 3 et 4 – Ms. Rouen, BM, O.4 (Ovide moralisé), f. 226ra : Hercule luttant contre Achéloüs sous forme de serpent (à gauche) ; f. 228ra : enlèvement
de Déjanire par Nessus (à droite). © BnF – Bibliothèque municipale de Rouen.
Cependant, le contenu textuel de l’épisode selon l’HAC2 fait apparaître des éléments qui nous amènent à remettre en question l’idée que l’auteur de Prose 5 se soit inspiré de l’Ovide moralisé pour adapter le passage. Une partie des discordances pourraient, certes, être des innovations de la part de l’auteur, telle l’attitude de Degermirra qui, dans l’HAC2, est censée aimer celui qui l’enlève, alors qu’elle est moult cremetureuse […] / pour la laidour dou centour dans l’Ovide moralisé67. Ajoutons que le héros atteint le séducteur de sa femme à la cuisse, alors que l’adaptation d’Ovide nous dit que [p]armi le pis l’a trespercié68. Ce sont des innovations qui semblent érotiser l’ensemble de l’épisode dans l’HAC2, présentant l’intrigue Hercule-Déjanire-Nessus comme véritable triangle amoureux, en mettant en avant l’image d’Hercule comme victime de l’amour69. D’autres éléments suggèrent plus particulièrement que l’auteur s’est appuyé sur une source autre que l’Ovide moralisé dans le passage en question. Le récit préliminaire à propos du combat d’Hercule contre le serpent en fait partie, car il est absent de l’adaptation moralisée des Métamorphoses, alors qu’il fait bien partie de l’intrigue mythologique sous-jacente. En effet, si les liens entre les événements ne sont pas explicités dans l’HAC2, il semble évident, comme l’a déjà noté Barbieri, que le serpent est censé être l’hydre et que ce premier combat est mentionné parce qu’il détermine l’issue de l’intrigue : quand Hercule retire la flèche du corps de l’hydre, elle est teintée du poison qui provoquera la mort de Nessus et, plus tard, celle d’Hercule, lorsqu’il revêtira la chemise tâchée du sang du centaure70. Rien de cela n’est dit explicitement dans l’Ovide moralisé. On peut aussi observer que les noms Degermirra et Hyloes paraissent bien plus corrompus qu’ils ne le sont dans tous les témoins de l’Ovide moralisé. On ne peut évidemment pas exclure que l’auteur de l’HAC2 ait intentionnellement ajouté des touches fantaisistes à son récit (comme il a pu le faire dans les lignes précédentes), mais on peut aussi relever le cas intriguant de Nexustaurus, qui apparaît aussi sous une forme pseudo-accusative, Nexumtaurum. Il pourrait s’agit là d’une sorte d’indice de latinité ou un écho latinisant voulu par l’auteur. On peut toutefois aussi se demander si le compilateur de l’HAC2 avait à 209sa disposition une autre source spécifique du récit, d’où il a pu tirer certains de ces éléments de contenu et de forme.
Il serait donc intéressant de continuer d’enquêter sur ce passage. Nous n’avons pas pu localiser un texte spécifique antérieur à l’HAC2 qui fournit toutes les données qui nous intéressent. Nous nous permettons néanmoins d’esquisser une piste à explorer. Comparé au développement de l’intrigue autour de Nessus et Déjanire dans les Métamorphoses et l’Ovide moralisé, le passage dans Prose 5 est considérablement abrégé. Nos observations précédentes suggèrent en même temps qu’il pourrait s’appuyer sur un texte se rattachant à la « tradition ovidienne ». Or dans les commentaires latins d’Ovide d’origine française que nous avons considérés dans ce travail, le passage est, certes, glosé, mais nous n’avons pas identifié des parallèles très parlants avec les particularités de l’épisode dans Prose 571. Nous avons toutefois découvert des données intéressantes dans une autre tradition de paratextes, d’origine italienne et ayant débuté, comme Prose 5, dans les premières décennies du xive siècle, qui renvoient systématiquement à l’épisode ovidien en question. C’est parmi les commentaires sur la Divine Comédie de Dante que l’on trouve des gloses comme celle citée infra, en rapport avec des vers du chant XII de l’Enfer où sont mentionnés plusieurs centaures, dont Nesso, / che morì per la bella Deianira, / e fé di sé la vendetta elli stesso72. Issue d’un commentaire rédigé vers 1360 et attribué à Pietro Alighieri, l’un des fils de Dante, la glose suivante comporte plusieurs échos intéressants à l’égard du passage dans l’HAC2, surtout dans la portion que nous avons notée en gras73 :
210Modo veniamus ad dicendum de hiis Centauris [ … ] nominando inter alios dictum Nexum, qui mortuus est pro Dyanira et, sic mortuus, se vindicavit de Hercule eius occisore, ut dicit textus hic, de cuius ystoria Ovidius scribit in viiii o , inter alia dicens quod Hercules, dum semel devenisse cum Dyanira, eius uxore predicta, ad Eubenum flumen, fecit transportari dictam eius uxorem per hunc Nexum centaurum ad aliam partem dicti fluminis, quam, sic transportatam, dictus Nexus carnaliter voluit cognoscere, unde dictus Hercules eum sagiptavit et vulneravit ad mortem venenata sagipta sanguine Ydre, qui, sic moriendo, dedit camisiam suam suo sanguine venenato infectam dicte Dyanire, dicendo quod erat talis virtutis quod quandocumque indueret ipsa eam, ipsum Herculem revocaret eum in amorem sui, unde postea, dum Hercules phylocaptus foret de Yole et non curaret de ipsa Dyanira, dicta Dyanira bona fide fecit hoc quod eam docuit Nexus, et sic mortuus est Hercules. {cf. Ov., Met. IX, 98-210}.
« Maintenant nous allons parler de ces Centaures, […] en nommant entre autres un certain Nessus, qui mourut pour Déjanire et qui, ainsi mort, se vengea d’Hercule, celui qui le tua, comme le raconte ici le texte (de Dante), et duquel Ovide écrit l’histoire dans le neuvième (livre des Métamorphoses) : (Ovide) dit, entre autres, qu’Hercule, une fois parvenu avec sa femme, nommée Déjanire, au fleuve Événos, fit transporter sa femme par le centaure Nessus de l’autre côté du fleuve. En la transportant, Nessus voulut la connaître charnellement, c’est pourquoi Hercule le frappa et le blessa à mort par la flèche empoisonnée du sang de l’hydre. Mourant, Nessus donna sa chemise imprégnée de son sang empoisonné à Déjanire, disant qu’elle avait un tel pouvoir que, quand Hercule la revêtirait, elle ranimerait en lui l’amour pour elle [= Déjanire]. C’est pourquoi plus tard, quand Hercule se fut épris d’Iole et qu’il ne s’occupa plus de Déjanire, cette dernière fit, de bonne foi, ce que lui avait appris Nessus, et c’est ainsi que mourut Hercule. »
Ce passage offre un résumé comparable à celui présent dans l’HAC2 par les détails qu’il comprend, et surtout parce qu’il comporte des données textuelles qui expliquent certaines particularités du texte français. Il ne s’agit pas seulement de la présence des formes Nexus et Nexum centaurum – ce qui pourrait être la forme de départ ayant été condensée et amalgamée en Nexumtaurum. La glose précise aussi explicitement, comme l’HAC2, que Nessus cherche tout de suite à « connaître charnellement » l’épouse d’Hercule plutôt que d’enlever cette dernière comme chez Ovide et dans l’Ovide moralisé. Le texte livre des détails à propos du venin de l’hydre, absents de Prose 5, mais nécessaires pour comprendre l’ajout à propos du serpent. Finalement, le résumé latin comporte un parallèle formel dans la précision qu’en l’habit 211trempé du sang du centaure erat talis virtutis – ce qui est peut-être à la base de la formulation ceste vertu a mon sanc dans le texte français.
Ce commentaire particulier, datant de vers 1360, n’est sans doute pas la source directe de l’HAC2 ; mais la Divine Comédie a connu toute une série de commentaires antérieurs qui, conjointement aux commentaires d’origine italienne de l’œuvre d’Ovide (que nous n’avons pas eu l’occasion de regarder de près), mériteraient un examen plus approfondi quant à ce passage. Ajoutons une dernière observation : les autres commentaires comportent ici non seulement, de manière généralisée, une glose qui résume l’intrigue autour de Nessus et Déjanire, mais aussi, dans plusieurs cas, des renvois explicites au neuvième livre des Métamorphoses74. Si ce dernier est une référence mobilisée pour relater les autres « aventures » d’Hercule, il se peut bien que le « livre de sa vie », auquel fait allusion l’auteur de Prose 5 en parlant d’Hercule renvoie à ce livre particulier de l’œuvre d’Ovide. Une fois de plus, l’historiographie se serait ouverte pour accueillir des informations provenant de la mythographie. L’une des raisons pour lesquelles le troisième portrait d’Hercule s’écarte des passages correspondants que l’on trouve dans d’autres histoires françaises de la même époque s’explique peut-être justement par le fait qu’il fut rédigé en Italie, cherchant à renouer avec des traditions en place dans le contexte italien et puisant dans des sources provenant de ce même cadre.
Après avoir regardé individuellement les trois portraits d’Hercule dans l’HAC2, essayons de faire un bilan final en les considérant ensemble, pour mieux en dégager les contours à l’intérieur de cet état textuel ultérieur de l’HAC. Le premier portrait du héros repris à l’ancienne section IV de l’HAC1 témoigne d’une prise de distance envers l’histoire biblique, qui se traduit par l’élimination de l’optique moralisatrice du texte – phénomène qui caractérisait déjà, dans une moindre mesure, le texte de l’HAC1b. Ce trait devient plus évident si l’on considère la macrostructure de l’HAC2, en notant que tous les manuscrits de cette « rédaction » omettent la section I sur la Genèse, qui était encore présente dans l’essentiel des témoins de l’HAC1a et b. La focalisation sur l’histoire ancienne païenne 212est accentuée davantage encore si l’on considère la nouvelle section V (Prose 5) qui étoffe la matière de façon considérable. Le texte emprunte des éléments à la lignée des romans de Troie, menant à un croisement net entre le mode historique et le mode romanesque, ce qui se manifeste, entre autres, par la présence du deuxième portrait d’Hercule, provenant de Prose 1. Finalement, le troisième et dernier portrait du héros témoigne d’un véritable amalgame entre différents éléments, historico-romanesques mais aussi mythologiques, remontant peut-être à des traditions latines et/ou italiennes. Le récit de la mort du héros ressemble en quelque sorte à un mythe, inséré dans un roman, inséré dans une histoire.

Fig. 5 – Représentation schématique des composantes herculéennes
dans HAC1a, HAC1b et HAC2.
Plus généralement, l’HAC2 en tant que compilation historiographique illustre plusieurs phénomènes qui caractérisent la biographie d’Hercule dans les chroniques en langue française. Certains épisodes restent identiques sur le plan des contenus, parfois quasiment inchangés même au niveau du texte (comme le portrait d’Hercule commun à l’HAC1b et l’HAC2). Des composantes de la vie du héros peuvent être omises (comme la comparaison étendue avec Samson). Une version d’un récit peut être échangée par une autre (tel le récit de la première destruction de Troie selon l’HAC1a/bversus celle, bien plus étendue, contenue dans Prose 5). Souvent, par ailleurs, les nouvelles « versions » d’un épisode semblent mettre à contribution et mélanger différentes versions antérieures (on peut penser à l’intégration d’éléments provenant de Prose 1 et la juxtaposition de différents matériaux dans le portrait final d’Hercule). Finalement, la biographie du héros peut être augmentée par l’intégration de nouveaux éléments (comme l’intrigue autour de Degermirra et Nexustaurus) qui viennent se placer à des endroits spécifiques de la toile de fond qui s’est établie au cours de la tradition historiographique. Ces mécanismes de compilation peuvent mener au dédoublement (involontaire) de certains éléments – c’est pourquoi, finalement, on a dans l’HAC2 trois portraits d’Hercule, dont chacun propose sa propre « histoire ».
Hercule dans la Chronique dite
de Baudouin d’Avesnes (CBA)
et quelques œuvres qui en dérivent
La biographie compilée d’Hercule mise en place dans l’HAC n’a pas seulement inspiré les « rédactions » ultérieures de l’HAC1. L’une des œuvres historiographiques françaises les plus diffusées qui a repris à l’HAC des blocs narratifs à propos d’Hercule est la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (ci-après CBA). Rédigée probablement pour Baudouin d’Avesnes, seigneur de Beaumont dans le Hainaut, entre 1278 et 1281, la CBA est une chronique universelle qui traite alternativement de l’histoire biblique et païenne suivant l’ordre de la chronologie universelle75. On connaît une cinquantaine de manuscrits 214de cette chronique, dont vingt-huit témoins comportent, selon les données de la littérature critique, les parties d’histoire ancienne, dans lesquelles on s’attendrait aussi à trouver la vie d’Hercule76. La tradition manuscrite de la CBA n’a cependant pas bénéficié jusqu’à ce jour d’une étude d’ensemble. L’identification de différentes « rédactions » de l’œuvre par la critique repose sur des éléments distinctifs trouvés dans les segments dédiés à une tranche courte de l’histoire médiévale, ce qui fait que bon nombre de témoins parlant de l’histoire ancienne gardent un statut « non-classifié77 ». Par ailleurs, les délimitations de l’œuvre par rapport à d’autres compilations restent floues78. Comme 215nous avons identifié des particularités concernant les épisodes en rapport avec Hercule dans certains témoins, nous proposerons ici un traitement descriptif qui cherchera d’abord à esquisser à larges traits une version « vulgate » de la biographie herculéenne dans la CBA, en relevant ensuite quelques schémas secondaires qui se retrouvent dans des compilations associées ou dérivées79. La « classification » qui se dégagera de ces pages n’est pas censée être définitive ni nécessairement s’appliquer à l’ensemble de l’œuvre.
La « version vulgate »
de la vie d’Hercule dans la CBA
Parmi les témoins de la CBA qui comportent les parties d’histoire ancienne, nous avons pu en consulter vingt-six, dont dix-sept donnent une version « vulgate » de la vie d’Hercule80. Nous présenterons celle-ci dans la suite, en citant premièrement le manuscrit Cambrai, Bibliothèque municipale, 683 (= Ca), datant du xiiie siècle, parmi les plus anciens témoins de la CBA, où le noyau de la « vie » du héros se situe aux feuillets 23r à 25r81. Suivant le modèle de l’HAC, les épisodes touchant Hercule dans la CBA commencent par un segment parlant Des Amazones (chapitre xxiii, commençant au f. 22vb) et se terminent par un segment à propos Dou siege de Troies (chapitre xv, débutant au f. 24va). Les contenus de la vie d’Hercule s’appuient eux aussi en grande partie sur l’HAC, ce que l’on peut illustrer à l’aide d’un schéma qui permet de visualiser les parallèles et divergences de contenu entre l’HAC1a, l’HAC1b et la CBA. Nous mettons sur fond gris les parties qui ne s’occupent pas principalement d’Hercule.
216|
HAC1a |
HAC1b |
CBA vulgate |
ff. ( Ca ) |
|
Portrait d’Hercule |
Id. |
Id. |
23rb |
|
Comparaison |
Id. (courte) |
Ø |
/ |
|
Expédition |
Id. |
Id. |
23rb-va |
|
Descendance |
Id. |
(segment déplacée ; |
/ |
|
Moralisations |
Ø |
Ø |
/ |
|
Antée |
Id. |
Id. |
23va |
|
Autres exploits : |
Autres exploits : |
Autres exploits : |
|
|
Cacus (Hercule/Thésée) |
Cacus (Thésée) |
Jeux olympiques (Hercule) |
23va |
|
Destruction de Thèbes (Thésée) |
Id. |
Id. |
23va |
|
Descendance |
23va |
||
|
Hébreux : juges d’Israël |
23va-24va |
||
|
Généalogies des Troyens |
Id. |
Id. |
24va-b |
|
Argonautes |
Id. |
Id. |
24vb-25ra |
|
Première destruction Troie |
Id. |
Id. (sans évocation d’Hercule) |
25ra |
|
Mort (courte) |
Id. |
Id. (étendue) |
25ra-b |
La CBA débute par un portrait du héros couvrant la plupart des mêmes épisodes « nucléaires » dans le même ordre que l’HACa/b : l’expédition d’Hercule et Thésée contre les Amazones est suivie de la victoire d’Hercule contre Antée, qui précède à son tour un segment évoquant une sélection d’autres exploits des deux héros. Hercule réapparaît à nouveau parmi les Argonautes et meurt peu après la première destruction de Troie. En d’autres termes, la toile de fond sur laquelle se greffe sa vie ne change pas de façon notable. Les divergences se situent plutôt à l’intérieur des différents blocs narratifs et aux moments de transition entre eux : la comparaison avec Samson, abrégée dans l’HAC1b82, disparaît entièrement dans la CBA, de même que les moralisations qui s’insèrent entre les 217récits à propos des Amazones et d’Antée (déjà absentes dans l’HAC1b). Les alia facta des deux héros ne sont plus tout à fait les mêmes : Cacus disparaît, et, à sa place, on retrouve l’institution des jeux olympiques, attribuée à Hercule (comme dans bon nombre de chroniques latines)83. La CBA déplace la descendance des Amazones après la série des autres exploits des deux héros, en insérant un segment sur l’histoire des juges d’Israël entre le bloc narratif sur les Amazones et celui au sujet de Troie. Cette insertion témoigne de l’une des caractéristiques de la CBA qui distingue cette œuvre de l’HAC1 (et encore davantage de l’HAC2) : la CBA s’occupe longuement de l’histoire des Hébreux, et cette dernière occupe des chapitres qui se placent systématiquement en alternance avec ceux dédiés à l’histoire profane. La CBA se rapproche dans ce sens davantage du modèle des chroniques universelles traditionnelles (d’après Eusèbe-Jérôme) plutôt que du modèle orosien dont s’inspire l’HAC.
En passant sur le plan textuel de la biographie herculéenne, on constate que plusieurs segments, dont le portrait initial du héros et la rencontre avec les Amazones, semblent utiliser comme modèle l’HAC1, tout en l’abrégeant. Considérons les premières lignes qui introduisent Hercule, en comparant la CBA avec l’HAC1a et l’HAC1b84 :
|
HAC1a (Paris, BnF, |
HAC1b (Londres, BL, Add. 19669 = L 5 ) |
CBA vulgate (Cambrai, BM, |
|
Segnor, adonques estoit Herculés en la flor de sa jovente. Cil Herculés fu fiz de la roïne Almene qui fu fille [le] roi Laudaci, qui vint de Crete. |
Adonc estoit Herculés en la flor de sa jovente. Cil Herculés fu fil la dame Armene qui fu filz le roi Laudaci, qui vint de Crete. |
Adont estoit Herculés en la flour de sa jouvente. Chil Herculés fu fius la dame Armee85. |
|
E bien sachés que plus fors hom ne plus hardis ne fu guaires puis le doloive que fu cil Herculés, si com on trueve en escriture. |
Et saichiez que plus forz hom ne plus hardiz ne fu puis le deluge que estoit Herculés. |
Saichié que plus fors ne plus hardis ne fu puis le deluve. |
| 218
Et por ce dient li pluisor et tesmoignent qu’il fu samblans a Sanson de proece et de force. Herculés fist mainte merveille en sa vie, qui bien funt a reprendre et ausi fist Sansos. |
Et por ce dient li plusor qu’il fu samblanz a Sanson de proesce et de force, a entendre autresi fist Sanses. |
|
|
[ Suite de la comparaison ] |
Sur le plan du texte, la CBA s’appuie peut-être sur l’HAC1b plutôt que sur l’HAC1a. La chronique résume de manière encore plus succincte ce qui a déjà été abrégé dans l’HAC1b et présente au moins une variante qui semble corrompre davantage ce qui est déjà corrompu dans l’état abrégé l’HAC1b : la mère d’Hercule, qui se présentait encore sous la forme plus correcte d’Almene dans l’HAC1a est devenu Armee dans la CBA, éventuellement en passant par une variante du type Armene telle qu’on en trouve dans les témoins de l’HAC1b. On peut aussi ajouter une observation à propos de l’absence de la comparaison avec Samson : contrairement à l’HAC1a/b, la CBA comporte bien, parmi ces segments sur les Hébreux, un chapitre à part à propos du pendant biblique d’Hercule86. C’est peut-être cette approche plus complète, plus « universelle » de l’histoire qui remplace, dans la CBA, les rappels constants et les moralisations caractéristiques de l’HAC, évoquant pour le lecteur l’omniprésence de l’histoire biblique.
L’auteur de la CBA pratique de manière générale un style bien plus succinct et centré sur la présentation des faits que l’auteur de l’HAC1. Dans le segment à propos des Amazones, par exemple, et plus précisément dans la description de la confrontation entre Hercule, Thésée et les deux sœurs de la reine des Amazones, il coupe les remarques présentes dans l’HAC1 (a et b), cherchant à justifier pourquoi les deux guerrières parviennent à faire tomber le fort Hercule de son cheval.
|
HAC1a ( P ) |
HAC1b ( L 5 ) |
CBA ( Ca ) |
|
Tost furent les damoiseles relevees, qui assés savoient d’armes, et ausi furent li chivalier, Herculés et Theseüs, qui grant vergoigne en orent. |
Tost furent les .ii. pucelles relevees qui assez savoient d’armes et ausi furent li chevalier Herculés et Theseüs qui grant vergoigne en avoient. |
Tost furent les .ii. pucelles relevees, qui assés savoient d’armes ; et ausi furent li doi chevalier Herculés et Theseüs, ki grant honte en* orent. |
| 219
Et si ne vos esmerveillés mie s’Erculés chaï, qui fors estoit a merveilles, quar ce fu par aventure par son cheval, qui chargiés estoit de lui et de ses armes, et par le ruiste encontre de la damoisele, qui le chival fist sous lui trebucher et fundre. Tantost com en piés furent revenu, |
Et ne vos mervilliez pas se Herculés chei, car ce fu par aventure et par son cheval qui trop estoit chergiez de lui et de ses armes et par la ruiste encontre de la damoisele qui le cheval fist soz lui trabuchier et fondre. Tantost com il furent soz lor piez venu, |
|
|
et les damoiseles orent les escus reons avant mis et es poins les espees, li Grigois lor corurent soure, [qui] la force avoient. Et tant les demenerent que Herculés prist Menalippe et Teseüs Hippolite. |
et les damoiseles orent les escuz aus cox et les espees tranchaz es poinz, li grezois lor coururent sore qui la force avoient. Et tant les menerent que Herculés prist Menalippe et Theseüs Ypolite. |
Lor misent les mains as espees et s’entredounerent grans cols sour les hiaumes et sour les escus ; mais en la fin prist Herculés Menalype et Ypolite fu prise par Theseüm. |
|
Leçon rejetée : *en mq. dans Ca, restitué d’après A1B6BaArs3P2Ge |
Nous sommes toujours dans le même épisode à propos d’Hercule et des Amazones, toujours sur la base du modèle de l’HAC1, mais les contenus sont devenus plus laconiques. Les parenthèses discursives et les pauses descriptives ne semblent guère intéresser le chroniqueur de la CBA, qui a abrégé ces passages en se concentrant sur les moments-clés de la narration. De manière générale, la composante « romanesque » se rétrécit, ici et ailleurs, au profit d’un résumé des données servant à la trame « historique ».
Dans le segment relatif à l’histoire de Troie, l’abrègement pratiqué par le chroniqueur est encore plus net. En effet, il résume les événements de manière à réduire la présence d’Hercule à deux mentions succinctes : lorsque les Argonautes partent à la quête de la toison d’or, Jason pria Herculés, dont vous avez oï desus parler, k’il alast avoec lui ; et quand ils reviennent en Grèce, on apprend que Herculés et Jason n’orent mie oubliee la honte c’on lour avoit faite au port de Troies87. La suite du récit est résumée de telle façon qu’elle omet entièrement Hercule. La présence de ce dernier est désormais purement implicite, au moins pour les lecteurs qui connaissent la version « romanesque » du récit sous-jacent88 :
220Si s’en alerent plaindre a tous chiaus de Gresse : premiers a Castor et a Pollus, ki estoient roi de Sparte et frere dame Elayne ; apriés au roi Thelamon de Salemine et au roi Nestor et a tous les autres de Gresse. Tuit lour orent en couvent ki lour aideroient. Lors firent faire grans nés. Si les garnirent et entrerent et nagierent tant k’il vinrent a Troies. Quant li rois Laomedon sot ke li Grijois venoient sour lui, il assambla toutes ses gens et ala encontre aus a bataille. La fu Laomedon ochis et tuit si fil, fors .i., ki avoit non Prians, qui estoit en ost contre .i. sien voisin. Quant Laomedon fu mors et ses gens vaincues, li Grigois entrerent en la cité a force et bouterent le fu par tout, et fu arse et destruite.
Sans pouvoir dire si l’auteur de la CBA s’est appuyé ici sur un modèle autre que l’HAC1 et dans lequel il aurait trouvé un abrégé du récit troyen, il est évident qu’Hercule n’y est plus une présence illustre, même digne de mention. S’il fait bien partie de la collectivité des Grecs qui partent pour se venger (comme l’atteste plus tard la mention de ce qui est arrivé puis ke Herculés fu repairiés de Troies), il n’a aucun statut particulier parmi eux89. Tout ce qui compte pour le chroniqueur c’est que la fu Laomedon ochis et que les Grecs ont détruit sa ville90.
Plutôt que de cibler et d’approfondir certains morceaux d’histoire sous la forme de narrations étoffées, ce chroniqueur cherche à en présenter un éventail plus large, se retournant vers les données présentes dans des chroniques plus « traditionnelles » dans la lignée d’Eusèbe-Jérôme. Ce phénomène s’observe également à l’intérieur des segments impliquant Hercule, notamment lorsqu’il est question des alia facta du héros et de son compagnon Thésée, ainsi qu’au moment où est relatée sa mort. Regardons d’abord le segment qui relate les « autres exploits » des deux héros dans la CBA, à côté des extraits correspondants dans l’HAC1a et l’HAC1b91 :
|
HAC1a ( P ) |
HAC1b ( L 5 ) |
CBA ( Ca ) |
|
E bien sachés qu’il fist mout de proeces autres, quar il ne doutoit rien ne lion ne serpent ne nulle autre beste, tant fust crueuse ne orrible. |
Et saichiez que il i fist maintes autres proesces, car il ne doutoit riens, ne serpant ne autre beste, tant fust crueuse. |
Car il estoit fors et si prex qu’il ne doutoit aventure k’il encontrast. |
| 221 |
Cil meïsmes Erculés establi une assamblee en la montaigne ki a non Olympus, ou tuit li chevalier de Gresce venoient de .v. ans a autre pour aus esprouver et pour conquerre los et pris. |
|
|
Segnor, et bien sachés que Theseüs, ses compains, fu ausi mout preus, quar ce fu cil dus qui destruist Thebes, si com je vos a conté ariere. |
Et sachiez que Theseüs, ses compainz, fu ausi moult preuz, car ce fu cil dus qui destruit Thebes, ensi com vos avez oï. |
Et saichiés ke Theseüs ses compains fu moult fors et moult fist de beles proueches. Et che fu li dus ki fu a Thebes destruire. |
|
Et si ocist un jaiant ausi, Quacus ot a non. Mes teus i a qui dient que Herculés l’ocist, qui bien le peut faire. |
Et si occist ausi un jaiant qui ot non Tatus. |
[ Fin du segment ] |
|
[ Descendance de Thésée ] |
[ Descendance de Thésée ] |
L’auteur de la CBA (ou de son modèle) a reformulé la phrase qui parlait dans l’HAC1 « de lions, de serpents et d’autres bêtes cruelles », substituant à la mention explicite des créatures la formule plus vague selon laquelle Hercule ne doutoit aventure qu’il encontrast. Dans la suite, il a inséré la description d’un exploit qui manque dans l’HAC, mais que nous avions bien retrouvée dans plusieurs chroniques latines : l’institution des jeux olympiques, reflet tacite de l’importance des Olympiades pour le décompte des années dans les « temps anciens92 ». Il poursuit son chapitre de manière analogue pour évoquer Thésée, en ne lui conservant qu’un exploit : la destruction de Thèbes. Sa victoire sur le géant Cacus, quant à elle, n’est pas évoquée, ce qui est également le cas dans la plupart des chroniques universelles latines traditionnelles93. Il est évidemment difficile de déterminer sur la 222base d’un échantillon si réduit si la présence ou l’absence d’un élément reflète simplement le contenu présent dans la source que suivait le chroniqueur ou si elle est motivée par un projet spécifique, qui pourrait alors consister à se focaliser sur des événements jugés suffisamment importants ou suffisamment « historiques », comme ceux retenus dans les chroniques latines, pour mériter une place dans l’histoire universelle.
Des innovations manifestes par rapport à l’HAC1 qui semblent puiser dans la tradition des chroniques latines concernent aussi la mort d’Hercule. Comparons encore l’HAC1a, l’HAC1b et la CBA, en marquant par les gras les éléments d’intérêt dans la CBA94 :
|
HAC1a (P) |
HAC1b (L 5 ) |
CBA (Ca) |
|
Segnor, Herculés ne vesqui mie puis lonc tens, ains li prist une greveuse maladie, et si tres greveuse qu’il por la grant fierté entra en un grant fue, si s’arst toz et ensi fina sa vie. Et Jason moru ausi et pluisor autre de diverses manieres, qui furent en cele compaignie. |
Herculés ne vesqui puis lonc tens, einz le prist une greveuse maladie si que par sa grant fierté entra en .i. feu si s’art toz et ensi fina sa vie. Et Jason morut ensi et plusor autre. |
Herculés et Jason ne vesquirent mie granment apriés, ains morurent assés tost. Car puis ke Herculés fu repairiés de Troies, il ocist .i. sien fil et .i. sien grant ami ki avoit non Yficus. Apriés le prist une si grans maladie ke, pour avoir remede de sa dolour, il se gieta ou fu de soufre ki est en la montaigne Oetha. Ensi fina Herculés, qui tant de proueches renoumees avoit faites par le monde quant il ot vescu .lii. ans. |
| 223 |
Varia lectio (sélection) : Oetha] oeacha A1oratha Ba oeatha B6ChP2P4P13ocatha Ars3Lh1oethea Ars1othea Ars2ethnna Ge ethna BeBesNh2ethnam Val1 |
Les trois textes parlent, certes, de la maladie d’Hercule et de son suicide par le feu, mais la CBA insère cette anecdote dans une matrice qui apporte plus d’informations contextuelles. Résumons : peu après son retour de Troie, Hercule aurait tué l’un de ses fils et un bon ami appelé Yficus. Ensuite, il aurait été saisi d’une gransmaladie, à cause de laquelle il se serait jeté dans le « feu de soufre » du mont Oetha afin de se délivrer de ses souffrances, mourant ainsi à l’âge de cinquante-deux ans. En considérant ce passage, il est possible d’apprécier sous une nouvelle lumière les anecdotes succinctes à propos de la mort du héros présentes dans les chroniques précédentes. Les événements résumés, quoique sans liens de causalité explicites, nous font penser que la maladie évoquée ici peut être comprise comme un renvoi au malaise dont a souffert le héros en guise de punition pour deux crimes spécifiques qu’il a commis. Nous les avions retenus dans notre esquisse initiale du mythe d’Hercule : dans un premier accès de rage, il avait tué ses enfants ; dans un deuxième, il avait précipité du haut d’une tour Iphitus, le fils d’Eurytus. Il semble être question de ces deux meurtres. Mais alors que ces crimes se situent à deux moments distincts de la vie d’Hercule chez les mythographes grecs et que le héros a pu se racheter – en se soumettant à Eurysthée pour accomplir ses douze travaux après le premier crime, et en se vendant en esclavage auprès d’Omphale après le second –, ici, les deux meurtres sont pris ensemble comme cause cumulative des souffrances qui poussent Hercule à se suicider. On relèvera aussi que le mont Œta, où Hercule a construit son bûcher selon le mythe antique, semble avoir acquis des qualités volcaniques dans l’imagination des chroniqueurs95. On observe accessoirement que la trame impliquant la chemise de Nessus et ses effets néfastes est entièrement absente.
Avant de réfléchir à l’image d’ensemble que cette fin confère à Hercule, il est intéressant de se tourner vers les sources possibles du passage. Nous avons déjà relevé la mention de l’âge d’Hercule, à sa mort, 224dans la chronique d’Eusèbe-Jérôme96. Cette information réapparaît, sans surprise, dans d’autres chroniques latines qui étaient disponibles à l’époque de la rédaction de la CBA, parfois avec des précisions ultérieures. En l’occurrence, c’est dans un texte déjà évoqué plus haut – la chronique de Fréculfe de Lisieux – que l’on rencontre les parallèles les plus nets avec le passage dans la CBA. Nous les marquons par des gras dans l’extrait de cette chronique latine cité ci-dessous97 :
Post necem uero filii , aqua purgatus est Athenis in sacris Cereris, et post interfectionem Ipphyti , quem peregrinum et amicum iniuste peremit, Hercules incidit in morbum pestilentem. Qui ob remedium doloris se iecit in flammas in monte qui vocatur Oeata, dum plura fortiter ac mirabiliter perpetrasset. Et sic morte finitus est anno aetatis suae LII, quidam uero aiunt XXX.
« Après la mort de son fils, il a été purifié par l’eau aux Mystères de Cérès à Athènes, et après le meurtre d’Iphitus, cet étranger et ami qu’il tua injustement, Hercule tomba dans une maladie pernicieuse. Celui-ci, pour remédier à ses douleurs, se jeta dans les flammes sur la montagne que l’on appelle Œta, alors qu’il avait accompli plusieurs (choses) courageusement et merveilleusement. Il mourut ainsi en sa cinquante-deuxième année, mais certains disent que c’était en sa trentième. »
On voit que Fréculfe relate la même suite d’événements, mais dans une forme plus complète et plus correcte suivant le mythe « reçu » d’Hercule : l’infanticide (avec l’indication, absente dans la CBA, qu’Hercule a pu se racheter de ce premier crime), le meurtre d’Iphitus (dans une graphie plus correcte), le mal pernicieux dont souffre Hercule, le fait de se jeter dans un feu in monte Oeta (ce qui permet de comprendre pourquoi le chroniqueur français en a fait un volcan), et l’âge du héros à sa mort. Comme d’habitude, la CBA raccourcit, notamment en passant sous silence la purification du héros, peut-être parce qu’elle fait référence à des rites païens ou parce que l’idée de pardonner un tel crime paraissait déplacée à l’auteur, ou encore pour de simples raisons d’économie du récit. Quoi qu’il en soit, la biographie d’Hercule dans la CBA se termine par l’aperçu frappant d’un héros déchu qui se jette littéralement dans les flammes, dans lesquelles peut se lire une image des enfers. On assiste à une sorte de contraction des données, qui cible les « mauvais exploits » du personnage, cherchant en cela à encadrer et éventuellement « justifier » sa mort. Si le chroniqueur s’abstient de jugements de valeur et de moralisations, il ne donne pas 225davantage une représentation positive de l’Hercule « historique ». L’auteur ne romantise ni ne mythologise la matière. Mais l’image finale que le lecteur garde du personnage est une image ambivalente.
Quelques biographies étendues d’Hercule
dans des chroniques apparentées ou dérivées de la CBA
La version « vulgate » de la biographie herculéenne que nous avons présentée dans les pages précédentes apparaît, comme nous l’avons indiqué plus haut, dans au moins dix-sept témoins de la CBA. Dans huit autres manuscrits que nous avons pu consulter, la vie d’Hercule se présente sous une forme altérée et, dans la plupart des cas, dotée d’ajouts98. Résumons rapidement les manuscrits des différentes versions que nous avons pu vérifier, en indiquant les feuillets qui contiennent les éléments biographiques sur Hercule.
|
Manuscrits de la version « vulgate » |
||
|
Sigle |
Manuscrit |
Localisation |
|
Ca |
Cambrai, BM, 683 |
f. 23r-25r |
|
A 1 |
Arras, BM, 863 (1043) |
f. 32r-36v |
|
Ars 1 |
Paris, Arsenal 3710 |
f. 23r-26v |
|
Ars 2 |
Paris, Arsenal 5076 |
f. 33v-36r |
|
Ars 3 |
Paris, Arsenal 5077 |
f. 43r-46r |
|
B 2 |
Bruxelles, Bibl. royale, 9069 |
f. 39r-41v |
|
B 4 |
Bruxelles, Bibl. royale, 10201 |
f. 10r (version abrégée) |
|
B 6 |
Bruxelles, Bibl. royale, II 988 |
f. 31v-34v |
|
Ba |
Baltimore, Walters Art Gallery, 307 |
f. 36v-40v |
|
Ch |
Chantilly, Musée Condé, 729 |
f. 80r-86r |
|
L 1 |
Londres, BL, Harley 4415 |
f. 31r-34v |
|
L 2 |
Londres, BL, Royal 18.E.V |
f. 58r-61v |
|
Lh 1 |
La Haye, KB, 71 A 14 |
f. 31v-34v |
|
Nh 2 |
New Haven, Yale University, Beinecke Library, 1106 |
f. 27v-30r |
| 226
P 2 |
Paris, BnF, fr. 685 |
f. 47r-50v |
|
P 4 |
Paris, BnF, fr. 1367 |
f. 49r-55r |
|
P 13 |
Paris, BnF, NAF 11199 |
f. 38v-43r |
|
Manuscrits d ’ une version avec ajouts |
||
|
Sigle |
Manuscrit |
Localisation |
|
Ge |
Gent, Universiteitsbibliotheek, 415 |
f. 50r, 53v, 56r-61v |
|
Bes |
Besançon, BM, 678 |
f. 25v, 28r, 29v-32r |
|
Be |
Berlin, Staatsbibliothek – Preussischer Kulturbesitz (en dépôt à Krakow, Biblioteka Jagiellonska), gall. fol. 216 |
f. 34r, 36v, 37r-42r |
|
Val 1 |
Valenciennes, BM, 538 |
f. 29r, 31r, 33r-36r |
|
Manuscrits d ’ autres versions hybrides |
|
|
Manuscrit |
Localisation |
|
Paris, BnF, fr. 17181 |
f. 38v-39r |
|
Arras, BM, 995 (1059) |
f. 62v, 66rv, 68v-69r |
|
Paris, BnF, fr. 15458 |
f. 7r-13v |
|
Vienne, ÖNB, 3370* |
f. 66r-69v |
Entre les différents témoins des versions altérées, tous tardifs, datant du xve siècle, les quatre manuscrits de la version comportant des ajouts, auxquels nous avons donné les sigles Ge, Be, Bes et Val1, présentent une série analogue d’ajouts. On peut visualiser ces derniers à l’aide d’une nouvelle vue d’ensemble schématique, qui montre comment ils s’intègrent à la trame de la version vulgate. Nous mettons sur fond blanc les composantes qui concernent Hercule. Les ajouts signalés en gras.
|
CBA version vulgate (d ’ après Ca ) et ajouts (d ’ après Ge ) |
|
Destruction de Thèbes |
|
Rois argiens |
|
Persée premier roi de Mycènes |
|
Dionysos / Liber Pater conquiert l’Orient |
| 227
(1) Ajouts : Précisions sur Liber Pater. Hercule vainc Antée. |
|
Hébreux. Juges d’Israël de Samgar à Gédéon |
|
(2) Ajouts : Hercule sauve Thésée de Cerbère. Orphée roi de musique |
|
Mercurius invente la harpe. Fondation de Tyr. Mort de Liber Pater. |
|
Vezones, roi d’Égypte, envahit la Scythie |
|
Début du règne des Amazones |
|
Hercule et Thésée contre les Amazones |
|
Hercule contre Antée |
|
Hercule institue les jeux olympiques |
|
Thésée détruit Thèbes |
|
Hébreux. Juges d’Israël d’Abimelech à Abdon |
|
Troie. Généalogie des rois troyens. |
|
Jason et Hercule parmi les Argonautes. Première destruction de Troie. |
|
Mort d’Hercule |
|
(3) Ajout : Hercule a été vaincu par une femme |
|
Reconstruction de Troie par Priam |
Comme on peut le déduire de ce schéma, les ajouts propres à Hercule ne sont pas insérés dans le but général d’amplifier les blocs thématiques qui étaient déjà en place dans la version vulgate de la CBA, mais ils s’insèrent plutôt à des moments spécifiques de la trame de l’histoire, précédant en partie la biographie d’Hercule à proprement parler. En cela, ils nous font penser aux chroniques latines, qui présentent des anecdotes relatives au héros dans une série de contextes discontinus, entrecoupés d’autres événements. En outre, nous voyons apparaître ici, comme dans les chroniques latines, des anecdotes concernant Antée et Cerbère (objets des ajouts 1 et 2 dans le schéma ci-dessus)99.
Les insertions en question étant concises, on peut les citer in extenso ici, tout en mettant en regard leur source vraisemblable. Cette 228dernière n’est pas une chronique latine, mais probablement un texte vernaculaire, à savoir l’abrégé historiographique appelé parfois le Manuel d’Histoire de Philippe VI de Valois, rédigé vers 1330, où l’on trouve les mêmes données100. Le Manuel suit à son tour l’optique d’une histoire universelle, commençant par la Création et allant, dans un premier temps, jusqu’en 1328, époque contemporaine de sa rédaction. Il survit dans plus de trente manuscrits, dans lesquels il a reçu plusieurs continuations. Nous citons le Manuel d’après un manuscrit précoce de la « première rédaction » de l’œuvre, Besançon, BM, 677, en indiquant une sélection de variantes d’après une série d’autres témoins101.
|
Manuel d ’ Histoire de Philippe VI de Valois (Ms. Besançon, BM, 677) |
CBA avec ajouts ( Ge ) |
|
[ au temps de Moïse : Liber Pater, invention du char, Deucalion ] [ 4rb ] En ce temps, Herculés vainqui Antheum le geant. |
[ après la destruction de Thèbes, au temps de Persée : Liber Pater, invention du char ] [ 50r ] En ce temps Herculés vainquit Antheum le jayant. |
|
[ après Samgar, au temps de Débora ] [ 5va ] En cellui temps fu Cerberus, un grant geant [var. chiens P19477P693] qui devora Peritoire [var. Peritoine P4939 Peritonie P4940 Paritoine P19477], qui estoit venu pour ravir Proserpine avec Theseüs ; et aussi eüst devouré Theseüs, mais Herculés seurvint qui le delivra. Et pour ce que il estoit si maulz, ly poectes dient que Cerberus est portier d’enfer. [ suivi d ’ une anecdote sur Orphée ] |
[ après Samgar et Gédéon, au temps d ’ Abimelech ] [ 53v ] [C]erberus, ung grant [ja]iant, regna en ce temps, lequel devora Pichoine [var. Pithomo Be Pichomne Bes], qui estoit venu pour ravir Proserpine avec Theseüs ; et aussi eüst devoré Theseüs, mais Herculés y survint qui le delivra. Et pour ce que ce jayant estoit si mauvais, les poetes dient que Cerberus est le [54r] portier d’enfer. [ suivi d ’ une anecdote sur Orphée ] |
| 229
[ à l ’ époque Jephté, suite à la mort d ’ Hercule ] [ 8v ] Cestui Herculés, on l’appelle victorien, pour ce que, selon Barro, il seurmonta toutes manieres de [ajout bestes P4940 monstres P673P693P19477 ; mq. Bes677], mais une femme qui avoit nom Omphale [var. Omiphale P1406 Olimpha P673 Olimphale P693P19477Deyfille V68] le seurmonta, car elle le fist filer et faire euvres de femmes. |
[ après la première destruction de Troie et la mort d ’ Hercule ] [ 61v ] Icellui Herculés est appellé victorieux pour ce que, selon Barro [var. Varro Be], il surmonta toutes manieres de bestes. Toutesvoies une femme, qui Deiphile [var. Deiphele Be Deiphile Deifile Bes] eüst a nom, le surmonta, car elle le fist filer et faire euvres de femmes. |
Pour mieux comprendre la raison d’être des insertions dans les manuscrits de la CBA avec ajouts, il convient de dire quelques mots de plus au sujet du Manuel. Ce dernier puise une grande partie de ses informations sur l’histoire ancienne, y compris probablement les anecdotes citées ici, dans le Speculum historiale de Vincent de Beauvais ainsi que dans l’Historia Scholastica de Pierre le Mangeur. Il constitue, pour ainsi dire, un condensé d’histoire universelle en langue vernaculaire qui s’appuie sur les autorités reconnues en la matière et qui est, en même temps, bien plus facile d’accès que les grandes histoires latines qui le précèdent. Le remanieur de la CBA responsable des ajouts semble donc, en d’autres termes, avoir cherché à compléter son propre texte, en y ajoutant des informations relevant de « l’essentiel » de l’histoire telle qu’elle était accessible à son époque en langue vernaculaire. Cette impression est renforcée par la désignation de « Trésor des histoires » que l’on trouve dans chacun des quatre témoins Ge, Be, Bes et Val1, et encore davantage par la rubrique initiale que reçoit le texte dans trois d’entre eux : Cy commence le livre du Trésor des histoires, lequel livre est extraict du Miroier historial et de tous aultres livres d’aultres histoires. Et y sont compris en brief par ordre tous les notables advenemens des successeurs d’Adam102.
Quant aux bribes d’information à propos d’Hercule reprises au Manuel, elles apportent de nouvelles nuances à la biographie du héros, mais contribuent aussi à son hétérogénéité apparente, voire à son éclatement. Par l’ajout de l’anecdote sur Antée, la lutte d’Hercule contre ce géant est présente à deux reprises dans la version de la CBA d’après Ge-Be-Bes-Val1103, située dans deux contextes différents de l’histoire – une 230fois sous forme d’anecdote, placée bien avant l’histoire des Amazones, et une deuxième sous forme de narration développée, à la suite du retour des Grecs après leur expédition contre les femmes guerrières. La mention de Cerbère est, à son tour, détachée du noyau principal de la biographie du héros et placée en amont, renforçant toutefois l’idée – quand on la considère à côté de l’épisode des Amazones – qu’Hercule et Thésée ont dû se côtoyer pendant une bonne partie de leurs vies104. On note par ailleurs que l’anecdote en question a été historicisée : portier d’enfer n’est plus qu’une appellation forgée par les poètes parce que ce « chien » ou « géant » (on trouve les deux variantes dans les manuscrits) était si féroce. La troisième et dernière anecdote, qui suit directement le passage sur la mort du héros, apporte à son tour une nouvelle touche au portrait d’Hercule. Le vainqueur qui a dompté toutes manieres de bestes a été, en fin de compte, vaincu par une femme qui l’a réduit à filer et faire d’autres euvres de femmes. Fait intéressant, Omphale est devenu Deiphile dans les manuscrits de la CBA avec ajouts, témoignant peut-être ici d’une confusion avec l’autre « femme fatale » par excellence dans la vie d’Hercule, Déjanire, responsable de la chute ultime du héros105. L’image d’Hercule dominé par une femme reste la dernière impression que le lecteur garde du héros, après le récit de son suicide par le feu. Hercule finit donc non seulement par une mort peu glorieuse, mais sous un travestissement qui risque de le ridiculiser.
Perspectives sur des portraits compilés
d’Hercule dans quelques autres chroniques hybrides
Les traditions de l’HAC, de la CBA et du Manuel se recoupent en divers points dans des compilations du xve siècle. Les éléments de la biographie d’Hercule que transmettent ces textes fournissent plusieurs exemples de ce phénomène. Nous avons abordé, dans un article récent106, la question de la délimitation et classification des œuvres désignées comme « Trésor des histoires », intitulé employé dans les rubriques et/231ou les incipit de certains manuscrits de la CBA (dont les quatre témoins Ge, Be, Bes et Val1 que nous venons d’examiner), mais également dans certains manuscrits de compilations qui ont été considérées par la critique comme des œuvres à part entière107. Nous n’approfondirons pas ici les mêmes aspects, mais proposerons quelques réflexions pour mettre en lumière la nature intriquée de la tradition en question, en regardant quelques autres compilations d’histoire universelle qui en font partie :
–deux autres témoins associés à la CBA qui ne donnent pas la version « vulgate » de la biographie d’Hercule, à savoir Paris, BnF, fr. 17181 et Arras, BM, 995, les deux du xve siècle. Les deux ont un prologue commun, débutant par les mots suivants : Ce livre est apellés le tresor des histores pour ce que toutes les histores de tous livres y sont mis en brief pour les mieux retenir108 […].
–une compilation inédite, appelée parfois « troisième rédaction » de l’HAC (ci-après HAC3) ou considérée alternativement comme une rédaction ultérieure de la CBA, qui survit dans les manuscrits Paris, BnF, fr. 15455 et Paris, Arsenal 3685, les deux datant du xve siècle. L’incipit de ce texte ressemble de près à celui de la CBA : Qui le livre de sapience vuelt bonnement mettre en l’aumoire de sa memoire et l’enseignement des saiges es tables de son cuer escripre, sur toutes choses il doibt fuir le fardel de confusion, car il engendre ignorance et est mere de oubliance109 […].
Les œuvres en question ont toutes la particularité d’emprunter certains éléments à la CBA (et, dans certains cas, à l’HAC), en les augmentant par des ajouts provenant du Manuel. Elles comportent également chacune une biographie d’Hercule construite à partir d’un stock commun de composantes, ce que nous commenterons dans un premier temps. Ensuite nous passerons à une présentation sommaire des différentes compilations à l’aide de fiches, en nous arrêtant sur une sélection d’éléments en 232rapport avec Hercule, pour relever les différents modèles (éventuellement indirects) mis à contribution. Cela permettra de revenir sur certains éléments présentés plus haut dans l’HAC1a, l’HAC1b, la CBA et le Manuel. Soulignons à cet endroit que le Manuel comporte, outre les passages déjà cités supra, d’autres anecdotes relatives à Hercule, dont une sélection a été importée dans chacune des compilations dont il sera ici question.
Les contenus thématiques en rapport avec Hercule dans les compositions en question sont mis en regard dans le schéma infra. Relevons-en d’abord les éléments communs : les compilations comportent chacune une « vie d’Hercule » qui commence par un portrait du héros, précédant immédiatement l’expédition d’Hercule et de Thésée contre les Amazones. Chacune parle, par ailleurs, des voyages des Argonautes et de la première destruction de Troie, à la suite de laquelle est placée la mort d’Hercule. Dans chacun des textes, la vie d’Hercule est racontée en plusieurs étapes, interrompues par des segments ne concernant pas le héros, qui se placent, de manière générale, entre l’évocation des « autres exploits » d’Hercule et de Thésée et le récit des voyages des Argonautes. C’est, si l’on recourt à la segmentation conventionnelle de l’HAC110, au moment de la transition entre les sections IV et V. Hormis le manuscrit fr. 17181, les textes comportent tous, par ailleurs, une série d’éléments herculéens qui sont placés en amont, avant la partie « nucléaire » de la vie du personnage, qui varient de par leur nombre, leur contenu et le contexte dans lequel ils s’insèrent. La variation entre ces textes concerne aussi l’articulation textuelle des différents éléments, ce que nous chercherons à mettre en évidence dans les fiches proposées par la suite.
|
Paris, BnF, fr. 17181 |
Arras, BM, 995 |
HAC3 |
|
ø |
Éléments antéposés Antée Autres exploits |
Éléments antéposés Cerbère Linus,maître d’Hercule |
|
Vie d ’ Hercule (noyau) Portrait Amazones Antée Autres exploits |
Vie d ’ Hercule (noyau) Portrait Amazones |
Vie d ’ Hercule (noyau) Portrait Amazones Descendance Antée Autres exploits (Orphala) |
| 233
Ne concernant pas Hercule Ajouts sur Thésée Descendance des Amazones Hébreux Généalogies Troyens |
Ne concernant pas Hercule Descendance Ajouts sur Thésée Hébreux Généalogies Troyens |
Ne concernant pas Hercule Hébreux |
|
Vie d ’ Hercule (fin) Argonautes Première destruction Olimpha Mort d’Hercule |
Vie d ’ Hercule (fin) Argonautes Première destruction Mort d’Hercule |
Vie d ’ Hercule Argonautes Première destruction Mort d’Hercule |
Paris, BnF, fr. 17181 (« Trésor des histoires ») 111
xv e siècle. Chronique universelle allant de la Création au pape Clément VI. Table de rubriques aux f. 1-18v ; au f. 18r, un paragraphe isolé :[A]u commencement, ainsy que la Sainte Escripture le tesmoigne, Dieu crea le ciel et la terre, selon les docteurs et les sains, en une masse confuse qu’ilz nomment matiere sans forme […](~ incipit du Manuel). L’œuvre semble débuter véritablement au f. 19r : Ce livre est appellé le tresoir des histoires pour ce que toutes les histoires de tous livres y sont mis en brief pour le mieulx retenir […], suivi d’un segment, rubriqué Chy commenche le prologue des gestes de l’exellence de chevalerie (f. 19r) : Qui le livre du tresoirs de sapience vœult mettre en l’ammaire de sa memoire et l’enseignement des sages es tables de son cœur escripre […] (~ incpit de la CBA).
La biographie d’Hercule se situe aux f. 38v-39r (rubrique au f. 38v : Comment Herculés combati les femmes d’Amasone) et 41rv (rubrique au f. 41r : Comment Jason conquist le toyson d’or a Colcos ; 41v, De la premiere destruction de Troies). Le texte est en gros un abrégé de la CBA. Voici le portrait initial d’Hercule, qui suit la CBA, en raccourcissant davantage le texte : Et lors y estoit en sa proesse et jonesse Herculés, filz de la dame Aomee ; plus fort ne fut depuis le deluge112.
Quoiqu’abrégé, le texte comporte un certain nombre d’ajouts, dont certains repris au Manuel, qui ne sont cependant pas identiques à ceux repérés dans les quatre manuscrits Ge-Be-Bes-Val1. L’anecdote supplémentaire sur Antée et celle sur Cerbère (présents dans Ge-Be-Bes-Val1) 234manquent, mais lorsqu’est narré in extenso la lutte entre Hercule et Antée après la victoire des Grecs sur les Amazones, le compilateur ajoute une série d’autres prouesses accomplies par Hercule et par Thésée113 :
Et fist encore Herculés maintes proesses : il vaincqui les sagittaires, qui sont, selonc les poethes, moitié homme et moitié queval ; il commencha le jeux et tornoiemens que on appelle les jeux olimpias pour ce que les faisoit au piet d’une montaigne qui ot nom Olimpe, et contoit les ans de ces jeux ainsi que nous contons orendroit les ans de l’Incarnation. Cilz Herculés ne doubtoit riens, ne moustre ne serpent, tant fu cruel. Theseüs son compaignon fut aussi bien fort et vaillant, et fu cellui duc d’Athenes qui fu a Thebes destruire. Et ot ung fil de sa femme Ypolite nommé Ypolitus.
En décomposant ce segment, on peut faire quelques observations intéressantes : d’abord, les sagittaires vaincus par Hercule ne proviennent pas de la CBA, mais ont été importés du Manuel, de même que les informations à propos des jeux olympiques114. Sur le plan des ajouts, fr. 17181 se poursuit sur la mention des serpents et monstres qui ne pouvaient faire peur au héros, rappelant de près le texte de l’HAC1b115. Le segment sur les alia facta paraît ainsi manifestement composite.
Après avoir parlé des exploits, le texte enchaîne avec un ajout (par rapport à la CBA) à propos du combat de Thésée, Minos et le Minotaure (39v-40r), avant de revenir à la descendance des Amazones (40r), aux juges d’Israël (40r-41r) puis à la généalogie des rois de Troie (41rv). Le récit sur la première destruction de Troie est abrégé suivant la CBA, sans mention d’Hercule (Laomedon assambla contre eulx et y fut occis, f. 41v). Le segment sur la mort d’Hercule se rapproche le plus du texte de la version étendue de la CBA suivant Ge-Be-Bes-Val1, ajoutant qu’Hercule a été vaincu par une femme ; cependant, il appelle cette dernière non pas Deiphile, mais Olimpha116 (nous y reviendrons infra) :
235A son retour, Herculés et Jazon ne vesquirent gaires. Herculés occist un sien fil et Ysicus son grand amy. Cestui Herculés appell’on victorien, car selon Varo il sourmonta toute manieres de bettes, serpens horribles et grandz moustres. Et touteffois une femme nommee Olimpha le sourmonta, car elle lui fist faire œuvre de femme et filler. Et puis Herculés encourut une grande maladie que pour l’aleganche d’icelle il se jetta ou feu de souffre en la montaigne Ethna. Ainsy fina Herculés que tant avoit fait proeches par le monde en l’eage de lii ans.
En effet, le manuscrit fr. 17181 se rapproche de la version de la CBA selon Ge-Be-Bes-Val1 aussi par la présence de la variante faisant du mont Œta lamontaigne Ethna117. En revanche, la forme du nom de la maîtresse d’Hercule suggère que la compilation a recouru à un modèle secondaire, soit une compilation qui nous est inconnue.
En somme, fr. 17181, inclus souvent parmi les témoins de la CBA, combine, dans les seuls segments considérés ici, des éléments remontant à la CBA (avec ajouts), au Manuel et éventuellement à l’HAC1b.
Arras, BM, 995 (« Trésor des histoires ») 118
xv e siècle. Chronique universelle allant de la Création à 1310. Table de rubriques aux f. 1-18r ; au f. 20r, rubrique : Prologue du tresor des histoires ; incipit : Ce livre est appellés le tresor des histores pour ce que toutes les histores de tous livres y sont mis en brief pour les mieux retenir […] (~ incipit de fr. 17181 supra) ; suivi, au même feuillet, d’un Aultre prologue : Qui le livre du tresor de sapience vœult mettre en l’ammaire de sa memoire et les enseignemens des sages es tables de son cœur escripre […] (~ incipit de la CBA)
La biographie d’Hercule est divisée en trois blocs :
–le bloc 1, antéposé, se trouve au f. 62v. Il parle d’Antée et des « autres exploits » d’Hercule (rubrique : Comment Herculés ocist ung merveilleus gayant et Des merveilleuses proesses de Herculés). Ce sont les éléments qui, dans la CBA, suivent l’expédition contre les Amazones. Dans le manuscrit en question, ils précèdent cependant le noyau de la vie du héros. Ils se situent, plus précisément, à l’endroit où est placée dans les manuscrits Ge-Be-Bes-Val1, la courte anecdote supplémentaire à propos de la victoire d’Hercule sur Antée119.
236–le bloc 2, situé au f. 66rv, relate l’expédition d’Hercule et Thésée contre les Amazones, précédé du portrait d’Hercule (rubrique : Comment Herculés sousprist les demoiselles d’Amasone ; Comment deux demoiselles jousterent contre Herculés et Theseüs et furent prises et vaincues ; Comment le paix se fist entre Herculés et les Amasones)
–le bloc 3 se trouve aux f. 68v-69r, et parle des voyages des Argonautes (f. 68v, rubrique : Cy parle comment Jason conquist la thoison d’or a Colcos), de la première destruction de Troie et de la mort d’Hercule (f. 69r, Cy parle de la premiere destruction de Troyes).
Le texte est notablement composite :
–Le récit à propos d’Antée (dans le bloc 1), le développement sur les Amazones et le portrait d’Hercule (compris dans le bloc 2) s’appuient non pas sur la CBA, mais sur l’HAC1b. On peut considérer, afin d’illustrer cela, le portrait du héros (en mettant en gras les éléments qui trahissent la dépendance sur l’HAC1b) : Cilz Herculés fu filz de la dame Armene et filz du roy Landar qui vint de Crete. Sachiés que plus fort homme de lui ne fut puis le deluge ; et pour ce dient aulcuns qu’il fut pareil a Sanses le fort120.
–Le chapitre à propos des merveilleuses proesses du héros au bloc 1 ressemble de près au segment correspondant présent dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 17181 (avec les sagitaires, les jeux olympiques et les serpents et monstres qu’Hercule ne craignait pas121) :
Il fist maintes aultres merveilles : il vainqui les sagitaires, quy estoient moitié homme et moitié cheval ; il commencha les jeus de l’Olimpiade en une montaigne nommee Olimpe. On contoit les ans de ces jeux ainsy que nous comptons les ans de l’Incarnacion. Cilz Herculés ne cremoit serpens ne moustre ne aultres bestes, tant fuissent cruelles. Et Theseüs fut moult vaillant et preux. Ce fu le filz de ce duc qui destruisy Thebes, ainsy que vous avez oÿ.
–Le récit à propos de la destruction de Troie dérive de la CBA. Il partage avec Ge-Be-Bes-Val1 (et fr. 17181) la variante faisant du 237mont Œta la montaigne Ethna, mais ne comporte pas l’ajout à propos d’Hercule vaincu par Omphale/Deiphile122 :
Herculés et Jason ne vesquirent mie granment aprés, ains morurent assés tost, car puis que Herculés fu retourné de Troies, il ochist ung sien filz et ung sien grant amy qui avoit non Ysicus. Aprés le prist une sy grant maladie que pour avoir remede de sa doleur, il se getta au feu de souffre qui est en la montaigne Ethna. Ainsy fina Herculés qui tant de prouesses renommees avoit faites par le monde, quant il eult vescu .lii. ans.
Le « Trésor des histoires » de ce manuscrit présente ainsi certains parallèles avec celui de fr. 17181 (l’incipit, et, dans les segments pris en compte, l’ajout à propos des « autres exploits », puisant dans le Manuel et l’HAC1b), mais le texte des deux compilations n’est pas identique. Celui du manuscrit Arras 995 restructure les composantes à propos d’Hercule et semble surtout puiser des éléments supplémentaires dans l’HAC1b afin d’étoffer les segments de la vie du héros.
« HAC3 »
xv e siècle, pour la compilation et les témoins. Les deux manuscrits de cette chronique comportent chacun uniquement le premier volume de l’œuvre. On s’appuiera ici principalement sur le manuscrit Paris, BnF, fr. 15455, qui semble présenter un texte plus correct dans les segments sur Hercule, quoiqu’il soit affecté de certaines lacunes.
La rubrique initiale et l’incipit du texte livrent déjà des indices sur la raison pour laquelle l’œuvre est associée tantôt à l’HAC tantôt à CBA. On lit au f. 1r en rubrique Ci commence li livre de Genesis selon la description de Orose, auquel saint Jherosme s’acorde en la Bible, laquelle nous tenons estre vraye selon nostre foy et selon l’Eglise, alors que l’incipit du prologue qui suit est presque identique à celui de la CBA : Qui le livre du tresor de sapience vuelt bonnement mettre en l’aumoire de sa memoire et l’enseignement des saiges es tables de son cuer escripre, sur toutes choses il doibt fuir le fardel de confusion, car il engendre ignorance et est mere de oubliance[…]123. On sait par ailleurs que le texte intègre Prose 5 lorsqu’il est question de traiter de la matière troyenne124.
La partie principale de la vie d’Hercule se raconte en deux volets, dont le premier (avec son portrait initial, l’expédition contre les Amazones, la lutte contre Antée et les « autres exploits ») se situe aux f. 97rb-99vb, 238et le second, inséré dans Prose 5, s’étend du f. 101ra au f. 106vb. La fin du récit sur la mort du héros est absente en raison d’une lacune matérielle. Par ailleurs, au moins deux anecdotes mentionnant le héros se trouvent antéposées à sa vie à proprement parler, présentées à la manière d’incidentia dans le contexte de l’histoire des Hébreux125.
À la lumière des compilations abordées précédemment, on s’attendrait à retrouver un portrait initial d’Hercule puisant soit dans l’HAC1b soit dans la CBA. Pourtant, il n’en est rien. Pour l’ensemble de la matrice sur l’épisode des Amazones, le compilateur semble s’être retourné vers la rédaction longue de l’HAC1a. Le portrait initial d’Hercule dans l’HAC3 est exemplaire à cet égard. Nous marquons par l’italique les éléments révélateurs126 :
Et adoncques estoit Herculés en la fleur de sa jeunesce. Seigneur, cil Herculés fut filz a la royne Almene[var. Amene Arsenal 3685], qui fu fille au roy Laudaci qui vint de Crethe. Et bien sachiez que plus fort homme ne plus hardy ne fut gueres de puis le deluge que cil Herculés, si comme on trouve en l’escripture. Et pour ce dient les plusieurs et teesmoingnent qu’il fut semblable a Sanson de force et de prouesce. Herculés fist maintes merveilles en sa vie qui bien font a entendre et auxi fist Sanson. Maiz de Sanson ne vous parleray je pas jusques atant que par droiture vendra a lui le conte de l’istoire. C’est quant on parlera des Ebrieux, car il fut de leur lignee. Et non pour quant, bien sachiez que entre Sanson et Herculés n’ot mie grant temps, car tous deulx furent au temps que Troye fut premierement destruite. Maiz a Troye ne fut mie Sanson ne aussi ceulz de sa lignee.
En effet, on retrouve dans l’HAC3 non seulement un portrait d’Hercule doté d’une comparaison avec Samson étendue et quasiment identique 239à celle présente dans l’HAC1a, mais également, plus loin, la série des moralisations qui s’intercalent dans l’HAC1a entre le retour d’Hercule du royaume des Amazones et sa lutte contre Antée127.
Le premier volet de la vie du héros ne s’appuie cependant pas dans son intégralité sur l’HAC1a. Au moment où l’auteur passe aux « autres faits » d’Hercule et de Thésée, il insère une série d’anecdotes que nous avons déjà rencontrées individuellement dans des compilations citées plus haut. Nous avons indiqué entre crochets et en gras les sources (lointaines) auxquelles remontent les données128) :
Et bien sachiez qu’il fist moult d’autres prouesces. Et tant ot force et grant prouesce qu’il ne doubtoit lyon ne serpent ne nulle aultre beste crueuse ne horrible (HAC1a). Il vainquy les centaurs [var. sagitaires Arsenal 3685] qui estoient, segon les poetes, partie homme et partie cheval (Manuel). Il establi et commença les gieux Olimpias. Ce estoit une assemblee de chevalliers de Grece qui venoit de an en aultre en la montainge de Olimpi [id. Arsenal 3685] pour eulx esprouver les ungs aulx aultres et pour concquerre los et pris. (CBA) Et tant fist d’aultres choses merveilleuses que on l’appelle victorien, pour ce que, selon Varro le poete, il seürmonta toutes manieres de bestes. Et touteffoys une femme, qui nommee fu Orphala, le seürmonta, si que elle le fist filer et faire oevre de femme (Manuel). Et bien sachiez que Theseüs, son compaignon, fut aussi de moult grant prouesce. Car ce fu cellui duc qui fut a Thebes destruire, sicomme je vous ay dit par avant. Et si occist ung jayant qui fut nommé Cassus, et aucuns dient que ce fut Herculés qui bien le pot faire (HAC1a).
On voit que le début du segment suit toujours l’HAC1a, disant qu’Hercule ne douta « ni lion ni serpent ni nulle autre bête ». Dans la suite, le compilateur a inséré l’anecdote des centaures/sagittaires reprise au Manuel, que nous avons déjà rencontrée dans les manuscrits fr. 17181 et Arras 995. Comme ces deux « Trésors des histoires », l’HAC3 continue avec une référence aux jeux olympiques ; mais contrairement à eux, l’HAC3 ne donne pas la version d’après le Manuel, mais plutôt la version d’après la CBA. Suit un nouvel élément remontant au Manuel : l’HAC3 rapporte l’épisode d’Hercule vaincu par Omphale (devenu Orphala) avant de revenir au cadre de l’HAC1a, avec la mention de la destruction de Thèbes par Thésée et celle de la victoire sur Cacus (devenu Cassus), attribuée aux deux héros. Pour faire un constat général à propos de ce segment, l’HAC3 témoigne de l’amplification d’un segment thématique particulier – les « autres exploits » des deux héros –, 240phénomène que nous avons déjà observé dans d’autres compilations semblables. Cependant, il ne s’agit pas, sur le plan textuel, d’une série identique d’anecdotes transmises d’une chronique à l’autre, mais plutôt d’un nouveau projet de compilation analogue, faisant appel à des sources supplémentaires.
Aux éléments que nous avons pu identifier dans l’HAC1a, la CBA et le Manuel s’ajoute, dans le deuxième volet de la vie d’Hercule, le texte de Prose 5. Les parties du texte parlant d’Hercule ne diffèrent pas de façon notable de celles que nous avons abordées supra en rapport avec l’HAC2. Est également présent, dans une forme très proche de la version de l’HAC2, le récit de la mort d’Hercule, dans le cadre d’un « troisième portrait » du héros animé par l’intrigue de Degermirra et Nexumtaurum.
Les trois compilations du xve siècle présentées supra sont exemplaires du haut degré d’hybridation des données textuelles qui caractérisent les « rédactions ultérieures » des différentes histoires identifiées par la critique. Il est intéressant de constater, à cet égard, que différents états textuels ou, plus concrètement, différents témoins d’une œuvre semblent être impliqués dans le jeu d’emprunts qui touchent les biographies d’Hercule. Un cas de figure permet de souligner cette caractéristique. Il s’agit de l’anecdote d’Hercule « filandier », qui semble avoir son origine dans le Manuel, mais a trouvé son chemin vers plusieurs compilations associées à la CBA. Les variantes multiples concernant le nom de la maîtresse d’Hercule dans ces témoins (en gras dans les extraits mis en regard ici) en sont révélatrices129 :
|
Manuel |
Ge-Be-Bes-Val 1 |
fr. 17181 |
fr. 15455 ( HAC3 ) |
|
[M]ais une femme qui avoit nom Omphale le seurmonta, car elle le fist filer et faire euvres de femmes. |
Toutesvoies une femme – Deiphele ot nom – le surmonta, car elle le fist filer et fere œuvres de femmes |
Et touteffois une femme nommee Olimpha le sourmonta, car elle lui fist faire œuvre de femme et filler. |
Et touteffoys une femme, qui nommee fu Orphala, le seürmonta, si que elle le fist filer et faire oevre de femme. |
|
Varia lectio : Omphale ] Olimpha Paris, Bibl. Sainte-Geneviève 673 Olimphale Paris, BnF, fr. 693 ; fr. 19477 Deyfille Vatican, BAV, Reg. lat. 688 |
Varia lectio : Deiphele ] Deiphile V 1 Deifile Bs |
forme identique Orphala dans Arsenal 3685 |
Si on ne considérait pas les variantes textuelles, on pourrait se dire que l’anecdote à propos d’Hercule « filandier », absente de la version vulgate de la CBA, a été empruntée une seule fois, à un moment donné, au Manuel, puis transmise via une compilation spécifique (par exemple, la version de la CBA « avec ajouts » suivant Ge-Be-Bes-Val1) aux textes que présentent le manuscrit fr. 17181 et l’HAC3. Les différentes variantes du nom d’Omphale suggèrent cependant un scénario plus complexe. Nous avons commenté supra la présence des formes du type Deiphele, sorte d’hybride entre Omphale et Déjanire, dans Ge-Be-Bes-Val1, en notant une variante proche, Deyfille, dans un témoin du Manuel (Vatican, BAV, Reg. lat. 688). Force est de constater que les autres chroniques hybrides prises en compte (fr. 17181 et l’HAC3) n’attestent pas une telle forme hybride, mais d’autres variantes, en partie corrompues. Chose intéressante : on peut trouver ces autres variantes dans d’autres témoins du Manuel. La variante Olimpha (qu’on a dans fr. 17181) se retrouve dans au moins un manuscrit du Manuel (Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 673) ; Orphala (présente dans l’HAC3) repose peut-être sur un autre modèle encore. En d’autres termes, le même épisode semble avoir été emprunté à plusieurs reprises et à partir de différents modèles, que ce soient des témoins du Manuel lui-même ou des textes apparentés ou dérivés de ce dernier130.
Ce phénomène en soi suggère que les chroniqueurs tardifs avaient développé une pratique consistant à utiliser certains textes – le Manuel entre autres – comme répertoire de matériaux sources. De plus, certains endroits de la trame de l’histoire ancienne devaient sembler, aux yeux des chroniqueurs, particulièrement aptes à recevoir des ajouts. Dans le cadre des biographies d’Hercule (et de Thésée), c’est notamment lorsque sont relatées les « autres prouesses » et quand est évoquée la fin du héros que l’on retrouve des innovations sous forme d’ajouts thématiques131. Ces moments sont, en d’autres termes, comme des espaces ouverts qui peuvent accueillir d’autres éléments sans entraver la progression des événements132. La présence des ajouts et des amplifications à ces endroits suggère que 242les chroniqueurs se sont bien intéressés à la matière des « histoires » (ou mythes) antiques. Les différentes réalisations de la biographie d’Hercule dans ces œuvres semblent indiquer qu’ils tentaient aussi d’inventorier les différents exploits de ce dernier. Simplement, le répertoire des exploits d’Hercule jugés dignes de figurer dans une chronique telle que la CBA ou un « Trésor des histoires » était, nous semble-t-il, limité par des contraintes génériques que voulaient respecter les compilateurs. C’est pour cette raison que l’on a l’impression de retrouver dans un nombre considérable d’œuvres la « même matière ». Les épisodes en question peuvent se trouver dans des constellations différentes, et on voit parfois s’y ajouter quelques anecdotes supplémentaires, mais ils s’organisent en général autour des mêmes composantes de base – un même stock – et ont la caractéristique générale de ne pas comporter de valorisations explicites. C’est aussi pourquoi le portrait d’Hercule est un portrait « neutre » dans une quantité considérable d’œuvres appartenant au genre historiographique.
Il existe une quantité notable de chroniques mêlant des matériaux provenant à l’origine de l’HAC, de la CBA et du Manuel et véhiculant un conglomérat d’épisodes herculéens133. À de tels textes s’ajoutent toutefois au fil du temps des œuvres qui proposent des vies plus synthétiques du héros, qui tendent à être bien plus longues que les exemples considérés précédemment. Dans le domaine de l’historiographie en langue française, les premiers exemples de telles vies n’apparaissent, à notre connaissance, qu’au début du xve siècle. Un premier cas se rencontre dans l’histoire universelle intégrée dans le Livre de Mutacion de Fortune de Christine de Pizan (1403)134. Cette œuvre comporte une biographie d’Hercule 243qui se greffe toujours sur le fond thématique de l’expédition contre les Amazones et la première destruction de Troie, en y intercalant un développement étendu à propos de la vie et de la mort du héros qui s’inspire notamment de l’Ovide moralisé135. Un deuxième exemple moins connu apparaît dans la Bouquechardière, compilation d’histoire rédigée par Jean de Courcy entre 1416 et 1422, qui puise pareillement dans la mythographie ovidienne ainsi que dans des textes philosophiques et bibliques, parmi d’autres. C’est l’analyse de ce texte qui va clore la deuxième partie de notre étude.
1 Il s’agit, en l’occurrence, d’une chronique connue par les manuscrits Paris, Arsenal 3685 et Paris, BnF, fr. 15455. Le nom de « troisième rédaction » de l’HAC se trouve dans le répertoire de B. Woledge, Bibliographie des Romans et Nouvelles en prose française antérieurs à 1500, Genève, Librairie Droz, 1954, no 79.
2 Voir, pour les trois extraits, ms. Londres, BL, Royal 20 D I, f. 24vab, 29vab et 37vb. L’hypothèse que ce manuscrit se trouve à l’origine de la tradition de l’HAC2 a été pour la première fois proposée par F. Avril, « Trois Manuscrits Napolitains des Collections de Charles V et de Jean de Berry », Bibliothèque de l’École des chartes, 127:2, 1969, p. 314. Elle a été reprise par L. Barbieri, Le « epistole delle dame di Grecia » nel Roman de Troie in prosa, Basel/Tübingen, Francke, 2005, et est toujours considérée comme valable, comme on le déduit de l’article récent de L. Barbieri, « La versione “angioina” dell’Histoire ancienne jusqu’à César. Napoli crocevia tra cultura francese e Oriente latino », Francigena, 5, 2019, p. 1-26, cf. le stemma à la p. 17. On dispose aujourd’hui d’une édition numérique intégrale semi-diplomatique et d’une seconde, interprétative, du manuscrit Royal 20 D I, préparée dans le cadre du projet anglais The Values of French et accessible via le site du projet, en ligne : https://tvof.ac.uk/textviewer/?p1=Royal/semi-diplomatic/section/3> (dernière consultation : 16-09-2022) (cf. déjà p. 156, n. 9 supra).
3 Voir, à propos de l’HAC2 et de Prose 5 en particulier, Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 505-562, Barbieri, Le « epistole delle dame di Grecia »[…], op. cit. et « La versione “angioina” dell’Histoire ancienne jusqu’à César », art. cité.
4 Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 353.
5 Il s’agit des manuscrits suivants dans le relevé de Jung : Paris, BnF, fr. 20125 ; Bruxelles, Bibl. royale, 10175 ; Dijon, BM, 562 ; Londres, BL, Add. 15268 (tous du xiiie siècle) ; Paris, BnF, fr. 168 ; fr. 686 ; et fr. 9682 (du xive siècle). Cf. Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit. p. 354.
6 C. Baker, « La version vulgate de l’Histoire ancienne jusqu’à César », Revue belge de philologie et d’histoire, 95, 2017, p. 745-772.
7 P. Meyer, « Les premières compilations françaises d’histoire ancienne », art. cité, p. 63.
8 Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 506-507.
9 Jung inclut dans ce groupe un quatrième manuscrit qui ne comporte que Prose 5, Grenoble, BM, 860 (cf.ibid., p. 506).
10 R. Trachsler, « L’histoire au fil des siècles : les différentes rédactions de l’Histoire ancienne jusqu’à César », Transcrire et/ou traduire. Variation et changement linguistique dans la tradition manuscrite des textes médiévaux, éd. R. Wilhelm, Heidelberg, Winter Verlag, 2013, p. 77-95.
11 Comme il a été suggéré par divers chercheurs, et dernièrement par Barbieri, « La versione “angioina” dell’Histoire ancienne jusqu’à César », art. cité, p. 16 sqq., le manuscrit en question semble être une copie directe de Ro. Comme Barbieri l’a constaté, Pr porte cependant des traces de contamination (cf. Barbieri, « Trois fragments peu connus du Roman de Troie en prose : Malibu, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 3 ; Porrentruy, Archives de l’ancien Évêché de Bâle, Divers 4 ; Tours, Bibliothèque municipale, ms. 1850 », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 23, 2012, p. 358-360).
12 Ce manuscrit met à contribution différents modèles, l’un d’eux se rapprochant de p. Le texte de ce témoin a été édité à côté de P dans les éditions citées supra de Marijke de Visser-van Terwisga (sections II-IV) et de Catherine Gaullier-Bougassas (section IX).
13 Trachsler, « L’histoire au fil des siècles », art. cité, p. 84, 89.
14 Ibid., p. 89.
15 F. Zinelli, « Je qui li livre escrive de letre en vulgal : scrivere il francese a Napoli in età angioina », Boccaccio angioino. Materiali per la storia culturale di Napoli nel Trecento, éd. G. Alfano, T. D’Urso et A. Perriccioli Saggese, Bruxelles, Peter Lang, 2012, voir p. 163-166.
16 Ces deux témoins n’avaient pas encore été classés lorsque nous avons commencé à étudier la matière. L’étude de Baker, « La version vulgate de l’Histoire ancienne jusqu’à César », art. cité, qui s’appuie sur d’autres exemples, confirme qu’il s’agit de témoins de l’HAC1a.
17 Cf. Barbieri, « Trois fragments […] », art. cité, p. 369, et, plus récemment, « La versione “angioina” dell’Histoire ancienne jusqu’à César », art. cité, p. 17.
18 Le même état textuel survit par ailleurs dans le manuscrit New York, Pierpont Morgan Library, M. 516, ainsi que dans une série de fragments au Paul Getty Museum à Malibu, sous la cote Ludwig XIII 3 (voir l’article de Barbieri, « Trois fragments […] », art. cité). Voir Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 507.
19 Les cotes des témoins de l’HAC1 sont reprises à l’éd. de Visser-van Terwisga, op. cit., voir t. 2, p. 12-14. Afin d’éviter des recoupements avec ces derniers, nous avons adapté en grande partie les sigles pour l’HAC2 sur la base de ceux de Barbieri, « Trois fragments […] », art. cité, p. 369. La colonne « Contenus » reproduit les sections et les éventuels autres textes contenus dans les manuscrits individuelles. Dans ce contexte, l’abréviation Fet Rom. désigne Li Fet des Romains.
20 Le texte (au moins dans les sections IV et V) est plus fortement abrégé que dans les autres témoins de l’HAC1b. Cette compilation intercale en outre une adaptation française de l’Historia regum Britanniae entre les segments sur Énée et la première partie sur Rome. Le texte a été édité par Géraldine Veysseyre, L’Estoire de Brutus : la plus ancienne traduction en prose française de l’Historia regum Britannie de Geoffroy de Monmouth, éd. G. Veysseyre, Paris, Classiques Garnier, 2015.
21 Ce manuscrit transmet un texte qui mélange différents modèles et est l’œuvre de plusieurs mains. Certains passages à propos d’Hercule sont présents à deux endroits. Notre relevé se base sur les morceaux de la section IV présents à la fin du codex (au f. 155), dont le texte reflète clairement l’état de l’HAC1b. D’autres éléments herculéens se situent aux f. 59 sq., mais donnent une version remaniée du texte, très différent de celui que nous avons repéré dans tous les autres témoins examinés de l’HAC1. Ces éléments demanderaient une analyse approfondie spécifique, que nous ne pourrons pas faire ici.
22 Nous nous appuyons sur L’histoire ancienne jusqu’à César : deuxième rédaction, d’après le manuscrit OUL 1 de la bibliothèque de l’Université Otemae, ancien Phillipps 23240, éd. Y. Otaka et C. Croizy-Naquet, Orléans, Éditions Paradigme, 2016.
23 Ms. P, f. 120vab ; L5, f. 76ra ; Ro, f. 24vab.
24 Nous n’avons pas inclus de transcription spécifique d’un témoin de l’état textuel HAC mixte. Ayant constaté cependant que les leçons des témoins en question se rangent, dans les passages étudiés de la section IV, du côté de l’HAC1b, nous avons décidé d’inclure les variantes de cette rédaction dans la même colonne avec les variantes de l’HAC1b.
25 Cf. Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 353. Le procédé peut être comparé à celui qu’on observe dans certains manuscrits de l’Ovide moralisé qui omettent les allégories à propos des récits mythologiques (voir infra, p. 374 sqq.).
26 Quant au lieu variant 4 de notre relevé, impliquant le raccourcissement de l’unique phrase restant dans l’HAC1b qui compare Hercule à Samson, elle s’avère intéressante, mais délicate en même temps à l’égard de l’interprétation des données. La variante qui caractérise la plupart des témoins de l’HAC1b et qui apparaît comme étape intermédiaire entre l’HAC1a et l’HAC2 – Et por ce dient li plusor qu’il fu samblanz a Sanson de proesce et de force, a entendre autresi fist Sanses – pose des problèmes de compréhension, car une fois coupée la partie précédente de la phrase, disant qu’Hercule fist mainte merveille, la remarque autresi fist Samson reste sans antécédant et n’a, par conséquent, plus de sens. Il n’est pas surprenant de ce fait qu’elle ait provoqué déjà dans certains témoins de l’HAC1b, puis dans la plupart des manuscrits de l’HAC2, la suppression du fragment en question. L’éclatement général de la tradition autour de ce lieu rend cependant difficile l’établissement de rapports nets entre les témoins qui ont supprimé le passage.
27 Cf. Oltrogge, Die Illustrationszyklen […], op. cit., p. 61-70 ; Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 355.
28 Cf. F. Zinelli, « Je qui li livre escrive de letre en vulgal »,art. cité, p. 163-166.
29 Ms. P, f. 123rab ; L5, f. 76vb-77ra ; Ro, f. 26rb.
30 On peut y ajouter un troisième exemple, moins exploitable parce qu’il s’agit d’un cas de variation adiaphore, mais néanmoins intéressant comme exemple complémentaire aux erreurs conjonctives évoquées dans le texte : ne lion ne serpent ne nulle autre beste]PLP3Re (HAC1a) ; ne serpant ne autre besteL5Ma (HAC1b), PxLa (HACmixte) ; ne serpanz ne autres bestesCP7P16P20Vat (HAC1b), RoPrStCh2OsPs (HAC2) ; ni serpant ne nulle besteV (HAC1b) ; ne serpent ne autre choseP5 (HAC1b) ; (nulle riens) ne nulle besteP13(HAC1b) ; ne il ne doutoit bestesP12(HAC1b) ; mq. (segment réécrit) P18 (HAC1b). – Le lion, mentionné dans l’HAC1a avant le serpent et nulle autre beste qui pouvait faire peur à Hercule, est omis dans tous les témoins consultés de l’HAC1b et l’HAC2. L’évocation des bêtes féroces fait, par ailleurs, apparaître une série de variantes dans les différents témoins, parmi lesquels on retrouve nos témoins de l’HAC2 (avec ne serpanz ne autres bestes au pluriel) se rapprochant plus précisément d’un ensemble de manuscrits de l’HAC1b dont font partie, une fois de plus, les manuscrits Ca, P16 et Vat (à côté de P7 et P20).
31 Pour être exact, on lit, dans Pr, car ce fut ce duc qui destruist Thebes (f. 24vb). Comme c’était déjà le cas dans le passage considéré supra à propos de la comparaison entre Hercule et Samson, Pr paraît mettre à contribution un deuxième modèle qui n’est pas Ro.
32 Cf. Barbieri, « Trois fragments […] », art. cité, p. 358-360, et « La versione “angioina” dell’Histoire ancienne jusqu’à César », art. cité, p. 16 sqq. Dans ce dernier article, Barbieri confirme que Pr est bien une copie directe de Ro, mais suggère que le copiste de ce premiera eu recours à d’autres modèles ou sources.
33 Trachsler, « L’histoire au fil des siècles », art. cité, p. 89-90.
34 Ms. P, f. 121vb.
35 Fabio Zinelli a proposé non pas l’un des témoins C, P16 ou Vat, mais un autre représentant du même groupe iconographique E, le manuscrit P13, comme lien possible entre les rédactions HAC1 et HAC2 (voir, pour quelques réflexions critiques sur ce sujet, Zinelli, « Je qui li livre escrive de letre en vulgal », art. cité,p. 165-166).
36 Cf. l’étude de M. T. Rachetta, « Sull’Histoire ancienne jusqu’à César : Le origini della versione abbreviata ; il codice Wien ÖNB cod. 2576. Per la storia di una tradizione », Francigena 5, 2019, p. 27-57. Le manuscrit V n’est sans doute pas le lien entre les deux rédactions, il paraît néanmoins s’en rapprocher.
37 Voir p. 195 et n. 31 supra. Cf. Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 552.
38 Citons Luca Barbieri : « l’atelier parigino in cui è stato realizzato il ms. Paris BnF fr. 301 doveva disporre di esemplari della prima redazione dell’Histoire ancienne, di Prose 3, e forse anche delle altre fonti della seconda redazione, che il compilatore ha potuto consultare. » (« La versione “angioina” dell’Histoire ancienne jusqu’à César », art. cité, p. 17).
39 Cf. p. 182.
40 Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., § 3, l. 21.
41 La plupart des segments en début de la partie troyenne proviennent de Prose 1, si l’on suit le relevé des sources fait par Barbieri, Le « epistole delle dame di Grecia » […], op. cit., p. 22 sq. Nous citons le segment de la mise en prose d’après l’édition par L. Constans et E. Faral, Le roman de Troie en prose, t. 1, Paris, Champion, 1922, chap. 7. Le passage correspondant de l’HAC2 est cité d’après Ro, f. 29vab.
42 Il se retrouve inchangé dans les autres manuscrits considérés de Prose 5, à savoir Pr (f. 27va), Ps (f. 35rb), St (f. 34ra), Ch2 (f. 28ra), Ox (f. 34r).
43 Ms. Ro, f. 30va. On peut comparer ce passage, précédé d’un autre dialogue entre le messager et Jason, avec la phrase succincte soulignant le mécontentement des Grecs dans l’HAC1 : Jason et Herculés et cil qui avec aus estoient furent mout aïré de la cruauté le roi Laomedon, por ce qu’il mal ni tort ne li voloient faire, et si vilainement les avoit congeés de son regne. (Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 360, chap. 3, l. 30-32).
44 Ms. Ro, f. 34va ; éléments repris à Prose 1 (cf.Le Roman de Troie en prose, éd. Constans et Faral, op. cit., chap. 24).
45 Voici le passage d’après Ro : Faisons armer de nos gens une partie et s’en aille vers Troie, et l’autre demeurt a la navie. Thalamon o toute sa gent et la nostre chevaucherons et vous demourés au navie et li autre demourront pres des murs. Et si se partiront en .iii. eschielles : en l’une sera li rois Nestor, en la seconde Pollus, en l’autre son frere Castor. Et, je croi, quant les Troiens les verront, il istront hors atout leur povoir sus euls et la cité remaindra vuide. Et vos maintaindrés la bataille contre et nous istrons de nostre embuschement et sans nul contredit enterrons en la vile et quant nous aurons les portes saisies et garnies de nos chevaliers, si leur vendrons a l’encontre par derriere le dos en tel guise que se il veullent en la ville tourner, il les convendra par nos mains passer. Et ensint les arons trestous mors et pris et c’est li miels que je i voie. (f. 35rab). Le passage reste très proche de son modèle, Prose 1 (cf.Le Roman de Troie en prose, éd. Constans et Faral, op. cit., chap. 27). Dans l’HAC1a/b, le lecteur n’apprend la stratégie des Grecs qu’à travers le récit de la rencontre belliqueuse elle-même (voir l’extrait cité supra, p. 177).
46 Ms. Ro, f. 36rb.
47 Il en va de même pour le passage sur la mort de Laomédon (cf.Le Roman de Troie en prose, éd. Constans et Faral, op. cit., chap. 33).
48 La seconde rubrique se retrouve dans les manuscrits Ps (Paris, BnF, fr. 254), voir f. 42ra-va pour le segment en question, et Paris, BnF, fr. 22554, f. 45ra-45vb. On lit De la mort Herculés dans Ro, f. 37vb-38va ; Pr (fr. 301), f. 34vb-35rb ; Ch2, f. 34vb-35ra ; Os, f. 30vb-31rb (d’après l’éd. Otaka et Croizy-Naquet, op. cit.) ; et dans Ox, f. 42v-43r ; Comment Herculés morut dans fr. 24396, f. 30ra-va ; le segment est sans rubrique dans le manuscrit de Bruxelles, Bibl. royale, IV 555, f. 36ra-36vb.
49 Ms. Ro, f. 37vb.
50 Ms. Ro, f. 24v, cf. p. 182 supra.
51 Comme Luca Barbieri l’avait observé, « Les modifications fantaisistes des noms des personnages et des lieux rendent difficile l’identification exacte des faits auxquels l’auteur fait référence. » (L. Barbieri, « Entre mythe et histoire : quelques sources de la version en prose “napolitaine” du Roman de Troie (Prose 5) », « Ce est li fruis selonc la letre ». Mélanges offerts à Charles Méla, éd. O. Collet, Y. Foehr-Janssens et S. Messerli, Paris, Champion, 2002, p. 125.)
52 Le « epistole delle dame di Grecia » [ … ] , op. cit., p. 23.
53 Guido est cité d’après Historia destructionis Troiae, éd. N. Griffin, Cambridge (MA), Mediaeval Academy of America, 1936, lib. I, p. 9 ; le texte de l’HAC2 est cité d’après Ro, f. 37vb.
54 L’Historia scholastica est citée d’après l’éd. Migne, Patrologia Latina, 198, op. cit., col. 1153.
55 Cf. « Entre mythe et histoire », art. cité, p. 125.
56 Le « epistole delle dame di Grecia » [ … ] , op. cit. L’observation de Barbieri nous paraît judicieuse, surtout si l’on considère les attestations textuelles des confusions du même type qui s’ajoutent aux incertitudes concernant l’attribution de la victoire de Cacus à Hercule ou à Thésée. Nous renvoyons à cet égard à la troisième partie de la présente étude, où nous examinerons les travaux d’Hercule évoqués dans l’Ovide moralisé (cf. p. 311-330 infra). Afin d’exemplifier un témoignage de ce type, citons une glose repérée dans un commentaire aux Métamorphoses d’origine française, conservé dans le manuscrit Berlin, Staatsbibliothek, Preussischer Kuturbesitz, Diez. B Sant. 11 (du xiie ou xiiie siècle), à propos d’une mention chez Ovide de la périphrase filius Vulcani dans une liste d’exploits de Thésée : « Notandum quod Erichoneus fuit filius Vulcani, […] qui fuit semis vir et semis equs [sic] quem Theseus sive Hercules interfecit. Vel potest legi de Caco qui vaccas Herculi furabatur, qui Theseus sive Hercules interfecit. » (f. 54v, en marge inférieure).
57 Le « epistole delle dame di Grecia » [ … ] , op. cit., p. 32.
58 Bibliotheca Mundi Vincentii Bellovacensis Speculum quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiale, Douai 1624, repr. Graz 1965, livre III, chap. 58 (trouvé via le site de l’Atelier Vincent de Beauvais, Université de Nancy, en ligne : http://atilf.atilf.fr/bichard/ (dernière consultation : 10/06/2023) ; notre traduction.
59 Barbieri, « Entre mythe et histoire », art. cité, p. 124-125 ; Le « epistole delle dame di Grecia » […], op. cit., p. 298-299 ; Le Roman de Troie en prose. Prose 5, éd. A. Rochebouet, Paris, Classiques Garnier, 2021, chap. 40.
60 L’épisode se situe aux f. 37v-38v du ms. Ro.
61 Comme Marc-René Jung l’a relevé, l’un des manuscrits du texte, notre Ps, l’appelle Mynostaurus dans le texte (M.-R. Jung, « Le Roman de Troie en prose du manuscrit Rouen, Bibl. Mun. O. 33 », Romania, 108, 1987, p. 443, note 12). Cette modification pourrait bien être due à la présence de l’information à propos de sa nature semi-humaine et semi-bovine dans le texte.
62 Ceci est, comme l’a déjà relevé Barbieri, une allusion à l’épisode du combat contre l’hydre (Le « epistole delle dame di Grecia » […], op. cit., p. 32). L’indication qu’Hercule l’a frappé d’une flèche, retirant ensuite celle-ci du corps du monstre, sert de lien tacite avec les événements suivants – c’est de la même flèche, trempée du venin de l’hydre, qu’il frappera Nessus, et c’est à cause de ce même poison, mélangé ensuite avec le sang du centaure, que la chemise sera la cause des souffrances terribles qui pousseront Hercule au suicide.
63 On lit littéralement : il la prist et voloit habiter avec lie en la presence de Herculés qui estoit de l’autre part du flume (Ro, f. 38ra).
64 Ms. Ro, f. 38rb. Élément entre parenthèses absent du manuscrit, restitué d’après les autres témoins pris en compte (cf.Pr, f. 35r ; St, f. 45r ; Ch, f. 35r, etc.)
65 Cf. Barbieri, « Entre mythe et histoire », art. cité, p. 129, ainsi que Le « epistole delle dame di Grecia » […], op. cit., p. 32. Voir notre édition du segment de l’Ovide moralisé (v. 347-452) en annexe. L’Ovide moralisé est par ailleurs, à notre connaissance, le seul texte connu en langue française antérieur à Prose 5 qui relate l’épisode en question dans son ensemble.
66 La miniature se trouve au f. 228ra dans le manuscrit de Rouen. Le même motif accompagne l’épisode dans un autre manuscrit précoce de l’Ovide moralisé, Paris, Arsenal 5069, au f. 121rb.
67 Voir les extraits édités en annexe, p. 429, OM IX, 371-373.
68 Cf. notre annexe, OM IX, 402.
69 L’HAC2 est à notre connaissance la première histoire en langue française qui développe cette idée.
70 Cf. Barbieri, Le « epistole delle dame di Grecia » […], op. cit., p. 32. Le fait que Nessus meure à cause du poison de l’hydre est suggéré par Ovide de façon allusive : sanguis per utrumque foramen / emicuit, mixtus Lernaei tabe ueneni. (Mét. IX, 129-130, d’après l’éd. Tarrant).
71 Citons, comme exemple, une glose à propos du passage figurant dans le manuscrit Vatican, BAV, Vat. lat. 1479 (xive siècle), transmettant les Métamorphoses avec un commentaire de provenance française, qui est intéressant pour les études sur l’Ovide moralisé parce qu’il fournit certaines données qui apparaissent également parmi les ajouts mythologiques et moralisateurs dans l’adaptation française des Métamorphoses (cf. nos remarques infra, p. 294 sqq.) : com Hercules divicisset Acheloum propter amorem Deianire, voluit remeare ad partes, sed, com ad quendam fluvium venisset, ille non potuit preterire nisi natando, unde reliquit uxorem suam Nesso, ut illam ultra fluvium portaret, quia extra partim equs, partim homo. Nessus voluit per violentiam habere rem cum illa, unde exclamavit, et Hercules illum com sagita sagitavit usque ad mortem. Tamen camisiam suam tonxicatam dedit Deianire, dicens : ‘Quando volueris maritum tuum ad amorem tuum revocare, da illi istam camisiam et tancito non aliam adamabit’. Illa credidit et accepit, et mortuus est Nessus. (ms. Vatican, BAV, Vat. lat. 1479, f. 123r, se rapportant à Mét. IX 106-107, cité d’après Un commentaire médiéval […], éd. Ciccone, op. cit.)
72 Dante Alighieri, La commedia secondo l’antica vulgata, éd. G. Petrocchi, t. 2. Inferno, Milan, Mondadori, 1966, canto xii, v. 67-69.
73 Cf. Pietro Alighieri, Comentum super poema Comedie Dantis : A Critical Edition of the Third and Final Draft of Pietro Alighieri’s « Commentary on Dante’s Divine Comedy », éd. M. Chiamenti, Tempe (AZ), Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2002, commentaire sur Inferno, chant xii, v. 67-69. Le texte de ce commentaire ainsi qu’une série d’autres paratextes sont accessibles sur le site du Dante Lab à Dartmouth College, en ligne : http://dantelab.dartmouth.edu (dernière consultation : 10/06/2023) ; la traduction est de nous.
74 Par exemple dans le commentaire de Guido da Pisa (1327-28, en latin), aux vers 67-69 d’Inferno, chant xii : de quo Ovidius, VIIII Methamorphoseos (Guido da Pisa’s Expositiones et Glose super Comediam Dantis, or Commentary on Dante’s Inferno, éd. V. Cioffari, Albany (NY), State University of New York Press, 1974), et dans l’Ottimo Commento (1333, en italien), sur les mêmes vers : che pone Ovidio nel IX libro del Metamorphoseos (L’Ottimo Commento della Divina Commedia. Testo inedito d’un contemporaneo di Dante[…], éd. A. Torri, Pisa, N. Capurro, 1827-1829). Données repérées sur le site du Dante Lab.
75 Le travail le plus récent et le plus approfondi sur la CBA et le contexte historique de sa genèse est la thèse de F. Noirfalise, Family Feuds and the (Re)writing of Universal History : The Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (1278-1284), thèse de doctorat, University of Liverpool, 2009. Parmi les études s’intéressant à la CBA, celles qui abordent les parties d’histoire ancienne sont moins nombreuses que celles qui portent sur l’histoire contemporaine à la rédaction du texte. Parmi les premières, il faut citer notamment Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 431-435. Des observations à propos des segments sur Alexandre le Grand, que nous ne traiterons pas ici, mais qui comportent quelques anecdotes sur le passage d’Hercule et de Liber Pater en Orient, se trouvent dans l’étude d’A. Salamon, « Le Traictié des Neuf Preux de Sébastien Mamerot : gérer l’autorité dans une compilation au second degré », Memini. Travaux et documents, 21, 2017, en ligne : http://memini.revues.org/881 (dernière consultation : 24/09/2022).
76 Cf. la liste de témoins donnée par Anne Rochebouet dans da thèse, « D’une pel toute entiere sans nulle cousture »La cinquième mise en prose du Roman de Troie. Édition critique et commentaire, thèse de doctorat, Paris, Université Paris-Sorbonne, 2009, p. 207-216, actualisée dans son étude sous presse sur « Le récit de la chute de Troie dans la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes », à paraître dans un volume de Mélanges pour Gilles Roussineau, chez Classiques Garnier. Nous remercions vivement Anne Rochebouet de nous avoir envoyé une première version de cette étude. Rochebouet inclut dans sa thèse une liste à part des témoins de la CBA qui comportent la section troyenne et qui sont au nombre de trente (liste reprise dans son article à paraître). Suivant les descriptions proposées par Rocheboet dans ce dernier article, tous ces témoins, à l’exception d’un fragment (Cambridge, University Library, Add. 2709 (1), qui donne un extrait de l’histoire troyenne) comportent les parties de la chronique consacrées à l’histoire ancienne. Un autre, appartenant à la collection particulière de van der Cruisse de Waziers au château le Sart, a été détruit en 1915.
77 Voir, à ce propos, Noirfalise, Family Feuds and the (Re)writing of Universal History, op. cit., p. 118-119, et passim. Comme le souligne Noirfalise, la première divergence identifiée entre les deux rédactions (A et B) concerne un chapitre sur la biographie de Richilde de Hainaut, ayant vécu au xie siècle. Or cette portion du texte n’est présente que dans deux témoins qui comportent également les parties d’histoire ancienne : ce sont le manuscrit de Cambrai, BM, 683 et les deux volumes de Bruxelles, Bibl. royale, II 988, qui sont également les deux témoins les plus anciens de la « rédaction A » de l’œuvre.
78 Cela concerne notamment une série de chroniques désignées comme Trésor des histoires, dont les témoins se chevauchent dans la littérature critique avec ceux de la CBA (cf. Noirfalise, Family Feuds and the (Re)writing of Universal History, op. cit., p. 18, note 3, ainsi que p. 49-52 (parlant des « hybrid versions » de la chronique). Nous avons abordé la question de la délimitation entre la CBA et les « Trésors des histoires » dans un article récent, L. Endress, « Trésor de sapience, Trésor des histoires ? Quelques observations sur la tradition manuscrite de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes », Les chroniques et l’histoire universelle, France et Italie (xiiie-xive siècles), éd. F. Maillet, F. Montorsi, M. Albertini et S. Ferrilli, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 85-110.
79 Nous reprenons ici des éléments de notre article récent (ibid.).
80 Nous avons inclus une liste de ces témoins à la p. 225-226 infra, avec l’indication des feuillets où se trouve la vie d’Hercule.
81 Les extraits du texte cités dans la suite se baseront principalement sur ce manuscrit, que nous avons revu et corrigé systématiquement à l’aide d’une série de huit autres témoins. Font partie des manuscrits de contrôle : quatre témoins précoces, du xiiie ou xive siècle : Arras, Médiathèque municipale, 863 (1043) (= A1), Bruxelles, Bibl. royale, II 988 (= B6), Paris, Arsenal 3710 (= Ars) ; trois témoins du xve siècle : Paris, Arsenal 5077 (= Ars3), Baltimore, Walters Art Gallery (= Ba) et Paris, BnF, 1367 (= P4) ; et un témoin de l’état textuel que nous avons défini comme version « avec ajouts », du xve siècle : Gand, Universiteitsbibliotheek, 415 (= Ge). Notons cependant que nous avons consulté les passages correspondants dans tous les manuscrits listés aux p. 225-226 infra. C’est ainsi que nous citons ponctuellement des variantes présentes dans ces autres manuscrits.
82 Comme nous l’avons vu supra, p. 190-192.
83 Cf. supra, p. 147, 149, 165, à propos des jeux olympiques dans des chroniques latines.
84 Ms. P, f. 120va ; L5, f. 76ra ; Ca, f. 23ra.
85 La même forme ou une forme apparentée se trouve dans la vaste majorité des témoins (cf. la liste de manuscrits et sigles donnée infra, p. 225-226) : Armee A1Ars1Ars2B2B4B6BeChGeL1Lh1Nh2P2P4P13Val1A(r ?)mee Bes ArmeesArs3. La phrase Chil Herculés […] Armee estabsente dans Ba. Seul L2 donne, avec Alcumena, une variante qui puise manifestement dans un savoir externe à la tradition manuscrite de la CBA.
86 Aux ff. 34va-35rb dans le ms. Ca.
87 Ms. Ca, f. 24vb (première mention) et 25ra (deuxième mention).
88 Ibid.,f. 25ra.
89 Ibid., f. 25rb.
90 Ibid., f. 25ra.
91 Ms. P, f. 123rab ; L5, f. 76vb-77ra ; Ca, f. 23va.
92 Voir nos remarques à propos de la chronique d’Eusèbe-Jérôme (supra, p. 147-148). À propos du décompte des années entre deux Olympiades et la montagne Olympus, voir notre discussion dans la première partie (supra, p. 117-119).
93 Selon les témoignages que nous avons pu consulter, la victoire d’Hercule sur Cacus ne semble s’introduire dans les chroniques universelles latines médiévales qu’au début du xiiie siècle avec le Chronicon d’Hélinand de Froidmont, dont la rédaction date des années 1210. Cette chronique comporte un épais chapitre traitant De morte Herculis (cf. Ms. Vatican, BAV, Reg. lat. 535, p. 350-352, dont nous ne pourrons pas parler dans le détail ici, mais qui mériterait une étude à part), intégrant de nombreux éléments repris au traité du Mythographe III du Vatican, dont des éléments parlant de la victoire d’Hercule sur Cacus, le brigand qui terrorisait les habitants du Latium avant la fondation de Rome. Une partie très mince des éléments retenus par Hélinand, dont l’anecdote à propos de Cacus, a été ensuite reprise par Vincent de Beauvais dans son Speculum historiale dans les années 1260 (dans un passage dont nous avons parlé supra, p. 204-205, en rapport avec l’HAC2), qui n’a cependant pas été utilisé par l’auteur de la CBA. D’autre part, la version de l’épisode d’après l’Histoire romaine de Tite-Live trouvera son chemin vers l’historiographie médiévale à partir du xive siècle, à travers l’adaptation française de l’œuvre par Pierre Bersuire, remaniée à son tour au xve siècle par Jean Mansel dans ses Histoires rommaines (conservées par l’unique manuscrit Paris, Arsenal 5087-5088, où le segment en question se trouve aux f. 20rb-21rb), ainsi que dans la version longue (ou « deuxième rédaction ») de sa Fleur des histoires. À propos de ces différentes adaptations de l’œuvre de Tite-Live, on consultera la page qui leur est consacrée sur le site du Miroir des Classiques, dir. Frédéric Duval, Paris, École nationale des chartes, 2007-, en ligne : http://elec.enc-sorbonne.fr/miroir_des_classiques/index.html (dernière consultation : 10/06/2023).
94 Ms. P, f. 124vb ; L5, f. 78ra ; Ca, f. 25ra-b.
95 Il n’est pas très surprenant que l’Œta ait été réinterprété dans une deuxième étape en Etna. Tel est le cas, entre autres, dans les quatre manuscrits de la version étendue de la CBA, où il est question d’un feu de souffre qu’est en la montaingne Ethnna (ms. Ge, f. 61v) (cf. aussi p. 235 et 237 infra à propos de chroniques qui reprennent l’information).
96 Cf. supra, p. 146 (Hercules […] morte finitus est anno aetatis .lii.).
97 La chronique de Fréculfe est citée d’après Frechulfi Lexoviensis episcopi opera omnia, éd. Allen, op. cit. ; avec notre traduction.
98 Voir aussi, à propos de la version vulgate et la version avec ajouts de la CBA, Endress, « Trésor de sapience, Trésor des histoires ? », art. cité. Les pages qui suivent ici s’appuient sur la même argumentation qui se lit dans l’article, mais se concentrent spécifiquement sur les épisodes herculéens.
99 Cf. supra, p. 145-147 et 151-152 au sujet des anecdotes dans l’historiographie latine. On notera que diverses chroniques latines, à commencer par celle d’Eusèbe-Jérôme, mentionnent la victoire d’Hercule sur Antée à plusieurs reprises, comme on l’observe aussi dans la CBA avec ajouts. Nous reviendrons infra, p. 232-233, sur le dédoublement de l’épisode dans ces chroniques vernaculaires.
100 L’œuvre est dédiée au roi Philippe VI de Valois, d’où le titre conventionnel, introduit par C. Couderc, « Le manuel d’histoire de Philippe VI de Valois », Études d’histoire du Moyen Âge dédiées à Gabriel Monod, Paris, Cerf et Alcan, 1896, p. 415-444. Voir aussi H. Omont, « Anonyme, auteur d’une “Chronique universelle” en français », Histoire littéraire de la France, t. 36, 1927, p. 631-633.
101 Nous avons choisi ce témoin sur la base des critères combinés de sa date précoce (du xive siècle), de son accessibilité et du bon état du texte qu’il transmet. Les variantes indiquées proviennent des manuscrits de Paris, BnF, fr. 4940 (= P4940, également du xive siècle), fr. 4939 (= P4939, xve siècle, dans lequel les anecdotes à propos d’Hercule ne sont cependant pas toutes présentes), fr. 19477 (= P19477, xive siècle), fr. 693 (= P693), fr. 1406 (P1406), et Vatican, BAV, Reg. lat. 688 (= V688). Voir aussi notre étude « Trésor de Sapience, Trésor des Histoires ? », art. cité, p. 100-104.
102 D’après Ge, f. 1r. La même rubrique se retrouve en tête des manuscrits Bes et Val1 (au f. 1r).
103 Comme c’est déjà le cas dans certaines chroniques latines, dont celle d’Eusèbe-Jérôme, mais aussi l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur. Cf.supra p. 145-147 et 151-152.
104 Les rapprochements entre Thésée et Hercule nous occuperont davantage dans la troisième partie de ce travail, sur l’Ovide moralisé (cf.infra p. 315-330).
105 Déipyle, ou Déiphile, est en même temps le nom de la femme de Tydée. Nos connaissances actuelles ne nous permettent cependant pas d’expliquer pourquoi un personnage associé à la guerre de Thèbes a ici remplacé Omphale, si ce n’est que Deiphile ressemble quelque peu à un croisement entre les noms d’Omphale et de Déjanire. Une attestation de la forme hybride Deyfille se trouve, par ailleurs, déjà dans un manuscrit du Manuel, Vatican, BAV, Reg. lat. 688, ce qui nous donne une piste pour repérer le(s) point(s) de rencontre entre la CBA et cet abrégé d’histoire.
106 Endress, « Trésor de sapience, Trésor des histoires ? », art. cité.
107 Un bon exemple d’une telle compilation, que nous n’aborderons pourtant pas ici, est contenu dans le manuscrit Londres, BL, Cotton Augustus V, décrit par J. A. Ross, « Some Geographical and Topographical Miniatures in a Fragmentary Trésor des histoires », Scriptorium, 23:1, 1969, p. 177-186.
108 Cité d’après le manuscrit Arras, BM, 995, f. 20r. Le manuscrit Paris, BnF, fr. 17818 donne ce même incipit au f. 19r, en tête d’un segment qui précède, dans le témoin en question, le « prologue » désigné en tant que tel.
109 Cf. Paris, BnF, fr. 15455, f. 1r. Comparer avec l’incipit de la CBA suivant le manuscrit de Cambrai, BM, 683 : Ki le tresor de sapienche veut metre en l’aumaire de sa memoire et l’enseignement des sages es tables de son cuer escrire, sor toutes choses il doit fuir le fardiel de confusion, car elle engenre ignorance et est mere d’oubliance (f. 1ra).
110 Cf. supra, p. 155.
111 Nous avons repris certains éléments de la description générale de ce témoin (au premier paragraphe, ne concernant pas Hercule) à la liste de manuscrits de la CBA dans la thèse d’A. Rochebouet, « D’une pel toute entiere sans nulle cousture », op. cit., p. 212.
112 Voici, pour rappel, le texte de la CBA : Adont estoit Herculés en la flour de sa jouvente. Chil Herculés fu fius la dame Armee. Saichié que plus fors ne plus hardis ne fu puis le deluve (Ca, f. 23ra).
113 Ms. fr. 17181, f. 39r.
114 Citons le Manuel (d’après le ms. Paris, BnF, fr. 4940, f. 8v) : Herculés commença les tournoiemens que on appelle les giex des Olimpias pour ce que on les faisoit au pié de celle montaigne.[…] Adonc on comptoit les ans des giex d’Olimpias ainsi comme nous comptons orendroit de l’Incarnacion. En ce temps Herculés vainqui les centa[u]res[var. sagitairesMetz, BM, 137],qui estoient, selon les poetes, la moitié homme et l’autre moitié cheval. En effet, la CBA tout comme le Manuel évoquent l’institution des jeux par Hercule, mais la version de l’anecdote reprise dans fr. 17181 se rapproche de celle du Manuel plutôt que de celle de la CBA. Contrairement au Manuel (et fr. 17181), la CBA ne mentionne ni la localisation de l’événement ni le décompte des années, mais évoque, en revanche, que tuit li chevalier de Gresce venoient de .v. ans a autre pour aus esprouver et pour conquerre los et pris (Ms. Ca, 23va).
115 Voir l’HAC1b, d’après le ms. Londres, BL, Add. 19669 (L5) : Et saichiez que il i fist maintes autres proesces, car il ne doutoit riens, ne serpant ne autre beste, tant fust crueuse.
116 Ms. fr. 17181, f. 41v.
117 Rappelons les variantes citées supra (p. 223) : oetha Ca oeacha A1 oratha B6 oeatha P4ChP2P13 ocatha Ars3Lh1 ethna BeBes ethnna Ge ethnam Val1.
118 Certains éléments de la description générale de ce témoin ont été repris à la liste de manuscrits de la CBA dans la thèse d’Anne Rochebouet, « D’une pel toute entiere sans nulle cousture », op. cit., p. 207-208.
119 On a ainsi l’impression que le compilateur du manuscrit d’Arras (ou l’auteur de la compilation qu’il copiait) connaissait d’autres chroniques qui comportaient des ajouts au même endroit, antéposés au noyau de la vie d’Hercule ; mais plutôt que de les suivre, il a décidé d’aménager la matière à sa propre façon.
120 Ms. Arras, BM, 995, f. 66r. On rappellera que la CBA ne comporte ni la mention de Laudaci (devenu ici Landar), ni celle de Samson. De même, le texte du manuscrit d’Arras donne, avec Armene, une forme du nom d’Alcmène qui ne se trouve pas dans les manuscrits de la CBA que nous avons regardés, mais bien dans ceux de l’HAC1b. Cf.supra, p. 190-191.
121 Ms. Arras, BM, 995, f. 62v. Le texte est proche de celui du ms. fr. 17181, mais le segment dans lequel s’insère l’extrait est antéposé au noyau de la vie d’Hercule dans le manuscrit d’Arras.
122 Ms. Arras, BM, 995, f. 69r.
123 Ms. Paris, BnF, fr. 15455, f. 1r.
124 Cf. Jung, La légende de Troie en France au Moyen Âge, op. cit., p. 555-559 ; Barbieri, « Trois fragments[…] », art. cité, p 345, et passim.
125 Il s’agit à nouveau d’emprunts au Manuel. Le premier ajout concerne Cerbère. À part la contextualisation initiale, il est quasiment identique à l’anecdote citée supra d’après le Manuel et Ge-Be-Bes-Val1 : Seigneurs, ou temps que cellui Barath gouvernoit les Ebrieux, fut Cerberus, ung grant jayant qui devoura Paritoine[= Pirithoüs], qui estoit venus pour ravir Proserpine avecques Teseüs ; et aussi eüst il devouré Theseüs, maiz Herculés y survint qui le delivra. Et pource qu’il estoit si maulx, les poetes dient que Cerberus est portier d’enfer. (fr. 15455, f. 94va). Le second concerne les trois maîtres de musique, Orphée, Museüs et Linus, dont le dernier aurait été le maître d’Hercule : Museüs fut son disciple[= d’Orpheé]et Lynus auxi, qui fut maistre Herculés ; et estoient ses trois maistres appelez poetes divins. (fr. 15455, f. 95vb). Le passage provient également du Manuel (cf. Paris, BnF, fr. 4940, f. 8r : Museüs fu son desciple. Lynus fu maistre de Herculés et estoient ces .iii. maistres appellez poetes divins).
126 Ms. Paris, BnF, fr. 15455, f. 97vb-98ra ; ms. Paris, Arsenal 3685, f. 178r. Nous renvoyons à notre discussion supra à propos des rédactions HAC1a, HAC1b et HAC2. Pour résumer rapidement les éléments soulignés : l’HAC3 comporte ici et ailleurs dans la vie d’Hercule, comme l’HAC1a, des appels aux « seigneurs » (absents dans HAC1b, HAC2 et CBA). Le texte du manuscrit fr. 15455 parle, comme tous les témoins considérés de l’HAC1a, d’Almene, et non d’Armene, comme dans l’HAC1b et l’HAC2 ou Armee (comme dans la CBA). Le segment témoigne enfin d’une série d’éléments ayant été coupés de l’HAC1b, absents de l’HAC2 et, encore davantage du texte abrégé de la CBA.
127 La présence de ces moralisations dans l’HAC3 a déjà été constatée par Richard Trachsler dans son article « L’histoire au fil des siècles », art. cité, p. 90 sqq. ; une partie de l’insertion moralisatrice est transcrite aux p. 91-93 de son article.
128 Ms. Paris, BnF, fr. 15455, f. 99vab ; ms. Paris, Arsenal 3685, f. 181v.
129 Voir encore notre étude « Trésor de sapience, Trésor des histoires ? », art. cité, p. 107-108.
130 On peut naturellement aussi imaginer des témoins glosés du Manuel, indiquant différentes solutions possibles. La question mériterait une étude plus approfondie sur l’ensemble de la tradition de l’œuvre.
131 Ces ajouts sont d’autant plus visibles quand ils apparaissent dans une chronique qui abrège ailleurs les segments narratifs.
132 De manière générale, c’est lors des moments de transition entre les segments thématiques que la matière peut bouger, et cela déjà dans les chroniques plus anciennes. Il suffit de penser au principe des incidentia qui s’accumulent à la fin des chapitres déjà chez Pierre le Mangeur.
133 Aux textes considérés ici, on peut ajouter, entre autres, la première version de la Fleur des histoires de Jean Mansel, composée entre 1446 et 1451. La vie d’Hercule que l’on trouve dans le premier livre de cette chronique, que nous ne pourrons pas traiter ici, se construit également autour des épisodes racontant l’expédition des Grecs contre les Amazones et la première destruction de Troie, augmentée par l’ajout d’anecdotes provenant du Manuel. Il suffit de citer l’anecdote à propos d’Hercule « filandier » et de la mort du héros afin de comprendre que l’on se trouve dans la même tradition générale : Herculés, qui tant fu vaillant en armes et qui fu nommé victorieux pour ce qu’il fist moult de prouesses et eult moult de victores en sa vie, il surmonta maints roix et mains princes et vainqui maintes batailles. Et toutesvoies, une femme que l’en nommoit Omphale le surmonta, car elle le fist filer et faire œuvre de femme. En fin, Herculés eult une maladie et pour cuidier trouver le remede d’icelle, il se gecta en ung feu et y fu ars (Paris, BnF, fr. 55, f. 160rb-vb).
134 Le livre de la mutacion de fortune par Christine de Pisan, publié d’après les manuscrits parS. Solente, vol. 3, Paris, Picard, 1964. Les éléments à propos d’Hercule se trouvent dans la quatrième partie, aux chapitres 2 (parlant de l’expédition contre les Amazones), 3 (sur la vie et la mort d’Hercule, voir v. 13885-14058) et 6-7 (sur les voyages des Argonautes et la première destruction de Troie).
135 À propos d’Hercule dans cette œuvre, voir l’article de L. Dulac, « Le chevalier Hercule de l’Ovide moralisé au Livre de la mutacion de fortune de Christine de Pizan », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 9, 2002 (Lectures et usages d’Ovide), p. 115-130.