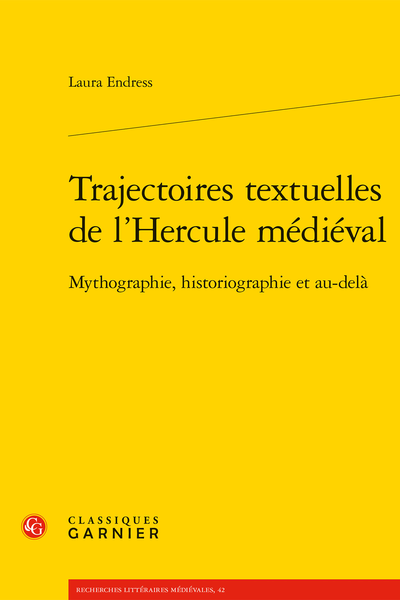
La vie d’Hercule dans l’Ovide moralisé (OM) Délimitation et résumé
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Mythographie, historiographie et au-delà
- Pages : 285 à 290
- Collection : Recherches littéraires médiévales, n° 42
- Série : Ovidiana, n° 3
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406154648
- ISBN : 978-2-406-15464-8
- ISSN : 2261-0367
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15464-8.p.0285
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/01/2024
- Langue : Français
La vie d’Hercule
dans l’Ovide moralisé (OM)
Délimitation et résumé
Pour commencer, il est utile de rappeler à grands traits ce que dit l’OM à propos d’Hercule. Comme les différentes rédactions et, plus concrètement, les manuscrits, varient sur le plan de leurs contenus, nous nous baserons pour notre premier résumé sur la version du texte transmis par la majorité des témoins de ce qu’on peut appeler la version vulgate du texte1. La matière herculéenne dans l’OM est éparpillée à travers les différents livres du poème, ressemblant de ce fait aux fragments d’une biographieéclatée : au livre VII, Hercule entre en scène pour libérer Thésée des enfers ; au livre XI, il assiège la cité de Troie après avoir sauvé Hésione, fille de Laomédon, d’un monstre marin ; et au livre XII, ses exploits sont rappelés en rétrospective par le roi Nestor2. Le nom du héros et certains épisodes de sa vie sont encore évoqués à d’autres moments de l’œuvre3. La plus longue partie consacrée à sa biographie occupe cependant le premier millier de vers du livre IX, où se retrouve le récit de la mort et de 286l’apothéose du héros, précédé des événements et des circonstances qui ont mené à cette fin. Ce segment est suivi d’un récit rétrospectif de la part d’Alcmène, mère d’Hercule, à propos de la naissance de son fils4. Parmi ces différents morceaux thématiques, celui consacré aux derniers événements de la vie d’Hercule peut être vu comme « noyau essentiel », de par sa longueur et par le fait qu’Hercule y intervient comme protagoniste5. Nous nous concentrerons ici avant tout sur cette partie « centrale » de la biographie du héros.
Les différentes composantes thématiques qui constituent la vie d’Hercule au début du livre IX sont représentées schématiquement dans la table suivante, où sont indiqués les vers concernés de l’OM ainsi que les passages-sources principaux chez Ovide6.
|
Contenu |
Vers |
Sources principales (Ovide) |
|
Récit d’Achéloüs : comment Hercule l’a vaincu pour gagner la main de Déjanire |
IX, 1-234 |
Mét. VIII, 879-883 |
|
Allégorie |
IX, 235-324 |
/ |
|
Exposition historique |
IX, 325-346 |
/ |
|
Rencontre entre Hercule, Déjanire |
IX, 347-438 (IX, 439-452) |
Mét. IX, 101-133 / |
|
Allégorie |
IX, 453-486 |
/ |
|
Introduction aux exploits héroïques d’Hercule |
IX, 487-506 |
Mét. IX, 134-135 (étendu dans l’OM) |
|
Interpolation : les amours d’Hercule |
IX, 507-575 ; |
Héroïde IX et Fastes II (et al.) |
|
la déception de Faunus |
IX, 576-599 |
|
|
Jalousie de Déjanire, souffrances d’Hercule et métamorphose de Lichas en rocher |
IX, 668-790 |
Mét. IX, 136-229 |
| 287
Mort et Apothéose d’Hercule |
IX, 791-872 |
Mét., IX, 229-272 |
|
Allégorie |
IX, 873-1029 |
/ |
|
Résumé final sur la mort d’Hercule |
IX, 1030-36 |
/ |
Compte tenu de la structuration bipartite de la trame en fables (les récits mythologiques à proprement parler, sur fond blanc) et expositions (leurs interprétations, sur fond gris), on peut distinguer trois blocs principaux de cette biographie du héros (sans compter le résumé final), chacun suivi d’au moins une exposition allégorique. Les deux premiers, tournant autour de la lutte d’Hercule contre Achéloüs pour gagner la main de Déjanire et de la rencontre avec Nessus, adaptés d’après les Métamorphoses, préparent le troisième, plus long et plus construit, mettant à contribution plusieurs sources ovidiennes supplémentaires, parlant des événements qui ont mené à la mort d’Hercule7.
Les contenus des différentes parties de la fable, avec leurs sous-parties et leurs expositions, peuvent être résumés comme suit :
– Récit d ’ Achéloüs sur sa lutte contre Hercule (OM IX, 1-234) : À la demande de Thésée, Achéloüs, dieu-fleuve capable de se transformer en serpent et en taureau, raconte comment il a perdu l’une de ses cornes taurines. Lui-même et Hercule se sont mesurés dans un concours de lutte organisé par le roi Oeneüs de Calydoine, dont le prix était la main de la fille de ce dernier, Déjanire. Lors de la confrontation, Achéloüs fait appel à ses ruses, en se métamorphosant en différentes formes. Lorsqu’Achéloüs combat sous forme de taureau, Hercule le jette par terre et lui rompt la corne droite. Celle-ci devient la corne d’abondance, répandant la plénitude.
– Allégorie sur la lutte entre Hercule et Achéloüs (OM IX, 235-324) : Le monde (~ Achéloüs) est l’un des trois prétendants à l’âme (~ Déjanire), à côté de la chair et du diable. Dieu (~ Hercule) souffre les tribulations du monde afin de conquérir l’âme et, en cela, surmonte l’instabilité et les vains plaisirs (~ Achéloüs sous forme de cours d’eau), la malice et les déceptions (~ Achéloüs sous forme serpentine) ainsi que l’orgueil et la présomption (~ Achéloüs sous forme de taureau). En effet, le monde avait jadis deux « cornes », 288mais il a perdu celle de droite, que possèdent désormais les saints hommes vivant dans la plénitude au paradis, laissant au monde honni seule la corne gauche, signifiant la mauvese vie.
– Exposition historique sur la lutte entre Hercule et Achéloüs (OM IX, 325-346) : Achéloüs était un riche duc contre lequel Hercule est parti en guerre, le surmontant par mer (~ Achéloüs sous forme de fleuve) et par terre (~ Achéloüs sous forme de serpent). Achéloüs s’enferme ensuite dans une tour (~ Achéloüs sous forme taureau8) qu’Hercule détruit, laissant la terre environnante fertile, améliorée par le fleuve qui traverse le paysage.
– Rencontre entre Hercule, Déjanire et Nessus (OM IX, 347-437) : Hercule et Déjanire arrivent au bord d’une grande rivière, où le sagitaire Nessus aperçoit l’épouse du héros et s’enflamme pour elle. Comme Hercule ne trouve pas de moyen pour traverser l’eau avec sa femme, Nessus lui propose de la porter de l’autre côté pendant qu’Hercule traverse le fleuve en nageant. Hercule y consent, mais dès qu’il entre dans l’eau, Nessus tente d’enlever Déjanire, ce qui pousse Hercule à le frapper d’une flèche empoisonnée. Se sentant proche de la mort, Nessus réfléchit à une manière de se venger : il donne sa chemise tâchée de sang et de venin à Déjanire, lui disant que le vêtement lui permettra de regagner l’amour de son mari une fois que l’attention de celui-ci se sera estompée. Déjanire le croit et garde la chemise.
Le segment se termine sur un court discours moralisateur qui critique la crédulité des femmes (439-452).
– Allégorie sur la rencontre entre Hercule, Nessus et Déjanire (OM IX, 453-486) : L’âme (~ Déjanire) est tentée par le diable (~ Nessus) de sorte qu’elle contrevient aux ordres que lui a donnés Dieu et qu’elle est livrée à son ennemi ; mais elle est sauvée du diable par la flèche de Dieu (~ Hercule) et rendue « a son droit seigneur ». Le diable cependant ne cesse de décevoir l’âme et de l’induire en erreur (~ le don de la chemise envenimée).
– Introduction aux exploits héroïques d ’ Hercule (OM IX, 487-506) : Les intrigues précédentes sont suivies d’un intervalle de moult lonc terme (488), pendant lequel Hercule reste avec sa nouvelle femme. Évocation globale des exploits d’Hercule qui, après avoir conquis la main de Déjanire, fist maint biau fet de noblesce (498), délivrant 289le monde des créatures malfaisantes, de sorte que Ses proesces et ses esfors / Fist aparoir par tout le mont (501-502).
– Amours d ’ Hercule et d ’ Iole (OM IX, 507-599) : La période de bonheur, marquée par les prouesses d’Hercule, est interrompue lorsque ce dernier s’éprend d’Yole/Yolent, qu’il a amenée prisonnière après avoir conquis l’Oechalie. Hercule se trouve pris aux giez (532) d’Amour et se soumet entièrement à Iole, échangeant sa peau de lion et sa massue contre les robes et les instruments de tissage de son amante.
L’épisode d’Hercule « filandier » se termine par un court récit annexe sur Faunus (.i. damedieu sauvage et sot, 576), qui est trompé par l’apparence du héros travesti et battu lorsqu’il tente de lui faire des avances.
– Jalousie de Déjanire et souffrances d ’ Hercule (OM IX, 600-790) : Déjanire, ayant entendu des rumeurs sur l’infidélité de son mari, s’adonne à un discours emporté, se lamentant sur l’injustice dont elle est victime. Sa colère et sa jalousie la poussent à envoyer à son mari la tunique empoisonnée qu’elle avait reçue de Nessus. Hercule revêt le vêtement qui lui est apporté par son serviteur Lichas et sent aussitôt le poison qui commence à brûler son corps. Incapable d’enlever la tunique sans déchirer sa propre peau, ravagé par des tourments, Hercule prononce son dernier discours dans lequel il implore la pitié de sa marâtre Junon, en rappelant les exploits qu’il a accomplis pendant sa vie. Dans sa rage, il saisit Lichas et le précipite dans la mer, où il est métamorphosé en rocher.
– Mort et Apothéose d ’ Hercule (OM IX, 791-872) : Hercule dresse son propre bûcher afin de se faire brûler et ainsi délivrer de ses souffrances mortelles. Lorsque son corps est consumé par le feu, son père Jupiter prend la parole, s’adressant aux autres dieux et annonçant l’exaucement et la déification de son fils.
– Allégorie finale (OM IX, 873-1029) : Dieu (~ Jupiter) s’incarne en Jésus Christ (~ Hercule), revêtant la chair humaine (~ l’échange d’habits) et descendant sur terre pour combattre le mal (~ les travaux d’Hercule). Lorsque la Judée (à savoir cele / Que Diex ot premeraine amee (933) ~ Déjanire) apprend que Dieu/Jésus avait embrassé la sainte Église (en d’autres mots, Que Diex avoit novele amie (936) ~ Iole), elle se retourne contre lui. En acceptant le don de la sainte char (947) (~ don de la chemise empoisonnée), Jésus est livré à la Passion et à la mort (~ souffrances et mort d’Hercule). Mais en acceptant la mort terrestre, le Fils accède à la vie éternelle (~ apothéose d’Hercule).
290– Résumé final sur la Mort d ’ Hercule (OM IX, 1030-1036) : L’unique allégorie est suivie d’une brève conclusion évoquant comment le monde entier est informé de la mort et de l’apothéose d’Hercule.
Bien qu’elle s’appuie sur le modèle primaire des Métamorphoses, cette biographie donne la nette impression d’être constituée d’une série de fragments ou de sous-ensembles narratifs, assemblés et cousus ensemble, interrompus par des digressions interprétatives et édifiantes, plutôt que de se présenter comme un récit unitaire. Elle ressemble en cela aux biographies d’Hercule que nous avons abordées dans la deuxième partie de ce travail. Comme nous l’avons fait pour ces dernières, il s’agit de comprendre comment se construit cette vie d’« Hercule moralisé » – à savoir quels matériaux sont mis à contribution et pourquoi l’auteur du texte les a assemblés de telle manière. C’est ce que nous chercherons à faire dans les chapitres suivants, en proposant une série d’études de cas sur des passages qui innovent par rapport à Ovide, en cherchant à mieux comprendre leurs sources et leur « raisons d’être » dans l’OM.
1 Voir infra, p. 366 sqq., à propos des manuscrits et rédactions du texte. Les renvois aux différents livres et vers du texte suivront les indications de l’édition de Boer. Nous avons également repris cette versification dans notre édition de la vie d’Hercule au livre IX. Sauf indication contraire, nous prenons comme témoin de référence pour la version vulgate le manuscrit Rouen, BM, O.4 (siglé A1), qui est également le manuscrit de base de notre édition.
2 Sur les évocations d’Hercule aux livres VII, XI et XII de l’œuvre, cf. Jung, « Hercule dans les textes du Moyen Âge »,art. cité, p. 49. Les segments concernés sont les suivants : OM VII, 1680-2003 (Thésée et Hercule) ; XI, 1021-1143 (siège de Troie) ; XII, 3138-3224 (récit de Nestor). Le segment à propos de Thésée constitue une longue interpolation par rapport au texte latin d’Ovide. Les Métamorphoses traitent, certes, du mythe de Thésée (aux v. 404-452 du livre VII), mais n’évoquent qu’accessoirement la descente d’Hercule aux enfers (v. 408-415) et ne parlent pas de la libération de Thésée.
3 Par exemple dans les allégories sur le mythe d’Atlas et de Persée au livre IV de l’OM, où l’on retrouve des références aux pommes volées du jardin des Hespérides et des traces de l’interprétation faisant d’Hercule le disciple d’Atlas (OM IV, 6302-41, surtout 6322-28). Voir, à propos de cette interprétation historicisante, nos observations dans la première partie supra, p. 41, 83-84, 107.
4 OM IX, 1030-1179.
5 Une association emblématique entre Hercule et le livre IX en général ressort également de l’ordre des miniatures contenus dans plusieurs témoins (cf. à ce sujet Jung, « Les éditions manuscrites de l’Ovide moralisé »,art. cité, surtout p. 260-261 ; nous reviendrons brièvement sur ce sujet infra, p. 382-383).
6 Tous nos renvois aux Métamorphoses se réfèrent, sauf indication contraire, à l’éd. Tarrant ; les indications à propos des Héroïdes et des Fastes se basent sur les éditions suivantes : Ovide, Les Fastes. éd., trad., comm. Schilling, op. cit., et Ovide, Héroïdes. éd. Bornecque, trad. Prévost, op. cit. Les indications de vers de la vie d’Hercule dans l’OM renvoient ici et dans la suite à notre édition provisoire en annexe, reprenant à son tour la numérotation des vers de l’édition de Boer.
7 Les données visualisées ici se limitent aux correspondances les plus substantielles entre l’OM et les hypotextes ovidiens, sans rendre compte des composantes plus ténues à l’intérieur des segments qui s’inspirent d’autres sources. Ces derniers éléments nous intéresseront dans les études de cas qui suivent cette présentation des contenus.
8 Comparer OM IX, 185, Lors me muai en un fier tour, et OM IX, 337-338, Acheloüs au tiers estour / Se mist en une soie tour (nos gras). Voir aussi infra, p. 305, à propos du rapprochement.