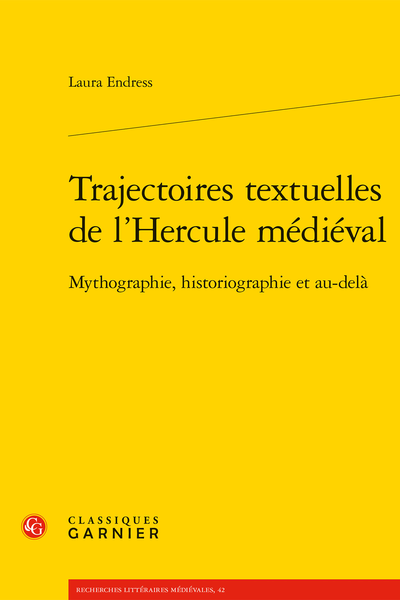
Introduction à la troisième partie
- Publication type: Book chapter
- Book: Trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Mythographie, historiographie et au-delà
- Pages: 279 to 283
- Collection: Medieval Literary Research, n° 42
- Series: Ovidiana, n° 3
- CLIL theme: 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN: 9782406154648
- ISBN: 978-2-406-15464-8
- ISSN: 2261-0367
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15464-8.p.0279
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 01-24-2024
- Language: French
Introduction
à la troisième partie
Des fragments du mythe d’Hercule ont trouvé leur chemin vers diverses œuvres du Moyen Âge français, où ils se manifestent dans des constellations variantes et sous différentes formes. Nous l’avons vu dans la deuxième partie de ce livre, avec l’exemple de la tradition historiographique. Les textes individuels s’avèrent être des répertoires d’une matière foisonnante, et chacun d’entre eux permet de mieux comprendre la constitution de la vie textuelle d’Hercule au fil du temps. Ce constat ne vaut pas seulement pour les compilations d’histoire ancienne et universelle, mais pour tout texte qui s’approprie une partie de la matière herculéenne que le Moyen Âge a héritée de l’Antiquité latine. Nous proposons dans cette troisième partie d’examiner de plus près cette matière dans une œuvre qui se situe elle-même, comme Hercule, au croisement de plusieurs traditions textuelles et que nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises au cours des deux parties précédentes de cette monographie : l’Ovide moralisé, la première adaptation intégrale en français des Métamorphoses d’Ovide, totalisant quelque 72 000 octosyllabes, qui a probablement vu le jour dans les premières décennies du xive siècle. Il s’agit d’une œuvre qui a bénéficié d’un intérêt grandissant depuis les années 1990 notamment, grâce à des travaux importants menés d’abord par Marc-René Jung et Marylène Possamaï-Pérez, et plus récemment par les différents chercheurs associés au groupe de recherche « Ovide en Français » (OEF)1. Les membres de ce groupe international préparent 280actuellement une nouvelle édition critique des quinze livres de l’Ovide moralisé2. Le neuvième de ces livres, dont nous nous occupons dans le cadre du projet éditorial, réserve une place de choix à Hercule, comme le faisait déjà le livre IX des Métamorphoses, racontant notamment les derniers exploits du héros et sa mort. C’est sur ces éléments biographiques herculéens que se concentrera la dernière partie de ce livre.
Mais revenons d’abord sur notre présentation plus générale de l’Ovide moralisé (OM). Au-delà de sa longueur monumentale, l’OM fascine, entre autres, par la richesse de ses contenus. Comme son titre le suggère, l’œuvre ne traduit pas simplement les mythes, ou fables, d’Ovide, mais elle en offre des moralisations, ou expositions, conformes au discours chrétien de son époque3. En d’autres termes, les mythes provenant de l’Antiquité païenne sont adaptés et « moralisés », afin d’être plus accessibles et plus acceptables pour les lecteurs médiévaux. Hercule qui nettoie le monde de ses monstres devient une analogie du Christ qui sauve l’humanité de l’emprise du mal. Les mythes ovidiens font l’objet de telles allégories chrétiennes, ainsi que, dans certains cas, de lectures historicisantes. Occasionnellement, ils se transforment aussi en exempla moraux. De manière générale, les différentes interprétations sont placées après les récits « mythologiques » sur lesquels elles s’appuient4. À côté de ces éléments exégétiques, l’OM intègre aussi une quantité notable d’autres matériaux, d’ordre mythologique, encyclopédique et historico-romanesque, qui s’ajoutent aux mythes adaptés d’après les Métamorphoses5. La matière herculéenne qui occupe le début du livre IX 281de l’œuvre française intercale, entre autres, une longue séquence à propos de l’épisode d’Hercule « filandier », absente dans le livre correspondant des Métamorphoses. L’énumération de ses exploits qu’Hercule fait dans son dernier discours avant de mourir est, à son tour, augmentée par l’ajout de plusieurs éléments absents du passage correspondant chez Ovide. Comme d’autres chercheurs l’ont souligné, l’œuvre acquiert, par les divers ajouts, le statut d’une véritable « somme mythologique » de son époque6. Diverses recherches récentes se sont concentrées sur l’étude des sources de l’OM et, en particulier, les gloses et commentaires accompagnant le texte latin des Métamorphoses dans des manuscrits qui ont circulé en France médiévale7. La troisième partie du présent livre contribuera, à son tour, à ce volet de recherche, en examinant la provenance et le fonctionnement de certains ajouts dans la partie herculéenne du livre IX.
La richesse des contenus de l’œuvre est doublée par la complexité de sa tradition textuelle. On en connaît aujourd’hui vingt-et-un manuscrits (sans compter les fragments), dont les plus anciens datent de la première moitié du xive siècle et le plus récent de 1480 environ8. L’OM nous est parvenu sous la forme de plusieurs « rédactions » distinctes, dont la plus tardive, appelée conventionnellement « rédaction z », témoigne d’un remaniement poussé du texte9. Si les connaissances de la « vie 282textuelle » de l’œuvre ainsi que des rapports généalogiques entre ses manuscrits ont bénéficié d’études importantes ces dernières années, elles restent partielles10. Les études précédentes sur l’OM s’appuyaient en grande partie sur l’unique édition moderne intégrale de l’œuvre disponible jusqu’à ce jour, procurée par le philologue néerlandais Cornelis de Boer entre 1915 et 1938, dont le texte a été établi sur la base de trois manuscrits seulement11. Les lacunes dans la connaissance de la tradition manuscrite de l’œuvre sont en voie d’être comblées par les travaux de recherche et d’édition menées par l’équipe OEF. Notre étude rejoint également les études de cette équipe, en visant à fournir quelques nouveaux aperçus de la tradition textuelle de l’œuvre.
En fonction de ces points d’intérêt, cette troisième partie prendra la forme d’une série d’enquêtes sur les sources de l’OM, suivie de quelques observations sur sa tradition manuscrite, sur la base des passages herculéens au livre IX. Après une présentation d’ensemble des contenus herculéens transmis par l’OM, nous nous pencherons sur une sélection de passages qui innovent par rapport à Ovide, en cherchant à éclairer leurs sources et à expliquer leur « raison d’être » dans l’œuvre. Les segments concernés seront, en particulier, la liste augmentée d’exploits énumérés par Hercule avant de mourir, l’interpolation mettant en scène 283Hercule « filandier » et ses amours avec Iole, ainsi que les interprétations allégoriques christianisantes relatives à la vie du héros. Dans un dernier volet, nous donnerons un aperçu de la vie textuelle et la tradition manuscrite de l’œuvre à travers les segments herculéens au livre IX, en nous arrêtant sur la rédaction z, le manuscrit Acquisti e doni 442 de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florence, nouveau témoin que nous avons identifié au cours de nos recherches, ainsi que le comportement stemmatique de certains manuscrits qui apportent de nouvelles perspectives sur les connaissances du stemma codicum de l’œuvre. Ces enquêtes seront accompagnées, en annexe, d’un échantillon d’édition provisoire de la biographie herculéenne couvrant les 1036 premiers vers du livre IX, dont le texte a été établi d’après tous les manuscrits connus de l’OM.
1 Cf. la série d’articles de M.-R. Jung, « Aspects de l’Ovide moralisé », Ovidius redivivus : Von Ovid zu Dante, éd. M. Picone et B. Zimmermann, Stuttgart, M/P Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1994, p. 149-172 ; « Les éditions manuscrites de l’Ovide moralisé », art. cité ; « Ovide, texte, translateur et gloses dans les manuscrits de l’Ovide moralisé », art cité, et, dernièrement, « L’Ovide moralisé : de l’expérience de mes lectures à quelques propositions actuelles », Ovide métamorphosé : les lecteurs médiévaux d’Ovide, op. cit., p. 107-122. La bibliographie de Marylène Possamaï-Pérez au sujet de l’OM compte plusieurs dizaines de publications, débutant dans les années 1990 par des études comme « Les dieux d’Ovide “moralisés” dans un poème du commencement du xive siècle », Bien dire et bien aprandre, 12, 1994, p. 203-214 et « Les Métamorphoses d’Ovide : une adaptation du début du xive siècle », art. cité. Elle est l’auteur d’une impressionnante monographie, L’Ovide moralisé. Essai d’interprétation, op. cit., et a dirigé ou co-dirigé une série de volumes collectifs, dont Nouvelles études sur l’Ovide Moralisé, op. cit. Dans les années récentes, l’OM a en effet occupé une place importante dans une série de volumes collectifs. Outre Ovide métamorphosé : les lecteurs médiévaux d’Ovide, op. cit., plusieurs volumes ont été dirigés par l’équipe OEF : Ovidius explanatus. Traduire et commenter les Métamorphoses au Moyen Âge, op. cit., Traire de latin et espondre. Études sur la réception médiévale d’Ovide, op. cit., et Ovide en France du Moyen Âge à nos jours : Études pour célébrer le bimillénaire de sa mort, op. cit.
2 L’édition du premier livre, établie collectivement par les membres de l’équipe OEF, a déjà paru : Ovide Moralisé. Livre I, éd. C. Baker et al., Paris, SATF, 2018.
3 Le sujet est au centre de nombreuses contributions de Marylène Possamaï-Pérez. Voir surtout L’Ovide moralisé, op. cit. et, dernièrement, son chapitre dans l’introduction au livre I de l’OM, « Étude littéraire », Ovide Moralisé. Livre I, op. cit., t. 1, p. 221-232, qui contient aussi une bibliographie.
4 Cf. Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé, op. cit., p. 363-493, et A. Strubel, « Allégorie et interprétation dans l’Ovide moralisé », Ovide métamorphosé, op. cit., p. 139-162.
5 Voir, pour une vue d’ensemble des ajouts dans l’OM, Jung, « L’Ovide moralisé : de l’expérience de mes lectures à quelques propositions actuelles », art. cité, p. 109. Certains ajouts ont été étudiés de manière approfondie dans l’excellent travail de Demats, Fabula, op. cit., p. 61-105. Voir aussi M. Possamaï-Pérez, « L’Ovide moralisé, ou la “bonne glose” des Métamorphoses d’Ovide », Regards croisés sur la glose, Cahiers d’études Hispaniques Médiévales, 38, 2008, p. 181-206.
6 Voir B. Ribémont, « L’Ovide moralisé et la tradition encyclopédique médiévale. Une approche générique comparative », Cahiers de recherches médiévales, 9, 2002, p. 13-25.
7 Le sujet était au cœur du projet de recherche « Les Sources de l’Ovide Moralisé (SOM) », co-dirigé par Richard Trachsler et Olivier Collet et financé par le FNS, 2018-2021, no 178899. L’édition parallèle de deux commentaires importants des Métamorphoses, le Commentaire Vulgate et celui contenu dans le manuscrit Vatican, BAV, Vat. lat. 1479, a été entamé dans le cadre de ce projet. Les deux éditions comporteront trois volumes chacune. Actuellement, le premier volume du Commentaire Vulgate, et les deux premiers du Vat. lat. 1479 ont paru : Commentaire Vulgate des Métamorphoses d’Ovide. Livres I-V, éd. Coulson et Martina, trad. Martina et Wille, op. cit. ; Un commentaire médiéval […], Livres I-V et Livres VI-X, éd. Ciccone, trad. Possamaï-Pérez, op. cit. Le deuxième volume de l’édition du Commentaire Vulgate, dans le cadre duquel nous préparons l’édition du commentaire au livre IX des Métamorphoses, est actuellement en voie de complétion.
8 Nous avons inclus une liste des manuscrits infra, p. 366-367. Pour des descriptions détaillées des témoins, voir « Description des manuscrits », dir. Marianne Besseyre et Véronique Rouchon Mouilleron, Ovide moralisé. Livre I, op. cit., t. 1, p. 16-91.
9 C’est notamment à Marc-René Jung que l’on doit l’identification des différentes rédactions du texte ; voir Jung, « Les éditions manuscrites de l’Ovide moralisé », art. cité. Des études approfondies ainsi qu’une édition critique de la rédaction z ont été menées par Prunelle Deleville dans le cadre de sa thèse de doctorat, Édition critique et étude littéraire des manuscrits Z de l’Ovide Moralisé, Université de Lyon / Université de Genève, 2019. Son étude et l’édition intégrale du texte contenu dans les manuscrits Z ont paru depuis : P. Deleville, Métamorphose des Métamorphoses. La réécriture de la version Z de l’Ovide moralisé, Paris, Classiques Garnier, 2022, et La Version Z de l’Ovide moralisé, éd. P. Deleville, Paris, Classiques Garnier, 2023.
10 À propos de la « vie » du texte, cf. l’étude de F. Mora et al. « Ab ovo. Les manuscrits de l’Ovide Moralisé », art. cité. L’état actuel des connaissances sur la tradition manuscrite de l’OM se nourrit avant tout des contributions récentes de M. Cavagna, M. Gaggero et Y. Greub, « La tradition manuscrite de l’Ovide moralisé. Prolégomènes à une nouvelle édition », Romania, 132, 2014, p. 176-213, C. Baker et M. Gaggero, « La tradition manuscrite de l’œuvre », Ovide moralisé, Livre I, op. cit., t. 1, p. 139-152. Les rapports entre les manuscrits de la rédaction z sont au centre des articles suivants : L. Endress et R. Trachsler, « Économie et allégorie. Notule à propos des manuscrits Z de l’Ovide moralisé », Medioevo romanzo, 39, 2015, p. 350-365, P. Deleville, « Lectures conjointes et divergentes de l’Ovide moralisé », Traire de latin et espondre, op. cit., p. 197-208, et I. Reginato, « Notes sur les modèles de la rédaction Z de l’Ovide moralisé. Le cas de la fable de Sémelé », Revue belge de philologie et d’histoire, 97, 2019, p. 175-216. Voir aussi notre récente étude sur un nouveau témoin de l’œuvre, L. Endress, « Un nouveau manuscrit de l’Ovide Moralisé. Ms. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e Doni 442 », Revue belge de philologie et d’histoire, 99:2, 2021, p. 283-308.
11 Comme de Boer l’annonce lui-même dans l’introduction à son édition : « Les copies complètes des mss. A [Rouen, BM O. 4], B [Lyon, BM 742] et un représentant du groupe y – que nous appellerons C – suffisent pour garantir un texte rigoureusement critique. (Ovide moralisé, éd. de Boer, op. cit., t. 1, 1915, p. 51).