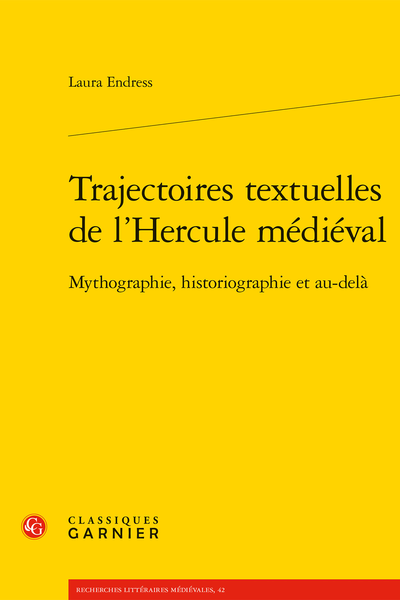
Conclusions
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Mythographie, historiographie et au-delà
- Pages : 397 à 404
- Collection : Recherches littéraires médiévales, n° 42
- Série : Ovidiana, n° 3
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406154648
- ISBN : 978-2-406-15464-8
- ISSN : 2261-0367
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15464-8.p.0397
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/01/2024
- Langue : Français
Conclusions
Nous voici à la sortie du labyrinthe herculéen que nous avons parcouru au fil des trois parties de ce livre et au rythme des trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval. Essayons d’en donner un récapitulatif, qui fera peut-être émerger de nouvelles pistes de réflexion
Le mythe d’Hercule est arrivé au Moyen Âge sous forme d’éclats. Aucun auteur connu de la latinité classique n’a traité de la vie du héros dans son ensemble comme l’avaient fait un Diodore de Sicile ou un Apollodore, auteurs grecs dont l’œuvre était inconnue en Europe occidentale pendant l’intégralité, ou presque, de l’époque médiévale. Plusieurs auteurs latins ont cependant retenu des épisodes de ce mythe, en faisant allusion à bien d’autres. À partir de l’Antiquité tardive, des grammairiens ont ajouté leurs commentaires aux œuvres des auteurs latins (à commencer par Servius pour Virgile et Lactance-Placide pour Stace), transmettant ainsi un vaste ensemble de fragments de savoir, abondant en variantes, incertitudes et erreurs qui se sont introduites au fil du temps. Ces bribes de savoir ont été recueillies et perpétuées, entre autres, dans les traités des mythographes et les gloses des commentateurs qui les ont suivis et qui ont remodelé et compilé les données selon leurs propres projets. L’activité foisonnante des maîtres d’école qui commentaient l’œuvre d’Ovide à partir du xie siècle a laissé des témoignages qui nous permettent de documenter l’évolution continue des composantes appartenant à cette matière – et cela en nous aidant des précieux indices de la varia lectio. L’absence des repères de l’ancien mythe grec d’Héraclès, conjugué à l’intérêt des clercs pour la transmission du savoir accumulé par leurs prédécesseurs (et auquel ils ont parfois ajouté leurs propres réflexions critiques), sont des facteurs décisifs pour la tradition du mythe : diffraction continue, multiplication des couches d’interprétation à propos de certains détails, perte totale d’autres. Aucun commentateur d’Ovide ne parlera des écuries d’Augias parce que ce « travail », si connu que les auteurs classiques n’avaient pas besoin de l’appeler par son nom, avait subrepticement glissé hors du champ de vision du savoir mythologique circulant au Moyen Âge.
398Tout comme il existe des éléments centrifuges à propos du complexe mythologique d’Hercule, il y en a qui s’avèrent centripètes. Les « mythographes » qui ont réorganisé le savoir à propos du héros dans leurs traités ont privilégié certains épisodes plutôt que d’autres. Les composantes de ce mythe dotées de compléments exégétiques en sont un exemple manifeste. Le maître Atlas qui enseigne l’astronomie à son disciple Hercule, interprétation qui avait déjà été proposée par Diodore de Sicile et qui a perduré dans le commentaire de Servius, a été reprise dans son essence par le Mythographe III du Vatican, puis par l’auteur du Commentaire Vulgate des Métamorphoses, retenue aussi dans le traité du Mythographe de Digby. L’association allégorico-morale d’Antée à la luxure apparaît chez Fulgence le mythographe et se retrouve pareillement dans les traités mythographiques du Moyen Âge central, de même que dans le Commentaire Vulgate et dans l’Ovide moralisé. La large diffusion des traités de Fulgence et du Mythographe III, qui mettent en avant l’exégèse allégorique des mythes, a pu contribuer à la nouvelle « canonisation » des éléments en question, dont la plupart ne faisait pas partie du noyau de l’ancien mythe d’Hercule. Voilà un autre aspect de l’évolution du mythe, à côté, bien sûr, de ses métamorphoses formelles.
Ces réflexions soulignent, par ailleurs, les délimitations incertaines et poreuses entre les différents types de textes dont nous venons de parler. Vu sous l’angle diachronique de leurs traditions respectives, l’œuvre des « mythographes » et celle des « commentateurs » se recoupent continuellement, au point que leur délimitation est parfois difficile – d’autant plus que certains auteurs, comme Arnoul d’Orléans, ont écrit à la fois des gloses et des traités autonomes. À partir de quel point un texte conçu en fonction d’une œuvre particulière, tout en étant détaché de cette dernière, devient-il une œuvre de mythographie à part entière ? Des réflexions de ce type pourraient aussi être faites à propos du traité De natura deorum du Mythographe de Digby, qui suit l’ordre « ovidien » des mythes présentés et qui partage certaines données à propos d’Hercule avec le Commentaire Vulgate des Métamorphoses. Dans un autre ordre d’idées, on ne peut ignorer la présence de certains textes, faisant partie de ces traditions enchevêtrées, qui s’orientent explicitement vers l’exégèse allégorico-morale de la matière traitée, alors que d’autres n’insistent pas dessus. À part le fait qu’elles traitent des mêmes mythes, partageant même des données textuelles, les œuvres respectives du « Mythographe II » et du « Mythographe III » ont une structure et des ambitions assez différentes. Le second a également eu une sphère d’influence bien plus 399manifeste : c’est bien grâce à lui que la version « correcte » de l’épisode d’Hercule filandier, impliquant sa soumission à Omphale, a trouvé son chemin vers l’historiographie, en passant par le Speculum historiale de Vincent de Beauvais, puis le Manuel d’Histoire de Philippe VI de Valois, vers d’autres textes en langue française.
Le canevas narratif de la vie d’Hercule ainsi qu’une partie de ses contenus remonte à l’Antiquité tardive et au premier Moyen Âge. Au fil du temps, en effet, de plus en plus de fragments du mythe d’Hercule se sont sédimentés dans les textes vernaculaires : dans les premières compilations françaises traitant de l’histoire ancienne et universelle, on en retrouve un conglomérat hétérogène. Les chroniqueurs latins, à commencer par Eusèbe-Jérôme, ont d’abord défini les coordonnées temporelles et certains événements marquants de la vie de l’Hercule « historique » – tels sa lutte contre Antée, son implication dans la destruction de Troie et sa mort par le feu. Les écrivains d’historiae aussi différentes que l’œuvre moralisante d’Orose, évoquant l’expédition d’Hercule et de Thésée contre les Amazones, et le récit de Darès, prétendu témoin oculaire de la guerre de Troie, ont fourni une matière narrative destinée à remplir le cadre prédéfini – fait qui se manifeste déjà dans certaines chroniques en langue latine, comme celle de Fréculfe de Lisieux1. D’autres éléments, comme la généalogie a priori erronée d’Hercule, fils de Laudaci, puisés peut-être dans un manuel de savoir scolaire transmettant des généalogies des dieux païens, se sont ajoutés à cette matière dans la première rédaction longue de l’Histoire ancienne jusqu’à César (HAC1a). En compilant un portrait (pour nous) manifestement hétéroclite de récits, de facta, de moralisations et d’informations mythologiques qui ne constituent au fond que quelques îlots du vaste mythe de l’Hercule antique, l’auteur de l’HAC1a a fourni un modèle important pour les générations d’historiens vernaculaires à venir après lui. S’il y avait dans la conscience des compilateurs d’histoires en français une histoire d’Hercule par excellence, on doit présumer que ces éléments en faisaient partie.
Les « biographies » compilées par les historiens qui se multiplient dans les nombreux exemplaires de l’HAC1b, version abrégée de l’HAC1, et les histoires qui en dérivent, en reprennent les coordonnées et certaines composantes essentielles, tout en les modifiant. À côté d’une tendance 400générale des écrivains postérieurs à étoffer le cadre donné par l’ajout de « nouveaux » éléments, les différents textes étudiés témoignent aussi d’omissions, d’abrègements, de remplacements d’une version d’un récit par une autre et de dédoublements. La constellation exacte des vies d’Hercule diffère d’une compilation à l’autre, tributaires qu’elles sont des sources utilisées, des motivations derrière les projets individuels et de leur contexte de genèse. Malgré le nombre réduit d’histoires étudiées de près dans le présent travail, les exemples de vies d’Hercule permettent d’illustrer la nature variée de ces textes et, accessoirement, les limites fluctuantes entre l’écriture « historiographique » d’une part, et des textes de type « encyclopédique », « romanesque » et « biographique » de l’autre. Sous un angle large, les vies historiques d’Hercule considérées ici se composent en effet d’éléments importés ou s’inspirant d’œuvres appartenant à différents genres, ce qui conditionne à son tour l’ordre des modifications et les sources mises à contribution. Ce constat, fait a posteriori, peut confirmer notre décision initiale d’opérer avec des catégories amples. Il invite naturellement aussi à reprendre l’enquête en plaçant en son centre, cette fois, la question du genre littéraire.
La Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (CBA) et certains de ses descendants, désignées comme des Trésors des histoires, semblent avoir une ambition savante et encyclopédique, ce qui explique éventuellement pourquoi l’auteur de CBA a réimporté des éléments présents dans les chroniques universelles latines et qu’il a écarté bon nombre de détails narratifs des épisodes repris à l’HAC1, réduisant ses récits à un format plus concis. En effet, son traitement de la première destruction de Troie est si court qu’il arrive à se passer entièrement d’évoquer le nom d’Hercule. Les Trésors des histoires se distinguent, à leur tour, par l’intégration d’éléments d’un texte qui se veut un abrégé, entre autres, du Speculum historiale de Vincent de Beauvais – le Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois. L’ajout d’une série d’anecdotes à propos d’Hercule reprises au Manuel, dont la descente aux enfers et l’épisode d’Hercule « filandier », suggère que les Trésors des histoires cherchaient à compléter et à enrichir le savoir présent dans les œuvres de leurs prédécesseurs2. La présence d’éléments repris probablement à différentes copies du Manuel (pensons aux variantes du nom d’Omphale) dans d’autres compilations ultérieures (comme l’HAC3 et la Fleur des histoires) suggère que cet 401abrégé était bien diffusé à partir du xive siècle. Les historiens ont pu trouver en lui un instrument de travail plus facilement maniable que, par exemple, le vaste Speculum historiale de Vincent de Beauvais, ou sa traduction par Jean de Vignay.
On peut opposer ces compilations « historico-encyclopédiques » à une œuvre comme l’HAC2. Ici, Hercule se retrouve dans le cadre non pas d’une histoire universelle, mais d’une histoire ancienne, et plus spécifiquement au sein de la vaste narration qu’est Prose 5, combinant des éléments de différentes adaptations du Roman de Troie qui remplacent le récit plus concis adapté d’après Darès dont témoigne l’HAC1. Œuvre « historico-romanesque » par excellence, celle-ci intègre par ailleurs, à l’intérieur de sa vie d’Hercule, des épisodes « ovidiens » ainsi que des éléments renvoyant vraisemblablement à la culture italienne locale, corrélées à l’aire napolitaine du xive siècle où l’œuvre est née. Souvenons-nous de l’épisode à propos de Nexumtaurum et Degermirra, dont on trouve certains parallèles dans l’Ovide moralisé (OM), mais aussi, à plus forte raison, dans la tradition des commentaires à l’œuvre de Dante. Si cet épisode paraît « exotique » quand on le compare aux contenus des vies d’Hercule dans les histoires de provenance française, on peut présumer que c’est justement parce qu’il n’a pas vu le jour en France, mais en Italie, et à une époque que l’on pourrait qualifier de pré-humaniste. Le constat souligne une autre particularité de la vie textuelle de l’Hercule médiéval, et surtout tardo-médiéval, en France : celle-ci se compose en partie d’éléments qui proviennent d’autres contextes culturels d’Europe, où Hercule a pu acquérir un statut de « célébrité locale » à une date où il ne figurait, en France, que comme un personnage parmi tant d’autres sur la toile de l’histoire. On ne s’étonne pas que l’épisode du séjour d’Hercule chez Évandre à l’endroit où Rome sera édifiée, détaillé par Virgile et repris par des commentateurs, mythographes et encyclopédistes, ait pu avoir une influence plus précoce et plus forte sur la perception du héros en Italie qu’elle ne l’avait en France – ce qui a pu, à son tour, conditionner l’ajout d’une mini-vie du héros à l’intérieur de Prose 5. Un scénario semblable s’applique, par ailleurs, à l’historiographie espagnole, qui accueillait, déjà au xiiie siècle, une vie d’Hercule comptant plus d’une dizaine de chapitres dans la General Estoria, brodant sur le passage d’Hercule à travers l’Ibérie pour chercher les bœufs de Géryon.
En France, il faudra en effet attendre le xve siècle avant de trouver des exemples de ce type. Nous n’avons étudié de près qu’une biographie d’Hercule comprenant toute une série de chapitres, celle contenue dans 402la Bouquechardière. Cette compilation suit encore d’autres tendances que celles « historico-encyclopédiques » et « historico-romanesques » observées dans les exemples précédents. Elle insère dans un cadre historico-moral la biographie synthétique d’un homme illustre, puisant dans une large gamme de sources, visant cohérence et complétude. La disponibilité de nouvelles adaptations vernaculaires traitant d’Hercule, dont surtout l’OM et des adaptations de la Consolatio philosophiae,a été décisive pour la vie du héros composée par Jean de Courcy. On y retrouvera, du coup, pour la première fois dans une histoire française, un catalogue étendu d’exploits du héros, s’appuyant principalement sur les deux traditions ovidienne et boécienne, et tout aussi composite que les autres exemples de répertoires médiévaux d’exploits herculéens que nous avons rencontrés dans la première partie de ce travail. Sur un plan plus général, il est intéressant de noter que la présence d’éléments manifestement « ovidiens » est très faible dans les histoires vernaculaires jusqu’au moment où l’OM voit le jour. C’est peut-être une impression corrélée à la thématique étudiée et/ou au nombre restreint de textes ici pris en considération, mais les contacts entre la mythographie ovidienne latine et l’historiographie vernaculaire française ne deviennent a priori perceptibles qu’au moment où émergent des textes « intermédiaires » comme l’OM.
Voici une autre raison, plus générale, pour laquelle cette translation d’Ovide– et sa propre vie d’Hercule – représente un objet d’étude digne d’intérêt. En étudiant l’OM à la lumière des commentaires d’Ovide, pour éclairer la raison d’être et les sources possibles de certaines innovations, nous avons obtenu des résultats que l’on peut tenter, dans un dernier temps, de considérer dans un contexte plus large. Ce sera également l’occasion de proposer quelques pistes à explorer ultérieurement.
En examinant les sources possibles du catalogue augmenté d’exploits herculéens dans l’OM, nous sommes retombée sur un ensemble de textes déjà croisés précédemment dans notre travail : les manuels de savoir encyclopédique et mythographique comprenant, entre autres, des généalogies des dieux antiques et des listes d’exploits d’Hercule et de Thésée. Ces textes mériteraient une étude plus approfondie dans la mesure où des représentants de cet ensemble pourraient avoir servi d’outil de travail non seulement à l’auteur de l’OM, mais aussi celui de l’HAC (et probablement à d’autres que nous n’avons pas abordés ici). Rappelons quelques constats : le catalogue d’exploits dans l’OM présente certains parallèles avec des énumérations d’exploits d’Hercule 403dans la General Estoria espagnole ainsi que dans certains manuscrits de l’œuvre historiographique de Paolin de Venise, apparentés à leur tour aux données fournies dans un ensemble de manuels de savoir encyclopédico-mythologique, qui transmettent, à côté des listes d’exploits herculéens et théséens, des répertoires de noms de montagnes et de fleuves, des noms de poètes classiques et de leurs œuvres et des généalogies de dieux antiques. Outre les observations faites dans le présent travail, nous avons abordé ailleurs des textes appartenant à cet ensemble (notamment les manuscrits Vatican, BAV, Pal. lat. 1741 et Dublin, Trinity College, TCD 632), en montrant qu’ils transmettent un catalogue de noms géographiques qui permettent d’expliquer les données, y compris certaines erreurs, dans un autre passage manifestement augmenté de l’OM, ce qui indique qu’un parent proche pourrait avoir servi de source à l’OM3.
La plupart des textes évoqués au paragraphe précédent, ainsi que d’autres représentants de la catégorie des traités ou manuels mythologiques comme le De natura deorum du Mythographe de Digby et le Fabularius de Konrad von Mure, ont été pris en compte par la critique dans des études sur les sources des Genealogie deorum gentilium de Boccace, parce qu’ils transmettent tous des généalogies de divinités, débutant en général par l’ancêtre Demogorgon. Or certains représentants de ces manuels de mythologie partagent également des parallèles avec l’HAC1. Pensons à la généalogie erronée d’Hercule fils de Laudaci, dont on trouve un écho également dans la General Estoria qui, elle, évoque parmi ses sources un Libro de las generaciones de los dioses de los gentiles. Les « airs de famille » entre ces différents textes qui ont tous certaines données en commun, les parallèles constatés entre l’OM et la General Estoria d’un côté, et entre l’OM et les manuels de savoir encyclopédique et mythographique de l’autre, suggèrent qu’ils puisent à des sources apparentées. On sait relativement peu des « manuels » en question, mais on est enclin à supposer qu’il en existe, en plus des exemples évoqués par la critique en rapport avec Boccace, bien d’autres qui n’ont pas encore été identifiés et étudiés. Prenons l’exemple du manuscrit Angers, Bibliothèque municipale, 312, datant des premières décennies du xiiie siècle, que nous n’avons trouvé que grâce à l’Incipitarium Ovidianum4. Ce recueil manuscrit, comprenant surtout des sermons, transmet aussi une généalogie des dieux qui occupe à peine trois feuillets et que la critique précédente n’a 404guère pris en compte. Selon toute vraisemblance, cela est dû en partie au fait qu’aucune généalogie n’est mentionnée dans la description du témoin que donne le catalogue général des manuscrits de la bibliothèque d’Angers, où l’on lit « Donatus minor. ‘Partes orationis quot sunt ? […] À la suite, notes de grammaire et de rhétorique5 ». Les généalogies et autres données mythologico-encyclopédiques font partie des « notes ». En d’autres termes, les données en question ne sont pas toujours très visibles, n’occupent pas beaucoup de place et peuvent, de ce fait, facilement tomber au-dessous du radar des descriptions de manuscrits. Si l’on espère en trouver d’autres, il faudrait partir des exemples identifiés, en considérant le reste de leurs contenus – car il s’agit en général de recueils mixtes – et en regardant ensuite d’autres témoins présentant des données semblables.
De manière générale, les manuels médiévaux de savoir scolaire et leur contexte manuscrit nous semblent être des textes clés à prendre en compte si l’on espère un jour percer les mystères des sources inconnues de l’OM. Rappelons que le manuscrit Vatican, BAV, Vat. lat. 1479, transmettant les Métamorphoses avec un commentaire qui présente les parallèles les plus prometteurs avec l’OM, est lui-même un livre de savoir scolaire, qui comprend d’autres textes à côté des vers d’Ovide. C’est peut-être une coïncidence si nous avons trouvé dans un commentaire à propos des Ecloga Theoduli, texte qui met en analogie des mythes païens et des légendes chrétiennes (un peu comme le fait l’OM) contenu dans ce même manuscrit, des interprétations allégoriques christianisantes telles que nous n’en avons jusqu’à ce jour trouvé dans aucun commentaire d’Ovide : Hercule, Alcides,id est virtus, id est dominus Jesus Christus. Les commentaires d’Ovide ne fournissent, au fond, que des bribes d’interprétation allégorique puisant dans la philosophie chrétienne morale, sans proposer d’associations relevant de la typologie biblique. Il semble possible cependant que le translateur français ait trouvé des données semblables dans un autre texte contenu dans le même manuscrit d’Ovide qui lui servait de modèle – manuscrit qui contenait peut-être aussi des « notes » mythologico-encyclopédiques. Et c’est là, dans des manuscrits de ce type, qu’il faut continuer à chercher.
1 L’influence de l’œuvre de Fréculfe, ou d’une chronique apparentée, sur l’historiographie en langue française serait intéressante à étudier de plus près, surtout parce que nous en avons trouvé des échos de contenus spécifiques faisant partie de la vie d’Hercule dans la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes.
2 On pourrait se demander en outre si la nature « historico-encyclopédiques » de ces œuvres les rendait plus susceptibles à recueillir des données à propos d’Hercule qui ne relèvent pas exclusivement des présumés facta historiques, mais également des curiosités appartenant au domaine de la fabula.
3 Endress, « Un répertoire du type “de montibus et fluminibus” dans l’Ovide moralisé ? », art. cité, p. 39-65.
4 Coulson et Roy, op. cit., no 22. Genealogia deorum.
5 Auguste Molinier, « Manuscrits de la bibliothèque municipale d’Angers », Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Départements, t. 31, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1898, p. 301.