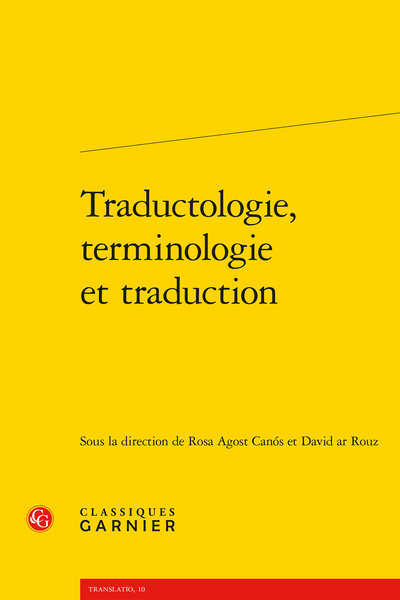
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Traductologie, terminologie et traduction
- Pages : 269 à 273
- Collection : Translatio, n° 10
- Série : Problématiques de traduction, n° 8
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782406112259
- ISBN : 978-2-406-11225-9
- ISSN : 2800-5376
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11225-9.p.0269
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/06/2021
- Langue : Français
Résumés
Rosa Agost Canós et David ar Rouz, « Introduction »
Après avoir brièvement rappelé la place de la terminologie, à la fois dans les politiques linguistiques, dans le processus de traduction, dans l’évolution des métiers et dans les formations, les éditeurs scientifiques du présent ouvrage présentent les chapitres qu’il contient, répartis en trois parties : « La terminologie dans le monde », « La terminologie dans les centres de formation », « La terminologie dans la profession ».
Loïc Depecker, « Terminologie, traduction et rédaction spécialisées. éléments de politique linguistique »
Cet article traite de plusieurs questions concernant la terminologie, la traduction et la rédaction spécialisées. D’un côté sont abordées les questions de terminologie envisagées sous l’angle de la politique linguistique. De l’autre, les questions de traduction et de rédaction spécialisées. La politique linguistique doit embrasser terminologie, traduction et rédaction spécialisées de façon à déterminer des actions d’aménagement linguistique rigoureuses, applicables pour la France.
Jean Quirion et Judit Freixa, « Les politiques terminologiques dans les langues minorisées. étude comparée de la Catalogne et du Québec »
La préservation des langues minorisées passe par des politiques linguistiques et terminologiques. Cet article s’intéresse aux politiques linguistiques de deux langues minorisées, soit le catalan en Espagne et le français au Canada. Il dresse un portrait de leurs situations géolinguistiques, puis compare la conception et les objectifs de leurs politiques terminologiques. Les points de rencontre et de divergence des deux modèles sont ensuite présentés.
270Jordi Bover, « Terminologie catalane. Le centre de terminologie TERMCAT »
Cet article présente les activités du Centre de Terminologie TERMCAT et les ressources qu’il propose. Il expose les quatre axes de travail du Centre : la normalisation terminologique, s’appuyant sur le Conseil de supervision ; les services d’expertise-conseil (recherche terminologique ponctuelle, au moyen de Cercaterm ; pour des projets terminologiques et documentaires) ; l’élaboration de produits terminologiques et, enfin, la recherche et la méthodologie.
Nava Maroto et Guadalupe Aguado de Cea, « Les possibilités des données linguistiques liées ouvertes pour la terminologie et la traduction »
Le développement de ressources linguistiques structurées sous forme de données linguistiques liées ouvertes (LLOD) présente de multiples avantages, tant pour le traducteur humain que pour les systèmes de traitement du langage naturel. Cet article présente les contributions de l’Association Espagnole de Terminologie (AETER) en ce sens à travers le projet Terminesp, ainsi qu’une brève introduction au paradigme LLOD.
Rosa Agost Canós, « Les liaisons avantageuses entre les traducteurs et la terminologie »
Ce travail consiste en une révision critique de la conception des programmes de terminologie dans le cadre des licences en traduction au sein des universités espagnoles, avec pour objectif d’identifier les aspects susceptibles d’être améliorés afin d’adapter la planification didactique de la terminologie aux nécessités et aux attentes de l’ensemble de la pratique professionnelle.
David ar Rouz, « Didactique de la traduction. Peut-on enseigner une démarche terminographique scientifique ? »
En 1997, Gouadec a publié un ouvrage qui explique en détail l’utilisation d’un tableau pour le traitement de la terminologie de textes à traduire. Dans sa propre université, l’outil a fait l’objet d’adaptations visant à le simplifier. La présente contribution s’attache à questionner les changements apportés : les objectifs qui y ont mené sont très compréhensibles mais l’outil en perd sans doute de la pertinence, ce qui peut s’avérer aussi nuisible à son appropriation par les étudiants.
271Anna Estellés, « Description d’un cours de terminologie en ligne »
Cet article analyse le contexte de l’enseignement en ligne dans les études supérieures et témoigne de l’expérience de conception d’un cours de terminologie dans le cadre d’études universitaires de traduction et d’interprétation. Centré sur l’étudiant, ce travail a consisté à sélectionner des objectifs d’apprentissage sur la base des compétences professionnelles et à explorer l’acquisition de ces compétences dans un environnement virtuel intégrant l’utilisation d’outils technologiques.
María-Teresa Ortego-Antón, « Les possibilités de DiCoEnviro en version frames comme ressource pour la traduction »
De nos jours, la description terminologique doit combiner les connaissances et les propriétés linguistiques. DiCoEnviro en version frames est une base de données terminologique multilingue sur l’environnement. Bien que l’outil ne soit pas destiné spécifiquement aux traducteurs, l’accent est mis sur la description des cadres sémantiques, qui pourront nous permettre de l’ajouter aux logiciels de traduction assistée par ordinateur afin de l’intégrer aux moteurs de traduction automatique.
David ar Rouz, Fabienne Moreau, Franck Barbin, Charles Gruenais, « TermiCo. Terminographie collaborative »
En matière de terminologie, la collaboration entre traducteurs, terminographes et réviseurs paraît évidente mais ils peuvent aussi faire appel à l’auteur, au client, à un informateur extérieur, etc. Il n’est pas toujours possible d’avoir ces échanges en face-à-face et, pourtant, les bases de données terminologiques qui les permettent à distance coûtent souvent très cher. L’outil TermiCo en cours de développement a pour objectif de rendre accessible la collaboration terminologique en ligne.
Marjan Alipour et Marie-Claude L’Homme, « Une typologie revisitée de la synonymie »
Ce travail étudie l’identification des synonymes parfaits et des quasi-synonymes. Il décline ainsi une série de critères permettant de distinguer les situations où deux termes sont sémantiquement identiques de celles où 272deux termes ne peuvent être utilisés de manière interchangeable dans tous les contextes. Puis, les auteurs expliquent l’application de ces critères menant à l’établissement de solutions d’encodage terminologique adaptées aux situations décrites.
Alicia Chabert, « Le rôle de la terminologie dans la gestion de projets de traduction »
Cet article décrit la contribution effective de la terminologie dans le processus de traduction du point de vue du chef de projets. Il détaille l’utilisation courante et les utilisateurs actuels des systèmes de gestion terminologique et vise à attirer l’attention sur la rareté des études en matière d’implication de la gestion de projets dans le cadre de la traduction professionnelle et à ouvrir de nouvelles pistes de recherche pour les études appliquées de traduction.
Weiwei Guo, « Dynamique entre la traduction et l’implantation de la terminologie. Le cas des descripteurs œnologiques en chinois »
Dans les années 1990, les traducteurs chinois en œnologie ont été confrontés à plusieurs difficultés, dont la différence de conception du goût, le manque de moyens lexicographiques et le manque de connaissances œnologiques. Les traductions donnaient alors priorité à l’équivalence formelle. Le long processus d’implantation de la terminologie se reflète aujourd’hui dans les stratégies de traduction par un rééquilibrage entre équivalence formelle et équivalence fonctionnelle.
Elvin Abbasbeyli, « Les difficultés de traduction et de transfert de la terminologie religieuse dans un traité de paix multilingue (turc, russe, italien). L’exemple du Traité de Küçük Kaynarca (1774) »
Dans cet article sont analysés la traduction et le transfert de quelques concepts tirés de la terminologie de l’islam et utilisés dans le traité de Küçük Kaynarca signé en 1774 entre l’Empire ottoman et l’Empire de Russie. L’étude des versions turque, russe et italienne nous permettra d’aborder les solutions trouvées par les drogmans dans les processus de traduction et de transfert. Pour ce faire, l’auteur procède à un survol étymologique de termes et syntagmes sélectionnés.
273Alina Buşila, « Moyens d’expression utilisés dans la formation des termes juridiques en anglais et en roumain »
Le langage juridique (LJ) est la langue spécialisée la plus ancienne au monde, car les premières relations entre les gens (échanges, achats, ventes, prêts, locations, etc.) étaient de nature juridique. Cette caractéristique a doté le LJ d’un lexique excessivement poli et enrichi de métaphores, de métonymies, de jeux de mots et des doublets, ce qui génère sa nature prolixe et des difficultés de compréhension au lieu de la précision, pourtant souhaitée, du langage juridique.
Marie-Hélène Girard, « Traduire le droit international pénal. Du concept international de génocide à ses définitions nationales »
Le droit pénal international (DPI) cultive le paradoxe de ces droits internationaux négociés dans l’abstrait par une pléthore d’États, qui sont pourtant destinés à être intégrés et appliqués au niveau national. Entre la formulation internationale et l’application nationale, le parcours du DPI est semé d’embûches, dont la traduction n’est pas la moindre. Ce parcours est révélateur d’un droit qui évolue au fil de son expression, comme en témoigne la présente analyse de définitions de génocide.