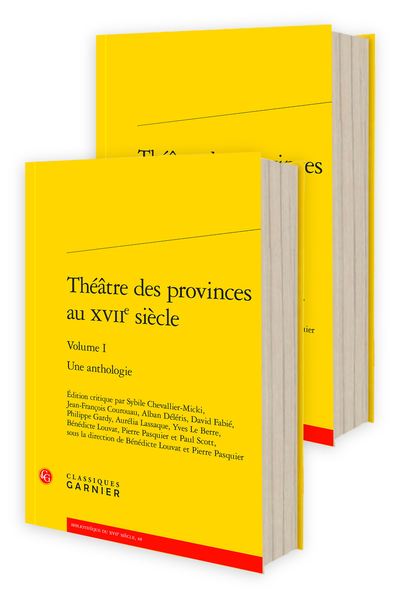
Principes d’édition
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Théâtre des provinces au xviie siècle. Une anthologie
- Pages : 307 à 310
- Collection : Bibliothèque du xviie siècle, n° 48
- Série : Théâtre, n° 10
- Thème CLIL : 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN : 9782406150923
- ISBN : 978-2-406-15092-3
- ISSN : 2258-0158
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15092-3.p.0307
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 17/01/2024
- Langue : Français
Principes d’édition
Conservé à la BnF dans le fonds celtique & basque, sous la cote 31, ce manuscrit est d’un format in-quarto peu fréquent parmi les manuscrits de théâtre parvenus jusqu’à nous. L’emplacement des filigranes dans la pliure et la reliure serrée ne permettent pas d’identifier la provenance du papier. Par rapport à d’autres manuscrits, il possède peu de traces d’usage – cire, suif ou résine –, de traces de manipulation – encrassement des marges –, ou de salissures – éclaboussures, taches etc.
Par ailleurs, nous ne savons rien de l’état du manuscrit avant son entrée à la Bibliothèque impériale et la restauration qu’il a subie. Si elle a jamais existé et si elle subsistait lors de son dépôt, la couverture d’origine a été déposée et remplacée par une couverture cartonnée de type institutionnel. Le corps de l’ouvrage a été dérelié et partiellement désorganisé lors de son remontage. Par ailleurs, les bords et les coins externes des feuillets ont été renforcés à l’aide de bandes ou de carrés de papier vergé collés au verso du support ancien. Enfin, certains feuillets ont subi un traitement par réactif chimique – peut-être de l’acide gallique1 – destiné à raviver les encres pâlies, couramment utilisé au xixe siècle : ils sont marbrés de stries brunes qui témoignent du passage de larges coups de pinceau.
Tout comme les autres manuscrits bretons de théâtre confectionnés entre le xviie et le xixe siècles, le manuscrit de Maurice Le Flem témoigne : papier de piètre qualité, bords des feuillets non rognés, déchirures. Mais, aussi, ajouts – expressions d’un acharnement à écrire, encore et encore –, ratures – marques de remords et de maladresses –, approximation du français des didascalies – témoignage émouvant, nous voulons le croire, d’une recherche de distinction –, indications d’appartenance multiples 308– preuve de l’importance de ces traces pour leurs détenteurs successifs –, et aussi, au final, homogénéité. En effet, Maurice Le Flem a un graphisme élégant et, sous sa plume, on constate des usages identiques à ce que l’on retrouvera dans des manuscrits plus tardifs2, qui témoignent d’une culture graphique :
–les particules verbales, les possessifs et les articles sont très souvent accolés au mot qui les suit, notamment lorsqu’il s’agit d’expressions figées (alleueret ; asou ; opollante ; euollante ; alloenet ; antat) ;
–les pronoms personnels antéposés ou postposés sont agglutinés aux verbes ou aux prépositions (leueretu ; voarnoume)
–les consonnes épenthétiques (d, g, h) sont unies au mot qui les suit (na guiue – en breton moderne : nag ive –, ha ganep – en breton moderne : hag an nep) ;
–les mots monosyllabiques inaccentués sont souvent accolés au mot qui porte l’accent (au fo 28 r, on comparera ene brou et asou ebrou, par exemple).
Même si ces usages attestent de la prosodie du scripteur, nous avons pris le parti de normaliser le texte, notamment parce que, dans de nombreux autres cas, il n’est pas toujours possible de distinguer ce qui relève d’une pratique commune ou d’une liaison aléatoire, inhérente au moment de la mise par écrit, inaccessible à notre interprétation. Par ailleurs, notre objectif principal n’était pas d’analyser la matérialité de ce manuscrit ou la mise en œuvre du processus d’écriture, mais bel et bien de rendre accessible ce texte. Pour ce faire, nous avons adopté les règles suivantes :
–nous avons formé des mots avec des lettres ou des groupes de lettres qui semblent non liés, sans raison apparente, si ce n’est le fil capricieux de toute plume ;
–parce que l’on trouve les deux formes au sein du manuscrit, nous avons décollé les particules verbales des verbes (asou > a sou ; asuplia > a suplia ; eteua > e teua), le possessif du nom (opollante > o pollante) ;
309–les pronoms sont très majoritairement accolés à la préposition (voarnoume, dime) ou au verbe (disteullompa, lesompa, leveretu) : nous les avons retranscrits ainsi ;
–nous avons modernisé l’emploi du « g » épenthétique : nous l’avons accolé à la particule verbale ou à la conjonction de coordination (a gasou > ag a sou) ;
–lorsque le « g » épenthétique de la conjonction de coordination « (h)ag » est suivi de « e » ou « i », Maurice Le Flem ajoute un « u » pour, sur le modèle du français, obtenir [g] : pour faciliter la lecture, nous avons retiré le « u » et nous avons mis une note – ainsi a gue choar est-il transcrit « ag e choar » avec, en note : « Ms : a gue choar » ;
–lorsque deux formes se présentaient, nous avons adopté la majoritaire : ar voalch > arvoalch ; e bars > ebars ; mard- > mar d- ; pand- > pan d- ; mopet > mo pet ;
–nous avons transcrit areal, real, dareal, da real, ha real sous les formes a re al, re al, da re al, ha re al ; anee, aneou sous la forme a nee, a neou ;
–le verbe « avoir » breton est composé de la 3e personne du verbe « être » et d’un pronom personnel infixe, avec une valeur de datif : ils sont très souvent agglutinés et c’est ainsi que nous les avons tous transcrits ;
–nous avons modernisé l’usage du « i » et du « j » : Maurice Le Flem suit assez fidèlement la norme scripturale pré-moderne, qui distingue ces deux lettres en fonction de leur emplacement dans le mot ;
–nous avons opéré de même pour la distinction entre le « u » et le « v », mais, néanmoins, nous avons conservé le « u » dans « guerches » ou « guellet », ainsi que dans « chuy » ou « chuiban », là où en breton moderne, on utiliserait un « w » : en fonction du contexte, le lecteur bretonnant saura distinguer entre « guellet », « voir » et « guellet », « pouvoir ».
–nous normalisons la répartition des minuscules et majuscules en suivant les règles de capitalisation actuelles : nous avons ajouté des majuscules aux noms de personnes et aux indications de changement de scène (« Senne ») ;
–lorsqu’il est écrit, nous avons conservé le « n » épenthétique devant les mots commençant par une voyelle (an nelles, an nol) ; pour le doublement du « l » (dallaret, dallaquat, olleue), nous avons transcrit 310« da laret » ou « da laquat » et nous avons mis en note : « Ms : dallaret » ; même chose pour le rare doublement du « f » : effou digazet est transcrit e fou digazet, avec en note « Ms : effou digazet » ;
–lorsque les choix de Maurice Le Flem étaient difficiles à normaliser sans ajouter des lettres, nous avons conservé certains mots ou groupes de mots, que nous éclairons par une note (ainsi, « rase » sera-t-il explicité par une note : « Lire ras se ») ;
–quoique rédigées en français, les didascalies sont souvent d’une lecture difficile. Nous les avons « traduites » en français standard, pour le confort du lecteur.
Dans notre transcription, apparaissent entre crochets les lettres supposées par nous, lorsque la lecture n’est pas assurée, ainsi que la numérotation des folios. Trois points entre crochets précisent qu’il y a là des mots ou des lettres illisibles. Les < > font apparaître des ajouts postérieurs, notamment dans les didascalies. Les mots barrés indiquent des ratures qui restent lisibles. Les lettres en italiques marquent la résorption d’une abréviation. Dans la traduction, les doutes, les hésitations et les interprétations sont indiquées entre crochets.
Que ce manuscrit soit une création originale, un centon ou la copie altérée d’un hypotexte, il est difficile, en l’état actuel des recherches, de trancher catégoriquement. À l’inverse, ce qui est sûr, c’est que Maurice Le Flem possédait une culture graphique conséquente et que, dans son écrit, il en fait montre.
1 Sur ce procédé, voir Ehrle Franz, traduit par Dorez Léon, « Sur la conservation et la restauration des anciens manuscrits », Bibliothèque de l’école des chartes, 1898, tome 59, p. 479-495. Nous remercions Estelle Boudillet pour cette référence bibliographique et pour son aide précieuse dans la description matérielle du manuscrit.
2 Voir par exemple le manuscrit daté de 1792 Le dernier jugement (Roparz Hemon, Ar Varn diwezhañ. Le Jugement dernier, pièce de théâtre bretonne (trégorois, xviiie siècle), avec la collaboration de Gwenaël Le Duc & Gwennole Le Menn, Skol, 2 volumes, 1998) et la description qu’en fait Gwenaël Le Duc, p. 79-81 du premier volume.