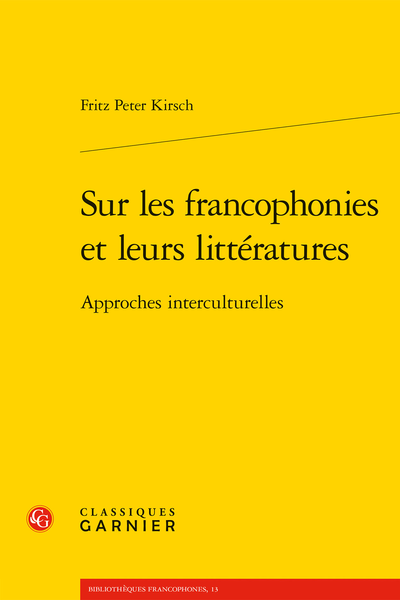
Conclusion de la deuxième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Sur les francophonies et leurs littératures. Approches interculturelles
- Pages : 151 à 153
- Collection : Bibliothèques francophones, n° 13
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406150954
- ISBN : 978-2-406-15095-4
- ISSN : 2494-7563
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15095-4.p.0151
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/10/2023
- Langue : Français
Conclusion
de la deuxième partie
Comment une littérature dominante fondée sur une langue d’empire se constitue-t-elle ? Voilà la question qui se pose en filigrane depuis le début de notre étude. S’y ajoute une autre question portant sur les forces de résistance d’une telle littérature pendant les périodes de crise, car dans l’Histoire de France, les défaites capables de provoquer des évolutions peu propices à la culture rayonnant à partir de Versailles ou de Paris ne manquent pas. Encore de nos jours, les médias soulignent le danger émanant de l’américanisme anglophonisant et des étapes par lesquelles le français peut être réduit au statut d’une langue sur la défensive. L’exemple du Québec et des autres francophonies du Canada en dit long.
Nous constatons d’emblée qu’une littérature peut fonctionner comme une arme avec l’aide du hasard et l’engagement d’une majorité réunie autour d’un pouvoir. C’est à Norbert Elias que revient le mérite d’avoir compris et expliqué les mécanismes de la prise de pouvoir par un ensemble d’individus à l’intérieur d’une société humaine cherchant à se démarquer d’un univers extérieur considéré comme différent sinon hostile. Son analyse sociologique du processus de civilisation fait de la France un cas particulier caractérisé par une centralisation au sein d’unités sociales dispersées, concentration d’abord limitée à une multitude de petites unités seigneuriales, par la suite entraînée vers un grand mouvement de convergence aux conséquences relativement durables.
La conception proposée par Norbert Elias se complique, semble-t-il, par la présence d’un aspect « anamorphique » dans la biographie du savant1. La tête de mort menaçant l’univers opulent des ambassadeurs, dans le tableau de Holbein, rayonne d’une intensité métaphorique qui 152fonctionne apparemment aussi dans le cas du jeune Elias, auquel la guerre et les nazis ont imposé, selon notre hypothèse de travail, le changement de position voulu par le fameux tableau. L’émigré a essayé de vaincre le crâne-monstre en étudiant de près cet essor de la civilisation dont l’Histoire de France présente un modèle inégalable quant à son ampleur et l’évidence de ses structurations. Peu à peu, pourtant, l’historien génial a dû être assailli par des doutes quant à la faculté de ses conceptions à limiter ou abolir les guerres. À cet égard, les conclusions de son discours de 1985 sur la condition humaine paraissent plutôt refléter un désarroi (Cf. Elias, 1985).
Les exemples choisis dans l’histoire de la littérature française pour illustrer le processus de civilisation analysé par Elias signalent tout d’abord la manière dont le centre s’applique à intégrer les altérités surgissant dans sa sphère d’influence. La figure du héros gascon, d’Alexandre Dumas à Edmond Rostand, en passant par le Tartarin de Daudet, suit les péripéties d’un processus visant à l’assimilation culturelle qui se prolongera dans le contexte d’une colonisation pourvoyant la littérature française d’une imagerie de pays exotiques.
Dans les analyses suivantes, nous avons confronté la culture de l’honnête homme du xviiie siècle, telle qu’elle se manifeste dans le comportement d’un baron cultivé, avec la protestation discrètement anticonformiste de Jean-Jacques Rousseau et la position d’un paysan occitanophone totalement incompatible avec « la civilisation ». Ainsi, nous découvrons toute la complexité de l’époque des Lumières où la marche triomphale du système culturel prédominant se poursuit impitoyablement, tout en rencontrant parfois les résistances d’un peuple.
Victor Hugo représente le point culminant du processus de civilisation au siècle du romantisme prométhéen. L’impact de ses œuvres monumentales est d’autant plus fort qu’il se fonde sur la fascination de la nature sauvage et des monstres dangereux qu’il s’agit de mettre hors d’état de nuire. En fin de compte, même les protestations sataniques des « petits romantiques », de Pétrus Borel à Lautréamont, servent la gloire de la série des génies de l’humanité dont le poète-mage croit posséder le secret.
Viendra le temps où, au cours du xxe siècle, l’assaut des forces incommensurables bravant l’idéal de la maîtrise par la raison et l’ordre se fera plus puissant, peut-être irrésistible. Ce sera alors le moment où Michel 153Houellebecq fera le tour des modalités visant à transformer ou, à la limite, à abolir la civilisation telle qu’on croit la connaître aujourd’hui. Selon le romancier, les sciences, en premier lieu naturelles, lui fournissent les instruments rendant possibles les bouleversements planétaires rêvés. Cependant, on peut toujours compter sur la souveraineté d’un narrateur qui tire les ficelles de la petite existence quotidienne et des troubles émotionnels de petits protagonistes sachant vivre et mourir selon les principes de l’honnêteté traditionnelle.
1 L’auteur de ces lignes ne sait pas si Norbert Elias a connu le tableau d’Holbein, si ce tableau l’a inspiré. Il a voulu créer un instrument de compréhension en mettant son espoir dans l’utilité de cette construction, un peu comme des gens ont créé le terme de ‘métaphore’ en espérant l’utiliser pour éclairer certains aspects du réel.