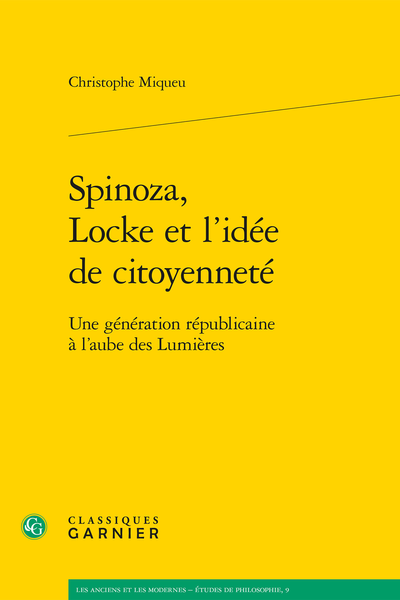
Note liminaire
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Spinoza, Locke et l’idée de citoyenneté. Une génération républicaine à l’aube des Lumières
- Pages : 13 à 15
- Collection : Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n° 9
- Thème CLIL : 3916 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Histoire de la philosophie
- EAN : 9782812440403
- ISBN : 978-2-8124-4040-3
- ISSN : 2260-8311
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4040-3.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/06/2012
- Langue : Français
Note liminaire
Pour ce qui est des éditions de référence, d’excellentes traductions des œuvres de Locke et Spinoza existent désormais en français. Les textes principalement cités le sont d’après les éditions suivantes :
Locke, Le second Traité du gouvernement, traduction de J.-F. Spitz avec la collaboration de Ch. Lazzeri, PUF, 1994 (STG).
Locke, Premier Traité du gouvernement civil, traduction de F. Lessay, dans F. Lessay, Le Débat Locke-Filmer, PUF, 1998 (PTG).
Spinoza, Ethica / Éthique, traduction de B. Pautrat, Seuil, 1999 (E).
Spinoza, Tractatus theologico-politicus / Traité théologico-politique, traduction de J. Lagrée et P.-F. Moreau, PUF, 1999 (TTP).
Spinoza, Tractatus politicus / Traité politique, traduction de Ch. Ramond, PUF, 2005. Pour cette dernière œuvre, nous avons également souvent comparé avec les deux autres éditions de référence : Tractatus politicus / Traité politique, traduction de P.-F. Moreau, Index informatique par P.-F. Moreau et R. Bouveresse, Réplique, 1979 et Traité politique, traduction d’É. Saisset révisée par L. Bove, Librairie Générale Française, 2002 (TP).
Les références internes aux ouvrages se font ainsi : livre ou partie en chiffres romains majuscules, chapitre (ou proposition pour l’Éthique) en chiffres romains minuscules, paragraphe en chiffres arabes, et page(s) en chiffres arabes précédés, quel que soit le nombre de pages de la lettre p. Lorsqu’il y a plusieurs pages, le chiffre des centaines n’est pas répété pour la page finale. Par exemple : TP viii.24-25, p. 215-17, pour le chapitre huit, paragraphe vingt-quatre et vingt-cinq, pages deux cent quinze à deux cent dix-sept du Traité politique. Pour l’Éthique, des abréviations supplémentaires interviennent dans les références internes : app. pour appendice, ax. pour axiome, corol. pour corollaire, déf. pour définition, déf.Aff. pour définition des Affects, dém. pour démonstration, explic. pour
explication, préf. pour préface, scol. pour scolie. Par exemple : E I.xxxiv.dém., p. 77, pour la démonstration de la proposition trente-quatre de la première partie de l’Éthique à la page soixante-dix-sept.
Ce livre a pour origine une thèse de doctorat réalisée dans le cadre du laboratoire Sophiapol et soutenue en 2009 devant l’université Paris Ouest – Nanterre-La Défense. Mes remerciements vont particulièrement à Christian Lazzeri, qui a dirigé et accompagné de ses remarques précieuses la rédaction de ce travail, à Chantal Jaquet qui l’a suivi d’un œil bienveillant du début à la fin, à Luc Foisneau, Alexis Tadié et Wes Williams qui ont permis qu’il s’épanouisse pendant deux ans, outre-Manche, dans le cadre de la Maison française d’Oxford et du collège St Edmund Hall, à Michel Bergès qui m’a offert les conditions idéales pour l’achever, et à Jean Terrel, qui m’a fait l’amitié de relire le manuscrit et dont les généreuses observations sont toujours pour moi décisives.
Ne l’oublions pas ! Le Tractatus theologico-politicus parut dès 1670 ; et il apportait assez de nouveautés pour bouleverser de fond en comble la société qui l’accueillit. Spinoza disait en son latin, paisiblement, qu’il fallait faire table rase des croyances traditionnelles pour recommencer à penser sur de nouveaux plans […]. De la religion chrétienne, il ne restait que formalisme et préjugés, préjugés qui changent les hommes en brutes, en leur ôtant le libre usage de leur jugement, en étouffant la flamme de la raison humaine. C’est de cette raison qu’il fallait partir, de nouveau. En son nom, il fallait détruire deux constructions illogiques et ruineuses : la cité de Dieu, la cité du Roi. […]
Qu’on songe à la valeur explosive de ces affirmations en 1670, et l’on ne s’étonnera pas de voir que Spinoza parut à ses contemporains le Destructeur par excellence, et le Maudit.
Sur les routes de France, dans les auberges ; ou bien à Londres, au milieu des tracas du pouvoir ; à Oxford, son asile très doux ; à Rotterdam, à Amsterdam, à Clèves, il réfléchissait, travaillait, lentement arrivait à la perfection de sa doctrine. Quand enfin il s’exprima, on reconnut qu’il avait l’exceptionnel pouvoir de vivifier tous les sujets qu’il abordait. Car il ne s’en tenait pas à la philosophie pure ; il lui plaisait de donner son avis sur la religion, sur la politique, sur la pédagogie ; et chaque fois qu’il publiait un livre, il provoquait des répercussions qui n’en finissaient plus. D’hommes qui, comme lui, n’ait rien écrit qui ne parût essentiel, je ne vois guère que Jean-Jacques Rousseau ; lequel, parlant religion, politique ou pédagogie, toujours provoquait des incendies. Locke, flamme discrète, n’avait pas les ardeurs dont Rousseau embrasera tous ceux qui l’approcheront. Mais, avant Rousseau, il a compris l’appel des consciences, et leur a répondu : de là sa force efficace. Ses écrits sont autant de conversations qui pressent le lecteur et ne lui permettent de partir que convaincu ; ils le persuadent par cent reprises ; ils le conquièrent patiemment ; ses phrases l’enlacent.
Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne (1935)