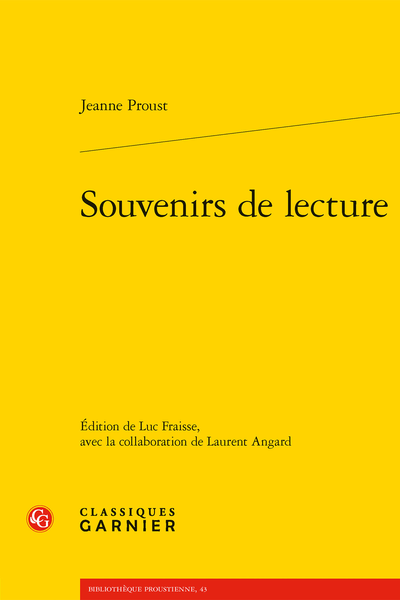
Une mère germinale par Marc Lambron, de l’Académie française
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Souvenirs de lecture
- Pages : 7 à 9
- Collection : Bibliothèque proustienne, n° 43
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406132707
- ISBN : 978-2-406-13270-7
- ISSN : 2258-9058
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13270-7.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 29/06/2022
- Langue : Français
Une mère germinale
par Marc Lambron,
de l’Académie française
Jeanne Weil avait deux ans en 1851, l’année de l’avènement de Napoléon III. Vingt ans plus tard, devenue l’épouse du docteur Adrien Proust, elle donne naissance à leur fils Marcel, pour disparaître en 1905. Marcel s’effacera en 1922. Dans ce basculement d’une génération vers l’autre s’inscrit l’une des plus grandes œuvres de la littérature française : grande lectrice, Jeanne Weil s’arrête sur le seuil d’une cathédrale que son fils construira seul. Pourtant, elle laisse une trace graphique, un relevé de préférences, sous la forme de ce carnet. On le croyait perdu, il se trouvait dans les archives de Bernard de Fallois.
De quoi s’agit-il ? D’un album de citations collectées au gré des lectures d’une femme polyglotte, fille d’un homme fréquentant tel poète occasionnel resté sans fortune littéraire, épouse et mère de médecin, ayant engendré un génial hapax humain qui deviendra l’auteur d’un cycle surhumain. Évelyne Bloch-Dano en avait exploré le profil avec une biographie qui reste indépassée, tant elle silhouette avec empathie une complexité tutélaire. Madame Proust lit donc beaucoup au fil des années, on peut même dire que sa psyché est tapissée de littérature, que son cerveau flotte dans une eau syntaxique. Indice, déjà, d’un rapport au monde que son fils démultipliera en même temps qu’il le dépassera : confectionnant à la diable, par additions de fragments, une sorte d’auto-bréviaire, elle cultive un rapport citationnel avec un réel filtré par le verbe des écrivains, comme une vie secondaire, une méta-vision. Les mots des autres forment un écran, son fils tissera le sien.
Modestie, donc, que celle qui se retranche derrière la plume d’oie des auteurs illustres pour poser ses diagnostics sur l’existence. Mais autoportrait en puzzle, indice d’un goût très dessiné. Madame Proust n’est pas incurieuse de l’histoire de son siècle et de ses tumultes. Au 8contraire, elle en revisite les pilotis, épistoliers du xviiie et mémorialistes de la grande Révolution, orateurs parlementaires de la monarchie de Juillet et du Second Empire, relevant avec Louis Blanc que les émeutes populaires signent un « pacte de la misère avec l’imprévu ». Assise sur le substrat des grands classiques – la plus longue entrée est un recopiage de la mort de Monseigneur dans les Mémoires de Saint-Simon –, Madame Proust ne dédaigne pas les espiègleries, mots boulevardiers, saillies de beaux esprits. On l’imagine égayée à citer le mot de Talleyrand sur Chateaubriand, « il se croit sourd depuis qu’il n’entend plus chanter ses louanges », ou l’ouverture que fit à une dame l’académicien Villemain, fort laid de visage mais collectionneur de succès galants : « Aimez-moi, Madame, personne ne le croira. »
Ce à quoi l’on assiste au fil des fragments, c’est surtout à un processus de raffinement, au sens physique du mot, comme pour un combustible brut : le tamis de la lecture isole quelques pépites, on extrait du temps de la lecture ses minutes essentielles. Il faut imaginer l’évanouissement graduel du lieu, salon ou chambre avec lampe à pétrole ou lustre à pampilles, des meubles cossus, une robe d’intérieur, pour se recentrer sur des annotations comme un pur dépôt de langage, une cosa mentale, une torréfaction du réel transformé en grains de littérature.
Par imprégnation textuelle, madame Proust taille ainsi sa griffe avec le ciseau des autres. C’est un autoportrait par compilation, un herbier de sentences. Elle prise les maximes, le trait qui porte, l’anacoluthe et le panache. Elle entend le français en experte des infra-sons livresques : attention à la découpe, à la formule, à l’effet. Citant des phrases à visée d’édification, elle en retient moins la valeur gnomique que le style qui l’exprime. L’esprit vif d’une lectrice assise porte à brocher une anthologie de la minutie segmentée, marquée au sceau d’une esthétique de la précision sèche : « la statistique aurait pour moi son éloquence », écrit-elle en septembre 1889 à son fils Marcel. C’est la dessiccation de la plante qui donne de belles feuilles de thé.
Son fils en a-t-il été irradié ? Il est certain que ce carnet, quand bien même Marcel Proust ne le lisait-il pas en temps réel, forme en lui-même un bloc de sapience, une archive d’ambiance, une sagesse des familles comme il existe une sagesse des nations. Ces phrases ont pu être distillées dans la conversation, commentées lors des repas vespéraux, elles créent un climat d’incubation, une sorte de florilège matriciel. Ce qui 9est vérifiable, c’est que la monstrueuse germination fictionnelle que représente la Recherche échantillonne çà et là, comme par translation interne, des occurrences présentes dans les carnets de Jeanne Proust : une double généalogie semble transiter par le canal maternel, celle du sang et celle des mots.
Comme par palimpseste, tel vers de Corneille cité dans ces carnets se retrouve dans la bouche du Bloch d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Une phrase de Victor Hugo refleurit dans une lettre à Daniel Halévy. Une maxime de l’abbé Galiani vient orner un passage du Temps retrouvé. Tel jeu de mots potache est replacé dans la bouche de Cottard. Infiltrations, nappes phréatiques du langage, résurgences maternisées, Jeanne Proust était assurément une génitrice de vocables, une mère germinale. Verbe originel tramé dans la tapisserie des générations ? Un jour, elle recopie cette phrase tirée d’une lettre de Madame de Rémusat à son fils : « Dans les têtes des mères, il y a toujours un côté qui se trouve avoir justement l’âge de leurs enfants. » On ne sait si c’est celui de Swann ou de Guermantes, mais on y entend vibrer, comme par anticipation, un accent de Temps retrouvé.
M. L.