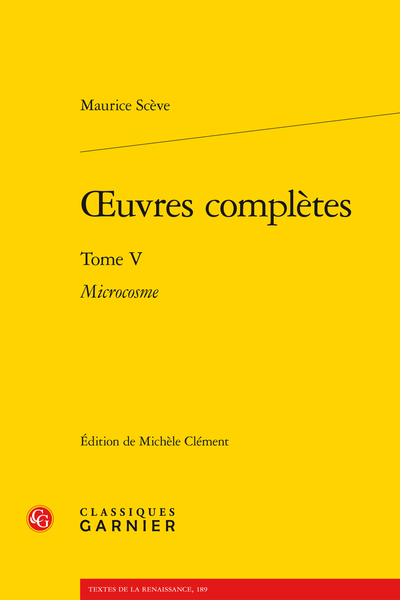
Œuvres de Maurice Scève publiées de son vivant (1501/1502 – après juin 1563)
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome V. Microcosme
- Pages : 139 à 143
- Collection : Textes de la Renaissance, n° 189
- Série : Studiolo humaniste, n° 3
- Thème CLIL : 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN : 9782812412530
- ISBN : 978-2-8124-1253-0
- ISSN : 2105-2360
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1253-0.p.0139
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/10/2013
- Langue : Français
Œuvres de Maurice Scève publiées
de son vivant
(1501/1502 – après juin 1563)
La naissance de Maurice Scève se situe entre avril 1501 et avril 1502 : c’est l’importante découverte de V.-L. Saulnier en 1950 qui a retrouvé un document d’archive contenant une supplique de Scève, clericus lugdunensis, en date de 1515, demandant l’attribution d’un bénéfice ecclésiastique alors qu’il est « dans sa quatorzième année1 » ; ce document atteste sa qualité de clerc, son âge et explique son célibat maintenu, nécessaire pour jouir d’un bénéfice ecclésiastique. La dernière attestation de vie de Scève est du 22 juin 1563, pièce d’archive faisant foi là encore, puisque Jean Guillemain a découvert que Scève a été témoin de mariage de Madeleine Du Choul et Jean de Tholomey (Tolomei) le 22 juin 1563)2 ; on ignore la date de sa mort, qui a pu se produire en 1564 pendant un épisode de peste assez violent à Lyon et expliquerait peut-être la reparution de Délie à Paris cette année-là dans une édition partagée entre trois libraires.
1535 La Deplourable fin de Flamete, Lyon, François Juste (rééd. Paris, D. Janot, 1536) ; roman traduit de l’espagnol par Scève à partir du roman de Juan de Florès Grimalte y Gradissa (contient un huitain initial repris et transformé en dizain dans Délie, d. 37).
1535 quatre vers latins signés et offerts à Ortensio Lando sur la page de titre de ses Forcianæ quæstiones (premiers vers publiés de Scève ?) (rééd. en 1536).
1536 Recueil de vers latins, et vulgaires de plusieurs Poëtes Françoys, composés sur le trespas de feu Monsieur le Daulphin, Lyon, François Juste : contient 5 poèmes latins et 3 poèmes français de Scève dont l’églogue Arion (228 vers) signée.
1536/1537 Hécatomphile. Les fleurs de poésie françaises. Blasons du corps femenin, s. l. s. n. 1537 [Lyon, D. de Harsy]3 ; contient les cinq blasons de Scève dans la section intitulée Blasons du corps feminin avec sa propre page de titre datée de 1536 (exemplaire de la BNU Strasbourg) ; nombreuses rééditions ensuite qui contiennent les cinq blasons de Scève comme chez Anthoine Bonnemère à Paris, en 1538, chez A. Bonnemère et P. Sergent en 1539… [Denis Janot donne la même année 1536 à Paris une édition de l’Hécatomphile (sans nom d’éditeur) accompagnée de blasons dont seulement deux blasons de Scève (exemplaire incomplet de la bibliothèque bodléienne].
1537 Le Valet de Marot contre Sagon, Lyon, François Juste. Contient dans ses liminaires un distique latin signé M. S. adressé à Clément Marot4.
1543 Sensuivent Les blasons Anatomiques du corps femenin, ensemble les contreblasons de nouveau composez, & additionnez, avec les figures, le tout mis par ordre : composez par plusieurs poetes contemporains. Avec la table desdictz Blasons & contreblasons, Imprimez en ceste Année. Pour Charles Langelier. 1543 (recueil dans lequel les cinq blasons de Scève portent mention du nom de leur auteur (SAEVE) ; rééd. à Paris, 1550, 1554, 1568).
1539 Le Parangon des chansons, Paris, Pierre Attaingnant : contient le futur dizain 89 de Délie mis en musique par Jean Maillard (voir 1542).
1540 Septiesme livre contenant XXX chansons nouvelles, Paris, Pierre Attaingnant : contient, dans une première version en huitain, le futur dizain 41 de Délie mis en musique par Pierre de Villiers (huitain réimprimé à Lyon en 1541 par Jacques Moderne dans Le parangon des chansons : huytiesme livre contentant xxx chansons) :
Le veoyr, l’ouyr, le parler, l’attoucher
Estoyent le bout de mon contentement,
Tant que le bien qu’amantz ont sur tout cher
N’eut oncques lieu en nostre appoinctement.
Que m’a valu d’aymer honnestement
Puiqu’on me peult pour vice reprocher
Qu’en bien aymant j’ay perdu promptement
Le veoyr, l’ouyr, le parler, l’attoucher.
1542 [Psaumes], Lyon, Etienne Dolet (page de titre manquante de l’unique exemplaire de ce livre conservé à la Vaticane, Riserva, VI, 26) : contient les deux psaumes en vers français de Scève, ps 26 et ps. 83, p. 110 et 115 (rééd. de ces deux psaumes de Scève dans d’autres psautiers : Paris, 1549 ; Paris, 1550 ; Lyon, 1555 ; Lyon, 1557 ; Lyon, 1558).
1542 Neufiesme livre contenant xxviii chansons nouvelles, Paris, Attaingnant : contient, sous la forme d’un huitain, le futur dizain 82 mis en musique par Certon (voir ci-dessous).
1542 La Fleur de poesie françoyse, Paris, A. Lotrian (recueil collectif, rééd. en 43) contient de manière anonyme un huitain et un dizain de Scève (vers repris et remaniés dans Délie pour devenir respectivement les dizains 82 et 89 ; le huitain préliminaire au futur dizain 82 est le même que celui publié par Attaingnant la même année et le d. 89 est le même que celui de l’édition Attaingnant de 1539) :
L’ardant desir du hault bien desiré
Qui aspiroit a celle fin heureuse
A tellement son ardeur attiré
Que le corps vif est desja cendre umbreuse,
Et de ma vie en ce point malheureuse,
Ne me reste que ces deux signes cy
L’œil larmoyant pour te rendre piteuse,
La bouche, helas, pour te crier Mercy.
Amour perdit les traits qu’il me tira
Et de douleur se print fort à complaindre,
Venus en eut pitié, et souspira
Tant qu’elle fit par pleurs sa torche estaindre
Dont aigrement furent contrains de plaindre,
Car amour fust sans feu remis sans flamme,
Ne pleure plus Venus, mais bien enflamme
Ta torche en moy, mon cueur l’allumera,
Et toy amour cesse, va vers madame
Qui de ses yeulx d’aultres traictz te fera.
1544 Delie, objet de plus haulte vertu, Lyon, chez Sulpice Sabon pour Antoine Constantin, à la marque du Rocher.
1547 Saulsaye. Eglogue, De la vie solitaire, Lyon, Jean de Tournes (rééditions : Lyon, Nicolas Bacquenois, 1548 ; Paris, Corrozet, 1548 ; Lyon, Bacquenois et Payen, 1549).
1548 Premier livre contenant trente sept chansons, nouvellement mises en musique par Dominique Phinot. Lyon, Godefroy et Marcelin Beringen et Second livre contenant vingt et six chansons nouvellement mises en musique par Dominique Phinot. Lyon, Godefroy et Marcelin Beringen ; contiennent trois dizains de Délie (d. 5 dans le Premier livre = chanson 1 et d. 256 et 364 dans le Second Livre, respectivement chansons 6 et 13).
1549 Trente et ugnyesme livre contenant trente chansons nouvelles de la facture et composition de Maistre Clement Janequin, Paris, P. Attaingnant, contient un huitain mis en musique par Clément Janequin dont les deux derniers vers sont une reprise presque exacte des deux premiers du d. 141 de Délie : « Comme des raiz de Phebus gratieux / Se paissent fleurs durant la primavere ».
1549 Le dizain 131 de Délie (modifié) est mis en musique par Jean Boyvin et publié à Paris chez P. Attaingnant, Livre xxviii, fo 12 :
Diane ceincte hault sa cotte attournée,
La trousse au col, arc et flesches aux mains,
Exercitant chastement la journée
Chasse et prent cerfz, biches et chevreulx mainctz.
Mais toy Diane en actes plus humains
Myeulx composée et sans viollens dardz
Tu poursuis ceulx par tes chastes regars
Qui tellement de ta chasse s’ennuyent,
Qu’eulx tous estans de toy sainctement ars
Te vont suyvant où les bestes te fuyent.
1549 La Magnificence de la superbe et triomphante entrée de la noble et antique cité de Lyon faicte au Treschrestien Roy de France Henry deuxième de ce nom et à la Royne Catherine son espouse le xxiii de septembre mdxlviii, G. Roville, Lyon (imprimé avec l’assistance de J. de Tournes selon H. Baudrier ; impression la même année de la version italienne : La Magnifica et triomphale Entrata… chez le même éditeur).
1562 Microcosme, Lyon, Jean de Tournes.
1564 Délie, objet de plus haulte vertu, Paris, Nicolas Du Chemin (édition partagée d’une part avec V. Norment et J. Bruneau et d’autre part avec G. Robinot, (éd. posthume ?).
Pièces offertes :
17 pièces offertes parues entre 1535 et 1563, adressées à quatorze destinataires dans quatorze ouvrages tous imprimés d’abord à Lyon5, et dont six sortent des presses de J. de Tournes.
Pièces incertaines existantes :
Le petit œuvre d’amour et gaige d’amytié, 1537 a. s. (privilège du 27 janvier 1537 = 1538) ; a donné lieu à une longue querelle d’attribution ; l’hypothèse d’attribution à Scève, d’abord émise par Prosper Blanchemain, puis par Edouard Herriot qui republia le texte en 1927, est réfutée par Guégan, défendue par Saulnier, partiellement admise par Parturier, réfutée par Lachèvre, sans arguments certains dans aucun des cas ; elle semble aujourd’hui abandonnée mais pourtant rien ne permet avec certitude de refermer le dossier ; la présence de la devise « non si, non la » en face de la devise « Ainsi, ou non » sur le dernier fo est troublante ainsi que la teneur de certains poèmes.
Paradoxe contre les lettres, Lyon, Jean de Tournes, 15456.
Sonnet italien (« Questo è il sonetto ritrovato nel sepulchro di Madonna Laura in questo modo) inséré par Jean de Tournes dans la dédicace à Scève du recueil Il Petrarca en 1545 : est-ce un poème de Scève ? Pascal Quignard et Enzo Giudici le donnent pour tel.
Pièces incertaines et inexistantes :
épitaphe(s) de Clémence de Bourges7.
épitaphe de Barthélemy Aneau.
1 V.-L. Saulnier, « La cléricature de Maurice Scève », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XII, 1, 1950, p. 14-19.
2 Jean Guillemain, Recherches sur l’antiquaire lyonnais Guillaume du Choul (ca. 1496-1560), Thèse de l’Ecole des Chartes, 2002 ; voir le résumé détaillé en ligne et la citation : « Madeleine fut la femme de Jean de Tholomey, neveu et héritier de l’humaniste siennois Claudio Tolomei ; Maurice Scève, que V.-L. Saulnier croyait mort en 1560, fut témoin de ce mariage, le 22 juin 1563 », http://theses.enc.sorbonne.fr/2002/Guillemain.
3 Voir Magali Vène, « À propos d’une traduction retrouvée (la Deiphire de 1539). Nouveaux éléments sur la diffusion française au xvie siècle des écrits sur l’amour de Leon Battista Alberti, (suite du vol. x, 2007) », Albertiana, Vol. xi-xii, Olschki Editore, 2008-2009, p. 146-147 ; c’est elle qui attribue à D. de Harsy cette édition. L’existence d’une édition chez F. Juste en 1536 puis 1537 des Blasons anatomiques des parties du corps feminin, invention de plusieurs poetes Francois contemporains contenant les blasons de Scève est incertaine ; aucun exemplaire connu.
4 C’est la récente découverte de Guillaume Berthon ; voir « ’Estienne Dolet, amy singulier de Clement Marot’. Dolet éditeur du Valet de Marot contre Sagon (François Juste, 1537) », dans Revue française d’histoire du livre, no 132, Nouvelle série, 2011, Société des bibliophiles de Guyenne, Librairie Droz, p. 5-20. Le distique de Scève suit deux pièces inédites de Dolet.
5 Sous fausse adresse pour le livre d’Ortensio Lando, Forcianæ Quæstiones en 1535 et 1536. Les quatorze destinataires sont par ordre chronologique : Ortensio Lando, Clément Marot, Gilbert Ducher, Étienne Dolet, Charles de Saincte-Marthe, Pernette Du Guillet, Marguerite de Navarre (et sa fille Jeanne), Philibert de Vienne, Matthieu de Vauzelles, Guillaume Rondelet, Louise Labé, Gabriel Symeon, Pontus de Tyard et Philibert Bugnyon. Je n’ai pas intégré ces textes dans la chronologie sauf celui offert à O. Lando qui est peut-être la première publication de Scève et parce qu’il montre son nom sur une page de titre (seule occurrence, paradoxale) et le distique de 1537 qui est une découverte récente, importante pour l’histoire littéraire.
6 Voir mon article, « Maurice Scève et le Paradoxe contre les lettres », édition critique commentée du Paradoxe contre les lettres, (anonyme), Lyon, 1545, B.H.R, tome lxv, 2003, no 1, p. 97-124.
7 Selon Claude de Rubys dans L’Histoire véritable de la ville de Lyon, Lyon, Bonaventure Nugo, 1604, p. 384, Scève aurait composé (ainsi que Claude de Taillemont) lors de la mort de Clémence de Bourges en 1557 de « doctes tumbeaux que l’injure du temps nous a faict perdre ». Le père Colonia reprend l’hypothèse dans son Histoire littéraire de la ville de Lyon, éd. de Lyon 1728-1730, fac similé, Slatkine Reprints, 1970, p. 547.