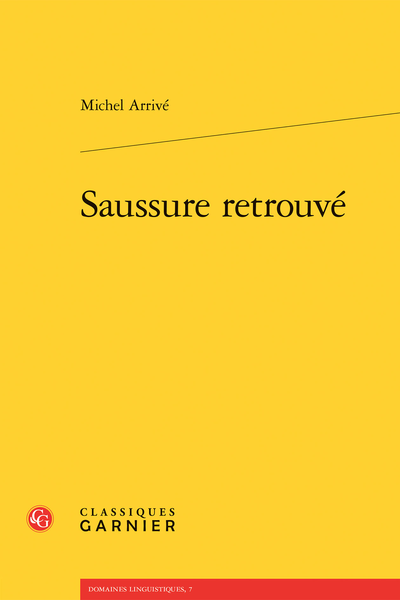
Mise en garde
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Saussure retrouvé
- Pages : 7 à 19
- Collection : Domaines linguistiques, n° 7
- Série : Grammaires et représentations de la langue, n° 5
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782812450655
- ISBN : 978-2-8124-5065-5
- ISSN : 2275-2803
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-5065-5.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/04/2016
- Langue : Français
Mise en garde
Après À la recherche de Ferdinand de Saussure, paru aux PUF en 2007, puis Du côté de chez Saussure, ouvrage collectif publié chez Lambert-Lucas en 2008, voici que j’ose un Saussure retrouvé. Le titre, je le crains, risque d’être mal reçu. Pour deux raisons. L’obstination dans la référence proustienne agacera peut-être certains lecteurs. J’en prends mon parti. Mieux : je fais le pari, selon une vieille expérience personnelle, que l’agacement qu’ils éprouveront ajoutera son once de piment au plaisir de leur lecture.
Mais il y a plus grave : mon titre peut se prêter à une interprétation désobligeante. Ne laisserait-il pas entendre que, dans tout ce qui a été publié avant Saussure retrouvé, Saussure ne s’est pas retrouvé, voire, peut-être, s’est provisoirement perdu ? Je souhaite donc expliquer pourquoi je ne pense rien de tel.
J’observe d’abord que s’il avait cette valeur, mon titre porterait notamment condamnation de mes deux précédents ouvrages saussuriens. Il n’en est rien : Saussure retrouvé s’inscrit dans la suite de À la recherche de Ferdinand de Saussure et de Du côté de chez Saussure, textes sur lesquels, inévitablement, je formule aujourd’hui certaines réserves, mais qui ne me semblent nullement devoir être rejetés pour avoir « perdu » Saussure. Et je reconnais volontiers les éminents mérites de plusieurs travaux relatifs à Saussure publiés depuis 2007, comme d’ailleurs bien avant : la bibliographie de cet ouvrage les révélera.
Que signifie donc le participe retrouvé ? Comme chez Proust, sans doute, je persiste dans la référence, il marque que je fais retour – ce n’est en somme rien d’autre qu’un simple déplacement anagrammatique de la consonne R – à Saussure. Comme on retrouve un ami perdu de vue depuis quelque temps, mais jamais oublié. Pour procéder à ce retour, une occasion m’est fournie par le hasard de la chronologie : mon livre paraît au moment où se célèbre le centenaire d’un événement considérable, la
publication, en juin 19161, trois ans après la mort de Saussure – elle était survenue le 22 février 1913 – du Cours de linguistique générale.
Mais cet anniversaire n’est évidemment pas le seul prétexte de mon retour à Saussure. La raison principale tient au fait que je considère son œuvre, depuis plus de cinquante ans que je la lis et relis, comme étonnante, inquiétante, mieux (ou pis ?) : perturbante. Pour tout dire : admirable. Point seulement parmi les travaux des linguistes : elle se démarque absolument de la quasi-totalité d’entre eux. Mais aussi entre tous les travaux de sciences humaines, à l’exception, peut-être, de deux œuvres paires : celles de Lévi-Strauss et de Lacan. Pour ne point entrer dans le délicat débat qui la ferait comparer à des œuvres de fiction, je me contente d’indiquer qu’à mon sens elle se rapproche, par plusieurs aspects, de certaines d’entre elles.
Ces traits perturbants et admirables se révèlent quel que soit le regard qu’on jette sur l’œuvre de Saussure.
Je ne saisirai ici que l’un de ces regards, celui qu’on jette – souvent c’est le premier – sur les conditions d’écriture et de publication d’une œuvre. J’ai cru pouvoir, en 19962, avancer que Saussure n’a pas publié ce qu’il a écrit et n’a pas écrit ce qui a été publié sous son nom
Il convient de préciser ce constat quelque peu provocateur.
Pour sa première partie, il devient, si j’ose dire, de plus en plus exact au fur et à mesure que le temps passe et que de nouveaux travaux sont publiés, plus d’un siècle après la mort de l’auteur, s’ajoutant à ceux qui, depuis de nombreuses années, ont été progressivement révélés. La recherche sur les anagrammes et les travaux sur la sémiologie légendaire étaient en 1913 totalement inédits. Leur existence même n’était connue que par de très rares amis, élèves ou collègues. Ils ne commenceront, très progressivement, à être publiés que dans la seconde moitié du siècle. De nombreux écrits relatifs à la linguistique au sens restreint du terme ont dû attendre 2002, puis 2011 pour être publiés3.
Il faut cependant apporter à ce premier élément de ma remarque une correction non négligeable : c’est bien Saussure qui a écrit et publié, en son très jeune âge, deux ouvrages. En 1878 – il venait d’avoir vingt-et-un ans – ce fut le Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Il est aujourd’hui d’une lecture difficile, même pour les spécialistes professionnels de l’histoire de la linguistique. L’intérêt spécifique de l’ouvrage est de faire apparaître le concept de système dans la description des sons d’une langue. C’est l’utilisation de ce concept qui permet à l’auteur de repérer l’existence dans l’état ancien de l’indo-européen de « coefficients », aujourd’hui désignés par le nom de laryngales. La découverte, puis le déchiffrage et l’analyse, survenus longtemps après la mort de Saussure – en 1927, par les soins de Jerzy Kurylowicz – des inscriptions hittites, permettront de reconnaître la trace, sous la forme de phonèmes spécifiques, des « coefficients » identifiés, longtemps avant, mais selon une méthode strictement déductive, par le Mémoire. Ce texte fondateur valut à son auteur à la fois une très précoce notoriété et de solides inimitiés théoriques. Trois ans plus tard, en 1881, il publie sa thèse, De l’emploi du génitif absolu en sanscrit, recherche syntaxique rigoureuse, parfaitement informée, mais, sans nul doute, dépourvue de la totale nouveauté théorique du Mémoire. Cette brève thèse est le dernier des ouvrages qu’il ait fait paraître. Il avait vingt-quatre ans. Précocité rarement vue, plus rarement encore dans le domaine « scientifique » et, spécifiquement, linguistique, que dans celui de la littérature, où l’on pense immédiatement à ces trois contemporains que furent Rimbaud, Jarry et Roussel.
Jusqu’à sa mort, Saussure ne publiera plus que des articles. Pas très nombreux et souvent très brefs, de moins en moins nombreux et de plus en plus brefs : en tout moins de 300 pages. Le total des deux livres et des articles – l’ensemble en est réuni dans le Recueil des publications scientifiques, publié en 1922 – atteint à peine 600 pages. C’est peu pour une carrière universitaire de trente-cinq ans, même à l’époque où les professeurs n’étaient pas encore gagnés par la frénésie de publication qui les a, depuis, progressivement atteints.
On a compris que la seconde partie de mon constat doit être plus sévèrement amendée. Dire que « Saussure n’a pas écrit ce qui a été publié
sous son nom » ne vaut, on vient de l’apercevoir, que pour le Cours de linguistique générale. Comme le titre l’annonce sans fard et comme le précisent dans leur Préface les éditeurs du texte, le livre a été réalisé à partir des trois cours successifs de linguistique générale que Saussure donna à l’Université de Genève en 1906-19074, 1908-1909 et 1910-1911. Ce n’est pas ici le lieu de faire l’histoire détaillée de cette publication : le livre d’Estanislao Sofia (voir, plus bas, la note bibliographique) fait le point, appuyé sur la publication de la « collation Sechehaye » et sur une analyse serrée de ce document. C’est encore moins le lieu d’entrer dans les débats orageux qui se sont élevés sur l’« authenticité » du Cours, parfois qualifié d’« apocryphe5 ». Il suffira de rappeler deux évidences connues depuis longtemps. La première est que le Cours (ou les Cours ? Rien n’indique si le nom est, dans le titre, au singulier ou au pluriel6), qui confère le statut d’auteur au seul Ferdinand de Saussure, a été composé, après sa mort, par ses deux collègues Albert Sechehaye et Charles Bally, d’après les « brouillons », c’est le terme utilisé par les éditeurs, assez rares, laissés par le professeur et, surtout, selon les cahiers de notes de certains des auditeurs des Cours. Parmi lesquels ne se comptaient ni Bally ni Sechehaye : ils firent appel pour avoir un témoignage direct à Albert Riedlinger, auditeur des deux premiers. La seconde est que le Cours a
longtemps été le seul moyen d’avoir accès à la réflexion de Saussure en linguistique générale. Même après la publication, en 1957, du livre de Robert Godel sur Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale, c’est par l’« édition standard », bientôt dénommée « vulgate », d’abord sans intention péjorative, que le Cours a été lu et a exercé son influence. C’est par elle que, pour d’évidentes raisons chronologiques, Meillet comme Troubetzkoy, Hjelmslev comme Merleau-Ponty, Guillaume comme Tesnière, et bien d’autres, en France et à l’étranger, ont reçu l’enseignement du Cours. Jakobson, Benveniste, Martinet, Lacan, Lévi-Strauss, Barthes et Greimas, là encore bien d’autres, ont été informés, à des moments et des degrés évidemment divers pour chacun d’eux, de l’existence des sources manuscrites et de leurs divergences avec le texte standard. C’est cependant pour une très large part la « vulgate » qui a informé leur réflexion. Je ne prends que deux exemples. Lacan, a, certes, dès leur première publication, en 1964, jeté un regard intéressé sur les travaux de Saussure relatifs aux Anagrammes. Il y remarque très justement la mise en cause de la linéarité du signifiant et « la polyphonie de tout discours, sur les plusieurs portées d’une partition » (Lacan, Écrits, 1966 : 503, note 2). Il revient sur le problème, de façon plus explicite, dans le Séminaire de 1972-1973, Encore (1975 : 88), en s’interrogeant sur l’« intentionnalité » de l’anagramme. Mais pour le CLG, il prend en compte de façon exclusive l’édition de Bally et Sechehaye. Derrida est allé plus loin, en prenant le parti, dans De la Grammatologie (1967 : 107), de ne se référer qu’au CLG dans sa version de 1915, comme il dit, sans doute selon la date de la « Préface » : « Nous nous sommes intéressés à un texte dont la littéralité a joué le rôle que l’on sait depuis 1915 ». Attitude à la fois paradoxale, significative, et, compte tenu des très lucides explications fournies par l’auteur, pleinement pertinente. C’est en effet le Cours dans son état originel, inchangé depuis 19167, qui a exercé son effet sur la linguistique, les sciences humaines et la philosophie au xxe siècle. Au point que les deux désignations « le Cours de linguistique générale » et « Saussure » en sont venues, souvent à cette époque, à s’utiliser de façon équivalente : Claudine Normand, encore en 2000, donne comme titre au premier chapitre de son Saussure « Le Cours de Linguistique générale : un texte nommé Saussure ». Le point
d’histoire sur lequel s’appuie cette assimilation est désormais fixé, et ne saurait être oublié. Ce qui n’empêche naturellement pas de porter un intérêt majeur à « la pensée même de Ferdinand de Saussure lui-même », comme dit Derrida, en prenant en compte tous les moyens dont on dispose aujourd’hui pour la connaître aussi complètement et exactement qu’il est possible. Sans s’aveugler devant ce qui reste une spécificité évidente – intentionnelle ? à quel degré ? – des conditions non seulement de divulgation mais aussi d’élaboration de cette pensée.
Dans ces deux aspects inséparables de l’œuvre de Saussure apparaît en effet clairement une évidence : Saussure, qui écrivait beaucoup, jugeait rarement, de plus en plus rarement au long de sa carrière et de sa vie, que ses écrits pouvaient, encore moins devaient être publiés : des fragments entiers de ses réflexions, non seulement dans le domaine des anagrammes et de la légende, mais encore dans la réflexion proprement linguistique ou sémiologique sont restés pendant des années, des décennies, parfois jusqu’à près d’un siècle, conservés à la Bibliothèque de Genève, enfouis dans des malles poussiéreuses ou catalogués dans des universités américaines avant d’en être exhumés et publiés. Et il en reste encore, on le sait avec certitude.
Cette spécificité – la dirai-je posthume, même si elle ne l’est que partiellement ? – de l’œuvre de Saussure tient-elle de l’accidentel ? À mon sens, certainement pas. Elle révèle les caractères les plus profonds de sa réflexion. C’est sans doute dans le domaine proprement linguistique que se manifeste de la façon la plus évidente un caractère distinctif de l’écriture et, indissolublement, de la pensée saussuriennes : il hésite à ce point devant les mots à utiliser qu’il laisse à la place qu’ils devraient prendre une déroutante plage blanche8. Parfois de la dimension approchée d’un mot unique, parfois beaucoup plus étendue. Parfois ponctuée – étonnante « ponctuation sans texte9 » – comme s’il était prévu d’y
insérer, plus tard, le texte achevé qu’elle fait attendre. Décevante et excitante, cette plage blanche. Au lecteur de s’interroger sur les mots entre lesquels l’auteur a hésité ou sur ceux qu’il n’a pas su trouver et, surtout, sur les raisons de son hésitation. Qui est sans doute parfois plus qu’une hésitation : ne serait-ce pas le désistement, marque du découragement devant l’impossibilité ? C’est avec une sorte de sérénité désabusée qu’il fait part à Antoine Meillet du constat suivant :
Sans cesse l’ineptie absolue de la terminologie courante, la nécessité de la réforme[r], et de montrer pour cela quelle espèce d’objet est la langue en général, vient gâter mon plaisir historique […]. Cela finira malgré moi par un livre où, sans enthousiasme ni passion, j’expliquerai pourquoi il n’y a pas un seul terme employé en linguistique auquel j’accorde un sens quelconque (lettre à Antoine Meillet du 4 janvier 1894, in Benveniste, « Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet », Cahiers Ferdinand de Saussure, 24, 1964 : 95).
En ce point, certes, le Professeur reste serein, quoique fort peu euphorique. Ailleurs, il en vient souvent au sarcasme sur les problèmes de « terminologie », révélateurs des difficultés de la saisie des « faits linguistiques » : on verra dans le premier chapitre les formes parfois très cruelles prises par le rire saussurien. Il lui arrive même d’atteindre une manière de désespoir épistémologique absolu, par exemple dans ce fragment de « brouillon » du Cours, qui, sans doute sous l’effet d’une trop prudente pudeur des éditeurs, n’apparaît pas dans le texte publié :
Quiconque pose le pied sur le terrain de la langue peut se dire qu’il est abandonné par toutes les analogies du ciel et de la terre (Engler, Édition critique du CLG, p. 169).
Ou, de façon plus radicale encore :
Faut-il dire notre pensée intime ? Il est à craindre que la vue exacte de ce qu’est la langue ne conduise à douter de l’avenir de la linguistique (Saussure 2002 : 87 ; 2011 : 72).
Sous les masques divers du Professeur, fatigué, ironique, sarcastique, se dissimule toujours une véritable passion : le désir de la « vérité » touchant la langue. La vérité et son contraire, l’erreur donnent lieu dans le Cours de linguistique générale à un long développement (p. 135-138). Il s’agit
de distinguer la vérité synchronique de la vérité diachronique. C’est en ce point – mais il n’est pas le seul – que surgit la difficulté, l’impossibilité même, peut-être. Car la langue est système, comme il est constamment répété dans le Cours et ailleurs. Mais elle est aussi substance, et « substance glissante », selon la métaphore qui surgit en plusieurs points des Écrits (voir notamment 2002 : 281). Glissante, et dans plusieurs sens, à tous les sens du mot sens : notamment sous l’effet de l’évolution, qui, constamment, et souvent sous l’effet de la « fortuité » – nom saussurien du hasard – la fait glisser d’un état à un autre. Mais aussi par les résistances sournoises qu’elle oppose, en tant que système, à tout effort de dénomination des unités, purement négatives, qui la constituent. Le glissement ici n’est plus chronologique, mais logique.
J’ai cherché dans cet ouvrage à « retrouver Saussure » en quelques-uns des points les plus aigus de ses perplexités, voire de ses angoisses. On trouvera ces essais de rencontre dans les six premiers chapitres, qui visent successivement la « terminologie », nom saussurien du métalangage (pages 21 à 38), les problèmes de la voix et de la lettre dans le langage (pages 39 à 58), la présence du sujet dans la langue et le langage (pages 59 à 76), le jeu de « la conscience de la langue » et de l’inconscient (pages 77 à 97), la place de la syntaxe dans la linguistique saussurienne (pages 99 à 113), enfin la littérature telle qu’elle est envisagée par Saussure (pages 115 à 135). Les deux derniers chapitres évoquent les relations qui s’établissent entre l’appareil saussurien et d’autres réflexions : celle, de peu antérieure, d’Ernest Renan (pages 157 à 175) et celles, ultérieures, des grammairiens français de l’entre-deux-guerres (pages 177 à 206). Entre ces deux groupements, un chapitre a des caractères communs avec les deux ensembles qui l’entourent : il est consacré à l’immanence telle que la conçoit Saussure – sans la nommer explicitement –, mais vise en outre la relation très étroite, quoique souvent infidèle, qui se tisse entre l’appareil saussurien et celui de la glossématique hjelsmlévienne.
Un ultime élément doit intervenir dans cette mise en garde. En dépit des glissements, de diverses natures, qu’elle subit en tout point et à tout instant, la langue telle que la conçoit Saussure est un système. Un système qui met en relation serrée tous les éléments qui la constituent. Il en va de même pour le discours qui a pour charge de rendre compte de ce système : celui de Saussure, notamment dans les Écrits, donne parfois l’impression au lecteur d’être répétitif. Il lui arrive
sans doute de l’être : c’est la rançon peu évitable de l’obstination dans la recherche. Mais le plus souvent la répétition n’est qu’apparente. C’est que l’auteur est contraint de faire intervenir dans sa description tous les éléments qui entrent en relation dans le système. Ils apparaissent donc plus d’une fois, mais rarement sous le même aspect : la fonction différente qu’ils prennent dans le système entraîne la différence dans le traitement qui leur est conféré. On a compris qu’il en va de même, pour les mêmes raisons, pour le discours qui s’est donné comme tâche de décrire l’appareil saussurien. On ne s’étonnera donc pas de voir, de loin en loin, réapparaître dans les chapitres de ce livre des éléments qui, d’un autre point de vue, auront déjà été traités dans un chapitre précédent ou le seront dans la suite de l’ouvrage.
Note bibliographique
sur les travaux de Saussure cités dans ce livre
Les travaux publiés du vivant de Saussure
Ils sont cités ici dans leur édition posthume de 1922, publiée chez Payot, à Lausanne et Paris, rééditée en 1984 chez Slaktine Reprints à Genève : Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure. Leur référence est donc : Saussure, 1922-1984, éventuellement abrégée en 1922-1984, suivie du numéro de la page.
Le Cours de linguistique générale
–L’édition originale du Cours de linguistique générale est datée de 1916. Elle est publiée chez Payot, à Lausanne et Paris. L’ouvrage est cité par l’abréviation traditionnelle CLG, suivie du no de la page de la 2e édition, publiée en 1922. La pagination de cette édition, différente de celle de la première, a été conservée dans toutes les reproductions qui l’ont suivie.
–Les sources manuscrites du CLG ont été successivement révélées de plusieurs façons différentes.
1. En 1957, Robert Godel publie à la Librairie Droz, à Genève, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale. L’ouvrage est cité sous la forme Godel, 1957-1969 (date du 2e tirage), avec l’indication du numéro de la page.
2. En 1968, Rudolf Engler fait paraître chez Otto Harrassowitz, à Wiesbaden l’ouvrage intitulé : Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Édition critique par Rudolf Engler, tome 1. Sur les six colonnes verticales de chacune des 515 doubles pages de l’ouvrage on lit, de gauche à droite, d’abord le texte de l’édition originale de 1916, puis, sur les quatre colonnes suivantes, les notes prises par les auditeurs des trois cours successifs, enfin, sur la sixième, les écrits préparatoires de Saussure lui-même, à vrai dire peu abondants. Comme on voit, cette très scrupuleuse édition prend pour base le texte de 1916. Elle redistribue donc le contenu des notes selon l’ordre adopté par les éditeurs de 1916. – Les citations qui en sont faites sont situées par l’indication : Engler, 1968-1989 (date de la 2e édition), suivie du numéro de la page.
3. En 1990, Rudolf Engler fait paraître, chez le même éditeur : Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Édition critique par Rudolf Engler, tome 2 : Notes de Ferdinand de Saussure sur la linguistique générale. Les citations sont situées par l’indication : Engler, 1990, suivie du numéro de la page.
À date plus récente les cahiers de notes de certains auditeurs ont été publiés de façon continue. Les travaux qui ont été utilisés dans ce livre sont les suivants :
–Ferdinand de Saussure, 1993, Cours de linguistique générale, Premier et troisième cours, d’après les notes de Riedlinger et Constantin. Texte établi par Eisuke Komatsu, Tokyo, Collection Recherches Université Gakushuin. Les citations sont situées par l’indication : Komatsu 1993, suivie du numéro de la page.
–Ferdinand de Saussure, 2005-2006, « Le Troisième Cours de linguistique générale », Cahiers Ferdinand de Saussure, 58 : 27-290. Il s’agit des textes relatifs à ce cours de Ferdinand de Saussure et des notes d’Émile Constantin, pubiées par Daniele
Gambarara et Claudia Mejía-Quintano. Les citations sont situées par l’indication : Saussure, Troisième Cours, 2005-2006, suivie du numéro de la page.
–Estanislao Sofia a publié en 2015 La collation Sechehaye du “cours linguistique générale” de Ferdinand de Saussure (1913). Édition, introduction et notes par E. Sofia. Leuven : Peeters. Le texte connu sous le titre « la collation Sechehaye » est une comparaison et une mise au net, par les soins d’Albert Sechehaye, des notes ayant trait au troisième cours de linguistique générale (1910-1911). Il constitue le premier brouillon et le noyau de ce qui deviendra, en 1916, le Cours de linguistique générale.
Autres écrits linguistiques
–Écrits de linguistique générale par Ferdinand de Saussure, Texte établi et édité par Simon Bouquet et Rudolf Engler, Paris, Éditions Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 2002. Cet ouvrage contient le texte inédit « De l’essence double du langage », quelques autres fragments non encore publiés et les textes précédemment publiés dans Engler 1990. Les citations sont situées par l’indication : Saussure, 2002 (souvent abrégée en : 2002), suivie du numéro de la page.
–Ferdinand de Saussure, 2011, Science du langage. De la double essence du langage. Édition des Écrits de linguistique générale établie par René Amacker. Genève, Librairie Droz S. A. Cet ouvrage contient le texte « De la double essence du langage », présenté de façon conforme au manuscrit (on remarquera la différence de place de l’adjectif double dans le titre), et quelques autres fragments inédits. Il ne reproduit pas les textes précédemment publiés dans Engler 1990. Les citations sont situées par l’indication : Saussure, 2011 (souvent abrégée en : 2011), suivie du numéro de la page. Pour les textes communs à 2002 et 2011, on a donné les références des pages des deux éditions.
Recherche sur les anagrammes
Ces travaux ont été progressivement révélés par Jean Starobinski de 1964 à 1970 dans des articles publiés dans divers périodiques. Ils ont
donné lieu en 1971 à l’ouvrage suivant : Jean Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Paris, Gallimard. Les citations sont situées par l’indication : Starobinski, 1971-2009 (date de la réédition, chez Lambert-Lucas), suivie du numéro de la page.
En 2003, sous le titre De dangereux édifices. Saussure lecteur de Lucrèce. Les cahiers d’anagrammes consacrés au De rerum natura (Paris et Louvain, Peeters), Francis Gandon, après une longue et passionnante étude, a reproduit en fac-similé de nombreuses pages des manuscrits de Saussure. L’ouvrage est cité par l’indication : Gandon, 2003, suivie du numéro de la page.
En 2013, sous le titre Anagrammes homériques (Limoges, Lambert-Lucas), Pierre-Yves Testenoire a, selon les termes de Daniele Gambarara dans sa préface, « donné la première édition intégrale d’un grand corpus homogène d’anagrammes de Ferdinand de Saussure ». L’ouvrage est cité par l’indication : Testenoire, 2013a, suivie du numéro de la page. L’indication Testenoire, 2013b, suivie du numéro de la page, renvoie à l’autre ouvrage du même auteur : Ferdinand de Saussure à la recherche des anagrammes.
Recherche sémiologique sur la légende germanique
Signalée par Godel, 1957-1969 : 25-26, puis, avec une citation, p. 28, ensuite par Starobinski, 1971-2009 : 8-9, puis, avec des citations, p. 14-20, cette recherche a été publiée en 1986 dans l’ouvrage suivant : Ferdinand de Saussure, Le leggende germaniche, Scritti scelti e annotati a cura di Anna Marinetti et Marcello Meli, Este, Libreria editrice Zielo. Les citations sont situées par l’indication : Saussure, 1986, suivie du numéro de la page.
Indications pratiques
Pour la commodité du lecteur, je me suis décidé à prendre les deux partis suivants :
–Les références bibliographiques des textes cités ont été données à la fin de chaque chapitre.
–Dans ces références bibliographiques, les indications relatives aux textes de Saussure qui viennent d’être énumérés n’ont pas
été répétées. C’est à ces indications que le lecteur se reportera en cas de difficulté.
Les neuf chapitres qui constituent cet ouvrage sont le résultat de la refonte et de l’actualisation de neuf textes préalablement publiés dans des revues ou ouvrages collectifs. Les éditeurs de ces publications nous ont aimablement donné l’autorisation de donner à ces textes une seconde manifestation dans Saussure retrouvé. Nous les en remercions vivement. Les références de chacune de ces publications précédentes ont été données dans une note dont l’appel suit le titre du chapitre concerné.
1 Mais la préface des deux éditeurs est datée de « Genève, juillet 1915 ». Le travail était donc sans doute terminé dès cette date. Le livre n’a cependant été livré au public qu’en 1916, date qui est indiquée sur la page de titre.
2 C’est dans une « Modeste contribution à la tâche du dénombrement des Saussure », in Sémiotique, phénoménologie, discours, Hommage à Jean-Claude Coquet, p. 53, que j’ai formulé cette remarque, sous une forme légèrement différente.
3 C’est en 2002 que furent publiés, par Simon Bouquet et Rudolf Engler, les Écrits de linguistique générale. Il fallut attendre 2011 pour disposer, grâce au volume Science du langage. De la douvle essence du langage, publié par René Amacker, d’une édition irréprochable de ceux des textes de Saussure qui n’avaient pas préalablement été publiés par Engler dans son Édition critique du CLG.
4 La première séance de ce Cours de l’année universitaire 1906-1907 ne se tint cependant que le 16 janvier 1907.
5 Le premier à avoir osé l’adjectif est sans doute Jakobson : dans son cours au Collège de France en 1972, il se laisse aller à « dire, sans blague, que ce texte a été un texte apocryphe ». François Rastier lui emboîte le pas, rechargeant (sans le savoir ?) le mot de ses antiques connotations bibliques. C’est en 2003 qu’il en vient sans barguigner à décréter que « si dogme il y a, il se trouve dans un apocryphe, le Cours de linguistique générale, qui n’énonce son propos qu’en l’affaiblissant. Qu’ils les instaurent ou les contestent, les dogmes en effet sont l’œuvre des disciples et non des maîtres » (« Le silence de Saussure ou l’ontologie refusée », L’Herne. Saussure, p. 23). Est-il utile de rappeler que Saussure refusait la qualité de « maître » ? « Vous voulez bien m’appeler votre maître, et je serais bien flatté d’avoir mérité ce titre en quoi que ce soit » : c’est ce qu’il écrit avec une très bienveillante énergie à Antoine Meillet, dans le post-scriptum de sa lettre du 4 janvier 1894, qui sera citée plus bas. Mais Rastier ne fut pas le dernier à parler d’apocryphisme. Après Simon Bouquet, un peu plus timide – il affecte l’adjectif d’un prudent point d’interrogation – Jacques Philippe Saint-Gérand reprend énergiquement la déjà vieille antienne : en 2013, il allègue « l’édition d’un Cours (apocryphe) de linguistique générale » (Questions de communication, 2013, 23 : 423-425).
6 La remarque a été formulée par Jean-Claude Milner à la page 16 de son « Retour à Saussure » – je ne suis donc pas le premier à effectuer un tel « retour » –, chapitre initial de son Périple structural.
7 À quelques détails près, dont la pagination, modifiée en 1922 dans la 2e édition, et restée inchangée depuis.
8 Sur « les blancs des manuscrits saussuriens », on lira l’article ainsi intitulé, publié par Claudine Normand dans Allegro ma non troppo, 2006, p. 79-112. À vrai dire, les plages blanches sont également très fréquentes dans les fragments des Leggende Germaniche (Saussure 1986) qui abordent les problèmes d’un point de vue sémiologique. Inversement, elles sont à peu près absentes dans la recherche sur les anagrammes (Starobinski, 1971-2009, Gandon, 2002 et Testenoire 2013a) : l’écriture de ces interminables relevés de mots dans des vers inlassablement recopiés est presque toujours soignée, presque calligraphiée, sans trace d’hésitation ni de remords.
9 Cette formule vient de Lacan, dans les Écrits (1966, p. 388). Je précise qu’elle ne vise en rien Saussure : c’est une métaphore qui image le sort de la castration quand, soumise à la Verwerfung, elle réapparaît périodiquement dans le réel.