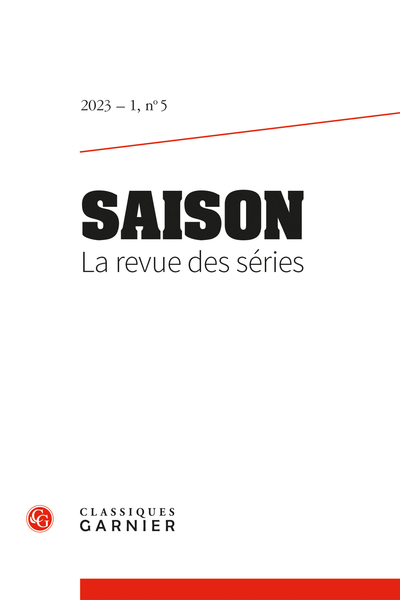
Éditorial Le sériephile et son alien
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Saison. La revue des séries
2023 – 1, n° 5. varia - Auteur : Taïeb (Emmanuel)
- Pages : 9 à 12
- Revue : Saison. La revue des séries
- Thème CLIL : 3652 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Actualités, Reportages -- Média, Télévision, Presse, Radio, Edition, Internet
- EAN : 9782406150756
- ISBN : 978-2-406-15075-6
- ISSN : 2780-0377
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15075-6.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 26/07/2023
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
ÉDITORIAL
Le sériephile et son alien
Stupeur et tremblements : la librairie de la Cinémathèque française ne possède pas de rayon livres sur les séries. Çà et là, dispersés, quelques ouvrages seulement pourront parler au sériephile. Alors même qu’il peut ne faire qu’un avec le cinéphile, habiter la même grammaire narrative, la même mise en scène et les mêmes récits. L’honnêteté invite à dire que dans nombre de librairies généralistes, les étagères dédiées au cinéma, à la culture ou à la « pop culture » sont souvent faméliques ; cannibalisées par les livres de fiction et leurs événements factices, comme la « rentrée littéraire ». Le fossé est donc étonnant entre l’insistance des médias autour du « phénomène des séries », l’attente que certaines d’entre elles suscitent, les enjeux financiers et de production qu’elles charrient pour les chaînes et les plateformes, et le plus faible écho qu’elles rencontrent dès qu’elles quittent leur médium originel. Aussi massives dans leur diffusion et aussi anciennes que la télévision – même si elles s’en sont affranchies – on ne peut plus sérieusement dire que les séries soient de « nouvelles entrantes » sur la scène audiovisuelle. Et dans leur sororité avec le cinéma, on voit bien, dans le cas américain, comment elles ont pu devenir un nouvel Hollywood, attirant des réalisateurs et des réalisatrices désireux de construire plus ou moins librement des récits et des œuvres de longue durée, ou lassés peut-être d’une production cinématographique qui prête aux seuls super-héros le super-pouvoir de faire revenir les spectateurs dans les salles et d’engranger rapidement des bénéfices.
Assez logiquement, c’est la situation du cinéma post-Covid qui serait à déplorer plutôt que celle des séries, puisque d’une part elles ont un public, ne sont pas soumises à la chronologie des médias, peuvent espérer plusieurs vies en restant dans les catalogues des chaînes – nous avons d’ailleurs plaidé ici même pour leur patrimonialisation ouverte –, et d’autre part elles ont conquis leur place comme forme artistique. La lecture des deux ouvrages que Pierre Langlais a consacrés aux showrunners 10comme aux acteurs et actrices de séries montre à quel point la série est pensée esthétiquement et appréhendée avec tous les outils de l’art par celles et ceux qui la font1. Il en va de même de la série documentaire de Charlotte Blum « The Art of Television » (OCS) sur les réalisateurs et réalisatrices de séries, pour lesquels les enjeux d’écriture et de réalisation sont pleinement cinématographiques, avec des enjeux de temps plus tendus que pour le grand écran.
Les grands studios hollywoodiens jadis, comme aujourd’hui les grandes plateformes de production, ne sont pas peuplés de philanthropes. Quelques décisions artistiquement aberrantes, sans doute financièrement rationnelles, comme l’arrêt subit de séries prometteuses, originales ou subversives au bout d’une ou deux saisons viennent le rappeler régulièrement (sur Netflix, Drôle de Fanny Herrero, créatrice de Dix pour cent, pour prendre un exemple récent d’annulation au bout d’une saison). Même si à l’inverse, les mêmes chaînes peuvent organiser le sauvetage d’autres productions (Designated Survivor, reprise et améliorée par Netflix, pour une ultime saison, ou Cobra Kaï originellement diffusée sur YouTube Red et relancée là aussi par la firme de Los Gatos). Historiquement, l’art essaie d’exister dans la tension permanente entre impératifs de rentabilité et ambitions créatrices ; et les séries n’échappent pas à cette règle.
Or ce sont parfois les séries qui sont évoquées dans le registre de la déploration. Soit dans une perspective élitiste parce qu’il s’agirait d’un sous-genre qui n’existerait que pour affaiblir le cinéma (en majesté), soit dans une perspective critique parce que les séries incarneraient le fast-thinking, le triomphe de la facilité narrative (à coups de cliffhangers pour gogos) et bien sûr le règne néo-libéral de l’argent, où les plateformes, nouvelles majors de la production, donc, fabriquent à la chaîne des « produits », et ne viseraient que le temps de cerveau disponible, l’abonnement et le clic. La forme sérielle n’est donc pas exempte de son investissement militant, prise dans la critique politique générale d’un libéralisme protéiforme.
L’ouvrage du producteur Romain Blondeau, publié dans la collection Libelle du Seuil, qui entend concurrencer la collection Tracts de Gallimard et dire la « vérité » cachée de l’époque, intitulé Netflix, l’aliénation en série est le dernier opus en date de cette dénonciation de l’impérialisme numérique, télévisuel et financier. L’habile nouveauté analytique de cet auteur est d’enrôler dans la critique de Netflix un volet politique qu’on 11ne trouve pas habituellement quand il est question de séries : la « culture start-up » dont Netflix et son patron, Reed Hastings, seraient les parangons trouve sa concrétisation idéologique et politique avec Emmanuel Macron2. Dès lors, le libéralisme issu de l’économie numérique s’incarne dans la passion pour la « destruction créatrice3 » politique d’En Marche et dans la disruption de Netflix. Laquelle est accusée d’avoir rapidement tourné le dos à des séries d’auteurs, comme House of Cards de David Fincher ou Sense8 des sœurs Wachowski, au profit de divertissements grand public comme La Casa de papel. Bref, c’est le moment où Netflix devient TF1, pourrait-on dire, cible un « nouveau marché (…) plus populaire, moins sériephile4 », et vise la consommation sans fin au point d’aliéner ses spectateurs. « Le binge watching que favorise le modèle de diffusion délinéaire de Netflix est une expérience de la mort », écrit même Romain Blondeau5. Une note interne de la plateforme destinée aux scénaristes insiste d’ailleurs sur la nécessité d’avoir des rebondissements en permanence pour maintenir l’intérêt du public. Ce qui fait dire à l’auteur que la variété des thématiques abordées dans les séries n’est qu’un leurre, car seuls comptent les arcs narratifs renouvelés et in fine la victoire d’un « capitalisme attentionnel » qui rive à son écran le spectateur6.
La comparaison de Hastings et de Macron est assez vite oubliée, sauf pour dire que Netflix fait du « en même temps » (c’est-à-dire ici mange à tous les râteliers pour, justement, ne s’aliéner personne), y compris quand ses programmes sont sensibles à la visibilité des minorités et à la violence qui les frappe7. Quoi qu’il choisisse, et même s’il a le sentiment de regarder de la quality TV et des séries qui se confrontent à des sujets politiques et sociaux sensibles, le spectateur netflixien est toujours-déjà aliéné par un récit calibré pour le retenir, et prisonnier d’un algorithme tout aussi aliénant. Là où le cinéphile aurait encore le choix de ne pas aller au cinéma, ou 12d’éviter telle ou telle production, le sériephile, ici étrangement distingué de son glorieux aîné, est d’emblée captif et incapable d’éteindre sa télévision.
Et si c’était plutôt le lanceur d’alerte pessimiste qui se faisait l’alien du sériephile ? Cela fait un moment que le sériephile et son alien cheminent ensemble, mais il faudrait désormais choisir entre l’aliéné et sa mauvaise conscience aliénante. Classiquement, l’ouvrage de Romain Blondeau confond l’industrie des séries et les séries comme formes industrielles, balayant leur dimension artistique et, se focalisant uniquement sur Netflix, comme si les autres modèles de production aux États-Unis mais pas seulement, étaient davantage ou moins vertueux, oublie des œuvres fortes écrites et diffusées sur d’autres plateformes. C’est toujours la même antienne : inquiéter le spectateur de séries sur sa transformation en consommateur et sur son incapacité à être précisément sériephile, c’est-à-dire cultivé, doté d’une mémoire et de préférences, retors, susceptible de choisir ce qu’il regarde et comment il le fait ; réflexif, en somme. Au spectacle des séries, la critique préfère l’alerte et l’évitement.
Là où cette critique rate sa cible tient dans l’ignorance de toute la production analytique, essayiste et académique, autour des séries en Occident. Ne pas présenter ces écrits aux lecteurs c’est faire comme si la forme pamphlétaire était la seule acceptable et disponible quand il s’agit de séries. Autant dire qu’on est très loin du programme de Saison, et de ses déclinaisons (Saison.media, le podcast Intersaison), où la culture sérielle est considérée non seulement comme digne d’intérêt, mais surtout comme le lieu de la transgression, de l’édification pour le plus grand nombre, d’une vraie éducation populaire, comme l’a montré Sandra Laugier. La « vie mode d’emploi », les questions politiques, morales, judiciaires, sentimentales, la place des minorités, les ressorts de la haine, les inquiétudes dystopiques, sont mis en scène et dans le débat public à partir de cette culture. Celle qui ne nécessite aucun prérequis et celle qui promet tous les possibles, parce qu’elle parle de nous8.
Emmanuel Taïeb
1 Langlais Pierre, Créer une série et Incarner une série, Paris, Armand Colin, 2021 & 2022.
2 Blondeau Romain, Netflix, l’aliénation en série, Paris, Seuil, 2022, p. 11.
3 Page 12.
4 Page 17.
5 Page 21.
6 Page 29.
7 Ce qui fait dire à Thomas Sotinel que cette charge contre Netflix procède d’une colère « injuste » : « “Netflix, l’aliénation en série” : un pamphlet contre la plate-forme numérique, lemonde.fr, 15/09/2022. https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/15/netflix-l-alienation-en-serie-un-pamphlet-contre-la-plate-forme-numerique_6141678_3232.html
On verra aussi l’article détaillé de Benjamin Campion sur les stratégies de choix de titres des séries anglophones par Netflix dans ce volume.
8 Mèmeteau Richard, Pop culture. Réflexions sur les industries du rêve et l’invention des identités, Paris, Zones, 2014.