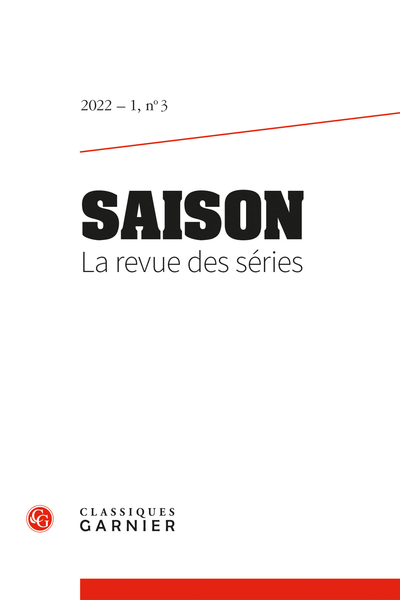
Éditorial Pour une Sériethèque française
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Saison. La revue des séries
2022 – 1, n° 3. varia - Auteur : Taïeb (Emmanuel)
- Pages : 11 à 13
- Revue : Saison. La revue des séries
- Thème CLIL : 3652 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Actualités, Reportages -- Média, Télévision, Presse, Radio, Edition, Internet
- EAN : 9782406132998
- ISBN : 978-2-406-13299-8
- ISSN : 2780-0377
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13299-8.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/06/2022
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
ÉDITORIAL
Pour une Sériethèque française
En matière de séries, les générations qui ont connu la télévision française avec trois chaînes hertziennes seulement ont, par effet de rareté, partagé réellement une expérience spectatorielle. Quelle que soit leur qualité, Starsky et Hutch, La croisière s’amuse, ou Shérif, fais-moi peur, ont été des séries « communes », au sens d’une présence et d’une diffusion rapide dans la culture populaire. Au point d’ailleurs que longtemps la mention du genre séries renvoyait à ce type de productions « grand public » jugées sans intérêt par les tenants d’une cinéphilie où la télévision était vouée aux gémonies. Il est clair que le lien initial des programmes français avec ce style de séries – sans parler de leur diffusion dans le désordre le plus complet – porte une responsabilité majeure dans le long divorce entre la critique et les séries. Alors même que l’offre sérielle s’est étoffée rapidement, d’une part avec Temps-X sur TF1 qui, dès 1979, a exploré le fantastique et la science-fiction1, et d’autre part avec l’arrivée de La Cinq qui a rempli ses programmes de séries (Star Trek, K2000). Clairement, à l’aube des années 1990, l’offre de séries sur les chaînes françaises est pléthorique, mais elle reste de l’ordre du « consommable », sans mémoire, et déjà moins partagée qu’auparavant, car le nombre de chaînes se multiplie. Avec le câble, et en particulier avec Canal Jimmy lancée fin 1990, la possibilité d’un visionnage de niche (les spin-offs de Star Trek), mais aussi de séries américaines emblématiques s’impose (Dream On, Friends, New York Police Blues). Alors qu’en parallèle, au début des années 2000, TF1 remplace l’inusable film du dimanche soir par Les Experts, avec des audiences importantes, qui joueront beaucoup dans la légitimation du genre.
12Aujourd’hui, l’explosion des plateformes de diffusion et des chaînes payantes (qui ringardisent au passage la redevance) produit des effets radicaux sur ce qui est « commun » aux spectateurs. Les propositions sont tellement nombreuses, renouvelées en permanence, qu’il apparaît clairement que les séries regardées ne sont plus du tout les mêmes d’un individu ou d’un groupe à l’autre. Le temps des chaînes hertziennes qui permettaient du partage paraît bien loin, et le marché des séries est tel qu’il existe même des applications pour s’y retrouver. Non seulement il y a profusion de séries, mais en plus l’offre s’avère parfois éphémère. Netflix, par exemple, sort des séries de son catalogue sans que les abonnés soient toujours au fait des questions de droits qui y président. Mad Men a ainsi quitté Netflix pour être reprise par Prime Video, tandis que Vikings s’est arrêté sur Prime en décembre 2021, mais continue d’être visible sur MyCanal et sur Netflix.
De notre point de vue, ce paysage des séries produit deux effets notables. Premièrement, il met en partie à mal l’idée – que nous défendons – d’une démocratisation des idées et des savoirs, voire d’une édification au monde, par les séries. Car si l’offre est bien démocratisée, quoique souvent payante, l’irréductibilité de ce qui est regardé par les uns et les autres affaiblit l’idée d’une culture commune des séries. C’est la forme sérielle qui irrigue la culture populaire, mais chaque œuvre y occupe une place différente, et le partage n’est plus si évident. N’importe quel sondage informel, dans un lieu de sociabilité ou dans un amphi empli d’étudiants, montre que les séries sont vues en fonction de diverses variables sociales, d’âge, de sexe, etc., et qu’une série considérée comme importante ou en tout cas « connue », comme The Wire ou House of Cards, a pu ne jamais atteindre certains publics. Deuxièmement, eu égard aux modes de diffusion actuel, les séries ont une date limite de consommation. Alors que chaque saison, voire chaque épisode, de Game of Thrones suscitaient une attente hors norme, depuis la fin de la série en 2019, elle est moins évoquée et sans doute n’a-t-elle pas été vue par la génération qui n’était pas contemporaine de sa diffusion ; bien qu’elle soit toujours intégralement visible sur OCS. Si les Soprano (1999-2007) a été considérée, ave Oz, comme la série matricielle du modèle HBO et du nouvel âge d’or des séries, le film qui en est issu, Many Saints of Newark, scénarisé par le showrunner de la série David Chase, n’est resté en salle en France que deux semaines en novembre 2021 et n’a touché 13que 26000 spectateurs2. Ce même prequel, où le propre fils de l’acteur James Gandolfini reprend le rôle de son père jeune, aurait-il eu un succès plus marqué s’il avait été décliné en une mini-série ?
En écho au précédent numéro de Saison sur la fin des séries, il faut soulever ici le problème de l’écho d’une série après que sa première diffusion s’est achevée. Son effet est-il nécessairement prisonnier d’un « ici et maintenant », comme peuvent l’être un match de football ou un débat politique ? Il nous semble que le visionnage des séries étant découplé du medium télévision, car on peut les regarder sur n’importe quel écran, elles n’ont pas être réduites à leur visionnage en direct ou en « US+24 ». Comme le cinéma et comme tous les autres arts, les séries appellent une continuité dans le temps, qui est la condition de leur véritable démocratisation. Pas seulement une disponibilité, mais une « présence », assurée à la fois par des passeurs, par des festivals3, par des revues et des institutions. Présence qui acte le fait sériel, ancien et nouveau, son langage cinématographique, et l’économie des images et de la narration, au-delà d’une seule série donnée. Présence qui affirme qu’une série survit à sa diffusion, à son insuccès comme à sa popularité, qu’elle est bien « là », en un lieu plus qu’en un temps de l’immédiateté, et qui en fait un objet artistique.
Pour s’y retrouver dans la jungle des productions sérielles, pour les commenter et les analyser, pour en faire l’histoire et l’esthétique, il faudrait monter une Sériethèque française, un Conservatoire des séries. En décembre 2021, la Cinémathèque française a accueilli Netflix, mais pour un film (Dont Look Up), pas pour une série. L’espace institutionnel et intellectuel est donc libre pour accueillir la mémoire des séries, sans les muséifier et au contraire en les revivifiant, pour les accompagner après la fin de leur diffusion originelle, pour les montrer quand elles ne sont plus disponibles nulle part, et surtout pour en parler encore et encore. Le 8e art attend son écrin.
Emmanuel Taïeb
1 On verra l’entretien en trois parties réalisé par Ioanis Deroide, « Les premiers passeurs de la “culture séries” », Saison.media, 2021, avec Jacques Baudou, Alain Carrazé, Christophe Petit et Martin Winckler. https://www.saison.media/2022/01/03/les-premiers-passeurs-de-la-culture-series-1-3/.
2 Aux États-Unis, avec une sortie simultanée sur HBO Max et en salles, il réalise 8 millions de dollars au box-office. Source : Allociné, https://www.allocine.fr/film/fichefilm-263227/box-office/.
3 Il y en a désormais au moins quatre en France, dont le pionnier et le plus important, Séries Mania.