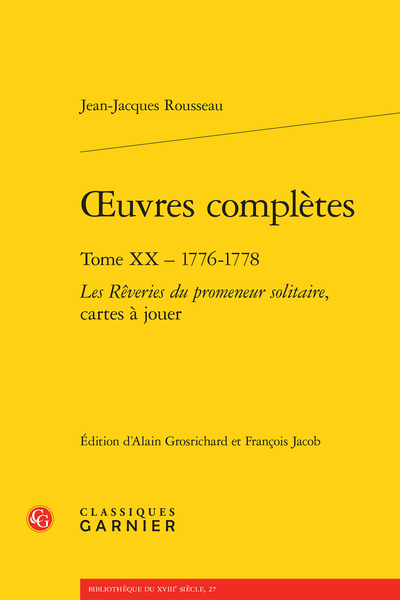
Avant-propos
- Publication type: Book chapter
- Book: Œuvres complètes. Tome XX - 1776-1778. Les Rêveries du promeneur solitaire, cartes à jouer
- Pages: 7 to 12
- Collection: Eighteenth-Century Library, n° 27
- CLIL theme: 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN: 9782812430190
- ISBN: 978-2-8124-3019-0
- ISSN: 2258-3556
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3019-0.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-07-2015
- Language: French
Avant-propos
Si la fin de la période chronologique concernée par ce vingtième et dernier volume des Œuvres complètes (appelé, par une sorte de paradoxe, à paraître le premier) s’impose naturellement au lecteur comme au critique, il n’en va pas de même de son point de départ. Faut-il considérer que l’aventure des Dialogues s’achevant avec la déroute du billet circulaire (à propos duquel Rousseau ne manque pas d’exiger de la comtesse de Saint-Haon, en un autre billet, très sec celui-là, une « réponse catégorique1 »), celle des Rêveries prend dès lors naturellement la suite ? Ce serait faire le jeu de lecteurs pressés qui ne souhaitent voir dans les Rêveries qu’un complément ou une suite des écrits dits « autobiographiques » de Rousseau. Faut-il plutôt prendre comme moment « fondateur » du projet des Rêveries ce vendredi 2 août 1776, date de la mort du prince de Conti, suivant en cela les conclusions de Robert Ricatte qui voyait dans ce funeste accident l’« événement aussi triste qu’imprévu » sur lequel on a, depuis deux cents ans, fait couler beaucoup d’encre ? Ce serait oublier que le débat n’est pas définitivement clos, loin de là, que d’autres hypothèses restent possibles, voire plausibles – nous le verrons dans le présent volume. Ce serait oublier surtout que Rousseau pourrait à dessein n’avoir pas nommé l’événement en question : comment dès lors bâtir une édition chronologique sur un fait non seulement inconnu, mais, et il faudrait s’interroger sur le sens d’une telle occultation, intentionnellement voilé ? Peut-on alors, de guerre lasse, se contenter de parler de l’automne 1776, date du début
de la composition des Rêveries, et renoncer à assigner à cette dernière aventure « littéraire » une origine chronologiquement repérable ?
La question risque fort, si l’on validait ce dernier choix, de devenir plus complexe encore, et présuppose une réflexion éditoriale qui pourrait, à terme, toucher tous les volumes de notre édition chronologique. Que convient-il, en effet, de publier ? Comment justifier de consacrer un plein volume aux seules Rêveries du promeneur solitaire et aux « Cartes à jouer », alors même que Rousseau a produit, dans la même période, plusieurs textes qui font également sens ? Passons sur le fragment « Quiconque sans urgente nécessité… » dont les éditeurs de la Pléiade eux-mêmes concèdent que « son style comme son contenu le rattachent certainement à l’époque où Rousseau rédigeait ses Dialogues2 » : mais le Mémoire écrit au mois de février 17773… n’est-il pas assez explicite quant à sa date de composition ? Et la note rédigée par Rousseau sur le jugement rendu par le tribunal du Châtelet concernant le livre de Delisle de Sales, De la philosophie de la nature, ne date-t-elle pas de mars ou d’avril 1777, c’est-à-dire d’un moment où le Promeneur a déjà commencé à rédiger ses Rêveries ?
C’est ici qu’un choix s’impose entre rigueur chronologique (laquelle eût de même imposé qu’on publiât, dans le présent volume, les fragments de Daphnis et Chloé auquel Rousseau travaille en avril 1777, voire sa lettre à Burney d’octobre 1777 et ses Fragments d’observation sur l’Alceste italien de M. le chevalier Gluck) et rigueur scientifique, lesquelles, loin de se confondre toujours, imposent au contraire un constant exercice de va-et-vient, d’aménagements et de rectifications. Si le Mémoire écrit au mois de février 1777… figure ainsi bel et bien dans le présent volume4, la note sur Delisle de Sales et les fragments musicaux ont été transposés dans le volume précédent : il eût été incompréhensible de ne pas lier les dernières remarques du philosophe sur l’Alceste de Gluck aux écrits qui signalent sa participation, fût-elle discrète, à la Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes. Quant à la lettre à Burney, n’a-t-elle pas sa place au sein d’une correspondance dont le propre est, dans cette édition, d’en retrouver, bien au-delà
de sa vertu informative, ce qu’Anne Chamayou avait jadis appelé la « poésie du quotidien5 » ?
Cette nécessité d’une cohérence thématique au sein même d’un ordonnancement chronologique devient encore plus flagrante avec la pasigraphie créée par Rousseau d’après le système de Linné6 et surtout ses annotations de La Botanique mise à la portée de tout le monde de Nicolas et Geneviève de Nangis Regnault, lesquelles datent de 1777 et 17787. S’il est clair qu’un instrument ad hoc doit permettre au lecteur de reconstituer la trame chronologique du geste « créateur » de Rousseau – et nous travaillons précisément à l’élaboration d’un tel instrument – les textes de l’écrivain n’en doivent pas moins être présentés dans un cadre contextuel et conceptuel que ne peut assumer, de par sa permanente diffraction, la simple rigueur chronologique. Pourquoi, d’ailleurs, ne pas aller jusqu’à interrompre le texte des Rêveries pour intercaler, entre telle ou telle Promenade, un fragment musical ou botanique composé à une période donnée ? Pourquoi ne pas imaginer, dans l’hypothèse où fût possible une telle reconstitution, revenir sur tel extrait d’une Promenade dont les variantes auraient permis d’identifier des dates de composition multiples et, bien évidemment, éloignées les unes des autres ?
Cette question de fond dans le classement des œuvres ou des textes destinés à publication a du moins le mérite, s’agissant de la période de composition des Rêveries du promeneur solitaire, de nous rappeler que Rousseau, rue Plâtrière, n’a rien d’un ermite incapable de la moindre relation sociale, du moindre rapport à une humanité rejetée en bloc et qui, à son tour, se détournerait de lui. C’est ainsi, aux dires de Voltaire, qu’il fête jusqu’à l’Escalade, le 12 décembre 1776, en compagnie de Jean Romilly et, probablement, d’Olivier de Corancez, le fondateur du Journal de Paris : il s’inquiète d’ailleurs, le 9 janvier 1778, de la « brûlure » de Romilly et fait part à son épouse, née Corancez, de sa récente lecture d’un numéro du Jardinier d’Auteuil, dans lequel il est fait mention d’un élevage d’hirondelles. Il est vrai, dans ce cas précis, que le post-scriptum adressé à Élisabeth de Corancez invite à une lecture quasi métaphorique :
L’hirondelle est naturellement familière et confiante ; mais c’est une sottise dont on la punit trop bien pour ne l’en pas corriger. Avec de la patience on l’accoutume encore à vivre dans des appartements fermés, tant qu’elle n’aperçoit pas l’intention de l’y tenir captive. Mais sitôt qu’on abuse de cette confiance, à quoi l’on ne manque jamais, elle la perd pour toujours. Dès lors elle ne mange plus, elle ne cesse de se débattre, et finit par se tuer8.
Les visiteurs, sans être nombreux, sont de même assez fréquents : encore ne connaissons-nous que ceux dont la visite est attestée par un témoignage écrit parvenu jusqu’à nous. Si certains, à l’instar de Moutonnet-Clairfons et Court Dewes fin octobre 1776, sont clairement rejetés, et si Rousseau déclare par ailleurs à François de Chambrier, en octobre 1777, qu’il est « mort au monde » et ne veut plus « voir personne9 », on ne compte pas moins d’une quinzaine de personnes qui défilent, rue Plâtrière, ou que Rousseau rencontre, dans d’autres circonstances, hors de son domicile. Citons Charlotte d’Ormoy et les petits du Soussoi, les seuls à figurer nommément dans le texte des Rêveries, mais encore Brooke Boothby, Grétry, Pierre Prévost, le précepteur des enfants de Mme Delessert, Dupin de Francueil, Aurore de Saxe, chez qui Rousseau va même dîner, Jean-François Ducis, Alexandre Deleyre, Anselme de Belloy, Bernardin de Saint-Pierre, l’abbé Bexon… Sans compter – c’est le cas de le dire – ces anonymes à qui Rousseau prête de l’argent et qui deviennent autant d’obligés : une « dame Saget » le 10 juin 1777, le « ménage Venant » douze jours plus tard, d’autres sans doute, dont nous avons perdu la trace… Il faut enfin, last but not least, ajouter ceux qui joueront un rôle décisif dans les deux derniers mois de la vie de Rousseau, et même après : Moultou bien sûr, qui se voit confier un des deux manuscrits des Confessions, le marquis de Girardin et sa famille, Lebègue de Presle et Magellan, si présents les derniers jours – nous serions presque tentés d’ajouter à cette liste le sculpteur Houdon, déterminant en ce qu’il lui fallait saisir les traits de Jean-Jacques sur le vif, avant que le cadavre fût complètement froid.
Mais c’est ici qu’une dernière question se pose. Si l’on considère que le début de la dixième « Promenade » et l’évocation de Mme de Warens sont les dernières lignes tracées par Rousseau ou, du moins, les dernières de ce que nous serions à bon droit de placer, deux cent cinquante ans plus tard, au rang de ses œuvres, pourquoi ne pas arrêter notre période chronologique au « jour de Pâques fleuries » de l’an 1778 ? Pourquoi Rousseau n’a-t-il pas éprouvé le besoin, une fois établi à Ermenonville, de reprendre la plume ? Et d’ailleurs, cette question se pose-t-elle sous l’angle du seul désir ou de la nécessité d’écrire ? En d’autres termes, que s’est-il passé, ou plus exactement que ne s’est-il pas passé à Ermenonville pour que l’œuvre s’arrête, et la vie après elle, aussi brusquement ? C’est ici, on le voit, qu’une édition chronologique révèle toute sa pertinence : non pas, comme on eût pu d’abord le penser, dans l’écoulement du temps et sa perpétuelle segmentation, évidemment nécessaire sur le plan éditorial, mais au contraire dans son interruption, dans la cassure offerte par ce vide, ce manque. La vie n’a plus alors charge, pour l’éditeur, d’éclairer l’œuvre, mais c’est l’œuvre même qui vient, dans un regard en creux et en profondeur, éclairer la vie. L’écrivain est d’abord un homme, il n’est même que cela : Rousseau n’a eu cesse de le dire, de l’écrire. Il nous faut, dans ce vingtième volume des Œuvres complètes, à la fois le dernier et le premier, le relire.
Remerciements
Ce volume n’aurait pu voir le jour sans le concours de plusieurs institutions et le dévouement d’un certain nombre de personnes auxquelles nous souhaitons adresser nos plus chaleureux remerciements.
Sur le plan institutionnel, nous sommes très reconnaissants à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, et tout particulièrement à M. Thierry Châtelain, son directeur, et Mme Sylvie Béguelin, conservatrice responsable des archives privées et des manuscrits, qui ont mis à notre disposition les manuscrits des Rêveries et ont permis que les images en fussent reproduites dans des conditions optimales.
À la Bibliothèque de Genève, nous aimerions saluer le travail de Mme Barbara Roth, conservatrice en charge des manuscrits, et celui de
toute son équipe ; nous remercions également chaleureusement le service de reproduction et particulièrement Mme Marieke Bopp. Au Centre d’Iconographie Genevoise et à l’Institut et Musée Voltaire, sites excentrés de la Bibliothèque, nous aimerions témoigner notre gratitude à Mmes Christine Falcombello et Catherine Walser, ainsi qu’à MM. Flávio Borda d’Água et Nicolas Schaetti. Nous remercions enfin pour son accueil M. Jean-Marc Vasseur, responsable culturel de l’abbaye royale de Chaalis.
La Société Jean-Jacques Rousseau, l’association PEROU et l’Université Paris Diderot sont intervenues, la dernière très massivement, dans le financement de la recherche afférente à ce projet d’édition. Nous en remercions très vivement les responsables respectifs.
De nombreuses personnes nous ont par ailleurs accompagnés tout au long des trois ans qu’a nécessités la préparation de ce volume. Nous tenons donc à remercier pour leur soutien toujours actif Mme Chiara Gambacorti et MM. Gauthier Ambrus, Kilian Favarger, Denis Goguet, Odon Hurtado, Lucas Lador, Erik Leborgne, Nicolas Morel, Martin Rueff et Manuel Tarabay.
Cette liste ne serait toutefois pas complète si nous n’y faisions figurer Mme Nina Rocipon, chargée d’édition, dont les très hautes compétences, l’énergie communicative et la permanente bienveillance ont permis que ce volume parût aujourd’hui. Qu’elle en soit vivement remerciée.
Ce volume est le résultat d’un travail effectué en commun, pendant quelques années, par les deux éditeurs.
Alain Grosrichard s’avoue néanmoins l’auteur de l’introduction dialoguée et de la quasi totalité des notes explicatives.
François Jacob devra quant à lui répondre de l’avant-propos, de l’établissement du texte et des variantes, de l’histoire éditoriale, de l’esquisse de réception, de l’introduction aux « Cartes à jouer », du lexique et des index.
Pour le reste, c’est-à-dire finalement tout, le lecteur peut s’adresser rue Plâtrière, au cinquième étage.
1 « Je suis fâché de ne pouvoir complaire à Madame la comtesse, mais je ne fais point les honneurs de l’homme qu’elle est curieuse de voir, et jamais il n’a logé chez moi. Le seul moyen d’y être admis de mon aveu pour quiconque m’est inconnu, c’est une réponse catégorique à ce billet. » (Leigh XL, lettre 7084, p. 65). Ce mot, que Ralph Alexander Leigh pense daté du 18 mai 1776, est repris et délayé cinq jours plus tard, avec une légère nuance : « Tout ce que je désire est une réponse à cet article. C’est mal à propos que je la demandais catégorique. Car telle qu’elle soit elle le sera toujours pour moi. » (Leigh XL, lettre 7087, p. 68).
2 Pléiade I, p. 1874. Le fragment est donné dans Pléiade I, p. 1189-1191 et dans Leigh XL, A648, p. 241.
3 On le trouve dans Pléiade I, p. 1187-1189 et dans Leigh XL, A649, p. 243.
4 Voir Sup., p. 675.
5 « Poétique du quotidien dans les dernières de la correspondance de Rousseau », in Rousseau en toutes lettres, E. Francalanza (dir.), Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 321-337.
6 Voir Leigh XL, A659, p. 266.
7 Ibid., lettres 7162 et 7163, p. 209 et p. 212, et A666, p. 304.
8 Rousseau à Élisabeth de Corancez, 9 janvier 1778, Leigh XL, lettre 7152, p. 188.
9 « J’ai vu J.-J. Rousseau, qui m’a remis l’air Che faro senza Euridice, de Bertoni, qui vaut bien celui de Gluck. C’est fini, il ne copie plus de musique, il l’a abandonnée entièrement, en sorte que personne n’a plus en cela de prétexte pour le voir, il m’a paru plus sauvage que jamais, car lui ayant parlé du désir que le comte Visconti aurait de le voir, il m’a rebuté en fronçant le sourcil disant qu’il était mort au monde et qu’il ne voulait voir personne. » Neuchâtel, Archives Chambrier, Journal de François de Chambrier, cité dans Leigh XL, lettre 7137, note ii, p. 163.