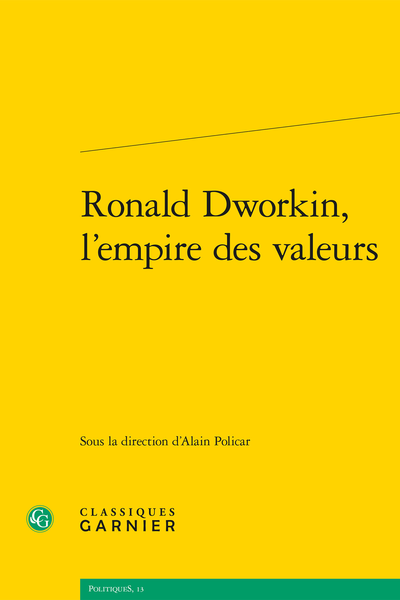
Résumés
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Ronald Dworkin, l’empire des valeurs
- Pages: 277 to 280
- Collection: PoliticS, n° 13
- CLIL theme: 3289 -- SCIENCES POLITIQUES -- Histoire des idées politiques -- Philosophie politique controverses contemporaines
- EAN: 9782406068402
- ISBN: 978-2-406-06840-2
- ISSN: 2260-9903
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-06840-2.p.0277
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-24-2017
- Language: French
Résumés
Serge Champeau, « L’égalité, valeur cardinale du libéralisme de Dworkin »
L’article montre que la théorie de l’égalité de Dworkin nécessite pour être comprise que l’on restitue préalablement son caractère philosophique. Elle possède ce caractère à un triple titre. En raison d’abord du caractère global de son approche. En deuxième lieu, parce qu’elle met en œuvre une méthode spécifique, l’interprétation. En troisième lieu, cette théorie est philosophique par la fin qu’elle s’assigne : la justification de la communauté libérale.
Pascal Solignac, « Le libéralisme de Dworkin. Une question de réussite ou de perfection ? »
L’article montre le lien fort entre unité des valeurs et responsabilité morale. Cette dernière constitue un élément fondamental de la conception dworkinienne de la vie réussie. Dès lors, le libéralisme de Dworkin acquiert une épaisseur telle qu’il n’est pas excessif d’évoquer une composante perfectionniste. Et, en effet, parler de vie réussie oriente la théorie dworkinienne vers un perfectionnisme fondé en nature humaine.
Jean-Cassien Billier, « Théorie du droit et théorie de la démocratie selon Dworkin »
L’article rappelle qu’il est essentiel, pour Dworkin de renoncer à une définition critérielle de la démocratie, celle-ci étant un concept politique dont la signification est essentiellement contestée. L’auteur reproche à ce point de vue d’être à la fois trop déterminé (il ne laisse pas suffisamment ouvertes les portes de l’interprétation) et trop indéterminé (il repose totalement sur le concept d’égalité qui, en tant que concept politique, est lui-même interprétatif).
278Daniel Sabbagh, « Ronald Dworkin et la discrimination positive »
Après avoir montré l’inexistence d’un droit que la discrimination positive viendrait enfreindre, l’article établit que cette inexistence ne suffit pas à justifier l’avantage octroyé aux bénéficiaires des politiques de discrimination positive. Comment alors fonder celles-ci ? Il convient d’évaluer la nature plus ou moins désirable de leurs effets sur la société américaine dans son ensemble. Leur évaluation dépendra donc de leur capacité à réaliser un objectif assimilable à un bien public.
Roberto Merrill, « Ronald Dworkin et la neutralité de l’État »
L’article montre que Dworkin défend une conception de la neutralité compatible avec le perfectionnisme. Cette compatibilité n’est évidemment envisageable que si l’on établit la plausibilité d’un perfectionnisme non coercitif (ou modéré). L’éthique du défi que défend Dworkin, est, à n’en pas douter, une conception du bien. Une telle théorie est-elle compatible avec l’idéal de neutralité ?
Cécile Laborde, « Dworkin, la religion sans Dieu et la liberté religieuse »
Sur la question de la liberté religieuse, l’article considère l’approche dworkinienne dans le cadre plus général des théories égalitaristes de la liberté. Celles-ci reposent sur une analogie entre la liberté religieuse et les autres libertés des sociétés libérales et elles sont ancrées dans les valeurs d’égalité et de non-discrimination. Bien qu’il ne conteste pas les positions libérales substantielles de Dworkin, l’article considère que ce dernier échoue à les fonder solidement.
Dimitrios Tsarapatsanis, « Avortement et euthanasie dans Life’s Dominion »
L’article s’intéresse à la problématique de l’indépendance éthique. Néanmoins, avec l’avortement et l’euthanasie, il ne se limite pas à l’éthique individuelle, mais pose également la question de la justice politique. C’est donc également une interrogation sur la neutralité de l’État : dans quelles conditions, est-il permis d’utiliser la contrainte ainsi que d’autres moyens étatiques pour réguler juridiquement les comportements des individus relativement à l’avortement et au suicide assisté ?
279Julie Allard, « La structure indéterminée du droit »
L’article montre que, pour Dworkin, le droit doit se donner le point de vue du juge lui-même, ce qui implique que seul un jugement interprétatif, intérieur au droit, puisse saisir sa validité. C’est la structure indéterminée du droit qui oblige à se référer à des principes, en réalité des valeurs morales, pour l’interpréter. La meilleure décision, du point de vue de la cohérence du droit dans son ensemble, garantit au droit sa validité ultime.
Philippe Raynaud, « Les règles et les principes »
L’article restitue la cohérence de la théorie dworkinienne et son adaptation au monde des démocraties contemporaines. Cette conceptualisation a l’avantage de refléter fidèlement le point de vue du juge dont l’autorité est mieux garantie s’il s’appuie sur des principes supérieurs aux règles juridiques. L’article reste circonspect sur la portée de la critique dworkinienne du positivisme juridique.
Michel Troper, « Le positivisme et la science du droit »
L’article définit le positivisme comme une tentative de construire une science du droit sur le modèle des sciences empiriques. Or ces dernières ne prescrivent pas et se limitent à décrire leur objet. Mais, bien entendu, cela ne remet pas en cause la légitimité de la morale à dire s’il faut ou non obéir aux règles juridiques. Dès lors, la séparation implique que le droit ne peut pas être juridiquement obligatoire, aucune norme juridique n’existe pouvant fonder ce caractère obligatoire.
Julie Allard, « Dworkin est-il kantien ? »
L’article évoque la « philosophie judiciaire » de Dworkin, c’est-à-dire une philosophie de la mise en œuvre du droit par les juges. Il dégage l’intérêt de rapprocher la philosophie judiciaire de Dworkin du concept kantien de jugement réfléchissant. La conceptualisation dworkinienne se construit à partir de l’interprétation des cas difficiles, objet central de l’affrontement entre Hart et lui, notamment à propos de l’existence d’un pouvoir discrétionnaire du juge.
280Jean-Marc Tétaz, « Vérité et interprétation »
Comment comprendre la tension entre les affirmations de Dworkin en faveur de l’indépendance radicale de la vérité des valeurs et celles qui semblent plaider pour leur dépendance à l’égard des convictions des individus et des stratégies d’argumentation par lesquelles elles s’expriment. En d’autres termes, Dworkin adhère-t-il au réalisme épistémologique ou à l’antiréalisme épistémologique ? L’auteur passe en revue les différentes variétés de réalisme et d’antiréalisme.
Bernard Reber, « Dworkin est-il un réaliste moral et un adversaire sérieux du pluralisme moral ? »
L’article situe Dworkin dans le camp du réalisme, même s’il s’agit d’un réalisme localiste et minimaliste. L’article propose une cartographie du paysage des positions en matière de philosophie morale. Il insiste sur le caractère lacunaire de l’analyse dworkinienne de la diversité des réalismes moraux et sur son ancrage profondément antinaturaliste. Il convient donc de se demander si Dworkin, qui revendique l’indépendance de la sphère axiologique, ne serait pas fondamentalement dualiste.
Charles Larmore, « Les failles du holisme »
L’article examine l’argumentation de Dworkin contre le réalisme et se demande comment nous pouvons rendre nos jugements moraux vrais ou faux. Savoir en quoi consiste la vérité de ces derniers est bien, contrairement à ce que pense Dworkin, une question méta-éthique. Dans la mesure où nous recherchons la vérité, il n’est guère cohérent de nier que les opinions morales peuvent être expliquées causalement par leur vérité. Peut-on, en outre, garantir l’objectivité tout en rejetant les objets ?