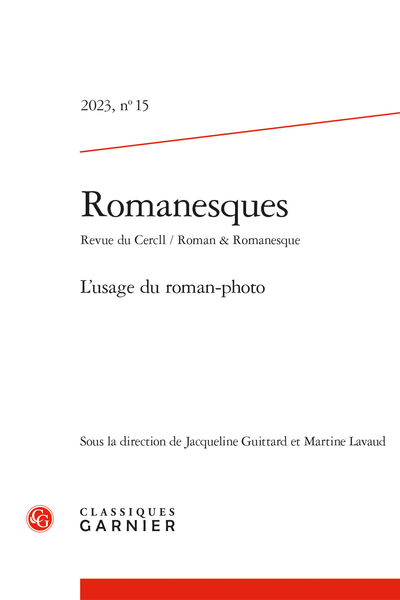
Foreword
- Publication type: Journal article
- Journal: Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque
2023, n° 15. L’usage du roman-photo - Authors: Reffait (Christophe), Adler (Aurélie)
- Abstract: This issue on the photo-novel was a necessary choice for a journal concerned with the romanesque. It is at once concise and panoramic, in that it analyzes the semiological particularities of the photo-novel with regard to other visual arts as well as its history and associated cultural practices.
- Pages: 11 to 12
- Journal: Romanesques (Fictions)
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406150770
- ISBN: 978-2-406-15077-0
- ISSN: 2271-7242
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15077-0.p.0011
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-26-2023
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: photo-novel, cultural studies, semiology, cinema, photography, comics
AVANT-PROPOS
Le présent numéro de Romanesques consacré au roman-photo s’inscrit à plusieurs égards dans la ligne éditoriale et la logique institutionnelle de la revue ces dernières années. Comme le numéro du printemps 2021 dirigé par Gaëlle Debeaux et Charline Pluvinet sur Numérique et romanesque, il explore une définition transmédiatique du romanesque, mais en s’enracinant dans la problématique dix-neuviémiste du feuilleton. Comme le numéro du printemps 2020 sur Littérature de jeunesse et romanesque, dirigé par Anne Besson et Francis Marcoin, il témoigne de la complémentarité, sans redondance, des intérêts du laboratoire « Textes et Cultures » de l’Université d’Artois et de l’équipe « Roman et romanesque » du Centre d’Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires de l’Université de Picardie – Jules Verne. En effet, à l’instar du numéro d’automne 2021 Jeu vidéo et romanesque dirigé par Isabelle Hautbout et Sébastien Wit, le présent numéro est le produit d’un séminaire doctoral commun aux deux universités qui s’est déroulé de janvier à juin 2021, et qui était cette fois co-dirigé par Amiens et Arras.
Martine Lavaud et Jacqueline Guittard, qui avaient d’abord intitulé ce séminaire « De la culture à la sous-culture : ce que le roman-photo fait de la littérature », composent ici, à partir des communications recueillies et de contributions supplémentaires, un ensemble dont le titre plus large traduit la richesse. En effet, concentré sur le discours de critiques ou d’acteurs éminents du champ, ce dossier agile et pénétrant parvient aussi bien à penser la définition sémiologique de l’objet roman-photo (en interrogeant son rapport au roman, au cinéma, à la photographie, à la bande dessinée) qu’à en considérer les aspects culturels et pragmatiques, mais aussi les conditions de production. La revue s’enrichit ainsi d’un dossier qui embrasse la question du romanesque (hors du roman) dans sa plus belle extension : le romanesque « au sens le plus désuet, et le plus “dramatique” que l’on puisse donner à ce terme », écrit Danièle Méaux ; le romanesque tel que l’envisageait Hubert Serra, dont l’autobiographie 12est citée par Martine Lavaud ; le romanesque tel que le concevait Barthes, auquel Jacqueline Guittard consacre son article… Les entretiens qu’ont menés les deux directrices du dossier montrent parfaitement l’empan de la réflexion, puisqu’ils envisagent aussi bien le roman-photo comme objet stéréotypé passible de détournements, que la rencontre la plus exigeante qu’on puisse concevoir entre scénario et photographie.
Comme il est d’usage dans les numéros de printemps de la revue, ce dossier et les entretiens qui lui sont afférents sont précédés de deux articles de varia qui envisagent la notion de romanesque à partir de corpus tout à fait différents. Produit d’un échange nourri avec Arnaud Bernadet, le premier article sur Michel Butor interroge, notamment à partir de Mobile (1962), l’évolution du roman vers un objet textuel posant, outre la question de l’épique, la question même de la phrase et de la polyphonie. Produit de la manipulation d’un corpus romanesque large et varié, l’article de Marianne Albertan-Coppola interroge la valeur d’un segment narratif type du roman du xviiie siècle.
Christophe Reffait
et Aurélie Adler
Équipe « Roman & romanesque »
CERCCL, Université de Picardie – Jules Verne