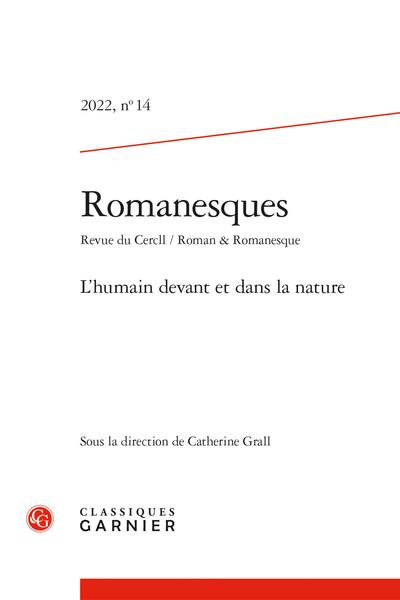
Foreword
- Publication type: Journal article
- Journal: Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque
2022, n° 14. L’humain devant et dans la nature - Author: Adler (Aurélie)
- Pages: 11 to 12
- Journal: Romanesques (Fictions)
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406133216
- ISBN: 978-2-406-13321-6
- ISSN: 2271-7242
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13321-6.p.0011
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-29-2022
- Periodicity: Biannual
- Language: French
AVANT-PROPOS
Coordonné par notre collègue Catherine Grall, spécialiste de littérature générale et comparée, membre de l’équipe « Roman & romanesque » et responsable de l’axe « Littératures et cultures du vivant » du laboratoire Cercll à l’Université de Picardie – Jules Verne, ce numéro de la revue Romanesques entend poursuivre la réflexion très contemporaine sur « l’humain devant et dans la nature » en interrogeant « les écritures de la situation critique » suivant une perspective pluriséculaire et selon des corpus de littératures francophones et étrangères1. La richesse d’un tel dossier, dont l’introduction de Catherine Grall donne une idée2, tient à la diversité des approches retenues pour étudier les rapports au vivant. Si les approches philosophiques et épistémocritiques permettent d’envisager la façon dont sont pensés de façon contrastée les liens entre l’humain et la nature du xviie siècle au xxie siècle, les approches littéraires, empruntant notamment à l’écopoétique ou à la zoopoétique, montrent à quel point les imaginaires de la nature et de l’environnement, tels qu’ils sont mobilisés et réinventés par les romanciers, chevillent étroitement le questionnement formel au débat d’ordre éthique et politique quant à la responsabilité de l’humain, et plus modestement (?) des écrivains et de leurs lecteurs, face à la crise écologique contemporaine. Si certains articles du dossier mettent l’accent sur l’engagement écologique des romanciers contemporains, les entretiens menés par Catherine Grall avec le romancier Antoine Volodine et avec Pierre Schoentjes, professeur à l’université de Gand et spécialiste d’écopoétique, affirment, pour leur part, l’autonomie de la littérature au regard des discours militants.
Suivant l’usage de notre revue, ce dossier est précédé de deux articles liminaires de varia, rubrique dédiée plus spécifiquement à la réflexion sur la catégorie du « romanesque ». Ces contributions, issues des séances 12du séminaire « Modernité et antimodernité du libéralisme romanesque » (2018-2020) et du séminaire « Ce que l’enquête fait au romanesque » (2021-2022), explorent à nouveaux frais des corpus familiers aux membres de l’équipe « Roman & romanesque » : Walter Benjamin et Jules Verne.
C’est en effet « Le Narrateur » de Walter Benjamin, qu’étudie notre collègue Carlo Arcuri, dans la perspective ouverte par sa précédente contribution à la rubrique varia sur « l’éthos dans La Théorie du roman de Georg Lukács3 ». Revenant sur le défaut de transmission qui caractérise, selon Benjamin, le roman « à l’époque de l’individu désocialisé et de la finitude », Carlo Arcuri montre comment Benjamin insiste a contrario sur l’oralité du conte. En reprenant la conception de l’épos comme Ur-genre, caractérisé par l’interchangeabilité des rôles entre le conteur et son auditoire, Benjamin œuvre à un décloisonnement entre domaine esthétique et vie quotidienne et renoue, ce faisant, avec le projet initial de La Théorie du roman de Lukács.
Dans « Enquête sur le Danube. Verne père et fils et le paradigme indiciaire », Christophe Reffait met en évidence le rapport « antiromanesque » que Jules Verne entretient avec le genre policier en s’appuyant sur une analyse approfondie du Beau Danube jaune, écrit par Jules Verne, puis remanié par Michel Verne pour devenir Le Pilote du Danube. Outre des écarts scénariques significatifs, ces deux romans investissent le paradigme indiciaire et jouent du soupçon de manière fondamentalement différente. Alors que Michel semble s’efforcer de satisfaire les conventions thématiques du genre policier, Jules Verne les infléchit ironiquement, instaurant une écriture du soupçon qui gomme de façon savoureuse la distinction entre indices et effets de réel, pour reprendre l’analyse, faite par Jacques Dubois, du roman policier arrivé à sa maturité.
Aurélie Adler
Université de Picardie – Jules Verne
Axe « Roman & romanesque »
1 Catherine Grall a précédemment coordonné le numéro de la revue sur « Le roman français vu de l’étranger » (Romanesques no 9, Classiques Garnier, 2017).
2 Voir infra, p. 55 à 59.
3 « Éthologie épique, éthique romanesque ? Grandeur et décadence dans La Théorie du roman de Georg Lukács » dans Aurélie Adler et Anne Coudreuse (dir.), « Romanesques et écrits personnels : attraction, hybridation, résistance (xviie-xxie siècles) », Romanesques no 11, Classiques Garnier, 2019, p. 43-57. Carlo Arcuri a aussi coordonné avec Andréas Pfersmann le numéro de la revue consacré au centenaire du la Théorie du roman de Georg Lukács (Romanesques no 8, Classiques Garnier, 2016).