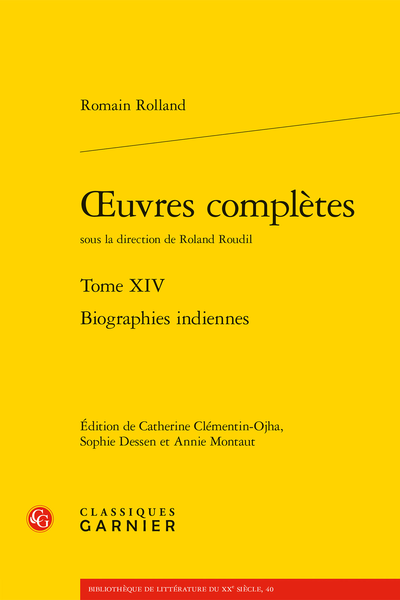
Glossaire
- Publication type: Book chapter
- Book: Œuvres complètes. Tome XIV. Biographies indiennes
- Pages: 815 to 836
- Collection: Library of Twentieth-Century Literature, n° 40
- CLIL theme: 3436 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques
- EAN: 9782406128748
- ISBN: 978-2-406-12874-8
- ISSN: 2258-8833
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12874-8.p.0815
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-03-2022
- Language: French
GLOSSAIRE
Note sur l’orthographe
des termes indiens
Tous les termes indiens, ceux des divinités inclus, sont présentés dans l’orthographe adoptée par Rolland, sans signes diacritiques, puis translittérés selon les normes en vigueur pour le sanskrit. Mais on a gardé l’orthographe indienne anglicisée pour les noms de lieux et les noms propres.
Le cas échéant, les normes de translittération du sanskrit sont adaptées pour rendre compte de la prononciation du gujarati, hindi, bengali ou d’autres langues parlées. Ainsi on ne trouvera pas Brāhma-samāja, translitération fidèle à la graphie originelle, mais Brāhmo Samāj, correspondant à la prononciation bengalie et à l’usage courant. Par convention, on ne met pas la marque française du pluriel aux mots indiens translitérés. En outre quelques spécificités du sanskrit doivent être signalées : les termes jñānin, yogin, sannyāsin deviennent au nominatif jñānī, yogī et sannyāsī ; le terme karman a pour nominatif karma. Rolland utilise tantôt l’une, tantôt l’autre orthographe.
Indications pour la prononciation
des termes indiens
|
ā, ī |
la voyelle correspondante allongée |
|
u, ū |
ou |
|
ṛ |
ri |
|
g |
toujours sonore (gītā se prononce guita) |
|
s |
toujours sourd (sannyāsin se prononce sannyaçine) |
|
ṇ, ḍ, ṭ |
les consonnes correspondantes prononcées en mettant la langue au palais |
|
ṅ |
nasalisation devant une consonne gutturale |
|
ś |
sh |
|
ṣ |
sh prononcé en mettant la langue au palais |
Advaita (sanskrit, m., « non-dualisme ») – École du vedānta fondé par Shankara.
Advaitisme – Substantif français formé sur advaita.
Akali (pendjabi, akālī, dévot de akāla, l’Être au-delà de la mort, c’est-à-dire Dieu) – Membre du Parti politico-religieux pour la défense et la réforme des temples sikhs, les gurudwaras. Les Akalis soutiennent le mouvement pour l’indépendance de l’Inde et participent à la non-coopération.
Ahimsâ (sanskrit ahiṃsā, f., « abstention de la violence ») – Non-violence. Rolland, qui rend l’expression par « ne pas faire de mal », et, à juste titre, évoque à son sujet Gandhi, l’associe au respect de Ramakrishna pour toutes les formes du vivant.
Alumbazar (Alambazar) – Proche banlieue de Kolkata (Calcutta). Entre 1892 et début 1898, le siège du deuxième monastère de la Ramakrishna Mission.
Allahabad – Ville de pèlerinage hindou de l’Inde du Nord située au confluent du Gange et de la Yamuna. Aujourd’hui Prayagraj.
Amarnath – Lieu de pèlerinage à Śiva situé dans les montagnes de l’Himalaya au Cachemire. Vivekananda fut profondément bouleversé par ce long et périlleux pèlerinage effectué en été 1898, comme le montre Rolland en s’inspirant du récit détaillé de Nivedita qui l’accompagnait.
Anna (hindustani, annā) – Unité de monnaie officiellement utilisée en Inde et au Pakistan jusqu’en 1957. Il y a seize anna dans une roupie.
Arjuna (sanskrit, adj. « blanc, brillant ») – L’un des principaux héros du Mahābhārata, il reçoit l’enseignement de Kṛṣṇa dans la Bhagavad-Gītā.
Arya (sanskrit ārya, m., « noble, honorable, homme de distinction ») – Dans le Veda, terme d’auto-désignation ethnique des membres de la société védique qui parlent le sanskrit et suivent les bonnes règles de conduite, puis, dans la littérature normative ultérieure, des membres des trois catégories héréditaires (varṇa) supérieures de la société brahmanique. Ārya est réinterprété au xixe siècle dans le sens de peuple, voire de race, pour promouvoir l’idée d’une identité nationale indienne pluri-séculaire reposant sur la culture sanskrite et magnifier le passé en Âge d’or. Dayananda Sarasvati fonde en 1875 la Société des Ārya (Ārya Samāj) pour rétablir la pure religion du Veda. Rolland emploie le terme ārya dans le sens que lui donne l’Ārya Samāj. Il lui substitue aryen quand, à propos du séminaire (Gurukul) de l’Ārya Samāj situé à Kangri (près de Haridwar), il écrit : « On veut y reformer le caractère aryen, la grande culture philosophique et littéraire hindoue, vivifiée par l’énergie morale. » (VR, p. 399).
Arya Samaj (composé moderne, du sanskrit ārya « noble » et samāja, « société ») – Société des Ārya. Mouvement religieux fondé à Bombay en 1875 par le brahmane gujarati Dayananda Sarasvati. Le mouvement qui combine la modernité (inséparable de la présence coloniale) et une interprétation valorisante du passé de l’Inde connaît un succès immédiat parmi les castes commerçantes qui monopolisent les nouvelles professions libérales introduites par les Britanniques. Les Aryasamajistes 817promeuvent une forme d’hindouisme expurgée des croyances et pratiques « récentes » qui ne se trouvent pas dans le Veda, notamment celles qu’enseignent les purāṇa, et prônent des réformes sociales radicales (droits des femmes et des castes inférieures). Plusieurs d’entre eux sont poursuivis par le gouvernement britannique parce qu’ils participent au mouvement anti-colonial. Lajpat Rai, sur l’étude duquel Rolland fonde sa présentation, paie de sa vie son engagement : il décède en 1928 des suites des violences policières dont il est victime lors d’une manifestation.
Aryen – Apparue dans les travaux des savants orientalistes qui, au xixe siècle, découvrent la parenté du sanskrit et des langues indo-européennes, cette forme francisée du sanskrit ārya est au fondement d’une vision raciste du monde que théorisent différents penseurs. Peu d’intellectuels occidentaux la remettent en cause avant les conséquences dramatiques de son appropriation par les Nazis. Dans cette perception, les Occidentaux et les Indiens appartiennent à la même grande famille, ou comme l’écrit Rolland ont « de grands ancêtres communs » (VV, p. 719). Quoiqu’en 1926 lors d’un échange avec Tagore Rolland se félicite que le « principe de l’égalité des races » ait toujours prévalu en Occident (JI, p. 124), il se fait plus d’une fois l’écho de l’utilisation courante en son temps d’« aryen » comme catégorie raciale. Il écrit ainsi de Jawaharlal Nehru : « De tous les Indiens que j’ai vus, il a le type le plus européen […] C’est qu’il est de l’Inde du Nord – originaire du Kashmir – bien plus près de la souche aryenne. » (JI, p. 105). Quand il revoit Nehru en octobre en compagnie de sa sœur et de son beau-frère P. S. Pandit, il relève que ce dernier « professe la théorie (qui est proche de la mienne) qu’entre les Aryens de l’Inde (il dit “les brahmanes” – il en est un, comme sa femme et Nehru [note ingénument Rolland, qui semble ignorer la règle de l’endogamie de la société des castes !] et les Européens, il n’y a qu’une différence de langue et de climat, nullement de tempérament et de civilisation […]. Ils sont de même souche. – Au contraire (et nous sommes d’accord), ils se sentent différents du monde arabe, afghan, etc. comme, en leur propre pays, des races dravidiennes. » (JI, p. 176). Quelques années auparavant, Tagore lui était apparu comme un « pur aryen » (avril 1921, JI, p. 20). Rolland a non seulement recours à l’adjectif pour caractériser l’apparence physique de ses interlocuteurs indiens, il se l’applique aussi à lui-même. Ainsi en avril 1922, Kalidas Nag lui ayant dit avoir retrouvé dans le dialogue métaphysique du Buisson Ardent de son Jean Christophe « presque textuellement la pensée et l’expression des vieux hymnes védiques à Vishnou et à Sîva […] », il commente : « Je suis certainement le dernier rejeton de l’avant-garde Aryane, venue des hauts plateaux d’Asie, – et perdue maintenant parmi les races négroïde et sémitisées d’Occident. » (JI, p. 30).
Ashram (sanskrit āśrama, m.) Le mot désigne à l’origine un lieu d’ermitage où se retirait un sage pour rechercher la solitude et achever sa formation religieuse. Il renvoie à l’époque moderne à l’institution où des élèves 818viennent suivre l’enseignement d’un maître. Gandhi s’inspire en partie de ce modèle pour organiser des lieux de vie communautaire, soumis à des règles de conduite strictes et visant à l’autosuffisance économique.
Âtman (sanskrit ātman, m.) – Le Soi individuel, le principe éternel qui anime l’être empirique ; il est au cœur de toutes les spéculations métaphysiques hindoues. L’une des idées centrales des upaniṣad et du vedānta est que le soi individuel est identique au brahman ou Absolu. Le summum bonum de l’existence est de prendre conscience de cette identité. Celui qui y parvient obtient la délivrance (mukti ou mokṣa). L’ātman ne peut pas être connu par des moyens conventionnels. Selon les upaniṣad il faut procéder par l’élimination graduelle de tout ce qui concerne l’égo mais non lui. L’expression « neti, neti » (pas ceci, pas cela) résume cette approche.
Avatar (sanskrit avātara, m., « descente ») – Manifestation sur terre, sous forme humaine ou animale, d’une divinité, notamment du dieu Viṣṇu, afin de rétablir l’ordre socio-cosmique du dharma. Rolland, qui traduit le terme par « incarnation » (VR, p. 485) évoque à son sujet la notion chrétienne (sans préciser qu’il s’agit de constructions théologiques distinctes) pour affirmer ses propres convictions : « Je n’ai pas à discuter ici, bien entendu, la croyance hindoue en les Avatars. Les croyances ne se discutent point ; et celle-ci est du même ordre que la croyance chrétienne en l’homme-Dieu. Je ne partage ni l’une ni l’autre. » (VR, p. 247).
Avidyâ (sanskrit avidyā, f.) – Nescience, ignorance métaphysique, l’opposé de vidyā. Dans le système de l’advaita vedānta, l’avidyā consiste à surimposer la conscience individuelle sur le Soi ou ātman.
Ayodhya (ayodhyā) – Le lieu de naissance du dieu Rāma et la capitale de son royaume. Plusieurs épisodes du Rāmāyaṇa s’y déroulent.
Bande Mataram (vande mātaram, sanskrit, « je te salue, ô Mère ») – Poème bengali composé par Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894) en 1870 et intégré à son roman Ānandamaṭha (« Le monastère de la Félicité », 1882). Le chant de ses deux premières strophes accompagne toute la lutte anticoloniale. Rabindranath Tagore l’interprète à la session de 1896 de l’Indian National Congress. C’est aujourd’hui le « chant national » de l’Inde (à ne pas confondre avec l’hymne national).
Baranagore (Baranagar) – Proche banlieue de Kolkata (Calcutta). Entre 1886 et 1892, siège du premier monastère de la Ramakrishna Mission.
Baul (bengali bāul, étymologie débattue) – Chanteurs et musiciens mystiques du Bengale. Divisés en plusieurs sous-groupes, les uns se réclamant du vishnouïsme, les autres du soufisme, ils pratiquent souvent l’itinérance. Leur influence sur la culture bengalie populaire est très importante. Tagore se fait l’écho de leurs croyances et pratiques dans The Religion of Man (1931).
Belur – Proche banlieue de Kolkata (Calcutta) située au bord de la rivière Hoogly, un défluent du Gange, face à Baranagar. Siège de la Ramakrishna Mission et du Ramakrishna Math.
Bénarès – Ville de pèlerinage de l’Inde du Nord située sur le Gange.
819Bhadralok (expression moderne forgée sur deux termes sanskrits, bhadra « bon, beau, prospère » et loka « les gens ») – Le terme désigne l’élite sociale hindoue qui a émergé au Bengale à la suite des changements introduits par la colonisation britannique. On range dans cette catégorie les membres des trois castes supérieures des brahmanes (prêtres et lettrés), vaidya (médecins traditionnels) et kāyastha (scribes et fonctionnaires).
Bhagavadgitâ (sanskrit bhagavad-gītā, f., « le chant du Bienheureux ») – Ce poème de 700 vers, composé entre le iiie et ier siècle avant J.-C., est le texte religieux le plus connu de la tradition hindoue. Il a été maintes fois commenté et interprété. Partie intégrante de la grande épopée du Mahābhārata, la Bhagavad-Gītā se situe au livre VI au moment crucial où les armées des Pāṇḍava et des Kaurava sont sur le point de s’affronter. Arjuna, l’un des frères Pāṇḍava, refuse de se battre et s’ouvre de ses doutes à son cousin Kṛṣṇa, qui conduit son char. Ce dernier lui enseigne l’action sans désir comme voie de délivrance (mokṣa), et, s’étant révélé à lui sous sa véritable identité d’avatāra de Viṣṇu, venu sur terre pour restaurer le dharma, l’engage à agir en lui dédiant tous ses actes (karma) par amour pour lui. Arjuna est convaincu qu’il doit accomplir son devoir (dharma) de guerrier et la grande guerre commence. Ce message est considéré comme la charte de la bhakti, la religion d’amour au Dieu personnel. Rolland connaît la Bhagavad-Gītā de longue date, il la citedans le tome VII (Dans la maison) de Jean-Christophe.
Bhagavan (sanskrit bhagavant[nominatif bhagavān], m., « bienheureux ») – Le Seigneur suprême, Dieu.
Bhakta (sanskrit, m.) – Celui qui cherche le salut au moyen de la bhakti.
Bhakti (sanskrit, f., « participation [à la personne suprême] ») – La religion de dévotion personnelle décrite par la Bhagavad-Gītā ; une des voies pour parvenir à la délivrance ; forme dominante de l’hindouisme. Rolland observe à juste titre que le terme français « dévotion », adopté par convention, est insuffisant pour rendre « le sentiment de donation de soi passionnée » de la bhakti (VR, p. 360).
Bhava-Mukha (sanskrit bhāva-mukha, m.) – Par cette expression imagée, qui lui est propre, Ramakrishna désigne l’état de conscience de celui qui se tient à la bouche (mukha) du bhāva (état, condition), c’est-à-dire reste sur le seuil du samādhi. Cet état de conscience est celui du vijñanī.
Brahmacarya (sanskrit, m.) – Désignant à l’origine l’état et le mode de vie ascétique de l’étudiant brahmanique qui se consacre à l’étude du Veda, ce terme connote la chasteté et diverses abstinences.
Brahman (sanskrit, nt) – L’Absolu non différencié et impersonnel des upaniṣad et du vedānta non dualiste. L’ātman lui est identique.
Brahma (sanskrit brahmā, m.) – Un des trois dieux majeurs du panthéon hindou, avec Viṣṇu et Śiva. C’est le dieu créateur, souvent représenté avec quatre têtes et avec un cygne pour monture. Il incarne la notion abstraite de brahman.
Brahmavadin (sanskrit brahmavādin, m., « celui qui expose le Veda ») – Titre 820de la revue en langue anglaise de la Ramakrisna Mission fondée à Madras en septembre 1895 par Alasinga Perumal (1865-1909), un disciple de Vivekananda. Bi-mensuelle (1895-1898) puis mensuelle (1898-1914), elle paraît depuis 1914 sous le titre de Vedanta Kesari (« le lion du vedānta »). Rolland a eu certains de ses articles entre les mains.
Brahmine (sanskrit brāhmaṇa, m.) – Variante de brahmane, plus courant. Membre du premier varṇa de la société brahmanique, seul habilité à enseigner le Veda, et à exercer les fonctions de clerc.
Brahmanisme – Terme utilisé par les indianistes pour désigner l’hindouisme orthodoxe.
Brahmosamaj (composé moderne construit sur brāhman, sanskrit « du brahman » – en composition brāhma[brāhmo correspond à la prononciation bengalie] – et samāja, skt « société »). – La « Société du Brahman » est un mouvement réformiste fondé en 1828 à Calcutta par Ram Mohan Roy pour purifier l’hindouisme de croyances (polythéisme) et pratiques (culte des images) jugées supersticieuses, car contraires à l’enseignement des upaniṣad et du vedānta, et promouvoir des réformes sociales. Les Brahmosamajistes s’opposent au mariage des enfants et à l’immolation des veuves, ils promeuvent l’éducation des filles et des castes inférieures et le remariage des veuves. Le mouvement est réorganisé en 1843 par Debendranath Tagore, le père de Rabindranath, adepte d’un strict monothéisme, puis se divise en 1866 en deux groupes, l’Ādi Brāhmo Samāj (le « Brāhmo Samāj originel », autour de Debendranath Tagore) et le Bhāratīya Brāhmo Samāj (le « Brāhmo Samāj indien »), autour de Keshab Chandra Sen. En 1878, l’orientation de plus en plus mystique et de moins en moins sociale de ce dernier conduit certains de ses disciples à le quitter pour fonder un nouveau mouvement, le Sādharaṇa Brāhmo Samāj (« le Brāhmo Samāj ordinaire », c’est-à-dire général).
Brahmosamajiste – Membre du Brāhmo Samāj.
Brindaban (du sanskrit vṛndāvāna,m. « le bois de vṛndā ») – Depuis le xvie siècle, nom d’une ville de pèlerinage de l’Inde du Nord au bord de la Yamuna (Jamna) ; elle passe pour être bâtie sur le lieu même où la légende krishnaïte situe l’enfance et l’adolescence de Kṛṣṇa et l’épisode de ses amours avec les bouvières (gopī), dont Rādhā.
Çâkta – Voir śākta
Çakti – Voir śakti
Chandala (sanskrit caṇḍāla, m.) – Nom donné dans la littérature normative hindoue à la caste la plus impure de la société. Le terme est souvent employé dans le sens générique d’« intouchable ».
Charkha (gujarati, hindi carkhā, roue, rouet) – Le terme désigne un petit rouet, symbole du mouvement gandhien. Gandhi l’utilise pour promouvoir l’auto-suffisance des Indiens, encouragés à filer eux-mêmes le coton pour rompre la dépendance aux filatures anglaises
Çiva – Voir Śiva.
Çivaïque – Adjectif français fabriqué sur Śiva.
Califat (mouvement du Califat, 821Khilafat Movement) – Mouvement d’émancipation musulman, panislamique, conduit par les frères Ali, né des suites de la Première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres, en mai 1920, qui organise le démembrement de l’empire Ottoman (le sultan de Turquie était le « commandeur des croyants ») conduit à la radicalisation de ce mouvement, qui prône le rétablissement du Califat et le boycott par les musulmans indiens de toutes les institutions britanniques. Sous l’impulsion de Gandhi, le Congrès National Indien se rallie à ce mouvement en septembre 1920. Le mouvement du Califat s’affaiblit et finit par disparaître en 1922 sous l’effet des divisions internes et de l’établissement d’une république laïque en Turquie, qui abolit le rôle de Calife.
Conférence de la Table Ronde. – Entre novembre 1930 et décembre 1932, le Premier Ministre britannique Ramsay Macdonald convoque à Londres trois conférences dites de la Table ronde pour discuter de réformes constitutionnelles en Inde britannique. Gandhi participe à la deuxième Conférence en septembre 1931en tant que représentant du Congrès National Indien. C’est à la suite de ce séjour londonien qu’il rend visite à Rolland chez lui à Villeneuve.
Congrès National Indien (Indian National Congress) – Plusieurs membres britanniques de la Société théosophique, dont l’écossais Allan Octavian Hume, sont à l’origine de la création du Congrès (alors appelé Union nationale indienne) en 1885. Il s’agit alors de réunir des Indiens éduqués pour les faire participer au gouvernement du Raj britannique et créer un espace de dialogue. Le Congrès se réunit tous les ans dans une ville différente, sous la présidence d’un de ses membres. Ses revendications deviennent plus radicales dans les premières années du xxe siècle, notamment après la partition du Bengale en 1905. Deux courants émergent alors : une aile « modérée », menée par Gopal Krishna Gokhale et un courant « extrémiste », mené par Bal Gangadhar Tilak. Gandhi devient une figure importante du Congrès après son retour d’Afrique du Sud en 1915. C’est sous son impulsion que le Congrès s’allie au mouvement pour le Califat des frères Ali et adopte le principe de non-coopération. Sous la présidence de Jawaharlal Nehru, lors de la session de 1929, le Congrès se fixe comme objectif l’indépendance de l’Inde (Purna Swaraj). À partir de 1934, le Congrès participe en tant que parti aux élections provinciales.
Coolie (Probablement du gujarati kūlī, terme qui désigne une caste de la région de Mumbai) – Terme péjoratif désignant les travailleurs agricoles asiatiques.
Dakshineswar – Localité dans la banlieue de Kolkata (Calcutta) située au bord de la rivière Hoogly, un défluent du Gange, face à Baranagar. En 1855 Rani Rasmani y inaugure le temple de la déesse Kālī et en confie le culte à Ramkumar Chattopadhyaya et à son frère cadet Gadadhar, qui prend plus tard le nom de Ramakrishna.
Daridra-Narayana (du sanskrit daridra « pauvre » et Nārāyaṇa, l’un des noms de Viṣṇu) – Par cette expression signifiant « [percevoir] Dieu 822dans [tout] pauvre », qu’il invente, Vivekananda affirme que la sevā des pauvres (les nourrir et les soigner) est un acte religieux, tout aussi pieux que la sevā de Dieu (lui offrir de la nourriture et l’habiller pendant le culte).
Dasyu (sanskrit, m. « esclave ») – Dans le Veda, un ennemi des ārya ; dans l’Ārya Samāj, un impie.
Dharma (sanskrit, m., « loi, justice, bon ordre ») – L’ordre cosmique et l’ensemble des conduites prescrites qui assurent son maintien et celui de la société. De là, le terme prend le sens du « devoir propre » (ou svadharma) de chacun individu – attribué en fonction de sa caste et de son stade de sa vie – et déterminé en dernier ressort par la loi cosmique du karma. Obéir à son svadharma produit des mérites spirituels, s’y soustraire expose au châtiment et à une mauvaise naissance dans la suivante. À partir du xixe siècle, dharma est compris comme « religion », comme, par exemple, dans Brāhmo Dharma, le manuel sur la religion du Brāhmo Samāj rédigé par Debendranath Tagore.
Durga (sanskrit durgā, f., « inaccessible », « dont on s’approche difficilement ») – La Déesse sous l’un de ses aspects les plus guerriers. Au Bengale, lors de la grande fête d’automne de Dasara, elle reçoit un culte spécial (Durgā pūjā), qui culmine dans le sacrifice de boucs (et non de chèvres, comme l’écrit Rolland, sans doute du fait d’une erreur de traduction de l’anglais).
East India Company (« La Compagnie des Indes orientales ») – Compagnie marchande britannique fondée en 1600 et dissoute en 1874. Créée pour assurer le commerce avec l’Inde, elle acquiert peu à peu des possessions territoriales et assume des fonctions militaires pour protéger ses intérêts, notamment en s’affrontant aux autres puissances maritimes européennes. À partir du milieu du xviiie siècle, elle met un terme aux prétentions françaises sur l’Inde et prend le contrôle administratif du Bengale. Après le soulèvement populaire de la révolte des Cipayes (1858), ses possessions territoriales, qu’elle n’a cessé d’accroître, passent sous le contrôle direct de la couronne britannique jusqu’en 1947.
Europe . Revue littéraire fondée en 1923 sous le patronage intellectuel et moral de Romain Rolland. Née sous les auspices du pacifisme, elle se rapproche à la fin des années 1920 du Parti communiste français perçu comme seul rempart contre le fascisme (voir Racine-Furlaud 1993). Font partie de son premier comité de rédaction Georges Duhamel, Charles Vildrac, Luc Durtain, Jean-Richard Bloch et Léon Bazalgette. Ses rédacteurs en chef successifs jusqu’à la Seconde Guerre mondiale sont Albert Crémieux, René Arcos, Jacques Robertfrance, Jean Guéhenno et Jean Cassou.
Fakir (arabe faqīr, m.) – Mot désignant en Inde un ascète soufi.
Gange (du sanskrit Gaṅgā) – Fleuve de l’Inde du Nord qui prend sa source dans l’Himalaya et se jette dans le Golfe du Bengale après avoir traversé l’Inde du Nord.
Gaya – Ville de pèlerinage de l’Inde du Nord située sur le Gange ; les hindous 823y accomplissent des rites en l’honneur de leurs ancêtres sur un site sacré marqué par une empreinte du pied droit de Viṣṇu.
Gayatri (sanskrit gāyatrī, f.) – Formule sacrée tirée du Veda que les brahmanes récitent silencieusement à l’aube et au crépuscule : « Puissions-nous recevoir cette lumière éminente du dieu Savitar [le Soleil] afin qu’elle aiguillonne nos pensées ».
Ghaut (aussi ghat) – Volée de marches qui conduit à une rivière ou à un réservoir d’eau ; les hindous y accomplissent leurs rites.
Gopala (sanskrit gopāla, m., « protecteur de la vache ») – Nom de Kṛṣṇa enfant lorsqu’il séjourne au Brindaban.
Gopi (sanskrit gopī, f.) – Bouvière du Brindaban et compagne de jeux et amante du jeune Kṛṣṇa dans la légende krishnaïte.
Gourou (du sanskrit guru, m., « pesant, important ») – Maître spirituel.
Gouroubhai (bengali guru-bhai, m., composé des termes « maître » et « frère ») – Deux disciples qui ont le même maître sont dits « frères de guru », selon l’usage prévalent dans les groupes initiatiques de désigner par des termes de la parenté réelle les liens spirituels entre les membres.
Gourkha – Terme longtemps utilisé par les Britanniques pour désigner la population népalaise. Ce mot vient du royaume de Gorkha, au centre du Népal, dont l’un des souverains entreprit de conquérir la vallée de Katmandou en 1769, ce qui conduisit à unifier les royaumes himalayens pour constituer le Grand Népal.
Gurudev – Voir gourou. Ce surnom était donné à Rabindranath Tagore.
Hamsa (sanskrit haṃsa, m., « oie sauvage, oiseau migrateur ») – Symbole de l’ātman envisagé comme âme transmigrante qui aspire à la délivrance.
Hanuman (sanskrit hanumant, m.) – Dans l’épopée du Rāmāyaṇa, le dieu singe, vénéré pour sa force et son dévouement. Fidèle allié et grand dévot de Rāma, il retrouve pour lui son épouse Sītā,en sautant d’un grand bond dans l’île de Lanka où elle est retenue captive.
Hari – L’un des noms de Viṣṇu.
Harijan – Hebdomadaire anglais fondé par Gandhi en 1933, pour lutter contre l’intouchabilité. Il parut jusqu’en 1948. Il paraissait aussi en traductions hindie et gujarati.
Hartal (gujarati, hindi hartāḷ, m.) – Fermeture des magasins dans le but de protester. Ce terme est employé par Gandhi pour désigner les grèves générales antibritanniques, avec fermeture totale des lieux de travail.
Ha ṭ ha yoga –Cette forme de yoga qui se rattache à l’ascèse tantrique remonte au xiie siècle. Par des techniques psychophysiologiques, elle vise à contrôler la puissance cosmique de la kuṇḍalinī, à la faire s’élever jusqu’au sommet du crâne en suivant l’axe imaginal de la suṣumnā. Le processus génère de plus en plus de pouvoirs spirituels et surnaturels et culmine dans la délivrance, envisagée comme l’identification avec la divinité.
Hindou – Le terme a été utilisé pour la première fois par les anciens Perses pour désigner les habitants des terres situées au-delà du fleuve Sindhu (l’Indus). Il ne renvoie à une identité religieuse distincte – bien que nébuleuse – que depuis l’époque moderne. Le terme « hindouisme » a été forgé sur cet ethnonyme au xixe siècle.
824Hindu Mahasabha (hindi Akhila Bhāratīya Hindū Mahāsabhā, « Grande assemblée hindoue de l’Inde entière »)–Organisation nationaliste hindoue fondée en 1915 dans le but de protéger les droits de la communauté hindoue. Lala Lajpat Rai et le pandit Madan Mohan Malaviya font partie des membres fondateurs.
India League –Organisation basée en Grande-Bretagne, dont le but était de soutenir le mouvement d’indépendance indien. L’organisation apparaît en 1916 sous le nom de Home Rule for India League et prend le nom d’India League en 1928, sous la direction de Krishna Menon.
Inquilab Zindabad (ourdou inqalāb (révolution) zindābād, « longue vie à la révolution ») –Le poète Maulana Hasrat Mohani est à l’origine de cette expression qui a été adoptée comme slogan de la All India Azad Muslim Conference avant de devenir un des slogans du mouvement d’indépendance de l’Inde.
I ṣṭ a-devatā (sanskrit, m., « divinité d’élection ») – Dans l’usage courant, le terme désigne la divinité du panthéon hindou que l’on choisit personnellement de révérer.
Jain (sanskrit jaina, m., dérivé de jīna « conquérant ») – Nom de la religion fondée au ve siècle avant notre ère par Mahāvīra, le vingt-quatrième et dernier Jīna (ou Tīrthaṅkara). On trouve ses membres surtout au Gujarat et au Karnataka. Quoique distinct de l’hindouisme, le jainisme entretient de nombreuses relations avec lui, notamment avec ses branches vishnouïtes. Il met l’accent sur la non-violence.
Jamna – Voir Yamuna.
Janaka – Roi de Videha [dans l’actuel Bihar] dans le Rāmāyaṇa, père adoptif de Sītā et beau-père de Rāma.
Jiva (sanskrit jīva, m.) – L’âme individuelle, le principe vital qui s’incarne tant que l’être n’est pas délivré de la transmigration.
Jivan-mukti (sanskrit jīvan-mukti, f., « en vie-délivrance ») – L’obtention de son vivant de l’état de délivrance (mukti) définitive de la transmigration. Selon l’advaita vedānta, qui en admet la possibilité, cette condition exceptionnelle signifie l’absorption permanente dans le brahman.
Jñâna (sanskrit jñāna, nt) – Connaissance, gnose. Le moyen de délivrance par excellence selon l’advaita vedānta.
Jñanin (sanskrit jñānin, m.) – Celui qui suit la voie du jñāna. Ramakrishna le compare avec le vijñānin.
Jumna – Voir Yamuna.
Kali (sanskrit, m., nom d’un coup de dé perdant) – Dans les purāṇa, l’Âge Kali, le quatrième et dernier yuga ou ère cosmique, est l’âge dégénéré dans lequel nous vivons ; on le traduit souvent par « âge de fer » en écho à la théorie occidentale classique des âges successifs de l’humanité. Ne pas confondre avec la Déesse Kālī.
Kâlî (sanskrit kālī, f., « noire ») – Nom de l’un des aspects les plus terribles de la Déesse suprême.
Kanyakumari (tamoul kannīyakumārī, « jeune vierge ») – Nom d’une déesse, sœur du dieu Kṛṣṇa, et de la ville à l’extrême pointe du sud de l’Inde ou se situe son temple – Cap Comorin depuis l’époque britannique.
Karma (nominatif du sanskrit karman, nt, « l’action » ; « l’acte rituel ») – Dans 825les plus anciens textes védiques, karman désigne l’acte rituel, notamment les rites sacrificiels prescrits dont l’accomplissement vaut l’obtention du Ciel. Les upaniṣad, textes du védisme tardif, dévalorisent l’activité rituelle et énoncent la loi dite du karman, selon laquelle tous les actes, bons ou mauvais, engendrent des fruits (également karman) dont l’accumulation par l’âme individuelle (jīva) déterminent les re-naissances futures, parfois sur une durée de temps très longue, engendrant d’infinies souffrances. Aussi enseignent-elles que pour échapper à la causalité karmique et sortir de la pénible transmigration (saṃsāra), il faut s’abstenir de produire du karman, il faut renoncer au monde (sannyāsa). Pour la Bhagavad-Gītā toutefois, c’est non à l’acte qu’il faut renoncer mais à son fruit : il convient d’observer les actes obligatoires (nitya-karma) de son dharma (3.35 et 18.47, 18-48) de manière désintéressée et de ne s’abstenir que des actes optionnels (kāmya), lesquels sont suscités par le désir. C’est la voie du karma-yoga. Rolland adopte deux traductions différentes pour karman. Dans la Vie de Ramakrishna, il le définit comme « l’acte, générateur des existences successives » (p. 344). Il signale aussi la croyance hindoue dans le transfert du karman et dans la capacité qu’auraient les saints hommes de prendre sur eux le karman d’autrui, notant que les disciples de Ramakrishna expliquent ainsi le cancer de leur maître. S’il fait bien d’observer à ce propos que la souffrance par procuration est aussi un grand thème du christianisme, il aurait fallu ajouter que pour les hindous le transfert du karman n’a pas seulement pour but de guérir ou de soulager mais surtout d’accélérer la délivrance, soit la sortie définitive de la transmigration. Dans la Vie de Vivekananda, Rolland adopte une autre traduction du terme karman. Il commence par le traduire par « action » (p. 344), puis le rend par « travail », faisant du Karmayoga « la voie à Dieu par le travail ». Ce choix rend difficile la juste interprétation des idées de Vivekananda (voir l’introduction de l’Essai).
Kayastha (kāyastha) – Caste de scribes. Voir kṣatriya.
Khadi (hindi khādī, « tissu en coton grossier ») –Dans le contexte de la désobéissance civile, Gandhi appelle à filer et porter le khadi pour mettre en valeur les produits manufacturés en Inde et rompre la dépendance de l’Inde envers les filatures britanniques.
Kirtan (sanskrit kīrtana, nt, « fait de mentionner, de célébrer ») – Chant dévotionnel à caractère émotionnel pratiqué en groupe.
Koundalini (sanskrit kuṇḍalinī, f. « la lovée ») – L’énergie cosmique présente dans le corps humain. Les techniques tantriques du Haṭha yoga permettent d’éveiller cette puissance dormante à la base de la colonne vertébrale, puis de la faire monter graduellement dans la suṣumnā jusqu’au sahasrāra cakra (« le lotus aux mille pétales ») au sommet du crâne, où elle s’unit à l’énergie universelle.
Krishna (sanskrit kṛṣṇa, m., « noir ») – L’un des dieux les plus populaires du panthéon hindou ; un avatāra de Viṣṇu. Jeune adolescent, il est le divin bouvier du Brindaban, joueur de flûte, amant de la gopī Rādhā ; adulte, 826identifié au Seigneur suprême, il éclaire le prince Arjuna sur son devoir de guerrier dans la Bhagavad-Gītā. Tandis que pour les hindous pieux Kṛṣṇa est un, certains indianistes estiment qu’il résulte de la fusion de plusieurs personnages (héros martiaux et pastoraux) éventuellement associés à de grandes divinités védiques, telles que Viṣṇu et Nārāyaṇa.
Kshatriya (sanskrit kṣatriya, m., « guerrier ») – Membre du deuxième varṇa, ou catégorie sociale héréditaire de la société brahmanique, celui des guerriers et des princes. Le terme apparaît chez Rolland à propos du varṇa de Vivekananda. Quoique né dans une famille de kāyastha, caste (jāti) de scribes, Vivekananda affirme être kṣatriya, comme nombre de kāyastha d’alors, quoique les brahmanes classent traditionnellement leur caste dans le quatrième varṇa des śūdra. Il se dit fier de ses ancêtres kṣatriya (« ma caste, hormis d’autres services rendus dans le passé, a gouverné la moitié de l’Inde pendant des siècles. Si ma caste est laissée de côté, que restera-t-il de la civilisation actuelle de l’Inde ? Au Bengale seul, mon sang leur a fourni leur plus grand philosophe, le plus grand poète, le plus grand historien, le plus grand archéologue, le plus grand prédicateur religieux ; mon sang a fourni à l’Inde le plus grand de ses scientifiques modernes », CW vol. III, Lectures from Colombo to Almora, « My plan of Campaign », début 1897). Il est intéressant de voir Rolland succomber à cette glorification des kṣatriya. Il note ainsi en juillet 1927 le jour de sa rencontre avec le biologiste Jagdis Chandra Bose : « Toutes les réformes héroïques et géniales, qui ont renouvelé l’Inde, sont parties, non des brahmines, mais de grands ksatrias [sic]. Bouddha, pour qui Bose paraît professer une admiration sans bornes, était un Kshatrya [sic]. (Et je ne suis pas sûr que Bose n’en soit pas un.) – Il faut, conclut Bose, que nous reconstituions dans le monde cette classe de kshatrias de l’esprit. » (JI, p. 220). Et encore, lors de la deuxième visite de Bose : « Il est un magnifique représentant de la caste des guerriers, – la même à laquelle appartenait Vivekananda ; (c’est lui-même qui rappelle cette communauté d’origine). » (JI, p. 246). Comme Vivekananda, en effet, Bose est bien kāyastha ; plusieurs disciples de Ramakrishna appartiennent également à cette caste qui, de longue date, occupe d’importantes fonctions administratives. Mais quoique ses membres forment avec les brahmanes et les vaidya (médecins traditionnels), l’élite sociale et intellectuelle bengalie des bhadralok, ils sont exclus des sacrements védiques.
Lakh (hindi lākh) –Nombre indien équivalent à cent mille.
Lakshman (sanskrit lakṣmaṇa) – Frère de Rāma, connu pour sa loyauté à son égard.
Lakshmi (sanskrit lakṣmī, f., « bonne fortune ») – La déesse de la prospérité, de la richesse et de la beauté, parèdre de Viṣṇu.
Lathi (hindi lāṭhī, baton) –Longues matraques en bambou utilisée par la police coloniale pour réprimer les manifestations. L’activiste Lala Lajpat Rai fut blessé à mort par des charges de lathis en 1928.
827Ligue musulmane (The All-India Muslim League) –Formation politique fondée en 1906 au Bengale pour défendre les intérêts des musulmans indiens.
Lila (sanskrit līlā, f., « le jeu divin ») – Notion théologique exprimant le caractère spontané, joyeux et gratuit de la puissance créatrice divine.
Lingam (sanskrit liṅga, m., signe, marque caractéristique, phallus) – Symbole phallique représentant Śiva et principal objet de culte dans les temples consacrés à cette divinité.
Mahabharata (sanskrit mahābhārata, m., « la grande histoire des descendants de Bharata ») – La plus longue (autour de 100 000 stances) des deux grandes épopées de la tradition hindoue, l’autre étant le Rāmāyaṇa. Attribuée à un seul auteur (Vyāsa), mais probablement composée sur plusieurs siècles entre 500 avant J.-C. et 400 après, elle traite du déclin du dharma et de la décadence morale en narrant la bataille tragique aux proportions cosmiques que se livrent pour le pouvoir les clans apparentés des Kaurava et des Pāṇḍava, tous descendants du roi Bharata. L’épisode de la Bhagavad-Gītā prend place au moment crucial où les armées s’apprêtent à s’affronter dans une guerre fratricide.
Maharajah (du sanskrit mahārājan, m., « grand roi ») – Titre royal. Avant l’indépendance (1947), l’Inde compte de nombreux maharajah en activité ; leur fonction est abolie par la suite.
Mahatma (du sanskrit maha-ātman, m., « grande âme ») – Titre donné à Gandhi.
Mantra (sanskrit, m.) – Formule stéréotypée employée dans la méditation et le culte divin dont l’efficacité rituelle dépend de l’exactitude de son énoncé.
Math (sanskrit maṭha, m., « hutte, cellule ») – Monastère.
Mâyâ (sanskrit, māyā, f., « illusion, magie, tromperie ») – Pouvoir d’illusion, illusion cosmique, parfois personnifiée. Pour le système de l’advaita-vedānta, le monde phénoménal, dont nous faisons quotidiennement l’expérience empirique, est dépourvu de toute réalité, seul le brahman est réel. Si nous percevons le brahman, substrat unique de toute réalité, comme le monde multiple et différencié, c’est dû au pouvoir illusionniste de la māyā. Notre incapacité à dire si le monde que nous percevons est ou non réel n’est pas sans affecter notre psychisme et notre conduite, comme le montre l’analogie célèbre de la corde prise pour un serpent.
Mleccha (sanskrit, m., « barbare ») – Large catégorie intégrant les étrangers, les non hindous, tous rituellement impurs.
Moksa (sanskrit mokṣa, m., « libération, délivrance ») – Voir mukti.
Moplah (Mappilas, Mapillais) –Nom des musulmans habitant le Kerala et parlant le malayalam. Rolland évoque dans MG (p. 141) la révolte des Moplahs en août 1921. Il s’agit en réalité d’une révolte des paysans (parmi lesquels figurent des Moplahs, mais pas uniquement) contre les propriétaires terriens et le gouvernement colonial. Ce mouvement fut très violemment réprimé par l’administration coloniale, puisqu’on estime qu’il coûta la vie à environ 10 000 personnes. La place des motifs politiques 828et religieux dans cette rébellion fait encore aujourd’hui débat.
Mukti (sanskrit, f., « libération, délivrance ») – Terme métaphysique qui possède le sens technique de délivrance de la transmigration (saṃsāra). Selon l’advaita vedānta, la prise de conscience de l’identité de l’ātman et du brahman conduit à la délivrance. Les écoles théistes du vedānta font dépendre l’obtention de celle-ci de la grâce divine.
Nada (sanskrit nāda, m., « son ») – L’Absolu manifesté comme son.
Naga (sanskrit nāga, m.) – Serpent de la mythologie hindoue.
Nara (sanskrit, m., « homme ») et Narayana (nārāyaṇa, sanskrit, m., « celui qui séjourne / est allé chez les hommes », forme de Viṣṇu-Kṛṣṇa) – Paire indissociable du Mahābhārata, Nara et Nārāyaṇa, un seul et même être dédoublé, sont dits surgir chaque fois qu’il y a la guerre : symbolisant l’union de l’homme et de la divinité, ils agissent pour la préservation du dharma. Dans la Bhagavad-Gītā, Nara désigne le prince Arjuna en tant qu’il est inséparable de la divinité Nārāyaṇa dans une évocation symbolique de la relation ātman-brahman.
Nataraja (sanskrit naṭarāja, m., « le roi de la danse ») –Épithète de Śiva, qui exécute la « danse de la félicité ».
Navajivan (gujarati navajīvana, m., « nouvelle vie ») –Hebdomadaire gujarati fondé par Gandhi et publié à Ahmedabad entre 1919 et 1931.
Nirakara (sanskrit nirākāra, m., « dénué de forme, incorporel ») –Un qualificatif du brahman.
Nirvikalpa (sanskrit, « qui n’implique pas d’imagination ») – Dans le yoga de Patanjali, forme de samādhi obtenue sans support, soit un état dépourvu de toute représentation sensible et même intellectuelle.
Nitya (sanskrit, adj., « permanent, perpétuel, continuel ») – Rolland accole l’adjectif à siddha.
Nivritti (sanskrit nivṛtti, f., « abandon de toute activité ») – L’idéologie brahmanique contraste deux démarches opposées : pravṛtti (activité) et nivṛtti, qui s’incarnent dans deux conduites de vie religieuse antithétiques : celle du maître de maison, homme marié prisonnier d’un réseau d’obligations domestiques et rituelles, celle du renonçant, qui rompt tous les liens et vit en solitaire. Le premier agit dans le monde, le second se retire du monde. Vivekananda interprète ainsi ces anciennes conceptions (voir p. 682) : « Il y a dans notre esprit une impulsion qui nous dit : faites. Une autre voix s’élève à l’arrière qui dit : non. […] Deux beaux mots sanskrits rendent compte de ces phénomènes : pravritti et nivritti, “circling forward” (rotation centripète), et “circling inward” (rotation centrifuge). C’est la rotation vers l’intérieur qui généralement régit nos actes. […] La spiritualité commence par ce “ne pas faire”. » La pensée védantique exige pour se manifester de transcender sa nature inférieure et de tourner son esprit vers l’intérieur, en adoptant la nivritti (définie plus loin comme le fait de « se détourner des objets des sens »), lit-on dans PB (vol. 36, no 4, 1931, p. 176).
Ojas (sanskrit, nt, « force physique, énergie ») – Dans le haṭha yoga, l’énergie ou la vitalité mentale que libèrent 829l’activité sexuelle contrôlée et certains exercices.
Om (sanskrit oṃ, m.) – Syllabe sacrée utilisée dans la liturgie védique et considérée comme le plus puissant des mantra. Selon certains hindous, il s’agit du son primordial.
Panchavati (sanskrit pāñcavati, f., « qui possède cinq éléments ») – Nom donné au bosquet de cinq arbres, planté par Ramakrishna à Dakshineshwar et situé non loin de sa chambre.
Pandit (sanskrit paṇḍita, m., « savant, cultivé ») – Titre donné à un brahmane lettré. Rolland écrit le terme en caractères tantôt italiques, tantôt romains, avec ou sans majuscule ; nous avons respecté son orthographe.
Paramahamsa (sanskrit paramahaṃsa, m., « haṃsa suprême ») – Titre donné à un ascète accompli et épithète obligée pour Ramakrishna.
Paria (du tamoul paraiyār) – Nom d’une caste de joueurs de tambour, utilisé pour désigner ceux qui sont intouchables parce qu’ils manipulent des matières impures. Terme générique pour intouchable.
Parivrajaka (sanskrit parivrājaka, m., « errant ») – Terme synonyme de renonçant, qui place l’accent sur la vie d’itinérance que celui-ci doit mener une fois qu’il a prononcé ses vœux monastiques.
Parlement des religions – Organisé en automne 1893 dans le cadre de l’Exposition universelle de Chicago, qui célébrait (avec un an de retard) la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, le Parlement des religions réunit pour la première fois sur la même estrade des représentants des religions du monde. Le discours mémorable de Vivekananda, le premier tenu devant un public américain, lance sa mission internationale.
Parsi (« persan ») – Membre de la communauté religieuse fondée par Zoroastre. Arrivés en Inde vers le xe siècle, les Parsis sont installés au Gujarat et au Maharashtra (Bombay). Bien éduqués, ils exercent une grande influence économique, politique et culturelle malgré leur faible nombre.
Patala (sanskrit pātāla, nt., « trou, région souterraine ») – Terme générique de la cosmologie puranique désignant l’enfer.
Pataliputra (moderne Patna) – L’ancienne capitale de l’empereur bouddhiste Ashoka (iiie siècle avant J.-C.). S’y serait tenu le troisième concile de l’ordre monastique bouddhiste. Mais les sources divergent. Il semble que l’on ait appelé ultérieurement « troisième concile » un ensemble de réunions organisées à des moments distincts par les différents courants du bouddhisme pour débattre de leurs points de discorde.
Pirili (bengali pīrālī, m.) – Descendants de brahmanes du Bengale ostracisés pour avoir partagé la table avec des musulmans du temps où ces derniers exerçaient le pouvoir. Appartenant à cette catégorie sociale, les Tagore sont tenus à l’écart par les brahmanes orthodoxes.
Prabuddha Bharata (« L’Inde éveillée ») – Titre de la revue mensuelle en langue anglaise de la Ramakrisna Mission fondée en 1896 par Vivekananda et publiée à Almora (Mayavati).
Prakriti (sanskrit prakṛti, f., « forme naturelle, nature ») – La Nature (divinisée) dans la philosophie dualiste du sāṅkhya etdu yoga, laquelle pose face 830à elle le principe spirituel ou puruṣa (« l’Homme »).
Prana (sanskrit prāṇa, m., « souffle, respiration ») – Le souffle vital qui anime le corps et toute la création, parfois identifié à l’ātman ; son contrôle (prāṇāyāma) fait partie intégrante des techniques du yoga.
Prarthana Samaj (sanskrit prarthanā samāja, « société de la prière ») –Mouvement hindou de réforme religieuse et sociale, fondé dans les années 1860 à Bombay. Le Prarthana Samaj promeut notamment le remariage des veuves, l’éducation des femmes et l’interdiction du mariage des enfants. À la différence du Brahmo Samaj, dont il s’inspire, le Prarthana Samaj ne s’oppose pas au culte des idoles et à la société de castes.
Prasada (sanskrit prasāda, m., « grâce ») – Dans son acception théologique, le terme renvoie à l’idée que la délivrance ne dépend pas des œuvres mais de la grâce divine. Dans le culte, il désigne des offrandes (de nourriture, d’encens, de santal, de curcuma, de fleurs, de tissus et d’autres substances encore) faites à la divinité et consacrées par elle que les fidèles se partagent à la fin du culte.
Pravritti (sanskrit pravṛtti, f., « activité ») – Voir nivritti.
Puja (sanskrit pūjā, f., « vénération, adoration, hommage ») – Rite effectué devant l’image divine. Dans la tradition tantrique, il est précédé d’une pūjā mentalecensée diviniser le corps de l’adepte. Quoique Ramakrishna célèbre quotidiennement la pūjā de Kālī au temple de Dakshineshvar, Rolland n’emploie le terme qu’une seule fois, à propos du culte qu’il rend à sa femme en l’identifiant à la Déesse en 1872 (voir « Shorasi »).
Purana (sanskrit purāṇa, nt, « ancien ») – Groupe de textes à visée encyclopédique, composés en sanskrit entre les premier et dixième siècles de notre ère. Ils présentent de manière accessible des légendes sur la cosmogonie et les divinités, des chronologies des anciens rois, des sites de pèlerinages, des règles de vie religieuse et des considérations philosophiques et morales. Avec le Mahābhārata et le Rāmāyaṇa, ce sont les principaux textes de référence de l’hindouisme vécu. La religion de Ramakrishna est largement façonnée par cette littérature.
Puranique – Adjectif français fabriqué sur purāṇa.
Purascharana (sanskrit puraścaraṇa, nt., « fait d’accomplir des préparatifs pour ») – Récitation répétitive de mantra pratiquée quotidiennement.
Purusha (sanskrit puruṣa, m., « homme ») Dans le Veda, l’Homme cosmique dont le démembrement sacrificiel crée le monde (Ṛg Veda X 90). Vivekananda voit dans cette évocation une métaphore de l’humanité tout entière (VV, p. 591) Dans la philosophie du sāṅkhya et du yoga, le principe masculin, innombrable dans ses manifestations et passif, indissociable de la prakṛti, la Nature, le principe féminin actif. Comme nombre d’hindous, Ramakrishna identifie le puruṣa du sāṅkhya au brahman du vedānta, alors que le second est un et le premier pluriel (il y a autant de puruṣa que de corps) (VR, p. 339).
Radha (rādhā) et Radhika (rādhikā) – Nom de la gopī favorite de Kṛṣṇa 831pendant l’adolescence de ce dernier au Brindaban.
Radhakanta (sanskrit rādhākānta, m., « l’amant de Rādhā ») – Un des noms de Kṛṣṇa.
Radhaswami-Satsang (hindi rādhāsvāmī-satsaṅg, m., « l’association des fidèles de Rādhāsvāmī [Dieu] ») – Mouvement hindou fondé en Inde du Nord en 1861, qui enseigne une méthode de délivrance par la méditation sur le son éternel (śabda) ; ses membres considèrent le fondateur (Shiva Dayal Singh, 1818-1878) et ses successeurs comme des incarnations divines.
Rajah (du sanskrit rājan, m., « roi ») – Titre royal.
Raja-Yoga (sanskrit rājā-yoga, « yoga royal ») – Le système classique du yoga exposé par Patanjali.
Rama (sanskrit rāma, m., « le charmant ») – Divinité majeure et héros du Rāmāyana. Avatāra de Viṣṇu, modèle de fils vertueux, de bon roi, il est l’époux de Sītā.
Ramayana (sanskrit Rāmāyana, m., « les aventures de Rāma ») – L’une des deux grandes épopées de la tradition hindoue avec le Mahābhārata, attribuée comme ce dernier à Vyāsa, probablement composée sur plusieurs siècles entre 500 avant J.-C. et 400 après. Le Rāmāyana raconte la vie de Rāma ; comment alors qu’il était promis au trône d’Ayodhya, il a été obligé de s’exiler avec son frère et son épouse Sītā ; comment celle-ci ayant été enlevée par Rāvaṇa, il s’est mis à sa recherche et l’a finalement délivrée avec l’aide de Hanuman, avant de rentrer dans sa capitale et être couronné.
Rig Veda (sanskrit ṛgveda, m., « le Veda des Hymnes ») – Le premier des quatre Veda.
Rishi (ṛṣi, sanskrit, m., « sage voyant ») – Sages antiques mentionnés dans le Veda, à qui le Veda a été révélé et qui l’ont transmis aux hommes.
Roupie –Monnaie indienne.
Ryot (ourdou raiyat, m., sujet, cultivateur) –Paysan.
Sadhaka (sanskrit sādhaka, m., « qui effectue ; adorateur (d’un dieu) ») – Celui qui est engagé dans une discipline spirituelle (sādhana) ; adepte tantrique.
Sadhana (sanskrit sādhana, nt, ou sādhanā,f., « moyen, instrument ») – Discipline spirituelle, réalisation pratique d’un enseignement sotériologique grâce à des méthodes appropriées.
Sadharanbrahmo (sanskrit, bengali Sādhāraṇa-brāhma-samāja, « Brāhmo Samāj commun ») – Branche du Brāhmo Samāj fondée par Keshab Chandra Sen en 1878.
Sadhu (sanskrit sādhu, m., « bon ») – Ascète hindou.
Śākta (sanskrit, m.) – Celui qui adore la Déesse comme śakti ou puissance suprême.
Śakti (sanskrit, f.) – L’Énergie divine, personnifiée en la Déesse suprême. Dans la théologie des tantra, elle est la force qui crée, soutient et pénètre l’univers. L’être humain peut la capter et l’utiliser.
Samadhi (sanskrit samādhi, m., « concentration parfaite, enstase ») – Dans le yoga de Patanjali, cet état de conscience stable correspond à la huitième et ultime étape sur le voie de la délivrance. Il en existe deux formes, l’une obtenue en utilisant un objet de concentration, dite savikalpa, l’autre supérieure à la première car obtenue 832sans support, dite nirvikalpa. Dans le Haṭha yoga, le samādhi résulte du réveil de la kuṇḍalinī.
Samhita (sanskrit saṃhitā, f., « recueil, collection ») – Nom donné à chacune des quatre grandes collections qui constituent le Veda.
Samkirtan (sanskrit saṃkīrtana, nt, « éloge ») – Chants dévotionnels collectifs. Cette pratique aurait été popularisée au xvie siècle par le mystique bengali Chaitanya.
Samkhya (sanskrit sāṃkhya, m., « énumération ») – L’un des six systèmes de philosophie (darśana) de l’hindouisme. Le sāṃkhya inventorie et classifie les réalités constitutives du monde et de l’être psychique. Il pose la réalité de deux principes opposés : puruṣa et prakṛti, le premier « l’Homme » (Esprit) correspond à une pluralité de monades spirituelles, la seconde, « Nature », une et perpétuellement en devenir, est la cause efficiente et matérielle du monde. L’interaction mutuelle de puruṣa et de prakṛti crée l’univers matériel et spirituel dont l’individu transmigrant est prisonnier tant qu’il n’est pas libéré du cycle des renaissances (saṃsāra). La délivrance résulte de leur discrimination. Ces thèses se retrouvent dans la plupart des systèmes de pensée hindous, et plus particulièrement dans celui du yoga. Dans la Bhagavad-Gītā, elles sont associées au théisme. Dans The Science and Philosophy of Religion. A Comparative study of Samkhya, Vedanta and other Systems of thought (1915), recueil de plusieurs conférences données en Occident avant 1900, Vivekananda s’affirme convaincu que les méthodes et découvertes du sāṃkhya relatives au cosmos sont similaires à celles de la science moderne.
Sannyas (sanskrit sannyāsa, m., « renoncement ») – Rite de renoncement au monde et état de mendiant religieux errant. Le sannyāsa marque l’entrée dans le quatrième āśrama, l’ultime stade de vie prescrit par les textes religieux. Il requiert un feu sacrificiel, et donc la présence d’un officiant, et consiste pour l’impétrant à célébrer un ultime sacrifice (appelé viraja homa) pour symboliser son abandon définitif de la condition de maître de maison. La plupart du temps, la cérémonie est dirigée par un sannyāsin, à l’ordre monastique duquel l’impétrant se rattache, mais il existe aussi une forme de sannyāsa libre de tout lien monastique.
Sannyâsin (sanskrit sannyāsin, m.) – Renonçant ; au féminin : sannyāsinī. Il en existe plusieurs ordres.
Santhal (Santal). – Groupe aborigène (d’origine austro-asiatique) vivant dans les États du Jharkhand, Bengale, Bihar et Odisha (Orissa).
Santiniketan – Centre universitaire et de vie communautaire fondé par Rabindranath Tagore près de Bolpur au Bengale en 1901. Le poète bengali lauréat du Prix Nobel y reçut quantité d’intellectuels occidentaux, dont Sylvain Lévi. Quoique invité à plusieurs reprises, Rolland ne put jamais s’y rendre, à son grand regret.
Satchitananda (sanskrit sat-cit-ānanda, en composé saccidānanda, m., « être-conscience-béatitude ») – Le nom trinitaire donné au brahman dans le vedānta.
Sati (sanskrit satī, f., « épouse vertueuse ») – L’épouse dévouée ; par extension, l’épouse pieuse qui, par fidélité, 833s’immole au côté du corps de son mari. Il est erroné de désigner par ce terme le bucher en question.
Satyagraha (satyāgraha, néologisme formé sur deux termes sanskrits, satya, vrai, et āgraha, attachement, obstination) –Nom donné par Gandhi à son mouvement de désobéissance civile. L’ashram de Sabarmati fondé par Gandhi à Ahmedabad porte aussi le nom de Satyagraha Ashram.
Satyartha Prakasha (sanskrit satyārthaprakāśa, m., « lumière sur le sens de la vérité ») – Œuvre principale de Dayananda Sarasvati rédigée en hindi et publiée en 1875 (une version révisée parue en 1882), dans laquelle il expose sa doctrine monothéiste, ses projets de réforme de la société hindoue et combat les principaux systèmes religieux présents en Inde.
Savikalpa (sanskrit, m., « avec imagination ») – Dans le yoga de Patanjali, forme de samādhi obtenue en fixant la concentration sur une idée ou un objet.
Sevā (sanskrit, f., « service ») – Notion clé de l’action sociale de la Ramakrishna Mission, sevā renvoie aux différentes formes d’assistances à autrui données gratuitement.
Sevashram, seva samiti –Organisations caritatives.
Shastra (sanskrit śāstra, m.) – Ouvrage didactique ou traité théorique de diverses sciences relié au Veda. Le terme est souvent utilisé seul comme abréviation de Dharmaśāstra, l’ensemble des textes juridiques sur le dharma.
Shorasi (sanskrit ṣoḍaṣī, f., « composé de seize [éléments] ») – La déesse Tripurāsundarī sous l’aspect d’une jeune fille de seize ans – seize étant le nombre parfait qui représente la totalité. En 1872 Ramakrishna rend un culte à la déesse en faisant jouer le rôle de cette dernière à sa jeune épouse.
Siddha (sanskrit, m., « qui est réalisé, parfait ») – Catégorie d’êtres semi-divins qui possèdent des pouvoirs surnaturels ; on qualifie ainsi certains ascètes passés maître dans les techniques du yoga tantrique.
Sikh (terme pendjabi dérivé du sanskrit śiṣya, m., « disciple ») – Membre de la religion fondée au xvie siècle au Pendjab par Guru Nanak (1469-1539).
Sita (sītā) – L’épouse de Rāma dans le Rāmāyaṇa, symbole de pureté et de fidélité conjugale.
Śiva (sanskrit, m. « favorable ») – Dans les mythes cosmogoniques des purāṇa, il est l’un des trois grands dieux avec Viṣṇu et Brahmā – personnification de l’Absolu, brahman ; dans la théologie des tantra, il est indissociable de śakti.
Soufisme – Forme mystique de l’islam.
Souchoumna (sanskrit suṣumnā, f., « carotide ») – Le canal de la colonne vertébrale dans la physiologie du Haṭha yoga par lequel s’élève, une fois réveillée, la kuṇḍalinī en traversant successivement les six centres d’énergie spirituelle (cakra, « disque », souvent rendu par « lotus ») : 1. adhara (ou mulādhara) ; 2. svadhiṣṭhāna ; 3. maṇipūra ; 4. anāhata ; 5. viśuddha ; 6. ajña, pour atteindre la fusion avec l’absolu au septième cakra, le sahasrāra padma ou « lotus aux mille pétales ».
Sudra (sanskrit śūdra, m.) – Membre du quatrième et dernier varṇa de la société brahmanique dont la fonction héréditaire est de servir les trois autres. Les śūdra, qui ne reçoivent pas 834l’initiation brahmanique, ne peuvent étudier le sanskrit ni célébrer les rites sacrificiels.
Su ṣ umna – Voir souchoumna.
Sutra (sanskrit sūtra, m., « fil, ligne ») – Nom d’un genre littéraire composé d’aphorismes. Rolland, qui utilise le terme sans spécifier le texte auquel il renvoie, a probablement à l’esprit le Yoga-sūtra de Patanjali, voir yoga.
Swadeshi (terme moderne fabriqué sur deux mots sanskrits sva « sien » et deśī, « du pays ») – Désigne la politique de boycott des produits manufacturés importés de Grande-Bretagne adoptée entre 1905 et 1911 par les Indiens pour protester contre la partition du Bengale.
Swaraj (terme moderne fabriqué sur deux mots sanskrits, sva « sien » et rājya « royaume, souveraineté ») – Correspondant à l’anglais home-rule (« auto-gouvernance »), swaraj est un terme clé du mouvement d’indépendance de l’Inde qui émerge lors de la session de 1909 de l’Indian National Congress. La même année Gandhi publie sous le titre Hind swaraj (« l’auto-gouvernance de l’Inde ») un ouvrage rédigé en gujarati dans lequel il évoque l’avenir politique, social et culturel de l’Inde ; il y trace un programme d’action politique qui se présente aussi comme une méthode de régénération spirituelle (voir Gandhi 2014).
Tantra (sanskrit, m., « toile, trame, livre ») – Catégorie de textes révélés, distincts de la révélation du Veda, qui exposent des théologies, des règles rituelles pour le culte de la divinité et des méthodes de délivrance. Réservés à ceux qui ont été dûment initiés par un maître spirituel, les tantra visent l’obtention d’un niveau de conscience supérieure et de pouvoirs surnaturels. Ils donnent une grande importance au contrôle du corps (yoga). Les divinités tantriques vont par couples sexués (Śiva/Śakti) et le féminin joue un rôle égal ou supérieur à l’aspect mâle. En principe, le monde tantrique n’exclut ni les catégories sociales inférieures ni les femmes ; mais quoique ses normes transgressent celles de l’ordre social dominant, il est inséparable de l’hindouisme et nombre de ces pratiques se retrouvent dans ce dernier (voir Padoux 2010).
Tantrika (sanskrit tāntrika, m.) – Celui qui pratique la religion des tantra.
Tantrique – Adjectif français fabriqué sur l’adjectif sanskrit tāntrika.
Tapasya (sanskrit, m. « échauffement ») – Mortification, macération du corps, ascèse.
Tat tvam asi, « Cela tu l’es » – Cette formule sanskrite, qui revient comme un refrain dans l’enseignement que prodigue Uddālaka à son fils Śvetaketu dans la Chāndogya Upaniṣad (6.8.7), signifie que l’ātman, le Soi dans son état originel, pur et primordial, est identique au brahman, l’Absolu, la Réalité ultime qui est à l’origine de tous les phénomènes. Sur la réinterprétation de cette formule par Vivekananda, voir l’introduction de l’Essai.
Thana (hindi, bengali, ourdou thānā, m.) –Poste de police.
Tirthankara (sanskrit tīrthaṅkara, m., « faiseur de gué [pour traverser l’océan des existences] ») – Titre des fondateurs de la religion des jains.
Turiya (sanskrit turīya, nt, « quatrième partie ») – Le quatrième et ultime 835état de l’esprit, au-delà des états de veille, de sommeil léger et de sommeil profond, décrit par les upaniṣad.
Udbodhan (« illumination ») – Titre du principal mensuel en bengali de la Ramakrishna Mission fondé en 1899 par Vivekananda.
Upanishad (sanskrit upaniṣad, f.) – Compositions anonymes en prose et en vers datées entre les viieet ive siècles avant notre ère, faisant partie intégrante du Veda, dont elles forment la dernière strate (d’où leur nom de vedānta, « fin du Veda »), et tenues pour révélées. Elles posent l’équivalence du microcosme (le corps humain) et du macrocosme (l’univers) et réfléchissent sur l’identité de l’ātman et du brahman ; les différentes écoles du système philosophique du vedānta donnent des interprétations divergentes de leurs spéculations gnostiques. Vivekananda se réclame de la lecture non dualiste (advaita) de Shankara bien qu’il s’en écarte, notamment en niant l’infaillibilité du Veda et en enseignant la nécessité de vérifier ses affirmations sur le brahman par l’expérience directe (voir l’introduction de l’Essai).
Vaishnavite – Adjectif français fabriqué sur le sanskrit vaiṣṇava « relatif à Viṣṇu, vishnouïte ».
Varna (sanskrit varṇa, m., couleur, sorte, catégorie). –Dans l’idéologie brahmanique, la société est divisée en quatre classes héréditaires, hiérachisées et complémentaires, appelées varṇa.
Veda (sanskrit, m., « science, savoir ») – Le texte le plus ancien et le plus sacré de l’hindouisme, constitué de quatre recueils : la Ṛg-veda-saṃhitā, la Yajur-veda-saṃhitā, la Sāma-veda-saṃhitā et l’Atharva-veda-saṃhitā. Les upaniṣad forment la strate finale et la plus spéculative de ce vaste corpus. Selon la doctrine de l’advaita vedānta, le Veda est la source de toute connaissance métaphysique.
Vedânta (sanskrit vedānta, m., « fin du Veda ») – L’un des six « points de vue » (darśana) philosophiques de l’hindouisme. Fondé sur les upaniṣad, la section finale du Veda, il est dans une relation essentielle à la révélation védique. Son investigation concernant le brahman (l’Absolu) et son identité avec l’ātman (le Soi) ont donné lieu à plusieurs lectures divergentes. Rolland ne mentionne que deux d’entre elles : celle du non-dualisme (advaita) fondé par Shankara (viiie siècle), qui pose l’unité absolue de toutes choses en brahman et pour qui tout ce qui appartient au monde phénoménal est relatif, et celle du « non-dualisme mitigé » (viśiṣṭādvaita) fondée par le théiste Ramanuja (xie siècle), qui affirme la réalité du monde extérieur, et fait du brahman le Dieu suprême accessible à l’amour (bhakti) de l’homme et dispensateur de grâce.
Vedanta pratique – Doctrine sociale enseignée par Vivekananda qui a eu une grande postérité dans l’hindouisme moderne. Tandis qu’aucune école traditionnelle du vedānta ne se préoccupe de changer la société, Vivekananda donne un fondement upanishadique (et donc védique) à l’engagement social. Cette interprétation est au cœur d’une série de conférences qu’il prononce à Londres en novembre 1896 sur la pertinence éthique, sociale et politique de la formule upanishadique tat tvam asi « toi 836tu es Cela » (Chāndogya Upaniṣad, 6.8.16).
Védantique/Védantiste – Adjectifs français fabriqués sur vedānta.
Viçistâdvaita (viśiṣṭādvaita, sanskrit, m., « dualisme mitigé ») – École théiste du vedānta.
Vidyâ (sanskrit vidyā, f. « connaissance ») – Connaissance métaphysique, savoir salvifique, gnose. Dans le système de l’advaita vedānta, vidyā est la capacité de distinguer la véritable nature du Soi et de prendre conscience de son identité avec le brahman. Elle est le moyen d’accès à la délivrance (mokṣa) par excellence.
Vijnâni (sanskrit vijñānin[vijñānī est le nominatif], m., « qui possède intelligence et discernement ») – Maintes paroles de Ramakrishna montrent qu’il se qualifie lui-même de vijñānin et non de jñānin. À la différence du jñānin, le vijñānin ne s’absorbe pas dans le samādhi, il y entre et en sort à volonté ou, comme le dit de manière imagée Ramakrishna, il reste sur le seuil de cette « condition », littéralement à la « bouche du bhāva (bhāva-mukha) ».
Virat (sanskrit virāṭ, forme nominative de virāj, m., « souverain ») Puissance créatrice personnifiée identifiée à puruṣa.
Vishnu (viṣṇu) L’un des trois grands dieux du panthéon avec Śiva et Brahmā dans les mythes cosmogoniques des Purāṇa. Se fondant sur une théorie savante aujourd’hui dépassée, Rolland en fait l’ancien dieu solaire (VR, p. 328).
Yamuna – Rivière prenant sa source dans l’Himalaya et se jetant dans le Gange à Allahabad.
Yoga (sanskrit, m., « moyen, méthode ») – Terme générique désignant diverses techniques de maîtrise du corps et de l’esprit en vue d’obtenir la délivrance (mukti). Les enseignements théoriques qui encadrent ces techniques constituent l’un des six systèmes de philosophie (darśana) de l’hindouisme. Leur exposé classique est le Yoga-Sūtra de Patanjali qui remonte au premier siècle de notre ère. Le yoga de Patanjali vise à l’arrêt des mouvements du citta ou mental (yogaś cittavṛttinirodhaḥ, YS 1.2). On a appelé rājayoga ou yoga royal cette forme de yoga conduisant à l’immobilisation du psychisme (Angot 2008). Une autre forme de yoga est le haṭha yoga ou yoga d’« effort ». Nombre de commentateurs considèrent le haṭha yoga comme une méthode préparatoire à celle de Patanjali (White 1996). Vivekananda a fréquemment recours au terme yoga ; il lui donne le sens de discipline ou de méthode visant à la délivrance, qui est celui qu’il reçoit dans la Bhagavad-Gītā (Edgerton 1924). Il en expose quatre modes : le karma-yoga, ou yoga de l’action, le jñāna-yoga ou yoga de la connaissance, le bhakti-yoga ou yoga de la dévotion et le rāja-yoga, ou yoga royal (voir l’introduction de l’Essai).
Yogin (sanskrit, f.) – Celui qui pratique le yoga, sous l’une ou l’autre de ses formes.
Yoghiste, yogiste – Adjectif français fabriqué sur yoga.
Young India (anglais, « jeune Inde »). Hebdomadaire fondé par les éditeurs Umar Sobani et Shankarlal Banker, membres de la All-India Home Rule League (« ligue pan-indienne pour l’auto-détermination »). Gandhi le dirige entre 1919 et 1931. Young India joue un rôle majeur pour la propagation des idées de désobéissance civile et comme support de la non-coopération dans les années 1921-1922.