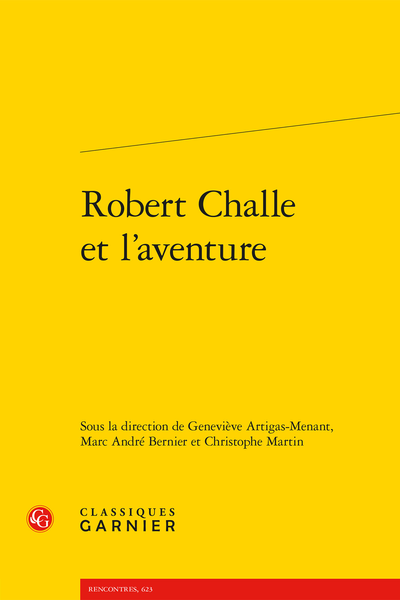
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Robert Challe et l’aventure
- Pages : 309 à 314
- Collection : Rencontres, n° 623
- Série : Le dix-huitième siècle, n° 46
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167570
- ISBN : 978-2-406-16757-0
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16757-0.p.0309
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/05/2024
- Langue : Français
Résumés
Geneviève Artigas-Menant, « La vie d’aventurier d’un bourgeois de Paris »
Pour mieux saisir le rapport étroit entre aventure écrite et réalité vécue chez Challe, un bref rappel biographique s’impose. Ce Parisien est allé aussi loin qu’il lui en a été donné l’occasion : l’Acadie vers l’Ouest, les Indes orientales vers l’Est. Il a connu la guerre, la prison, les tempêtes, le dénuement, la ruine. Ce bourgeois de Paris a eu une vie d’aventurier. Mais chez Robert Challe, l’aventure est inséparable de l’écriture, une écriture nourrie par l’imagination et par la réflexion philosophique.
Christophe Martin, « Le jeu de l’aventure et de la nécessité »
Dans le Journal de voyage, Challe formule la thèse paradoxale d’une corrélation entre disposition à l’esprit et exposition aux caprices de la Fortune : il n’est donné qu’aux gens d’esprit de se rendre disponibles à l’aventure. Mais pour cet écrivain philosophe et aventurier, ce que l’on nomme hasard n’est que l’autre nom d’une nécessité dont on ne perçoit pas les ressorts. L’aventure, chez Challe, est donc à la fois le signe de la finitude de l’esprit humain et le territoire propre de l’humanité.
Mami Fujiwara, « Aventures d’un texte. Des Difficultés sur la religion au Militaire philosophe »
À l’époque de Challe, de nombreux écrits (y compris les imprimés) ont une forme ouverte, livrée aux aléas de transformations diverses. Le cas le plus exemplaire est celui des manuscrits philosophiques clandestins. C’est ainsi que les Difficultés sur la religion de Challe deviennent Le Militaire philosophe. L’analyse de cette métamorphose révèle un travail collectif, dialogique, au plus loin de toute souveraineté de l’auteur. L’écrit est ainsi livré à l’aventure, dans un pur esprit de partage.
310Sébastien Drouin, « Challe et les aventuriers de la foi en Hollande »
Les auteurs du Journal littéraire sont les premiers à avoir publié un compte rendu des Illustres Françaises. S’ensuit un passionnant échange entre Challe et Prosper Marchand, Thémiseul de Saint-Hyacinthe et les autres journalistes de La Haye qui, tout comme Challe, sont des aventuriers de la foi. Envisagée sous l’angle de la religion et de l’hétérodoxie, cette correspondance permet de retracer l’histoire complexe du manuscrit des Tablettes chronologiques envoyé par Challe aux journalistes hollandais.
Flora Mele, « L’aventure au théâtre. Favart lecteur de Challe dans Don Quichotte chez la duchesse »
L’analyse de l’intertextualité entre la comédie-ballet Don Quichotte chez la duchesse de Charles-Simon Favart et la Continuation de l’Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche de Robert Challe est riche d’enseignements. L’opéra qui fut créé pour le Carnaval de 1743 à l’Académie royale de musique voit le jour à une époque mémorable pour l’évolution de l’opéra-comique. Le livret met en relief autant la théâtralité implicite de la Continuation de Challe que les affinités entre les deux auteurs.
Françoise Gevrey, « La rencontre amoureuse dans Les Illustres Françaises »
Même si Challe prend ses distances avec les aventures amoureuses de la fiction jugées trop conventionnelles, il accorde une place importante à la première rencontre de ses personnages en l’insérant dans un cadre narratif et social qui lui confère de la vraisemblance. Dans chaque histoire il cultive les variations et les effets de symétrie. En accordant la topique de l’aventure avec sa morale, en valorisant le sentiment et le plaisir, il ouvre ainsi la voie aux romanciers du Siècle des lumières.
Floriane Daguisé, « Les Illustres Françaises ou l’aventure déjouée »
En dépit du refus préfaciel des « incidents surprenants », Les Illustres Françaises présente des épisodes topiques, dont le traitement dévoile l’originalité de la poétique challienne : le récit déjoue la trame et l’issue traditionnelles. En refusant les événements de convention, Challe dessine une autre forme de surprise ; l’aventure romanesque se déploie en jouant avec les attendus et 311les attentes réflexes du lecteur, par des effets de répétition, de déplacement, d’opacification.
Carole Martin, « De l’aventure parodique au “théâtre de la cruauté”. La Continuation de Don Quichotte »
Avec l’accession du petit-fils de Louis XIV au trône d’Espagne, on se propose d’examiner la présence d’éléments caractéristiques de la « légende noire » espagnole dans la suite que Challe donne aux aventures de Don Quichotte. Y sont parodiées certaines pratiques relevant de l’Inquisition, où se manifeste une violence que l’aventure chevaleresque – à travers ses propres procédés et ceux de Cervantès – tendait à éloigner. Que faut-il donc voir dans cet effet de rapprochement des écarts de l’aventure ?
Shelly Charles, « Les mésaventures de l’aventure. Le mot et la chose à l’épreuve de la traduction anglaise des Illustres Françaises »
Dans la célèbre traduction des Illustres Françaises par Pénélope Aubin, on observe une réduction des occurrences du terme « aventure », ainsi qu’une transformation ou une disparition de certains des épisodes qu’il désigne. Avec le discrédit esthétique et moral qui y frappe l’aventure, cette traduction corrective, connue pour son influence sur l’œuvre de Richardson, participe d’une évolution profonde du genre romanesque tel qu’il s’élabore alors dans une étroite relation entre la France et l’Angleterre.
Jacques Cormier, « Des “histoires” de la Continuation aux anecdotes des Mémoires.L’écriture romanesque de l’aventure »
Les « Histoires » insérées dans la Continuation de Don Quichotte sont des objets de fiction littéraire présentés comme tels, alors que les anecdotes rassemblées dans les Mémoires de Challe se veulent témoignages historiques et revêtent les signes extérieurs de la réalité : affirmation de la compétence et de l’honnêteté du témoin, enregistrement des circonstances spatiotemporelles de l’action sont insérés dans le récit pour entraîner l’assentiment du lecteur.
312Mathilde Mougin, « La vie à bord de L’Écueil. D’ennuyeuses “bagatelles”, ou la transfiguration aventureuse du quotidien ? »
Si le Journal d’un voyage de Robert Challe (1721) s’inscrit dans une tradition romanesque par la mise en scène d’aventures topiques héritées de l’épopée (comme la tempête et les affrontements navals), celles-ci paraissent supplantées par un autre type d’aventures : celles, burlesques, des intrigues de bouteilles cachées et de soupers clandestins, et celles, plus spirituelles, générées par l’expérience même du voyage hauturier, qui engagent une véritable révolution perceptive du voyageur.
Lise Andries, « Le Journal d’un voyage fait aux Indes orientales. Robert Challe, aventurier des Lettres »
C’est probablement pendant son voyage aux Indes que Challe se découvre une vocation d’écrivain et même d’« écrivain-voyageur ». Dans son Journal de voyage, Challe apparaît à la fois comme un homme qui s’adresse à nous et un observateur tout en finesse de la vie à bord. Aimant les surprises du destin, il relate ces événements avec un plaisir évident. C’est aussi un amoureux de la littérature pour qui l’écriture devient parfois un exercice spirituel et se rapproche du journal intime.
Frédéric Charbonneau, « Les goûts aventureux d’un écrivain du Roi »
L’auteur explore dans cet article l’imaginaire gustatif et culinaire de Robert Challe tel qu’il ressort de son Journal d’un voyage fait aux Indes orientales (1690-1691), en se tournant vers ce qu’il révèle au lecteur d’aventureux, d’audace expérimentale et de goût pour la sensation forte. Challe a consigné un trésor d’informations sur les vivres, sur leur exotisme croissant et sur ses découvertes lors des escales, notamment des fruits – coco, banane, ananas – et des viandes – tortue, paon, perroquet.
Bernard Cartier et Bernadette Cartier-Rivière, « Robert Challe et les chirurgiens “navigans” »
Dans son Journal de voyage, témoin critique et informé d’une pratique destinée à préserver la santé des équipages, Challe juge sévèrement les « chirurgiens navigans » : « des ânes ». L’article conceptualise cette expérience personnelle 313en analysant l’évolution de leur formation et de leur pratique. Ils font leur apprentissage sur le tas avant l’organisation d’écoles spécialisées. Botanistes et ethnologues au xviiie siècle, ils sont ensuite marginalisés par des médecins auxiliaires ou de marine.
Carole Dornier, « Aventure maritime, risque et prévoyance dans le Journal d’un voyage fait aux Indes orientales »
La notion de risque se développe à l’époque moderne avec le calcul des probabilités. Témoin de cette évolution, l’auteur du Journal d’un voyage fait aux Indes orientales évalue les décisions prises au cours du voyage selon un calcul bénéfices/risques. S’il affirme la possibilité d’éviter les coups du sort par la prévoyance, il exprime une confiance limitée dans la science et dans la toute-puissance de la raison humaine au profit de rationalités multiples et d’une conscience aiguë de sa précarité.
Sylvain Menant, « La culture de l’aventurier. Robert Challe et Le Petit Flambeau de la mer »
Dans son Journal de voyage aux Indes orientales, Challe témoigne de son attrait pour l’aventure et des sentiments que créent le danger, la présence de la mort, l’inconnu. Mais ce témoignage personnel semble bien nourri aussi de lectures préparatoires, celles notamment des manuels de navigation comme Le Petit Flambeau de la mer de René Bougard. Ainsi se différencie l’approche de l’aventure chez un auteur cultivé et chez les matelots avec lesquels il partage de périlleuses expériences.
Francesca Frontini, Amaury Roth-Boll etSusana Seguin, « Cartographie d’une aventure. Approche numérique du Journal d’un voyage fait aux Indes orientales de Robert Challe »
L’article propose d’étudier le Journal d’un voyage de Robert Challe grâce aux outils des humanités numériques. Nous avons reconstitué la cartographie de l’aventure challienne et comparé les trajets ainsi restitués avec leur exploitation viatique. La rencontre des espaces réellement visités avec leur représentation textuelle fait ainsi émerger l’existence d’une forme de géographie mémorielle, affective et poétique, indispensable au travail littéraire de Robert Challe.
314Marc André Bernier, « Postface. L’aventure de la pensée »
Chez Challe, l’aventure n’existe pas sans la culture de l’aventurier. Celle-ci lui permet tantôt d’enraciner le récit dans une communauté de sentiments avec le lecteur, tantôt d’en tirer une expérience de pensée. L’aventure devient ainsi la condition indispensable d’un savoir qui ne s’acquiert que dans l’expérience de la diversité des êtres et des choses. Cette leçon est aussi bien celle que livrent, au seuil du xviiie siècle, la vie et l’œuvre de Challe que la philosophie et le roman des Lumières.