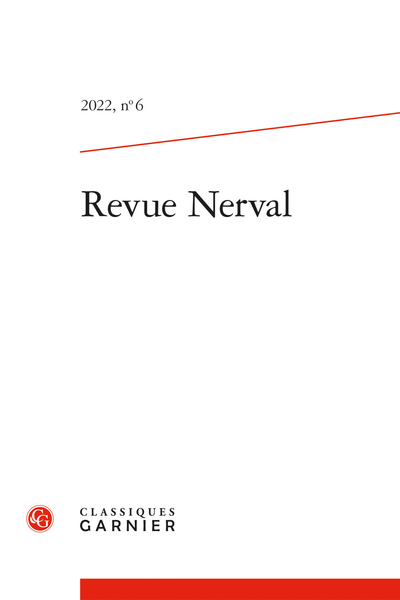
Abstracts
- Publication type: Journal article
- Journal: Revue Nerval
2022, n° 6. varia - Pages: 411 to 425
- Journal: Nerval Review
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406130963
- ISBN: 978-2-406-13096-3
- ISSN: 2554-8948
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13096-3.p.0411
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-20-2022
- Periodicity: Annual
- Languages: French, English
Résumés/Abstracts
Hélène Laplace-Claverie et Sylvain Ledda, « Introduction »
Dramaturge, critique, adaptateur, traducteur, collaborateur et spectateur passionné, Gérard de Nerval est l’un des écrivains romantiques qui connaît le mieux l’art du théâtre sous toutes ses facettes. Sa production dramatique fait pourtant l’objet d’un certain mépris. Il est temps de la resituer dans son contexte pour mieux saluer son inventivité et la redécouvrir dans sa diversité.
Mots-clés : création théâtrale, romantisme, genres, théâtres étrangers, culture populaire, illusion dramatique, esthétique et politique.
Hélène Laplace-Claverie and Sylvain Ledda, “Introduction”
Playwright, critic, adapter, translator, collaborator and passionate spectator, Gérard de Nerval is one of the Romantic writers who is most familiar with the art of theatre in all its forms. His dramatic production is nevertheless the object of a certain contempt. It is time to put it back into context in order to better salute its inventiveness and rediscover its diversity.
Keywords: dramatic creation, Romanticism, generic types, foreign theatres, popular culture, dramatic illusion, aesthetics and politics.
Caroline Legrand, « De L’Académie au Nouveau Genre. Itinéraire d’un “vagabondage” comique »
Parmi les premières tentatives littéraires de Nerval, la comédie occupe une place d’importance, qui contribue à la construction de son identité artistique. Écrites à un an d’intervalle, L’Académie et Le Nouveau Genre interrogent par leur forme et par leur propos. À la faveur d’un jeu de dialogue et d’opposition, les deux comédies semblent s’unir dans un diptyque métathéâtral, qui reproduit la querelle littéraire de l’époque, mais offre encore au débat théorique un relai dramatique de premier choix.
Mots-clés : comédie, L’Académie, Le Nouveau Genre, métathéâtralité, querelle littéraire.
412Caroline Legrand, “From L’Académie to Le Nouveau Genre. Itinerary of a comical ‘vagrancy’”
Comedy is an important part of Nerval’s firsts literary tentatives: it contributes to the construction of his artistical identity. The plays L’Académie and Le Nouveau Genre, which were written one year apart, have both surprizing form and purpose. Through a dialog game and opposition, these two comedies seem to create a metatheatrical diptych. This one reproduces the literary quarrel of the time, and gives a dramatical relay to the theoretical debate.
Keywords: comedy, L’Académie, Le Nouveau Genre, metatheatricality, literary quarrel.
Florence Fix, « Le mélange des genres dans Han d’Islande. Mélodrame, drame social et tragédie de la vengeance »
En 1826, Gérard de Nerval adapte pour le théâtre Han d’Islande de Victor Hugo. Peut-être espère-t-il renouveler le coup d’éclat et la notoriété acquise lors de la traduction du Faust de Goethe. Mais la pièce n’est jamais jouée. Elle est pourtant une interprétation audacieuse qui condense un roman frénétique en une tragédie de la vengeance en trois actes.
Mots-clés : Victor Hugo, mélodrame, frénétique, adaptation théâtrale.
Florence Fix, “The mix of genres in Han d’Islande. Melodrama, social drama and revenge play”
Gérard de Nerval adapts Han d’Islande by Victor Hugo for the stage in 1826. He might have hoped to achieve as big a success for this play as what he received for his translation of Goethe’s Faust. But his work never goes on the stage. Nevertheless, it is a daring interpretation of Hugo’s long gothic novel into a three-act revenge play.
Keywords: Hugo, melodrama, gothic novel, theatrical adaptation.
Gabrielle Bornancin-Tomasella, « La fabrication de l’espace scénique dans Les Monténégrins. Transferts génériques et poétisation »
L’article explore les phénomènes d’intertextualité dramatique, et de dialogue entre théâtre et poésie, à l’œuvre dans l’écriture de l’espace du second acte des Monténégrins de Nerval (version de 1848). Nous montrons comment le recours à des dispositifs propres à la poésie vient enrichir l’écriture de l’architecture 413scénique chez Nerval : le spectaculaire nervalien semble ne jamais se départir totalement d’une certaine qualité poétique.
Mots-clés : Gérard de Nerval, opéra-comique, Les Monténégrins, décors de théâtre, espace scénique, clou spectaculaire, mélange des genres, faux-fantastique, poétisation, mélodrame.
Gabrielle Bornancin-Tomasella, “Creating scenic space in Les Monténégrins. Generical transfers and poetization”
This paper explores phenomena of intertextuality in Gérard de Nerval’s Les Monténégrins. Focusing in particular on the second act of the play, in which Maladetta Castle shelters the vampire’s pseudo-fantastic apparition, this paper sets out to analyse the dialogue between theatre and poetry and to demonstrate how poetic devices enrich Nerval’s writing for the stage.
Keywords: Gérard de Nerval, opéra-comique, Les Monténégrins, settings, scenic space, spectacular, generical transfers, pseudo-fantastic, poetization, melodrama.
Sophie Mentzel, « Le pouvoir et son double. Dramaturgie du désenchantement politique dans le théâtre de Nerval »
Le théâtre de Nerval est traversé par le motif du double qui souligne la duplicité des représentants du pouvoir et des lieux qu’ils occupent. Figures contradictoires et oppositionnelles, espaces occultes qui creusent la scène, révèlent une vision profondément pessimiste du jeu social et politique et remettent en cause deux idées reçues : le théâtre de Nerval apparaît tout à la fois préoccupé des enjeux politiques du siècle et des enjeux scénographiques de la scène.
Mots-clés : théâtre, politique, double, dramaturgie, pouvoir, scénographie.
Sophie Mentzel, “Power and its double. Dramaturgy of political disenchantment in the theater of Nerval”
The motif of the double runs through Nerval’s theater, which emphasizes the duplicity of the representatives of power and the places they occupy. Contradictory and oppositional figures, occult spaces that hollow out the stage, reveal a deeply pessimistic vision of the social and political game and challenge two received ideas: Nerval’s theater appears both preoccupied with the political issues of the century and the scenographic issues of the scene.
Keywords: theatre, politics, double, dramaturgy, power, scenography.
414Olivier Bara, « Du théâtre en République. Nerval, Bocage et Une nuit blanche »
Une nuit blanche, de Nerval, Méry et Paul Bocage (février 1850), a disparu. La présence dans le fonds du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France d’une partition intitulée Une nuit blanche, malheureusement dépourvue de texte, incite à reprendre l’enquête autour d’une œuvre victime de la censure en régime républicain. Elle contribua à précipiter la destitution du directeur de l’Odéon qui l’avait suscitée : le comédien Bocage.
Mots-clés : Bocage, censure, deuxième république, folie-vaudeville, musique de scène, Odéon, revue de fin d’année, romantisme, théâtre.
Olivier Bara, “About theater in the Republic. Nerval, Bocage and Une nuit blanche”
Une nuit blanche, by Nerval, Méry and Paul Bocage (February 1850), has disappeared. The presence in the collection of the music department of the Bibliothèque nationale de France of a score entitled Une nuit blanche, unfortunately devoid of text, prompts a resumption of the investigation around a work victim of censorship under the Republican regime. It helped precipitate the dismissal of the director of the Odéon who had sparked it: the actor Bocage.
Keywords: Bocage, censorship, Second Republic, Folie-vaudeville, incidental music, Odéon, year-end review, romanticism, theater.
Guillaume Cousin, « Nerval et la “réaction” au théâtre après 1843. Un long ensevelissement des morts »
L’année 1843 marque un tournant dans l’histoire du théâtre français, que Nerval analyse dans sa critique dramatique des années 1844-1846. Le retour de la tragédie y apparaît moins comme une véritable « réaction » que comme le signe de l’incapacité du théâtre à produire des formes dramatiques adaptées à son époque. La « réaction » est selon lui un symptôme de l’échec romantique, qui n’est pas parvenu à substituer au théâtre d’Ancien Régime un théâtre moderne.
Mots-clés : Nerval, critique dramatique, presse, tragédie, genres dramatiques.
Guillaume Cousin, “Nerval and the dramatic ‘reaction’ after 1843. A long burial of the deads”
The year 1843 is a turning point in the French theatre’s history, that Nerval considers in his dramatic critic of the years 1844-1846. The tragedy’s return appears to be less a true reaction than a sign of the inability of the theatre to produce 415dramatic forms adapted to its times. To Nerval, the reaction is the symptom of the romanticist failure, which hasn’t managed to replace the Old Regime theatre by a modern theatre.
Keywords: Nerval, dramatic criticism, press, tragedy, dramatic genres.
Akio Wada, « Proust et la critique nervalienne »
Notre étude a pour but de situer les réflexions de Proust sur Nerval dans l’histoire de la critique nervalienne. Tout en réfutant le point de vue traditionaliste et nationaliste de Maurice Barrès et de Jules Lemaitre au début du xxe siècle, Proust semble avoir bien assimilé les deux courants de la critique sur Nerval à la fin du xixe siècle : études pathologiques et critiques symbolistes. L’article d’Arvède Barine notamment peut être une des sources importantes pour Proust.
Mots-clés : Proust, critique, études pathologiques, symbolisme, Arvède Barine.
Akio Wada, “Proust and the nervalian criticism”
Our study aims to locate Proustian ideas about Nerval in the history of Nerval criticism. While refuting the traditionalist and patriotic point of view of Maurice Barrès and Jules Lemaitre at the beginning of the 20th century, Proust seems to have well assimilated the two currents of criticism on Nerval at the end of the 19th century: pathological studies and symbolist criticism. The article by Arvède Barine in particular may be one of the important sources for Proust.
Keywords: Proust, critic, pathological studies, symbolism, Arvède Barine.
Simone Dubrovic, « Nerval, Leopardi. Une rencontre stellaire »
À partir d’un rapprochement entre des images communes aux poèmes de Leopardi et à Sylvie de Nerval, cette étude, d’inspiration comparatiste, réfléchit sur les manières dont ces deux poètes abordent le problème de la Raison telle qu’elle a été conçue par les Lumières. Elle porte aussi sur la nostalgie de la jeunesse et de l’amour ainsi que sur le vide, stellaire, qui entoure, chez les deux écrivains, l’objet perdu du désir.
Mots-clés : Leopardi, Nerval, Lumières, raison, désir, absence, vide, imagination, jeunesse, temps.
416Simone Dubrovic, “Nerval, Leopardi. A stellar encounter”
Moving from a parallel between images that are similar in Leopardi’s poems and Nerval’s Sylvie, this study, inspired by a comparative perspective, reflects on the ways the two poets reckon with the problem of Reason, as set up by the Enlightenment. It is also about the longing for youth and love as well as about the stellar emptiness surrounding the lost object of desire, as described by the two writers.
Keywords: Leopardi, Nerval, Enlightenment, reason, desire, absence, nothingness, imagination, youth, time.
Marine Le Bail, « Livres de fous pour fous de livres. De Nodier à Nerval »
Au seuil de la galerie de portraits des Illuminés, Nerval évoque le souvenir matriciel de la bibliothèque de son oncle, dont les ouvrages continuent de garnir les rayonnages de son « excentrique » bibliothèque intérieure. Dans la lignée de Nodier, Nerval superpose ainsi les livres et les hommes, dans une quête de sens dont il s’affirme à la fois comme l’auteur et le sujet. Dès lors, le « livre de fous » le plus insaisissable du recueil n’est-il pas celui-là même qu’il s’efforce d’écrire ?
Mots-clés : bibliophilie, bibliothèque, excentrique, folie, livre.
Marine Le Bail, “Books of madmen for madmen of books. From Nodier to Nerval”
At the beginning of the gallery of portraits called Les Illuminés, Nerval brings up the primitive memory of his uncle’s library, which contained a great deal of books still present in the depths of Nerval’s inner library. Following the steps of Nodier, Nerval superimposes books and men. He appears, in the same time, as the author and as the purpose of an hermeneutic quest, the most elusive “mad book” of his collection could therefore be the one he precisely attempts to write.
Keywords: bibliophilia, book, excentric, library, madness.
Bruno Penteado, « Devenir-Nerval. Une esthétique de la désubjectivation »
Cet article se penche sur la problématique du sujet chez Nerval, ou plutôt de l’a-sujet, étant donné que la notion même de sujet disparaît. À travers une lecture des Filles du feu et d’Aurélia, je suggère que Nerval rejette la conception d’un sujet transcendantal comme centre synthétisant. L’esthétique désubjectivante de Nerval remplace le sujet par le devenir, tel que l’ont pensé 417Deleuze et Guattari. Pour Nerval, on ne cesse de devenir, tout et personne, à la fois et perpétuellement.
Mots-clés : subjectivité, désubjectivation, sujet transcendantal, devenir, Les Filles du feu, Aurélia.
Bruno Penteado, “Becoming-Nerval. An aesthetics of desubjectivation”
This article turns to the problem of subjectivity in Nerval, rather the question of the asubject, given that the notion of the subject itself disappears. Through readings of Les Filles du feu and Aurélia, I argue that Nerval rejects the conception of a transcendental subject as a center of synthesis. Nerval’s aesthetics of desubjectivation replaces the notion of the subject with that of becoming, as theorized by Deleuze and Guattari. For Nerval, one never ceases to become, becoming everything and no one, perpetually and at the same time.
Keywords: subjectivity, desubjectivation, transcendental subject, becoming, Les Filles du feu, Aurélia.
Pierre Fleury, « Nerval entre chanson folklorique et chanson de chansonnier »
Cet article tente d’éclairer l’imaginaire et la pratique des chansons chez Nerval, qu’elles appartiennent au fond ancien (chanson folklorique) ou qu’elles soient l’œuvre d’un chansonnier. Puisque c’est la musique qui fait la chanson, on fera ici dialoguer les partitions et les textes, en particulier dans deux poèmes à timbre : « Les Pavés » (1831) et « Les Papillons » (1830).
Mots-clés : Nerval, chanson, chansonnier, chanson folklorique, musique, timbre, Papillons, Pavés, odelette.
Pierre Fleury, “Nerval and the different traditions of popular songs”
This article attempts to shed light on the imagination and practice of songs at Nerval, whether they belong to the folk song tradition or whether they are the work of a songwriter. Since it is the music that makes the song, we create a dialogue here between the scores and the texts, in particular in two poems that can be sung: “Les Pavés” (1831) and “Les Papillons” (1830).
Keywords: Nerval, song, chansonnier, song writer, folk song, music, Papillons, Pavés, odelette.
418Iseult Andreani, « Trois appropriations de Wagner. Nerval, Gautier, Baudelaire »
Dans les textes qu’ils consacrent à Wagner entre 1850 et 1860, Nerval, Gautier et Baudelaire se heurtent à la difficulté de traduire la nouveauté artistique. La résistance du modèle wagnérien amène les écrivains à repenser leurs postures et leurs pratiques d’écriture. Ce faisant, ils dépassent la seule mission de vulgarisation pour réviser de manière théorique et ou pratique leur propre idée de la composition, au prisme de ce qu’ils perçoivent de Wagner.
Mots-clés : Nerval, Gautier, Baudelaire, Wagner, critique musicale au xixe siècle, presse.
Iseult Andreani, “Three appropriations of Wagner. Nerval, Gautier, Baudelaire”
In the texts they devoted to Wagner between 1850 and 1860, Nerval, Gautier and Baudelaire came up against the difficulty of translating the artistic novelty. The resistance of the Wagnerian model led the writers to rethink their postures and writing practices. In doing so, they went beyond the mere task of popularisation to revise their own idea of composition in a theoretical and/or practical way, in the light of what they perceived of Wagner.
Keywords: Nerval, Gautier, Baudelaire, Wagner, critique, press.
Jean-Nicolas Illouz, « Un “logogriphe” romantique. Pandora de Nerval »
Les aléas de la publication de Pandora dans Le Mousquetaire ont fait de la nouvelle, selon le terme même de Nerval, un « logogriphe », c’est-à-dire non pas seulement un être « chimérique », « né des songes d’un malade », dirait Horace, mais une construction « monstrueuse » du langage lui-même. Cet article étudie donc, jusque dans la disposition des manuscrits et dans le jeu des renvois intertextuels, le mode de composition de Pandora : celui-ci est à la fois paratactique et rhapsodique, et il vaut comme l’expression d’une imagination « supernaturaliste ».
Mots-clés : logogriphe, supernaturalisme, manuscrits de Nerval, intertextualité, imagination romantique, mythographie romantique, Pandora de Nerval.
Jean-Nicolas Illouz, “A romantic ‘logogryph’. Pandora by Nerval”
The contingencies of Pandora’s publication in Le Mousquetaire have made the novella, according to Nerval’s own term, a “logogryph”, that is, not only a “chimeric” creature, “born of the dreams of a sick person”, Horace would say, but a “monstrous” construction of 419language itself. This article studies, in the arrangement of manuscripts and in the interplay of intertextual references, the mode of composition of Pandora,, which is both paratactic and rhapsodic, and which is valid as the expression of a “supernaturalist” imagination.
Keywords: logogryph, supernaturalism, Nerval’s manuscripts, intertextuality, romantic imagination, Pandora, Nerval.
Takeshi Matsumura, « Et d’où Nerval tire-t-il tout cela ? – sur deux chansons qu’il a empruntées à Dumas »
Le chapitre xiv « Ver » de La Bohême galante contient deux chansons que Nerval n’a pas citées ailleurs. Quoique Paul Bénichou n’ait pas réussi à en identifier la source, elles semblent venir d’une scène du roman champêtre d’Alexandre Dumas intitulé Dieu et diable (ou Conscience l’innocent) et publié en feuilleton dans Le Pays du 26 février au 7 avril 1852. Cette œuvre qui évoque l’enfance de Dumas à Villers-Cotterêts n’aura pas manqué d’intéresser Nerval.
Mots-clés : Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, chanson populaire, roman champêtre.
Takeshi Matsumura, “And where does Nerval get it all from?–about two songs he borrowed from Dumas”
Chapter XIV “Ver” of La Bohême galante contains two songs that the author did not quote elsewhere. Although Paul Bénichou could not identify the source, they seem to come from a scene from Alexandre Dumas’s rural novel entitled Dieu et diable (or Conscience l’innocent) and serialized in Le Pays from February 26 to April 7, 1852. This story which tells about the childhood of the novelist in Villers-Cotterêts would not have failed to interest Nerval.
Keywords: Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, popular song, rural novel.
Takeshi Matsumura, « “La France a ri longtemps de mon indifférence” – sur un passage d’Une répétition »
Une répétition et l’Épître à M. de Villèle parues dans les Élégies nationales et satires politiques (1827) contiennent plusieurs allusions assez obscures. Pour compléter l’annotation de Claude Pichois, cet article se propose d’expliquer à quel événement de l’époque se référait mon indifférence de Draconnet. En même temps, d’autres expressions comme un consul très plaisant et rimer l’Indifférence ou le Bois du village recevront une interprétation hypothétique.
Mots-clés : Gérard de Nerval, Joseph de Villèle, loi sur le sacrilège de 1825.
420Takeshi Matsumura, “‘France laughed for a long time at my indifference’–on a passage of Une répétition”
Une répétition and Épître à M. de Villèle published in Élégies nationales et satires politiques (1827) contain several rather obscure allusions. To complement Claude Pichois’s annotation, this article proposes to explain to which event of the time Draconnet’s mon indifférence referred. At the same time, other expressions like un consul très plaisant and rimer l’Indifférence ou le Bois du village will be given a hypothetical interpretation.
Keywords: Gérard de Nerval, Joseph de Villèle, the sacrilege law of 1825.
Takeshi Matsumura, « Peut-être valait-il mieux n’y plus penser – noir, vert et bleu »
Les mots de couleurs dans les œuvres de Nerval ne sont pas toujours faciles à interpréter. Par exemple, pourquoi voit-on des « noirs » dans le scénario La Forêt Noire ? Dans une citation de Mathurin Régnier, comment faut-il comprendre l’expression laisser sur le verd ? Doit-on la corriger en laisser sur le vers ? Et pour quelle raison l’auteur a-t-il utilisé les adjectifs bleu et bleuâtre dans une description presque identique ? Autant de questions qui intriguent les lecteurs et les éditeurs de textes.
Mots-clés : Gérard de Nerval, mots de couleurs, Camisards, Mathurin Régnier.
Takeshi Matsumura, “Perhaps it was better not to think about it anymore–black, green and blue”
Words of colour in the works of Nerval are not always easy to interpret. For example, why do we see black people in the scenario La Forêt Noire? In a quote from Mathurin Régnier, how should we understand the expression laisser sur le verd? Should we correct it by laisser sur le vers? And for what reason did the author use bleu and bleuâtre in an almost identical description? So many questions that intrigue readers and editors of texts.
Keywords: Gérard de Nerval, colour words, Camisards, Mathurin Régnier.
Takeshi Matsumura, « En herborisant dans la forêt des variantes »
En passant d’une publication à l’autre, un même texte nervalien montre parfois des variantes inattendues, qu’il n’est pas toujours aisé à interpréter. 421Est-ce une erreur qu’il faut attribuer à la distraction de l’auteur ou du typographe ? Ou s’agit-il d’une modification voulue par l’un d’entre eux ? Si elle est délibérée, dans quel but ? Parmi les cas embarrassants, l’article examine herboriseur / herborisateur, aigles éployé(e)s / déployés et automne.
Mots-clés : Gérard de Nerval, variantes, héraldique, genre.
Takeshi Matsumura, “While herborizing in the forest of variants”
Moving from publication to another, the same text by Nerval sometimes shows unexpected variations that are not always easy to interpret. Is it a error that must be attributed to the distraction of the author or printer? Or is it a modification wanted by one of them? If it is deliberate, for what purpose? Among embarrassing cases, the article examines herboriseur / herborisateur, aigles éployé(e)s / déployés, and automne.
Keywords: Gérard de Nerval, variants, heraldry, name gender.
Takeshi Matsumura, « Que lisait-on dans le vestibule de l’enfer ? »
Dans ses œuvres de jeunesse telles que L’Enterrement de « La Quotidienne » et La Discorde descend sur terre, Nerval fait allusion à différentes sources, que les lecteurs d’aujourd’hui ne devinent pas toujours facilement. Le présent article se propose de montrer de quels ouvrages viennent une ode ridicule de La Harpe, deux vers de Scarron, un mot de Boileau et l’expression le vestibule de l’enfer, et de compléter les interprétations données jusqu’ici.
Mots-clés : Gérard de Nerval, histoire littéraire, versification, journaux.
Takeshi Matsumura, “What were they reading in the hall of hell?”
In his early works such as L’Enterrement de “La Quotidienne” and La Discorde descend sur terre, Nerval alludes to different sources, that today’s readers don’t always easily guess. This article aims to show from which works come a ridiculous ode of La Harpe, two lines by Scarron, a word from Boileau and the expression le vestibule de l’enfer, and to complete the interpretations given so far.
Keywords: Gérard de Nerval, literary history, versification, newspapers.
Takeshi Matsumura, « Personne n’a été plus houspillé que lui – sur Jean-Pons-Guillaume Viennet »
L’écrivain et député de l’Hérault Jean-Pons-Guillaume Viennet est aujourd’hui une figure oubliée ou décriée. Pourtant son Épitre aux mules de 422Don Miguel (1829) qui a fait beaucoup de bruit a intéressé ou amusé Nerval qui, en en ayant tiré une expression, l’a mise auprès de deux allusions à Boileau dans son « Introduction » au Choix des poésies de Ronsard. Peut-être La Philippide (1828) de Viennet est-elle aussi évoquée dans la même « Introduction ».
Mots-clés : Gérard de Nerval, Jean-Pons-Guillaume Viennet, le Moyen Âge.
Takeshi Matsumura, “No one has been more criticized than him–on Jean-Pons-Guillaume Viennet”
The writer and deputy for Hérault, Jean-Pons-Guillaume Viennet, is today a forgotten or decried figure. However his Épitre aux mules de Don Miguel (1829) that was a great success interested or amused Nerval who, having drawn an expression from this poem, put it next to two allusions à Boileau in his “Introduction” to Choix des poésies de Ronsard. Perhaps Viennet’s La Philippide (1828) is also mentioned in the same “Introduction”.
Keywords: Gérard de Nerval, Jean-Pons-Guillaume Viennet, the Middle Ages.
Takeshi Matsumura, « Si l’on faisait un peu de musique à petit bruit ? »
Les allusions à la musique et aux musiciens sont nombreuses dans les œuvres de Nerval. Cet article se propose d’en élucider trois qui n’ont pas fait jusqu’ici l’objet d’un examen suffisant, afin d’un peu mieux saisir le sens des termes employés et de comprendre moins mal les nuances des passages examinés. Les deux évocations concernent de bons mots prononcés par Grétry, tandis que la troisième est une citation de Don Giovanni de Mozart.
Mots-clés : Gérard de Nerval, André Grétry, Wolfgang Amadeus Mozart.
Takeshi Matsumura, “Are we not going to play some quiet music?”
Allusions to music and musicians are numerous in Nerval’s works. This article aims to elucidate three allusions which have so far not been the subject of sufficient analyse, in order to better understand the meaning of the words used and the nuances of the passages examined. The two evocations concern funny phrases spoken by Grétry, while the third is a quotation from Mozart’s Don Giovanni.
Keywords: Gérard de Nerval, André Grétry, Wolfgang Amadeus Mozart.
423Takeshi Matsumura, « “Absurdes quiproquos philologiques” ? – sur deux mots régionaux dans Pandora »
Dans ses récits de voyage, Nerval se montre attentif aux variations du français. On pense à une Allemande qui emploie des néologismes, à des descendants des réfugiés protestants qui conservent la langue du xviie siècle, ou à des Belges dont les particularités linguistiques frappaient déjà les touristes. Si notre auteur s’intéresse ainsi à cet aspect de la langue, il ne serait pas étonnant qu’il ait introduit des mots régionaux dans Pandora. C’est ce qu’essaie de montrer le présent article.
Mots-clés : Gérard de Nerval, vocabulaire, variations du français.
Takeshi Matsumura, “‘Absurd philological misunderstandings’?–on two regional words in Pandora”
In his travel accounts, Nerval is attentive to variations in French. We think of a German woman who fills with neologisms, of the descendants of Protestant refugees who retain the language of the 17th century, or of Belgians whose linguistic peculiarities already struck tourists. If our author is interested in this aspect of language in this way, it would not be surprising if he introduced regional words into Pandora. This is what this article tries to show.
Keywords: Gérard de Nerval, vocabulary, variations in French.
Takeshi Matsumura, « Trois élucubrations de plaisantin sur Promenades et souvenirs »
Dans Promenades et souvenirs, on trouve plusieurs allusions et citations, dont la plupart sont éclaircies, mais il y en a quelques-unes qui restent mal expliquées. Dans cet article, je me propose de répondre à trois questions : qui a composé une chanson citée dans l’œuvre ? ensuite quels poèmes de Ronsard et de Du Bellay le narrateur aurait pu déclamer en pensant à Marie Stuart ? et enfin d’où vient son emploi du mot bari au sens de « barque égyptienne ?
Mots-clés : Gérard de Nerval, chanson, poésie, vocabulaire.
Takeshi Matsumura, “Three joker’s ramblings on Promenades et souvenirs”
In Promenades et souvenirs, we find several allusions and quotations, most of which are clarified, but there are a few that remain poorly explained. In this article I propose to answer three questions: who composed a song cited in the work? and then what poems by Ronsard and Du Bellay the narrator could have declaimed while 424thinking of Marie Stuart? and finally where does his use of the word bari in the sense of “Egyptian boat” come from?
Keywords: Gérard de Nerval, song, poetry, vocabulary.
Takeshi Matsumura, « En fixant les yeux sur Les Papillons »
L’odelette Les Papillons, publiée en 1830 et 1831 et remaniée en 1833 et 1853, contient plusieurs noms de papillons. Combien d’espèces et de genres mentionne-t-elle ? Dans quelle mesure leurs désignations et leurs traits sont-ils conformes à l’entomologie de l’époque ? Cet article se propose d’identifier les insectes évoqués par le poète pour mettre en lumière sa part de création.
Mots-clés : Gérard de Nerval, odelette, entomologie.
Takeshi Matsumura, “Staring at The Butterflies”
The little ode Les Papillons (The Butterflies), published in 1830 and 1831 and reworked in 1833 and 1853, contains several names of butterflies. How many species and genera does it mention? To what extent do their designations and characters conform to the entomology of the time? This article aims to identify the insects evoked by the poet to highlight his part of creation.
Keywords: Gérard de Nerval, little ode, entomology.
Takeshi Matsumura, « C’est là une belle histoire de chiens ! – quelques remarques sur le Voyage en Orient »
Dans le Voyage en Orient on trouve des mots qui semblent ne poser aucun problème d’interprétation mais qui ont une signification peu familière aux lecteurs d’aujourd’hui. Il y a aussi des leçons qui paraîtraient erronées, alors qu’en fait elles peuvent se justifier si l’on les replace dans leur contexte littéraire ou linguistique. Cet article examine certains de ces cas pour suggérer que notre réaction spontanée est parfois trompeuse.
Mots-clés : Gérard de Nerval, linguistique historique, Brantôme, Fénelon.
Takeshi Matsumura, “This is a nice dogs scene!–Some remarks on Voyage to the Orient”
In Voyage to the Orient we find words that seem to pose no problem of interpretation but which have a meaning unfamiliar to today’s readers. There are also passages which would appear to be erroneous, when in fact they can be justified if we 425put them in their literary or linguistic context. This article examines some of these cases to suggest that our spontaneous reaction is sometimes misleading.
Keywords: Gérard de Nerval, historical linguistics, Brantôme, Fénelon.
Takeshi Matsumura, « Mots régionaux dans Le Marquis de Fayolle »
Les mots régionaux que contient Le Marquis de Fayolle sont déjà assez bien étudiés par Jacques Bony. Toutefois il me paraît possible de compléter quelques-unes de ses notes à l’aide d’un examen lexicographique un peu poussé, et, en même temps, d’améliorer nos dictionnaires. Cet article se termine par une remarque sur la source d’une anecdote, que l’on n’a pas encore identifiée.
Mots-clés : Gérard de Nerval, mots régionaux, lexicographie, Armand Duchatellier.
Takeshi Matsumura, “Regional words in Le Marquis de Fayolle”
Regional words in Le Marquis de Fayolle are already fairly well studied by Jacques Bony. However, it seems to me possible to complement some of his notes with the help of a lexicographical examination a little thorough, and at the same time, to improve our dictionaries. This article will end with a remark on the source of an anecdote, which no one has yet identified.
Keywords: Gérard de Nerval, regional words, lexicography, Armand Duchatellier.