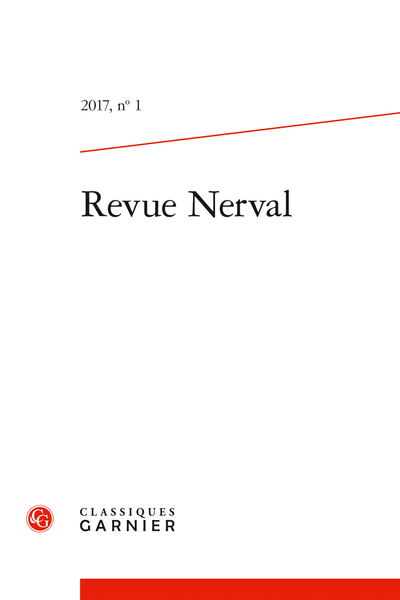
Résumés des contributions
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue Nerval
2017, n° 1. varia - Pages : 197 à 199
- Revue : Revue Nerval
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406069096
- ISBN : 978-2-406-06909-6
- ISSN : 2554-8948
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06909-6.p.0197
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 31/03/2017
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
RÉSUMÉS DES CONTRIBUTIONS
Gabrielle Chamarat, « Quel réalisme dans Les Nuits d’octobre ? »
L’interrogation sur le réalisme encadre les Nuits d’octobre, récit de la déambulation du narrateur dans Paris, la nuit, qui se poursuit à Meaux et dans son Valois natal. Attaché à l’observation des « combinaisons bizarres de la vie », mêlé de fantaisisme et d’essayisme, le réalisme nervalien s’oppose, forme et fond confondus, à l’académisme historique et littéraire qui s’affirment alors contre une juste représentation de la réalité.
Michel Collot, « Défense et illustration des droits de l’imaginaire »
Les progrès de notre connaissance de la vie et des publications de Nerval ont favorisé le développement des études qui mettent l’accent sur leur contexte politique, social et littéraire, souvent aux dépens de l’imaginaire. Cette étude s’attache à rétablir l’imaginaire dans ses droits, en montrant la part qui lui revient, y compris dans la pratique d’un genre aussi référentiel que le récit de voyage et dans un texte comme Les Nuits d’octobre, où le réalisme n’est invoqué que pour être déconstruit.
Kan Nozaki, « Gérard de Nerval et le partage du rêve »
Le thème du partage du rêve occupe une place importante chez Gérard de Nerval. Les grands rêveurs dans ses récits, de Raoul Spifame au calife Hakem en passant par Francesco Colonna, rêvent à deux, ce qui leur permet d’échapper au caractère solitaire de l’expérience onirique. Le déclin de ce thème est concomitant à l’accès du poète à une écriture à la première personne. Pourtant, dans une narration désormais centrée sur le « je » isolé, on peut toujours discerner la survivance de l’idéal du double rêve.
Aurélie Foglia, « Nerval ou la chimère du moi »
Dans l’œuvre nervalienne, l’identité du sujet n’est jamais sûre ni donnée. Le « je » fluctue dans le temps, aspiré par un vertige d’images. Il s’altère avant 198de s’aliéner, et fait l’épreuve lucide de la dépossession de soi. C’est pourquoi la mise en récit du passé n’aboutit pas chez lui à une pratique traditionnelle de l’autobiographie, mais à un creusement impersonnel qui représente un formidable élargissement du moi aux dimensions du mythe et du cosmos.
Aurélie Moioli, « Les arabesques de Nerval. Une théorie romantique de l’imagination créatrice »
Cet article s’intéresse à la manière dont l’arabesque, en tant que figure de pensée du romantisme allemand, se traduit dans la prose autobiographique de Gérard de Nerval et engage plusieurs conceptions de l’imagination. Il met en rapport l’Entretien sur la Poésie de F. Schlegel avec la poétique originale d’Aurélia ou Le Rêve et la Vie. Les arabesques placent l’écriture de soi sous le signe d’une Willkür ambiguë, d’une imagination à la fois volontaire et arbitraire.
Hélène Laplace-Claverie, « L’Imagier de Harlem. “Drame-légende”, féerie ou monstre dramatique ? »
Coécrit avec Joseph Méry et Bernard Lopez, L’Imagier de Harlem est en quelque sorte le testament théâtral de Gérard de Nerval. Ce « drame-légende », créé en 1851 à la Porte-Saint-Martin, se veut à la fois un spectacle populaire destiné à un large public et une synthèse extraordinairement ambitieuse des expériences menées jusque-là par Gérard dans le domaine des arts de la scène. C’est aussi une tentative pour repousser les limites de la forme dramatique en conciliant théâtre littéraire et grand spectacle.
Sylvain Ledda, « Nerval et les genres dramatiques »
Gérard de Nerval ne s’est pas limité à un domaine théâtral mais a exploré de nombreuses formes, du drame au mystère, de la comédie de circonstance à l’opéra-comique. Une telle variété générique témoigne tout ensemble d’une grande curiosité intellectuelle et d’un rapport empirique à l’écriture dramatique. Nous nous proposons d’analyser le théâtre de Gérard de Nerval à travers le prisme des genres, afin d’en dégager les possibles principes, les grandes lignes de force et la singularité.
Takeshi Tamura, « Fantaisies nervaliennes sur les Celtes gaulois »
L’intérêt de Gérard de Nerval aux Celtes, fantaisiste en apparence, consiste à rechercher l’origine des cultes des ancêtres gaulois, avant le règne des Francs christianisés. Dans ses récits valoisiens, parsemés de décors mythiques 199celto-gaulois, l’auteur a réussi à recréer au sein du pays son paradis perdu, libre de tout joug mental, social et temporel, où vivent éternellement tous les êtres aimés, évoqués par la puissance de mémoire.
Henri Bonnet, « Un “compendium” du Voyage en Orient. La Santa-Barbara »
Importante par sa place au centre du Voyage en Orient et par sa fonction d’écho au modèle odysséen, la section de « La Santa-Barbara » a été retenue par Nanteuil pour l’affiche des Scènes de la vie orientale. Le compendium, qu’à l’exemple de Chateaubriand elle met en scène, constitue une procédure par laquelle Nerval développe poétiquement un épisode. Ce n’est pas qu’un abrégé, c’est surtout une fleur d’anthologie, un concentré de création, un jeu de rythmes d’écriture.
Guy Barthèlemy, « Le syndrome de la conversion et les frontières du religieux dans le Voyage en Orient »
Les scénarios de conversion prolifèrent dans le Voyage en Orient, où ils viennent scander chacune des grandes étapes du périple oriental de Gérard, et aussi les variations du regard de Nerval sur l’Orient, avec notamment le basculement du récit du champ des projections existentielles vers celui de la méditation historique et éthique. Ce brassage d’enjeux multiples et la complexité des dispositifs mis en œuvre illustrent bien la subtilité de l’écriture nervalienne de l’Orient.
Alizée Alexandre, « Gérard de Nerval en pays de Saba. Bible, mystères et fiction dans l’Histoire de la reine du matin et de Soliman, prince des génies »
Dans l’Histoire de la reine du matin et de Soliman, prince des génies, Gérard de Nerval propose une version syncrétique et résolument « romantisée » de la venue de la reine de Saba à Jérusalem. Entre héritage biblique, fantaisie orientale et rêverie maçonnique, ce conte du Voyage en Orient se fait l’écho des hantises nervaliennes : la reine Balkis est bien celle qui, comme l’écrit le narrateur de Sylvie, réunit en son mythique sein l’« idéal sublime et la douce réalité ».