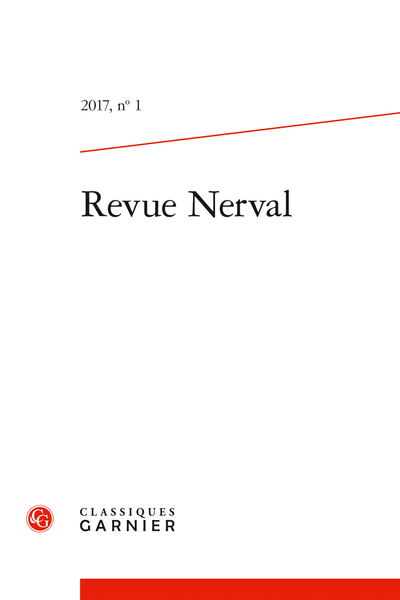
Éditorial
- Publication type: Journal article
- Journal: Revue Nerval
2017, n° 1. varia - Authors: Illouz (Jean-Nicolas), Scepi (Henri)
- Pages: 11 to 13
- Journal: Nerval Review
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406069096
- ISBN: 978-2-406-06909-6
- ISSN: 2554-8948
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-06909-6.p.0011
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-31-2017
- Periodicity: Annual
- Language: French
ÉDITORIAL
« L’amicale, à tous prête », écrivait Mallarmé de la Revue Blanche, à laquelle il venait de confier quelques-unes de ses Divagations1 : c’est par un tel « Salut » – que l’on aimerait en vérité adresser à toute nouvelle revue ayant trait aux choses de la poésie – que nous voudrions ici, non sans quelque « ivresse belle2 », baptiser la Revue Nerval en son numéro 1.
Sans doute conviendrait-il de faire le bilan des vagues successives, de plus en plus amples, par lesquelles se sont constituées, au fil des générations, avec toujours plus de science et de patience, les études nervaliennes. Nous savons ce que nous leur devons. Et les articles qui seront publiés ici même dans les années à venir témoigneront assez, nous n’en doutons pas, de la dette immense que les chercheurs d’aujourd’hui ont contractée à l’égard de leurs aînés. Mais une revue est aussi une aventure et une ouverture : c’est vers ce qui viendra, – et donc vers ce que nous ignorons –, que nous voulons nous tourner au seuil de ce premier volume, en invitant chacun à inventer avec nous ce que deviendra la Revue Nerval.
Nous avons bien évidemment veillé à donner à celle-ci les garanties et le mode de fonctionnement de ce que l’on appelle aujourd’hui, trop uniformément, une « revue scientifique ». Nous ne saurions trop remercier les membres du comité de lecture et nos correspondants à l’étranger d’avoir bien voulu s’engager à nos côtés dans cette entreprise ; et, pour ce numéro 1, nous ne saurions trop remercier ceux qui ont dès à présent participé à l’appréciation et au perfectionnement des articles reçus. Ces articles, au reste, ainsi que leurs auteurs (nouveaux dans les études nervaliennes ou des plus confirmés), augurent du meilleur.
12D’un numéro à l’autre, nous expérimenterons diverses configurations possibles : à côté des varia, qui resteront sans doute majoritaires dans une revue consacrée à un auteur, nous constituerons quelquefois des ensembles d’articles portant sur un texte en particulier ou des dossiers thématiques recentrés sur une question ; à côté des études, nous publierons, au grès des occasions, tels documents nouveaux qui peuvent réapparaître, telles notules d’érudition ou d’intuition, ainsi que diverses informations sur le cours des études nervaliennes. Un souhait plus profond nous guide (qu’atteste, dans l’organigramme de la revue, la présence d’un comité d’honneur) : que des écrivains d’aujourd’hui trouvent ici un espace pour écrire en écho à Nerval, – à la recherche d’une forme critique qui suspende, un moment, la dimension méta-discursive de l’interprétation, afin de faire participer le lecteur, d’une autre manière, à la connaissance de notre auteur : selon quelque « raison poétique » qui aurait encore à voir avec ce que les romantiques allemands appelaient la « poésie de la poésie3 » ou encore avec ce que Mallarmé nommait quant à lui le « poème critique4 ».
Une ligne éditoriale ici s’indique.
Nous voudrions profiter de l’espace polyphonique de la revue pour réaccorder deux gestes herméneutiques opposés, trop souvent séparés, mais complémentaires et constitutifs ensemble, dans leur tension même, de tout acte de lecture authentique et un tant soit peu exigeant : d’un côté, un geste qui éloigne Nerval de nous pour le resituer dans l’époque qui fut la sienne ; de l’autre, un geste qui le rapproche de nous pour le rendre à nouveau présent, à la fois parlant et poignant jusque dans l’éloignement d’où, à travers maints relais et autant de recréations, il questionne encore notre temps et parle à notre intelligence ou notre sensibilité. Pour le dire autrement, avec les mots d’Antoine Compagnon5, il s’agira de donner à la revue tout l’empan que mesure l’oscillation de la critique entre un geste « philologique », qui met le passé de son objet à côté du présent de la lecture, et un geste « allégorique », qui met le passé de l’objet dans le présent de son interprétation. La démarche herméneutique se garde ainsi du double écueil signalé par Bertrand 13Marchal à propos des interprétations de Mallarmé : l’illusion « historiciste », qui fait du passé une chose sans avenir ; et l’illusion « moderniste », qui rabat toute profondeur temporelle sur le seul présent sans mémoire du contemporain6. Bref, il s’agira de comprendre l’œuvre de Nerval dans son historicité, par laquelle elle invente sa valeur dans le temps, en se faisant alors, non plus simplement objet de son histoire, mais sujet vivant de celle-ci7.
Une telle herméneutique reste, on le sait, « romantique » dans son inspiration première : comprendre l’œuvre comme sujet, ou comme vie, revient, non pas à l’étouffer sous un savoir positif qui en vérité la méconnaît, mais à augmenter toujours plus son mystère, dans la chaîne indéfiniment ouverte de ses interprétations.
À chacun alors en effet de reprendre sa lecture ; à chaque lecteur de dialoguer avec d’autres ; et à tous d’œuvrer ensemble à quelque tâche collective inconsciente. Bref à nous d’inventer, en l’utopie de son « bel aujourd’hui », une Revue Nerval.
Jean-Nicolas Illouz
et Henri Scepi
1 Mallarmé, Divagations, dans Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 2003, p. 276.
2 Mallarmé, « Salut », Poésies, dans Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1998, p. 4.
3 Voir, de Friedrich Schlegel, le fragment 238 de l’Athenaeum, dans Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, L’Absolu littéraire, Seuil, 1978, p. 132.
4 Mallarmé, Divagations, édition citée, t. II, p. 277.
5 Antoine Compagnon, « Allégorie et philologie », dans Anna Dolfi et Carla Locatelli (dir.), Retorica e interpretazione, Rome, Bulzoni, 1994, p. 191-202.
6 Bertrand Marchal, Introduction à Mallarmé, Œuvres complètes, édition citée, t. I, p. XII.
7 Nous renvoyons implicitement à la définition que Gérard Dessons donne de « l’historicité » dans son Introduction à la poétique. Approche des théories de la littérature, Armand Colin, 2005 [Dunod, 1995], p. 264 ; voir également Gérard Dessons et Henri Meschonnic, Traité du rythme. Des vers et des proses, Paris, Armand Colin, 2005 [Dunod, 1998], p. 234.